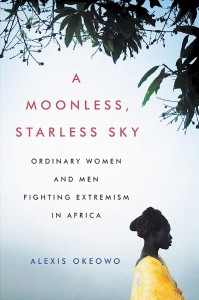Les basketteuses de Mogadiscio
Publié dans le magazine Books n° 87, janvier/février 2018.
Pour Aïcha et ses coéquipières, pratiquer le basket dans un pays aussi dangereux que la Somalie est bien plus qu’un sport. C’est un pied de nez à tous ceux qui, à commencer par les islamistes, prétendent régir leur vie.
© Jan Grarup/LAIF/REA
Nasro Mohamed, entraîneuse de basket : « On est tout le temps sur le qui-vive. Sur le terrain, on risque de se faire tuer parce qu’on est en pantalon de survêtement. »
Aïcha avait 14 ans quand les terroristes l’ont appelée pour la première fois. C’était en 2013. Elle était chez elle à Mogadiscio, en Somalie. Un numéro inconnu s’est affiché sur l’écran de son portable ; elle a répondu. L’homme au téléphone lui a dit que l’islam interdit aux femmes de faire du sport, et de porter un maillot et un pantalon. C’est impudique et indécent, a-t-il dit d’un ton sec et menaçant, ajoutant qu’il la tuerait si elle n’arrêtait pas le basket-ball. Le lendemain, quelqu’un d’autre a appelé pour dire la même chose.
Aïcha a changé trois fois de numéro, mais les appels n’ont pas cessé et elle s’est demandé si quelqu’un, chez l’opérateur de téléphonie mobile, ne communiquait pas ses coordonnées. Au bout de quelque temps, Aïcha a commencé à tenir tête à ceux qui l’appelaient. Quand ils menaçaient de la tuer, elle leur répondait que Dieu seul avait un droit sur les âmes. Elle n’était qu’une adolescente, mais même elle, elle savait ça – contrairement à ces hommes soi-disant pieux. Et puis sa mère a commencé à recevoir elle aussi des coups de fil d’hommes qui l’avertissaient qu’elle allait perdre sa fille. Ils en appelaient à sa foi et lui disaient que le basket était haram, interdit. Sa mère était inquiète ; elle voulait qu’Aïcha arrête de jouer.
Aïcha ne s’était mise au basket que peu de temps auparavant, mais elle s’était vite prise de passion pour ce sport. Son téléphone s’était rempli de photos et de vidéos du joueur auquel elle voulait le plus ressembler, un célèbre sportif américain nommé LeBron James. Elle l’avait vu sur Internet et l’avait trouvé fascinant : « Il est noir, il est grand, et c’est un très bon joueur », dit-elle. Il était puissant et agile, et terriblement futé ; elle voulait posséder cette magie-là.
Aïcha se sentait pour ainsi dire faite pour ce sport. Sa mère, Warsam, l’avait pratiqué dans sa jeunesse. Son père, Khaled, avait été arbitre des championnats somaliens de basket, et elle avait assisté à ses matchs. « Voir des hommes et des femmes jouer, c’était exaltant », se souvient Aïcha. Elle a commencé sur le sol de latérite autour de sa maison, avec les gosses du quartier. Elle ne savait pas ce qu’il fallait faire, mais s’en fichait ; c’était déjà tellement génial de tenir un ballon. « J’ai toujours voulu jouer au basket, mais j’avais peur de ne pas trouver de filles pour faire équipe avec moi », raconte-t-elle. Peu de temps après, une entraîneuse du nom de Nasro Mohamed, une ancienne coéquipière de sa mère, lui a demandé si ça l’intéresserait de jouer régulièrement. Nasro Mohamed a constitué un groupe avec Aïcha et sept autres filles, et les entraînements ont commencé.
Mogadiscio était autrefois une ville magnifique, avec d’élégants bâtiments officiels de couleur claire, des mosquées, des demeures somptueuses, le tout à proximité des plages de sable blanc qui ourlent l’océan Indien. Aujourd’hui, après plus de vingt ans de guerre civile et d’anarchie, les façades sont criblées d’impacts d’obus et de balles ou s’effondrent faute d’entretien. Les immeubles récents sont sans caractère. Les rues, où le sable s’accumule dans les crevasses, grouillent de soldats et de policiers.
Aïcha a grandi à Suuq Baqqad, un quartier de petits bungalows derrière des portails aux couleurs vives et à la peinture écaillée. Son père avait quatre épouses et partageait son temps entre elles. Mais il parvenait à passer suffisamment de temps avec Aïcha pour qu’elle se sente aimée. Sa famille n’était pas riche, mais avait de quoi vivre. « Mes parents se sont vraiment donné beaucoup de mal pour que j’aie tout ce dont j’ai besoin », se souvient-elle. Aïcha avait deux frères et une sœur, et il était évident pour elle que chaque membre de la famille devait prendre soin des autres. Son quartier lui-même fonctionnait comme un clan ; elle jouait à cache-cache avec d’autres enfants, dont certains lui étaient aussi chers que des frères et sœurs.
Sa mère, Warsam, tenait un café et un petit commerce de vente d’or. Elle était grande et douce et ne frappait jamais ses enfants, à la différence des autres mères du quartier. Elle comprenait la passion d’Aïcha pour le basket parce qu’elle avait elle-même jadis éprouvé ce besoin de jouer. Khaled aussi soutenait Aïcha ; il allait la voir sur le terrain et l’incitait à progresser. La Somalie possède une ligue de basket-ball regroupant des centaines de filles et de femmes qui jouent dans l’une des huit équipes de Mogadiscio ou ailleurs dans le pays. « Mon père m’a dit : ou tu arrêtes le basket, ou tu essaies de passer professionnelle », raconte Aïcha.
Pour elle, le meilleur moment de la journée, c’était quand elle retrouvait ses amies sur un terrain du quartier. À l’école, elle avait du mal à se concentrer. « Je n’étais pas sympa avec les profs, dit-elle. Je n’arrêtais pas de bavarder et de raconter des blagues ; j’agaçais tout le monde. » Elle a arrêté l’école à 13 ans. Ses parents étaient furieux ; ils étaient tous deux allés à l’université et considéraient l’éducation de leurs enfants comme une priorité absolue. Ils avaient essayé de l’obliger à y retourner, mais Aïcha avait refusé. « Je ne voyais pas l’intérêt de continuer », me confie-t-elle. En plus, la guerre civile faisait rage, et l’avenir était plus qu’incertain.
La Somalie a cessé d’être un État fonctionnel en 1991, année où le dictateur Mohamed Siad Barre a été destitué par les milices rebelles. Il s’était emparé du pouvoir deux décennies plus tôt par un coup d’État militaire et avait traité ses opposants avec brutalité ; mais il avait aussi cherché à moderniser le pays en tentant d’abolir le système de clans, fondement de la vie politique somalienne, et d’imposer à la place un régime socialiste teinté de nationalisme. Il avait codifié la forme écrite de la langue somalie, auparavant exclusivement orale, et mis en place un programme national d’alphabétisation. Son gouvernement avait promu les droits des femmes, ce qui avait permis au basket-ball féminin de s’épanouir. Les joueuses de l’équipe nationale avaient participé aux jeux Panarabes et disputé des matchs en Irak, en Jordanie et au Maroc.
Après la chute de Siad Barre, la Somalie connaît une décennie de chaos jusqu’à l’arrivée au pouvoir de l’Union des tribunaux islamiques (UTI), une alliance de tribunaux appliquant la charia et soutenue par des milices armées. Les délits sont sévèrement punis, les voleurs amputés des mains, les femmes accusées d’adultère lapidées. Le sport est décrété activité satanique et les personnes surprises à regarder des matchs à la télévision sont arrêtées. Les filles sont interdites de stade comme spectatrices et, a fortiori, comme sportives. Mais, dans un pays las de l’insécurité, les tribunaux islamiques jouissent du soutien de la population. Après leur éviction par une intervention militaire éthiopienne soutenue par l’armée américaine en 2006, une faction de leurs milices, appelée Al-Shebab, « les jeunes » en arabe, poursuit le combat. Les shebabs sont encore plus extrémistes que les tribunaux : les Somaliens surpris à faire du sport sont parfois tués.
Pendant cinq ans, les shebabs multiplient les accrochages sanglants pour contrôler Mogadiscio et ses environs. Les soldats de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom) les combattent avec le soutien des milices claniques somaliennes. Les États-Unis, désireux de lutter contre le terrorisme mais pas d’engager des troupes, fournissent de l’aide aux pays d’origine des soldats de l’Amisom et ferment volontiers les yeux sur leurs violations des droits de l’homme. En 2011, la coalition reprend finalement le contrôle de Mogadiscio.
Mais les combattants islamistes font de la résistance et affrontent les forces régulières quartier par quartier. Les États-Unis livrent eux aussi une guerre clandestine par le biais de leurs forces spéciales et d’entreprises sous-traitantes. Les Somaliens continuent de subir des attentats terroristes autour de chez eux et lors de mariages ou d’enterrements. Les responsables politiques, dit-on, paient les milices claniques et les dirigeants d’Al-Shebab pour garder leur poste et rester en vie. Les attaques de drones et les descentes brutales dans les quartiers contribuent à dresser les jeunes contre le gouvernement. L’organisation État islamique tente d’établir son influence, ses membres essayant d’implanter des avant-postes sur la côte.
Pour le commun des Somaliens, les terroristes et les militaires constituent des menaces similaires ; on ne peut se fier ni aux uns ni aux autres. L’an dernier, une amie m’a emmenée dans un restaurant en plein air à Mogadiscio, le Beach View, que les shebabs avaient attaqué quelques mois auparavant. Les activistes avaient lancé une voiture bourrée d’explosifs contre l’hôtel attenant, puis s’étaient rués dans le restaurant tout en tirant. Les clients s’étaient cachés sous les tables et dans la cuisine ; certains s’étaient enfuis vers la plage mais avaient été abattus sur le sable. L’attentat a fait au moins 20 morts. Mais, quand je m’y suis rendue, il ne restait plus aucune trace de la tragédie. Le restaurant était plein, les gens riaient, dégustaient des fruits de mer, prenaient des selfies. De l’autre côté du parapet, des enfants jouaient sur la plage. Sur la mer, les familles s’entassaient dans des barques en bois pour admirer le coucher du soleil. Tant qu’ils étaient encore sur cette terre, les Somaliens n’allaient pas se laisser priver des rares plaisirs qu’elle pouvait leur offrir.
Aïcha partage son temps entre la maison de sa mère et celle de sa sœur, dans un quartier régulièrement ciblé par les shebabs parce qu’il abrite un poste de police. Quand je suis allée la voir, mon chauffeur, fébrile, m’a dit qu’il ne m’attendrait pas plus de quelques minutes. Il a filé sans moi. Les murs de la maison sont peints d’un bleu vif et la cour est couverte de boue à cause des fortes pluies de la nuit précédente. Sous la véranda, les cousines d’Aïcha se font des tresses, essaient des foulards, boivent du thé. De derrière le portail provient, assourdi et mélodieux, l’appel du muezzin.
La chambre où dort Aïcha donne sur la véranda. Sombre, étouffante, la pièce n’a qu’une fenêtre, avec des volets bleus entrouverts. Un voilage accroché à la va-vite s’agite mollement au gré d’une faible brise. Deux matelas aux draps repliés sont posés sur le sol, et nous nous asseyons dessus.
Aïcha a 17 ans, un visage expressif et un anneau de nez en or si petit qu’on ne le remarque pas tout de suite. Elle se décrit comme quelqu’un de « toujours content », et a un besoin compulsif de communiquer ses pensées et ses émotions. Elle parle sans arrêt, d’une voix éraillée et haut perchée, en gesticulant. À l’entraînement, sa coach menace régulièrement de la virer du terrain si elle ne cesse pas de bavarder. Elle est fluette et je lui fais remarquer qu’elle est petite pour une basketteuse. « Il y a beaucoup de joueuses qui sont petites et super-bonnes. C’est le cœur qui fait tout, pas la taille », me rétorque-t-elle. Elle a un match ce soir et propose de me montrer une fille qui est grande mais ne sait pas tirer.
Quand Aïcha a commencé à jouer, elle n’avait ni la bonne tenue, ni les bonnes chaussures. Nasro Mohammed, sa première entraîneuse, l’a aidée à se procurer l’équipement, et Aïcha lui en est reconnaissante. « Quand on a la passion que j’ai pour le basket, tout le reste passe après », dit-elle. Lorsqu’elle n’a pas de quoi prendre le minibus pour aller à son entraînement, elle demande aux voisins de l’aider ou appelle pour voir si quelqu’un de son équipe peut passer la prendre. « Je suis prête à tout pour aller au stade », poursuit-elle.
Nasro Mohamed, la quarantaine bien sonnée, a la peau claire et des yeux rieurs derrière des lunettes rose fluo. Elle a grandi dans le sud de la Somalie et est venue adolescente à Mogadiscio pour jouer dans l’équipe Jeenyo, l’une des meilleures à l’époque. « On allait de chez nous au terrain de basket en short avec nos coupes afro, et on rentrait vers minuit dans la même tenue », se souvient-elle. Maintenant, pour les gens, il n’y a que la religion qui compte. Ils vous disent de vous voiler. Ils vous y obligent. »
Pendant les combats, Nasro a quitté la Somalie pour les Émirats arabes unis. À son retour, en 2012, elle s’est à nouveau impliquée dans le basket féminin, qui était en plein marasme. « J’ai pris une trentaine de filles pour les entraîner », dit-elle. Ce n’était pas facile de les protéger. « Beaucoup aimeraient jouer, mais elles ont peur. Si on ne porte pas le hidjab, les gens font des commentaires dans la rue. Et il faut toujours être sur le qui-vive : sur le terrain, on risque de se faire tuer parce qu’on est en pantalon de survêtement. »
Une fois qu’Aïcha a appris les bases du basket avec Nasro Mohamed, elle a navigué d’une équipe de la ligue à l’autre. Elle a joué avec des filles célibataires, des femmes mariées, des mères, des étudiantes. La plupart étaient adolescentes ou avaient une vingtaine d’années, et elles bavardaient et rigolaient comme des sœurs. Les coéquipières d’Aïcha étaient énergiques et combatives, un mélange de joueuses expérimentées et de novices. Dans un match auquel j’ai assisté, il y avait une fille de petite taille qui n’arrêtait pas de chiper la balle pour tenter tir sur tir, et ratait presque à chaque fois, un grand sourire aux lèvres. Quand une joueuse de l’équipe adverse a mis un panier à trois points, elle est allée la féliciter. Aïcha possède au contraire l’intensité d’une boxeuse. Elle est constamment en mouvement, préparant des coups. Elle joue pivot, la position physiquement la plus exigeante du terrain.
Dans une équipe appelée Heegan, Aïcha s’était liée avec deux filles extraverties et intrépides, Salma et Bouchra. Un soir, après l’entraînement, toutes les trois ont hélé un tuk-tuk, un de ces motos-taxis jaunes qui sillonnent les rues de Mogadiscio, et ont indiqué au conducteur où elles voulaient aller. En chemin, il a pris une mauvaise rue avant de s’arrêter. Aïcha s’est penchée vers lui pour lui demander ce qui se passait. Il lui a dit qu’il avait un problème mécanique, et qu’il devait appeler quelqu’un pour l’aider. Un homme est arrivé, une arme à la main. « Vous, les filles, vous êtes des infidèles, leur a-t-il dit. Vous faites du sport et vous marchez dans la rue en pantalon. » Il a visé Salma et celle-ci a bondi pour essayer d’attraper l’arme. L’homme a tout de même tiré, et la balle a éraflé la jambe de Bouchra. Les filles ont réussi à trouver un policier et lui ont raconté en haletant ce qui venait de se passer. Il a embarqué les deux hommes. Plus tard, la police a tenu une conférence de presse pour annoncer l’arrestation de l’homme qui avait tiré. Il a avoué qu’il préparait plusieurs attentats dans la ville. Aïcha a tout vu à la télévision. « Il est encore en prison aujourd’hui », se réjouit-elle. Mais partout dans la ville, il y en a d’autres qui partagent ses idées.
À Mogadiscio, on passe difficilement inaperçu ; quand on circule, il y a toujours plein d’yeux qui vous scrutent. À toutes les heures du jour, des hommes sont là, aux terrasses des cafés, discutant et se disputant, buvant du thé, fumant la chicha, mâchonnant du khat. Autour, des femmes vendent de la nourriture sur des étals. Tous gardent un œil sur la rue, observant les passants et les événements du jour. Les gens peuvent être aimables, prêts à apporter de l’aide en cas d’attentat à la voiture piégée, comme ils peuvent être hostiles. À Mogadiscio, on dit que des indics – voisins, collègues, amis, proches – informent les shebabs.
Les femmes savent dans quelles parties de la ville elles doivent porter le niqab et surtout ne pas donner l’impression qu’elles font du sport afin de rester en vie. Les basketteuses jouent en bas de survêtement et en maillot, mais beaucoup revêtent le niqab pour aller au terrain ou en revenir, dissimulant leur visage en signe de piété et pour ne pas être reconnues. Aïcha refuse d’en porter un. « Je m’en fiche, dit-elle, je laisse voir mon visage. »
Quand j’ai rencontré Aïcha, elle jouait dans un club appelé OFC. Une fin d’après-midi, chez sa sœur, elle se prépare pour l’entraînement. Dans sa chambre, Aïcha est l’incarnation de la Somalienne féminine, avec sa longue jupe à fleurs, son chemisier clair et son foulard foncé à motifs floraux. Elle traverse la pièce pour fouiller dans une valise rouge. Elle enlève sa jupe, son chemisier et son foulard et revêt à la place un débardeur en coton rouge et un maillot bleu ciel avec le numéro 10 dans le dos (elle portait déjà sous sa jupe un pantalon de survêtement assorti, comme à son habitude). Elle renoue son foulard en chignon plutôt que de le laisser tomber sur ses épaules à la façon traditionnelle. Puis elle enfile une jupe longue jusqu’aux pieds et un djilbab [vêtement ample à capuche] couleur moutarde qui laisse voir son visage. Elle est prête à se rendre au terrain de basket.
Nous traversons en voiture le dédale du marché de Hamar Veyne, un quartier de ruelles étroites bordées d’anciennes murailles crénelées. Le marché grouille de gens qui bavardent, marchandent aux étals, tirent des charrettes déglinguées chargées d’animaux ou de marchandises. Nous arrivons à un complexe sportif doté d’un terrain de basket à l’air libre entouré de murs de ciment couverts de peinture rose écaillée. Les coéquipières d’Aïcha sont éparpillées sur le terrain, elles font des lancers, trottinent sur des tapis de course ou sont assises sur des bancs à bavarder. Aïcha ôte sa jupe et son djilbab avant de fouler le terrain. Même si les filles ne sont pas tellement plus en sécurité ici qu’ailleurs dans Mogadiscio, elles parlent haut et sans crainte. Elles sont chez elles.
Aïcha se considère comme une fervente musulmane. Elle a appris le Coran par cœur, et son oncle avait une bibliothèque de livres islamiques dont elle a lu la plupart. « Prier, lire le Coran et ces livres, ça me donne le sentiment d’être connectée à Dieu. Ça me donne le sentiment que, le jour du Jugement dernier, je ne serai pas condamnée parce que j’ai raté la prière ou un truc du genre. Inch’Allah ! », explique-t-elle. Mais elle ne comprend pas que Dieu trouve à redire à des filles qui jouent au basket, dès lors qu’elles s’efforcent d’être pieuses et de bien se conduire.
En dépit des tentatives des extrémistes pour réprimer les femmes, Aïcha et ses amies trouvent moyen de vivre leur vie comme elles l’entendent. Quand elle avait 16 ans, son équipe est allée disputer un match à Galkayo, dans le nord de la Somalie, et, sur le chemin de l’aéroport de Mogadiscio, un jeune homme lui a demandé son numéro de téléphone. Aïcha l’a trouvé beau, et, même si elle ne lui a pas donné son numéro, ils ont échangé plus tard sur Facebook. Elle s’est mise à réfléchir à ce que l’amour pourrait signifier pour son avenir. Beaucoup des garçons qu’elle avait rencontrés jusque-là voulaient qu’elle arrête de jouer et qu’elle se marie. « Je crois que je peux réussir à me marier et à jouer au basket. Il y a des filles qui sont mariées, qui ont des enfants et qui continuent à jouer dans mon équipe », rappelle-t-elle. Aïcha a commencé à aller à la plage avec le jeune homme ; il lui a rendu visite chez elle et a pris le thé avec sa mère. Comme son père, il l’encourage à jouer et assiste à ses matchs. Désormais, quand d’autres garçons l’appellent, Aïcha met son téléphone sur silencieux. Ça ne l’intéresse pas.
Certaines des femmes de l’entourage d’Aïcha sont nettement moins encourageantes. Quand elle habite chez sa sœur, les voisines ne cessent de lui dire que les filles qui jouent au basket sont de mauvaises musulmanes. La grand-mère d’Aïcha pense qu’elle ferait mieux de rester à la maison, à l’écart des hommes en armes. Mais elle, elle s’en fiche. « On doit poursuivre nos rêves et ce qu’on veut pour nous-mêmes », affirme-t-elle.
Beaucoup des joueuses et des entraîneuses se plaignent que les autorités chargées du sport en Somalie n’en fassent pas plus pour aider les sportives. Les clubs masculins ont des tenues, des terrains, des matchs et des entraînements réguliers. Les équipes féminines, rien de tout cela. L’équipe nationale masculine dispute des compétitions dans toute l’Afrique. L’équipe féminine n’est pas sortie du pays depuis 2011, année où elle avait été au Qatar pour les jeux Panarabes et avait fini quatrième sur 22 pays. C’est le seul championnat auquel les femmes ont pris part depuis le début de la guerre civile, vingt-cinq ans auparavant.
Duran Ahmed Farah, le président du comité olympique somalien, explique que le problème est de trouver des endroits sûrs pour jouer. « Il nous faut limiter les risques autant que possible, me dit-il. D’un point de vue culturel, ce n’est pas évident pour les filles de faire du sport en extérieur. Les garçons peuvent jouer au foot dans la rue, mais les gens n’apprécient pas que les filles fassent du sport en plein air. »
L’entraîneuse d’Aïcha à l’OFC, Mulki Nur, est une femme discrète et modeste, mais son ample djilbab aux couleurs pastel dissimule mal sa taille et sa carrure. À l’entraînement, quand elle montre comment récupérer un rebond, elle fait preuve d’autorité. Elle a joué dans l’équipe nationale à la meilleure époque de celle-ci, dans les années 1980. « Tout ce que je voulais, c’était jouer au basket dans le monde entier », me confie-t-elle. Son visage s’éclaire. « J’adorais ça et j’étais fière de ce que je faisais. »
Pendant la guerre, Nur entraînait des filles jusqu’à ce qu’elle reçoive des menaces de mort. « J’étais traquée par les militants. Il y avait beaucoup d’insécurité alors, et ils auraient pu facilement m’avoir. » Elle a fui la Somalie, laissant ses dix enfants à la charge de son mari. Elle s’était fait arrêter à la frontière soudanaise et est revenue chez elle, où elle a repris ses activités sportives. « J’estime que les femmes doivent être libres, dit-elle. Elles doivent avoir leur entière liberté. »
En 2015, plusieurs filles de la ligue ont eu la possibilité de participer à un tournoi aux Émirats arabes unis, mais la fédération a refusé. « Il y a des gens dans la fédération qui veulent vraiment améliorer le basket féminin, me dit Aïcha. Mais il y en a d’autres qui ne veulent rien faire pour nous. Ils veulent juste qu’on continue à jouer entre nous. »
Aïcha cherche d’autres façons de s’affirmer. Une station de radio locale organise des radio-crochets pour les jeunes, et elle aime y participer en chantant des chansons qui racontent la réalité somalienne. Sa mère n’aime pas ça, mais elle a dû se résigner. Aïcha a récemment organisé une soirée dans un hôtel qui se transforme en boîte clandestine la nuit. Elle et ses amis ont bu et dansé sur de la pop somalienne et américaine, et elle a tenu son petit ami par la main. C’était risqué – les militants attaquent parfois les boîtes de nuit à l’explosif –, mais Aïcha trouve toujours le moyen de faire ce qu’elle veut.
« Les conflits peuvent constituer des opportunités, souligne Shukria Dini, une universitaire canado-somalienne spécialiste des questions de femmes en Somalie. Oui, les femmes ont perdu beaucoup de leurs droits, mais elles sont aussi devenues extrêmement créatives et ont gagné quelque chose du désastre de la guerre : le conflit émascule les hommes et ébranle les structures sociales traditionnelles ; les femmes assument de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités. Dans 70 à 80 % des ménages somaliens, ce sont les femmes qui sont les principales pourvoyeuses de revenus, ce qui leur ouvre la possibilité de devenir les principales décisionnaires. »
Plus Aïcha grandit, plus elle est en conflit avec sa famille. Elle a récemment rappelé à son beau-frère que sa mère, en plus de jouer au basket, faisait de la natation de compétition avant la guerre, revêtue d’un maillot de bain. « Les femmes pouvaient sortir sans hidjab et représenter la Somalie à l’international avec presque rien sur le corps. Alors, on ne peut pas dire à présent que l’islam nous interdit de faire du sport ! » Aïcha trouve bien que les Somaliens se conforment davantage à leur religion, mais pas que l’on cherche à contrôler la façon dont les femmes se comportent. « Ça doit être à elles de choisir, pas à quelqu’un de les forcer ou de leur dire ce qu’il faut faire », proteste-t-elle.
Mais tout dans la vie d’Aïcha n’obéit pas à sa volonté. Un après-midi d’avril 2016, son frère Abdi rentrait à la maison après son cours à l’université, où il faisait des études d’ingénieur. C’était une journée chaude et ensoleillée, de celles qui vous écrasent de fatigue. Abdi s’est arrêté à une pharmacie pour acheter des médicaments pour leur mère, qui est diabétique. Deux hommes se disputaient à côté, et la dispute a dégénéré en échange de coups de feu. Son frère a pris une balle perdue et est mort peu de temps après. Aïcha était effondrée ; de tous ses frères et sœurs, Abdi était celui dont elle était le plus proche. Il comprenait son état d’esprit et son tempérament. C’était souvent lui qui ramenait la paix dans la famille. « Il me soutenait et me défendait », dit Aïcha. Quand je lui ai exprimé mes condoléances, elle a haussé les épaules, suggérant que c’était idiot de s’attendre à mieux. « C’est la vie, personne n’est éternel. »
C’est pourquoi, bien qu’adorant la Somalie, Aïcha songe tout le temps à partir. Beaucoup de ses amies et coéquipières ont émigré en Europe, via la Libye. « Je veux quitter le pays », clame-t-elle, même si ça veut dire embarquer dans un rafiot surchargé et risquer sa vie sur la mer. « On n’est pas en sécurité ici. Il peut nous arriver n’importe quoi. » Pour le moment, elle continuera à jouer au basket. « Je ne peux pas faire preuve de faiblesse, dit-elle. La faiblesse m’expose encore plus. Je dois être forte et tenir bon. Je leur dis que je vais faire tout ce que je veux – tout ce qu’ils interdisent. »
Fin 2016, Aïcha a appris que la Somalie allait organiser le premier tournoi national de basket féminin dans la ville de Garowe, dans la région du Puntland, où les shebabs sont moins puissants. Elle ne peut s’arrêter d’en parler. Des femmes de tout le pays se retrouvaient pour jouer. Hana Mire, une cinéaste qui prépare un documentaire sur le basket féminin en Somalie, accompagnait l’équipe. Mais juste avant Noël, un groupe de religieux influents, le Conseil religieux somalien, déclarait le basket « contraire à l’islam » et « dangereux pour la foi musulmane ». Le porte-parole du conseil déconseillait aux filles comme Aïcha d’exhiber « leur corps et leur beauté » devant les hommes. Sur Facebook, raconte-t-elle, les religieux incitaient les gens de Garowe à leur trancher la gorge.
Aïcha est montée dans l’avion avec appréhension dans sa tenue de sport jaune et noire. « J’étais effrayée par ce qu’ils disaient. On était toutes effrayées. » Mais l’excitation à l’idée d’être dans un avion, de voir sa ville natale s’éloigner, d’atterrir dans un endroit nouveau – la ville de Bosaso, plus paisible que Mogadiscio – lui a fait oublier sa peur. L’équipe s’est entassée dans une camionnette qui les a conduites jusqu’à Garowe, à presque 500 kilomètres de là. Les filles chantaient des chansons pop somaliennes, agitaient les mains par la vitre, hélaient les gens qu’elles croisaient.
À l’hôtel, les joueuses ont rencontré les équipes adverses. « C’était un sentiment extraordinaire. Je ne savais même pas que toutes ces filles existaient », dit Aïcha. Un terrain, immense et magnifique, avec un revêtement vert clair, était à leur entière disposition ; pendant toute la semaine, elles pourraient ne faire que du basket, jour et nuit.
Les chefs religieux ayant raconté que les joueuses se promenaient nues et qu’elles commettaient des péchés, les filles ont décidé de montrer qu’elles pouvaient être pieuses selon les normes des religieux mais aussi rebelles. Elles ont joué en hidjab avec leurs pantalons de survêtement et leurs maillots habituels. C’était chaud et inconfortable, mais Aïcha pensait que si porter le foulard les protégeait à un moment aussi crucial, elle le ferait – pour cette fois.
Des vigiles fouillaient tous les spectateurs à l’entrée du stade, mais l’atmosphère dans les tribunes était festive. Il y avait beaucoup de femmes dans le public : des jeunes et des moins jeunes, des femmes avec des bébés, des femmes portant des djilbabs de toutes les couleurs. Pour beaucoup d’entre elles, c’était leur premier match de basket, et elles encourageaient les deux équipes, refusant de choisir un camp. Lors de la première partie, à la mi-temps, la foule s’est précipitée sur le terrain, croyant que c’était déjà fini.
Au terme d’une série de matchs difficiles, l’équipe d’Aïcha a terminé deuxième. Elle-même était plus sûre que jamais de la qualité de son jeu, et elle voulait se faire transférer à Horseed, la meilleure équipe de la ligue. Participer au tournoi lui avait donné un sentiment inappréciable : pour une fois, pas besoin de penser à sa famille, à son amoureux, à ses voisins et à ce qu’ils avaient à dire de ses choix. Elle a décidé de laisser cette sensation se prolonger le plus longtemps possible.
— Ce texte, paru dans The New Yorker le 11 septembre 2017, est un extrait de son premier livre, A Moonless, Starless Sky. Il a été traduit par Jean-Louis de Montesquiou.