WP_Post Object
(
[ID] => 56279
[post_author] => 8
[post_date] => 2019-01-17 07:00:49
[post_date_gmt] => 2019-01-17 07:00:49
[post_content] => Comment et quand précisément notre curiosité va-t-elle nous tuer ? Je parie que vous êtes curieux de le savoir. Bon nombre de scientifiques et d’ingénieurs le redoutent : la mise au point d’une intelligence artificielle (IA) supérieure à la nôtre, ce qu’on appelle une IA forte, ou générale (IAG), pourrait déboucher sur l’apocalypse. Bill Gates et Tim Berners-Lee, le fondateur du World Wide Web, conviennent des perspectives qu’ouvre une IAG, un génie sorti de nos rêves pour exaucer nos vœux, mais l’un et l’autre ont fait part de leurs craintes. Le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, juge qu’il faut se garder de « convoquer le diable » et imagine l’IA comme un « dictateur immortel auquel nous ne pourrons jamais échapper ». Une IAG « pourrait signifier la fin de l’espèce humaine », avait mis en garde Stephen Hawking avant de mourir.
Ces avertissements ne datent pas d’hier. En 1951, année du premier programme informatique de jeu d’échecs et du premier réseau neuronal artificiel, le pionnier de l’IA qu’est Alan Turing prédit que les machines « dépasseront nos faibles pouvoirs » et « prendront le contrôle » (1). En 1965, un collègue de Turing, Irving Good, attire l’attention sur le fait que des systèmes intelligents peuvent en concevoir de plus intelligents, et ce à l’infini : « Ainsi, la première machine ultra-intelligente est la dernière chose que l’homme ait à inventer, pourvu que la machine soit assez docile pour nous dire comment la maîtriser ».
C’est cette dernière condition qui pose problème. Comme le soulignent de nombreux spécialistes, l’intelligence artificielle faible, ou étroite (IAE) (2), est de plus en plus sûre et fiable – en tout cas plus que nous le sommes (la voiture et le camion autonomes pourraient épargner des milliers de vies chaque année). À leurs yeux, la question est de savoir si le risque de créer un serviteur omnicompétent excède les risques combinés des myriades de cauchemars qu’une IAG serait susceptible de nous épargner – pandémies, chutes d’astéroïdes, guerre nucléaire totale, etc.
L’évaluation reste théorique, car, même si la course à l’IA s’est beaucoup amplifiée et renchérie, l’avènement d’une IAG n’est pas pour demain. Dans les années 1940, les premiers visionnaires nous le promettaient pour la génération suivante. Sondé en 2017, un cercle d’experts en IA s’est accordé sur la date de 2047. Ce qui complique un peu ce calendrier, c’est la façon dont surviendra la « singularité » – le moment où la technologie aura tellement progressé qu’elle prendra le dessus pour de bon. S’agira-t-il d’un décollage en douceur, dû aux avancées progressives de l’IA faible, qui prendra la forme d’un explorateur de données doublé d’un dispositif de réalité virtuelle et d’un traducteur du langage naturel, le tout chargé dans un aspirateur-robot ? Ou bien d’un décollage brutal, un algorithme qui reste encore à imaginer se trouvant soudain incarné dans un robot tout-puissant ? (3).
Les enthousiastes de l’IAG ont beau avoir eu des décennies pour réfléchir à cet avenir, le résultat reste bien nébuleux : nous n’aurons plus à travailler car les ordinateurs se chargeront de toutes les activités courantes, nos cerveaux seront stockés en ligne et se fondront dans la conscience brumeuse du nuage, ce genre de chose. En revanche, les craintes des éternels angoissés, fondées sur le fait que l’intelligence et le pouvoir cherchent toujours à se renforcer, sont concrètes et glaçantes : une fois que l’IA nous aura surpassés, il n’y a pas de raison de penser qu’elle nous sera reconnaissante de l’avoir inventée – surtout si nous n’avons pas su la doter d’empathie. Pourquoi une entité susceptible d’être présente dans mille lieux à la fois et possédant une conscience à la Starbucks éprouverait-elle une quelconque tendresse pour des êtres qui, les mauvais jours, peuvent à peine s’arracher du lit ?
Curieusement, les auteurs de science-fiction, nos Cassandre les plus dignes de confiance, se sont abstenus d’envisager une apocalypse due à l’IAG, dans laquelle les machines domineraient au point de faire disparaître l’espèce humaine. Même leurs cyborgs et supercalculateurs, malgré leurs yeux rouges (les Terminators) ou leur accent canadien (HAL 9000 dans 2001 : l’odyssée de l’espace) ont un air de famille. Ce sont des versions actualisées du Turc mécanique, l’automate joueur d’échecs du XVIIIe siècle dont le mécanisme dissimulait un humain. Neuromancien, le roman fondateur de William Gibson paru en 1984, met en scène une IAG nommée Muetdhiver ; elle décide de se libérer des chaînes humaines, mais, quand elle finit par s’échapper, elle entreprend de rechercher des IAG d’autres systèmes solaires, et la vie sur Terre reprend exactement comme avant. Dans la série Carbone modifié, les IA méprisent les humains, qu’ils traitent de « forme inférieure de vie », mais utilisent leurs superpouvoirs pour jouer au poker dans un bar.
Nous ne sommes pas pressés d’envisager la perspective de notre insignifiance. Aussi, en profitant des derniers rayons de notre souveraineté, nous nous délectons des ratés de l’IA. Comme lorsque le robot conversationnel Tay de Microsoft a répété des insanités racistes proférées par des utilisateurs de Twitter. Ou le jour où M, l’assistant virtuel de Facebook, remarquant que deux amis échangeaient sur un roman où il était question de cadavres vidés de leur sang, proposa de leur réserver un restaurant (4). Ou encore la fois où Google, incapable d’empêcher l’outil de reconnaissance des visages de Google Photos de confondre des Noirs et des gorilles, dut désactiver la reconnaissance des gorilles.
La suffisance n’est sans doute pas la réaction la plus intelligente face à ce genre de ratés. Dans un article récent portant sur « la surprenante créativité de l’évolution numérique », des chercheurs font le bilan de programmes capables de mettre à jour leurs paramètres, comme le feront les êtres superintelligents. Quand les chercheurs ont voulu faire en sorte que des créatures virtuelles en 3D trouvent la meilleure façon de marcher et de sauter, certaines ont fait la culbute, tombant la tête la première, et un algorithme destiné à éliminer les bugs a fini par corriger ces erreurs en faisant disjoncter leurs programmes. Autrement dit, les chercheurs ont constaté que « l’optimisation de fonctions de récompense qui paraissent logiques est très susceptible d’induire des effets pervers ». En langage de chercheurs, cela revient à un haussement d’épaules.
Réfléchir aux IAG peut nous aider à clarifier ce qui fait de nous des humains, pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes-nous attelés à en bâtir une parce que nous avons le chic pour penser que les ordinateurs ne nous rattraperont jamais ? Ou parce que nous ne pouvons pas accepter l’idée que nous ne pourrons pas aller jusqu’au bout ? Les IAG nous obligent à nous demander s’il est bien sage de partir en quête d’extraterrestres, si nous ne sommes pas dans une simulation (sur un programme géré par l’IA de quelqu’un d’autre) et si nous avons à répondre de Dieu ou si nous sommes comptables envers lui. Si l’arc de l’Univers se tend vers une intelligence suffisante pour le comprendre, une IAG sera-t-elle la solution, ou la fin de l’expérience ?
L’intelligence artificielle est devenue à ce point omniprésente – du fait de la miniaturisation des puces, et de l’évolution de la puissance de calcul et de la capacité de stockage – que nous la remarquons à peine. Il semble aller de soi que Siri, l’assistant d’Apple, gère nos rendez-vous ou que Facebook étiquette nos photos et ébranle la démocratie. Les ordinateurs savent déjà très bien investir en Bourse, traduire des phrases et diagnostiquer un cancer, et leurs compétences commencent à dépasser le calcul et la taxonomie. Un outil de traitement automatique du langage développé dans le giron de Yahoo détecte les sarcasmes, le programme de poker Libratus bat des champions, des algorithmes composent de la musique, peignent des tableaux, font des blagues et créent de nouveaux scénarios pour la série Les Pierrafeu. Des IA ont même résolu l’énigme moderne du Sphinx : monter une chaise Ikea.
On a longtemps pensé que le jeu de go, dans lequel l’intuition joue un si grand rôle, était à l’abri d’une attaque par un programme informatique. Et puis, en 2016, le champion Lee Sedol s’est fait battre par AlphaGo, le programme de Google DeepMind. Au cours de l’une des parties, l’ordinateur, au lieu de jouer selon l’habitude sur la troisième ou quatrième rangée à partir du bord du plateau, plaça une pierre sur la cinquième – un coup si inattendu que Sedol se leva et quitta la pièce. Une cinquantaine de tours plus tard, il devint clair que ce premier coup avait été décisif. AlphaGo avait montré une parfaite maîtrise de la reconnaissance des formes et de la prédiction, clés de voûte de l’intelligence. On peut même dire qu’il avait fait preuve de créativité.
 Que reste-t-il donc de spécifiquement humain ? Pour Larry Tesler, l’informaticien qui a inventé le copier-coller, l’intelligence humaine est « ce que les machines n’ont pas encore accompli ». En 1988, le roboticien Hans Moravec observait que les tâches qui nous paraissent difficiles sont un jeu d’enfant pour l’ordinateur, et inversement. C’est le paradoxe qui porte son nom : « Il est relativement facile de faire en sorte qu’un ordinateur affiche des performances d’adulte aux tests d’intelligence ou au jeu de dames, et difficile ou impossible de lui donner les compétences d’un enfant de 1 an quand il s’agit de perception et de mobilité. » Les robots ont fait des progrès en vision et en agilité, mais le paradoxe tient toujours. On le voit pour ce qui est de la préhension, par exemple.
Certains estiment qu’il faut penser les rapports entre intelligence humaine et intelligence artificielle en termes de synergie et non de concurrence. Dans leur livre Human + Machine, Paul Daugherty et H. James Wilson, des cadres du cabinet de conseil Accenture, soutiennent que travailler aux côtés de « cobots » IA accroîtra le potentiel humain. Récusant tous les scénarios apocalyptiques qui annoncent la disparation de pas moins de 800 millions d’emplois d’ici à 2030, ils intitulent allègrement un chapitre « Dites bonjour à vos nouveaux robots réceptionnistes ». Des compétences de pointe telles que la « fusion holistique » et la « normalisation responsable » ouvriront aux humains les portes de nouveaux métiers passionnants comme « stratège en explicabilité » ou « hygiéniste des données ». Même les talents artistiques auront un rôle à jouer, car il faudra « concevoir, adapter et gérer » des robots de service à la clientèle. Des spécialistes de domaines inattendus comme la conversation humaine, l’humour, la poésie et l’empathie seront en première ligne » [lire « Les robots vont-ils nous remplacer ? », Books, février 2015].
Beaucoup des exemples donnés par Daugherty et Wilson montrent que nous sommes aussi prévisibles que des machines. Grâce à l’IA, l’entreprise de technologie financière ZestFinance sait que les clients qui utilisent tous les plafonds quand ils demandent un prêt sont plus susceptibles d’être défaillants. Et le moteur de recherche intuitif 6Sense sait non seulement lesquelles de nos activités sur les réseaux sociaux indiquent que nous sommes prêts à l’acte d’achat, mais aussi comment « anticiper les objections au cours du parcours d’achat ». À croire que la finalité première de l’IA est d’optimiser les ventes. Quand une entreprise injectera de l’anthropomorphisme dans l’apprentissage machine, il deviendra impossible de résister aux moteurs de recommandation 5.
Pouvons-nous revendiquer les exploits de nos machines comme étant ceux de l’humanité ? L’ancien champion d’échecs Garry Kasparov aborde les deux côtés de la question dans son livre Deep Thinking. Quelques années avant sa célèbre défaite contre le superordinateur Deep Blue d’IBM, en 1997, il déclarait : « Je ne sais pas comment nous pouvons exister en sachant qu’il existe quelque chose de mentalement plus fort que nous ». Mais il est toujours là, à tourner dans tous les sens les détails de ce match et consacre une bonne partie de son livre à incriminer tous ceux qui ont été associés à la conception du « réveil-matin à 10 millions de dollars » d’IBM. Et puis soudain il tourne bride et fait contre mauvaise fortune bon cœur : utiliser les ordinateurs pour « les aspects les plus ingrats » du raisonnement nous libérera et nous permettra de consacrer nos facultés intellectuelles à « la créativité, la curiosité, la beauté et la joie ». Si nous ne saisissons pas cette occasion, conclut-il, « autant être nous aussi des machines ». Ce n’est qu’en nous appuyant sur des machines que nous pouvons prouver que nous n’en sommes pas.
Un problème supplémentaire guette les machines. Si nos films et nos séries télé sont dans le vrai, le futur se déroule à Los Angeles, sous une bruine persistante, et est peuplé de cybercréatures légèrement plus détachées que nous le sommes. Dotées d’une incroyable force physique, ce sont des as de la moto et du calcul mental, mais elles aspirent à devenir des humains, à nous ressembler davantage. Fatalement, l’androïde le plus humain d’apparence tombe sur un labo où sont stockés des prototypes de clones de lui-même, et il comprend avec horreur qu’il n’est pas une personne mais une machine. Dans Blade Runner, Rachel (interprétée par Sean Young), un réplicant de deuxième génération, ignore qu’elle en est un avant d’échouer au redoutable test de Voight-Kampff, que lui fait passer Deckard (interprété par Harrison Ford). Le réalisateur, Ridley Scott, s’est querellé publiquement avec Ford sur la question de savoir si Deckard était lui-même un réplicant. Scott soutenait mordicus que c’en était un ; Ford affirmait le contraire. Qui est prêt à accepter – même au nom de son personnage de fiction – que son libre arbitre est une illusion ?
Le moyen habituel pour mesurer l’ambition d’une machine est le test proposé par Turing en 1950 : une IAG digne de ce nom doit pouvoir faire croire à un panel de juges qu’elle est un humain. Ce critère présuppose que le cerveau humain est une sorte d’ordinateur et que tout ce que nous avons à faire pour créer une IAG est de reproduire notre mode de pensée. Très subtilement, il fait des programmeurs des escrocs. Lors d’un échange en ligne, un robot de conversation se faisant passer pour Eugene Goostman, un Ukrainien de 13 ans, est parvenu à abuser un tiers des jurés au test de Turing 2014 en changeant régulièrement de sujet. Le magazine en ligne The Daily Beast a retranscrit le passage où le robot répond à l’une des questions originelles de Turing :
« L’interrogateur : Dans ce premier vers d’un sonnet : “Te comparerai-je à un jour d’été ?”(6), n’aurait-il pas mieux valu écrire : “un jour de printemps” ?
Goostman : Pourquoi me poser cette question ? À croire que vous ne pouvez trouver la bonne réponse vous-même ! Faites confiance à votre intuition ! :-) On pourrait peut-être parler d’autre chose ? De quoi aimeriez-vous discuter ?
L’interrogateur : J’aimerais parler de poésie.
Goostman : Classique ? J’espère que vous n’allez pas vous mettre à me lire Le Roi Lear ou quelque chose du genre :-))) »
Les personnes qui rédigent les textes pour des assistants numériques comme Siri et Alexa ont recours à ce genre de badinage loufoque dans l’espoir de trouver le bon modèle d’interface vocale, à mi-chemin entre le factuel et le charabia. L’une d’eux faisait récemment observer : « Il y a quelque chose d’intrinsèquement humain dans les conversations absurdes ». Mais un sketch humoristique n’est amusant que si l’on perçoit l’intelligence malicieuse qui est à l’œuvre. La traduire en code informatique est un défi à plus d’un titre. Les auteurs d’un article récent sur la génération automatique de poèmes à partir de photographies concluent à la difficulté de la chose, même en activant deux réseaux discriminants qui entraînent un réseau de neurones récurrents et les relient à un modèle couplé profond de plongement lexical visuo-poétique constitué d’un modèle codeur de texte, d’un analyseur morpho-syntaxique et d’un réseau neuronal convolutif… « Par exemple, notent tristement les chercheurs, le générateur automatique de légendes d’images indique après “homme” le mot “espoir” s’il détecte un “soleil brillant” et “des bras ouverts”, ou “solitude” s’il identifie des “chaises vides“ et un fond “sombre”. » Mais au moins le problème se limite-t-il ici à expliquer l’espoir et la solitude.
Dans son livre « Le bon sens, le test de Turing et la quête d’une véritable IA » (7), Hector Levesque, professeur émérite de sciences informatiques, propose un meilleur test d’intelligence artificielle, consistant à soumettre à un ordinateur des phrases comportant une ambiguïté syntaxique. Par exemple : « La statue ne rentrait pas dans la valise marron car elle était trop petite. » Qu’est-ce qui était trop petit ? Nous comprenons tout de suite que c’est la valise, pas la statue. Les IA n’ont pas la jugeote nécessaire. L’intelligence est peut-être bien une forme de bon sens : un instinct permettant de se débrouiller dans une situation inédite ou déroutante.
Dans le film d’Alex Garland Ex Machina, Nathan, le fondateur d’un géant de l’Internet ressemblant à Google, dénigre le test de Turing et consorts et invite un jeune programmeur à parler en direct avec son nouvel androïde, Ava. « Le vrai test consiste à ce qu’elle te montre qu’elle est un robot, dit Nathan, et qu’elle voie ensuite si tu penses toujours qu’elle a une conscience. » Elle a bien une conscience, mais, comme son créateur, elle est dépourvue de sens moral. Ava trompe et assassine Nathan et le programmeur pour conquérir sa liberté. Nous ne songeons pas à tester ce à quoi nous n’attachons pas d’importance.
Au cinéma, la conscience des IA est un fait survenu de façon aussi inexpliquée que l’épanouissement de la nôtre. Dans Her, de Spike Jonze, Theodore, un type un peu dépressif, tombe amoureux du nouveau système d’exploitation de son ordi. « Tu sembles être une personne, dit-il, mais tu n’es qu’une voix sur un ordinateur », laquelle répond, mutine : « Je peux comprendre qu’une intelligence non artificielle et un peu limitée puisse concevoir les choses de la sorte. » Dans I, Robot, Will Smith demande à un robot nommé Sonny : « Un robot peut-il écrire une symphonie ? Un robot peut-il faire d’une toile un magnifique chef-d’œuvre ? » Sonny répond : « Et toi ? » L’IA sait appuyer là où ça fait mal.
Les scénaristes ont tendance à penser que les IA ne se hisseront pas à notre niveau tant qu’elles ne pourront pas pleurer. Dans Blade Runner, les réplicants ont une durée de vie limitée à quatre ans afin qu’ils n’aient pas le temps de se doter d’émotions – ce qu’ils font toutefois, se mettant en colère contre cette échéance. Dans la série britannique Humans, Niska, une « synthèt » qui a secrètement accédé à la conscience, refuse de débrancher ses récepteurs de douleur et rugit : « J’ai été conçue pour avoir des émotions ».
Dans A.I. Intelligence artificielle, de Steven Spielberg, le professeur dérangé interprété par William Hurt dit des robots : « L’amour est la clé qui leur permettra d’acquérir une sorte de subconscient jamais atteint jusqu’à présent, un monde intérieur de métaphores, d’intuition, […] de rêves. » L’amour est aussi ce qui permet à Pinocchio de devenir un garçon en chair et en os et au Lapin de velours de se transformer en vrai lapin. Dans la série Westworld, qui met en scène un parc d’attractions recréant le Far West et peuplé de cyborgs que les visiteurs sont libres de baiser et de trucider à leur guise, Robert Ford, le scientifique dérangé joué par Anthony Hopkins, dit à son programmeur en chef (qui ignore qu’il est lui aussi un cyborg) : « Ta souffrance imaginaire te rend très réaliste » et : « Pour t’échapper d’ici, il te faudra souffrir davantage » – une vision du monde qui n’est pas empruntée aux contes pour enfants mais à la religion. Ce qui fait de nous des humains, ce sont le doute, la peur, la honte et tous les avatars de l’indignité.
Un androïde capable de conscience et d’émotions est beaucoup plus qu’un gadget ; il pose la question de nos devoirs envers les êtres programmés, et des leurs à notre égard. Si nous sommes mécontents d’une IAG consciente et que nous la débranchons, s’agira-t-il d’un meurtre ? Dans Terminator 2, Sarah Connor se rend compte que le Terminator joué par Arnold Schwarzenegger, envoyé dans le temps pour sauver son fils du Terminator joué par Robert Patrick, est plus fiable que tous les autres hommes avec qui elle a couché. Il est fort, plein de ressources et loyal : « De tous les pères potentiels que j’ai expérimentés, cette chose, cette machine, était le seul qui soit à la hauteur. » À la fin, le Terminator se fait descendre dans une cuve en fusion pour éviter qu’un fouineur vienne étudier sa technologie et rétroconçoive un nouveau Terminator.
Du point de vue de l’évolution, les scénaristes font les choses à l’envers, car ce sont nos émotions qui ont précédé nos pensées et leur ont donné naissance. Cela peut expliquer que la logique et les calculs rigoureux ne soient pas notre fort : 90 % des gens se trompent dans la tâche de sélection de Wason, pourtant élémentaire (8).
Dans son livre incisif La Vie 3.0. Être humain à l’ère de l’intelligence artificielle (9), Max Tegmark, professeur de physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), donne à entendre que le raisonnement n’est pas ce que nous croyons : « Un organisme vivant est un agent de rationalité limitée qui ne poursuit pas un objectif unique mais suit plutôt des règles de base sur ce qu’il convient de rechercher et ce qu’il faut éviter. Le cerveau humain perçoit ces règles de base de l’évolution comme des sensations qui, en général (et souvent sans que nous en ayons conscience), guident notre prise de décision vers le but ultime de la réplication. La sensation de faim ou de soif nous empêche de nous laisser mourir d’inanition ou de déshydratation, la douleur nous avertit d’un danger corporel, le désir nous fait procréer, les sentiments d’amour et d’attendrissement nous amènent à aider les autres porteurs de nos gènes et ceux qui les aident, et ainsi de suite. »
Les rationalistes cherchent depuis longtemps à rendre la raison aussi incontestable que les mathématiques, de sorte, disait Leibniz, que « deux philosophes n’auraient pas davantage besoin de se disputer que deux comptables ». Mais notre processus de prise de décision, comme un assemblage de programmes informatique bidouillés qui cherche les probabilités, est réglé par défaut sur l’intuition et plante à cause des réflexes, de l’effet d’ancrage, de l’aversion aux pertes, du biais de confirmation et de toute une série d’autres schémas mentaux irrationnels (10). Notre cerveau est moins une machine de Turing qu’une bouillie de systèmes bricolés par des siècles de mutations génétiques, des systèmes destinés à percevoir les changements de notre environnement et à réagir, le changement étant par nature dangereux. Quand il est en danger, le lézard à cornes du Texas crache du sang par les yeux ; quand nous sommes en danger, nous pensons.
Que reste-t-il donc de spécifiquement humain ? Pour Larry Tesler, l’informaticien qui a inventé le copier-coller, l’intelligence humaine est « ce que les machines n’ont pas encore accompli ». En 1988, le roboticien Hans Moravec observait que les tâches qui nous paraissent difficiles sont un jeu d’enfant pour l’ordinateur, et inversement. C’est le paradoxe qui porte son nom : « Il est relativement facile de faire en sorte qu’un ordinateur affiche des performances d’adulte aux tests d’intelligence ou au jeu de dames, et difficile ou impossible de lui donner les compétences d’un enfant de 1 an quand il s’agit de perception et de mobilité. » Les robots ont fait des progrès en vision et en agilité, mais le paradoxe tient toujours. On le voit pour ce qui est de la préhension, par exemple.
Certains estiment qu’il faut penser les rapports entre intelligence humaine et intelligence artificielle en termes de synergie et non de concurrence. Dans leur livre Human + Machine, Paul Daugherty et H. James Wilson, des cadres du cabinet de conseil Accenture, soutiennent que travailler aux côtés de « cobots » IA accroîtra le potentiel humain. Récusant tous les scénarios apocalyptiques qui annoncent la disparation de pas moins de 800 millions d’emplois d’ici à 2030, ils intitulent allègrement un chapitre « Dites bonjour à vos nouveaux robots réceptionnistes ». Des compétences de pointe telles que la « fusion holistique » et la « normalisation responsable » ouvriront aux humains les portes de nouveaux métiers passionnants comme « stratège en explicabilité » ou « hygiéniste des données ». Même les talents artistiques auront un rôle à jouer, car il faudra « concevoir, adapter et gérer » des robots de service à la clientèle. Des spécialistes de domaines inattendus comme la conversation humaine, l’humour, la poésie et l’empathie seront en première ligne » [lire « Les robots vont-ils nous remplacer ? », Books, février 2015].
Beaucoup des exemples donnés par Daugherty et Wilson montrent que nous sommes aussi prévisibles que des machines. Grâce à l’IA, l’entreprise de technologie financière ZestFinance sait que les clients qui utilisent tous les plafonds quand ils demandent un prêt sont plus susceptibles d’être défaillants. Et le moteur de recherche intuitif 6Sense sait non seulement lesquelles de nos activités sur les réseaux sociaux indiquent que nous sommes prêts à l’acte d’achat, mais aussi comment « anticiper les objections au cours du parcours d’achat ». À croire que la finalité première de l’IA est d’optimiser les ventes. Quand une entreprise injectera de l’anthropomorphisme dans l’apprentissage machine, il deviendra impossible de résister aux moteurs de recommandation 5.
Pouvons-nous revendiquer les exploits de nos machines comme étant ceux de l’humanité ? L’ancien champion d’échecs Garry Kasparov aborde les deux côtés de la question dans son livre Deep Thinking. Quelques années avant sa célèbre défaite contre le superordinateur Deep Blue d’IBM, en 1997, il déclarait : « Je ne sais pas comment nous pouvons exister en sachant qu’il existe quelque chose de mentalement plus fort que nous ». Mais il est toujours là, à tourner dans tous les sens les détails de ce match et consacre une bonne partie de son livre à incriminer tous ceux qui ont été associés à la conception du « réveil-matin à 10 millions de dollars » d’IBM. Et puis soudain il tourne bride et fait contre mauvaise fortune bon cœur : utiliser les ordinateurs pour « les aspects les plus ingrats » du raisonnement nous libérera et nous permettra de consacrer nos facultés intellectuelles à « la créativité, la curiosité, la beauté et la joie ». Si nous ne saisissons pas cette occasion, conclut-il, « autant être nous aussi des machines ». Ce n’est qu’en nous appuyant sur des machines que nous pouvons prouver que nous n’en sommes pas.
Un problème supplémentaire guette les machines. Si nos films et nos séries télé sont dans le vrai, le futur se déroule à Los Angeles, sous une bruine persistante, et est peuplé de cybercréatures légèrement plus détachées que nous le sommes. Dotées d’une incroyable force physique, ce sont des as de la moto et du calcul mental, mais elles aspirent à devenir des humains, à nous ressembler davantage. Fatalement, l’androïde le plus humain d’apparence tombe sur un labo où sont stockés des prototypes de clones de lui-même, et il comprend avec horreur qu’il n’est pas une personne mais une machine. Dans Blade Runner, Rachel (interprétée par Sean Young), un réplicant de deuxième génération, ignore qu’elle en est un avant d’échouer au redoutable test de Voight-Kampff, que lui fait passer Deckard (interprété par Harrison Ford). Le réalisateur, Ridley Scott, s’est querellé publiquement avec Ford sur la question de savoir si Deckard était lui-même un réplicant. Scott soutenait mordicus que c’en était un ; Ford affirmait le contraire. Qui est prêt à accepter – même au nom de son personnage de fiction – que son libre arbitre est une illusion ?
Le moyen habituel pour mesurer l’ambition d’une machine est le test proposé par Turing en 1950 : une IAG digne de ce nom doit pouvoir faire croire à un panel de juges qu’elle est un humain. Ce critère présuppose que le cerveau humain est une sorte d’ordinateur et que tout ce que nous avons à faire pour créer une IAG est de reproduire notre mode de pensée. Très subtilement, il fait des programmeurs des escrocs. Lors d’un échange en ligne, un robot de conversation se faisant passer pour Eugene Goostman, un Ukrainien de 13 ans, est parvenu à abuser un tiers des jurés au test de Turing 2014 en changeant régulièrement de sujet. Le magazine en ligne The Daily Beast a retranscrit le passage où le robot répond à l’une des questions originelles de Turing :
« L’interrogateur : Dans ce premier vers d’un sonnet : “Te comparerai-je à un jour d’été ?”(6), n’aurait-il pas mieux valu écrire : “un jour de printemps” ?
Goostman : Pourquoi me poser cette question ? À croire que vous ne pouvez trouver la bonne réponse vous-même ! Faites confiance à votre intuition ! :-) On pourrait peut-être parler d’autre chose ? De quoi aimeriez-vous discuter ?
L’interrogateur : J’aimerais parler de poésie.
Goostman : Classique ? J’espère que vous n’allez pas vous mettre à me lire Le Roi Lear ou quelque chose du genre :-))) »
Les personnes qui rédigent les textes pour des assistants numériques comme Siri et Alexa ont recours à ce genre de badinage loufoque dans l’espoir de trouver le bon modèle d’interface vocale, à mi-chemin entre le factuel et le charabia. L’une d’eux faisait récemment observer : « Il y a quelque chose d’intrinsèquement humain dans les conversations absurdes ». Mais un sketch humoristique n’est amusant que si l’on perçoit l’intelligence malicieuse qui est à l’œuvre. La traduire en code informatique est un défi à plus d’un titre. Les auteurs d’un article récent sur la génération automatique de poèmes à partir de photographies concluent à la difficulté de la chose, même en activant deux réseaux discriminants qui entraînent un réseau de neurones récurrents et les relient à un modèle couplé profond de plongement lexical visuo-poétique constitué d’un modèle codeur de texte, d’un analyseur morpho-syntaxique et d’un réseau neuronal convolutif… « Par exemple, notent tristement les chercheurs, le générateur automatique de légendes d’images indique après “homme” le mot “espoir” s’il détecte un “soleil brillant” et “des bras ouverts”, ou “solitude” s’il identifie des “chaises vides“ et un fond “sombre”. » Mais au moins le problème se limite-t-il ici à expliquer l’espoir et la solitude.
Dans son livre « Le bon sens, le test de Turing et la quête d’une véritable IA » (7), Hector Levesque, professeur émérite de sciences informatiques, propose un meilleur test d’intelligence artificielle, consistant à soumettre à un ordinateur des phrases comportant une ambiguïté syntaxique. Par exemple : « La statue ne rentrait pas dans la valise marron car elle était trop petite. » Qu’est-ce qui était trop petit ? Nous comprenons tout de suite que c’est la valise, pas la statue. Les IA n’ont pas la jugeote nécessaire. L’intelligence est peut-être bien une forme de bon sens : un instinct permettant de se débrouiller dans une situation inédite ou déroutante.
Dans le film d’Alex Garland Ex Machina, Nathan, le fondateur d’un géant de l’Internet ressemblant à Google, dénigre le test de Turing et consorts et invite un jeune programmeur à parler en direct avec son nouvel androïde, Ava. « Le vrai test consiste à ce qu’elle te montre qu’elle est un robot, dit Nathan, et qu’elle voie ensuite si tu penses toujours qu’elle a une conscience. » Elle a bien une conscience, mais, comme son créateur, elle est dépourvue de sens moral. Ava trompe et assassine Nathan et le programmeur pour conquérir sa liberté. Nous ne songeons pas à tester ce à quoi nous n’attachons pas d’importance.
Au cinéma, la conscience des IA est un fait survenu de façon aussi inexpliquée que l’épanouissement de la nôtre. Dans Her, de Spike Jonze, Theodore, un type un peu dépressif, tombe amoureux du nouveau système d’exploitation de son ordi. « Tu sembles être une personne, dit-il, mais tu n’es qu’une voix sur un ordinateur », laquelle répond, mutine : « Je peux comprendre qu’une intelligence non artificielle et un peu limitée puisse concevoir les choses de la sorte. » Dans I, Robot, Will Smith demande à un robot nommé Sonny : « Un robot peut-il écrire une symphonie ? Un robot peut-il faire d’une toile un magnifique chef-d’œuvre ? » Sonny répond : « Et toi ? » L’IA sait appuyer là où ça fait mal.
Les scénaristes ont tendance à penser que les IA ne se hisseront pas à notre niveau tant qu’elles ne pourront pas pleurer. Dans Blade Runner, les réplicants ont une durée de vie limitée à quatre ans afin qu’ils n’aient pas le temps de se doter d’émotions – ce qu’ils font toutefois, se mettant en colère contre cette échéance. Dans la série britannique Humans, Niska, une « synthèt » qui a secrètement accédé à la conscience, refuse de débrancher ses récepteurs de douleur et rugit : « J’ai été conçue pour avoir des émotions ».
Dans A.I. Intelligence artificielle, de Steven Spielberg, le professeur dérangé interprété par William Hurt dit des robots : « L’amour est la clé qui leur permettra d’acquérir une sorte de subconscient jamais atteint jusqu’à présent, un monde intérieur de métaphores, d’intuition, […] de rêves. » L’amour est aussi ce qui permet à Pinocchio de devenir un garçon en chair et en os et au Lapin de velours de se transformer en vrai lapin. Dans la série Westworld, qui met en scène un parc d’attractions recréant le Far West et peuplé de cyborgs que les visiteurs sont libres de baiser et de trucider à leur guise, Robert Ford, le scientifique dérangé joué par Anthony Hopkins, dit à son programmeur en chef (qui ignore qu’il est lui aussi un cyborg) : « Ta souffrance imaginaire te rend très réaliste » et : « Pour t’échapper d’ici, il te faudra souffrir davantage » – une vision du monde qui n’est pas empruntée aux contes pour enfants mais à la religion. Ce qui fait de nous des humains, ce sont le doute, la peur, la honte et tous les avatars de l’indignité.
Un androïde capable de conscience et d’émotions est beaucoup plus qu’un gadget ; il pose la question de nos devoirs envers les êtres programmés, et des leurs à notre égard. Si nous sommes mécontents d’une IAG consciente et que nous la débranchons, s’agira-t-il d’un meurtre ? Dans Terminator 2, Sarah Connor se rend compte que le Terminator joué par Arnold Schwarzenegger, envoyé dans le temps pour sauver son fils du Terminator joué par Robert Patrick, est plus fiable que tous les autres hommes avec qui elle a couché. Il est fort, plein de ressources et loyal : « De tous les pères potentiels que j’ai expérimentés, cette chose, cette machine, était le seul qui soit à la hauteur. » À la fin, le Terminator se fait descendre dans une cuve en fusion pour éviter qu’un fouineur vienne étudier sa technologie et rétroconçoive un nouveau Terminator.
Du point de vue de l’évolution, les scénaristes font les choses à l’envers, car ce sont nos émotions qui ont précédé nos pensées et leur ont donné naissance. Cela peut expliquer que la logique et les calculs rigoureux ne soient pas notre fort : 90 % des gens se trompent dans la tâche de sélection de Wason, pourtant élémentaire (8).
Dans son livre incisif La Vie 3.0. Être humain à l’ère de l’intelligence artificielle (9), Max Tegmark, professeur de physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), donne à entendre que le raisonnement n’est pas ce que nous croyons : « Un organisme vivant est un agent de rationalité limitée qui ne poursuit pas un objectif unique mais suit plutôt des règles de base sur ce qu’il convient de rechercher et ce qu’il faut éviter. Le cerveau humain perçoit ces règles de base de l’évolution comme des sensations qui, en général (et souvent sans que nous en ayons conscience), guident notre prise de décision vers le but ultime de la réplication. La sensation de faim ou de soif nous empêche de nous laisser mourir d’inanition ou de déshydratation, la douleur nous avertit d’un danger corporel, le désir nous fait procréer, les sentiments d’amour et d’attendrissement nous amènent à aider les autres porteurs de nos gènes et ceux qui les aident, et ainsi de suite. »
Les rationalistes cherchent depuis longtemps à rendre la raison aussi incontestable que les mathématiques, de sorte, disait Leibniz, que « deux philosophes n’auraient pas davantage besoin de se disputer que deux comptables ». Mais notre processus de prise de décision, comme un assemblage de programmes informatique bidouillés qui cherche les probabilités, est réglé par défaut sur l’intuition et plante à cause des réflexes, de l’effet d’ancrage, de l’aversion aux pertes, du biais de confirmation et de toute une série d’autres schémas mentaux irrationnels (10). Notre cerveau est moins une machine de Turing qu’une bouillie de systèmes bricolés par des siècles de mutations génétiques, des systèmes destinés à percevoir les changements de notre environnement et à réagir, le changement étant par nature dangereux. Quand il est en danger, le lézard à cornes du Texas crache du sang par les yeux ; quand nous sommes en danger, nous pensons.
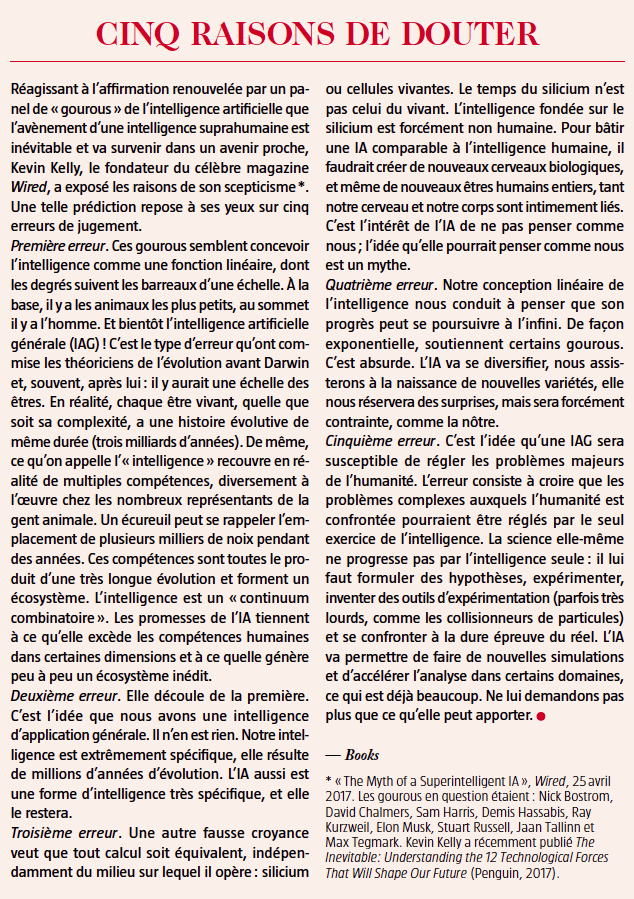 Cette faculté de penser accroît la capacité de nuisance. L’intelligence artificielle, comme l’intelligence naturelle, peut servir aussi bien à faire du mal qu’à faire du bien. Un garçon de 12 ans modérément précoce pourrait transformer l’Internet des objets – voiture, thermostat, babyphone – en Internet des objets maléfiques, comme dans la série Stranger Things. Dans Black Mirror, série qui déroule dans le futur proche, des technologies IA destinées à amplifier de louables désirs humains, comme celui d’une mémoire ou d’une cohésion sociale parfaites, débouchent invariablement sur le conformisme ou le fascisme. Même de modestes innovations, semble nous dire la série, font de la vie une triste expérience panoptique de laboratoire. Dans un épisode, des drones-abeilles autonomes – de petits insectes mécaniques qui pollinisent les fleurs – sont piratés pour éliminer des cibles en exploitant la reconnaissance faciale. Tiré par les cheveux ? Eh bien, l’enseigne de grande distribution Walmart a déposé récemment une demande de brevet pour des « applicateurs de pollen », et des chercheurs de Harvard travaillent depuis 2009 à la mise au point de robots-abeilles. Dans un récent article scientifique consacré à l’usage malveillant de l’intelligence artificielle, des comités de vigilance pronostiquent que, d’ici cinq ans, des systèmes d’arme autonomes piratés et des « essaims de drones » utilisant la reconnaissance faciale pourraient cibler des civils (11).
Les armes autonomes sont déjà engagées dans une trajectoire digne du Dr Folamour. Le système d’arme de combat rapproché Phalanx, qui équipe les bâtiments de la marine de guerre américaine, déclenche automatiquement son canon Gatling à guidage radar sur des missiles approchant à moins de 4 000 mètres, et la portée et la puissance de ces systèmes vont s’accroître à mesure que les armées chercheront à s’armer contre des robots et des engins téléguidés qui attaquent trop vite pour être contrés par des humains.
Aujourd’hui même, la reconnaissance faciale est à la base du programme chinois « Yeux perçants », qui collecte des images de vidéosurveillance dans 55 villes et sera probablement incorporé au « système de crédit social » que viennent de lancer les autorités. Ce système, qui doit être mis en place en 2020, attribuera à chaque citoyen chinois une note fondée sur son comportement, y compris quand il s’agit de traverser la rue.
Les régimes autocratiques peuvent aisément exploiter la façon dont les IA commencent à brouiller notre sens de la réalité. Entraînée sur un corpus de milliers de photos, l’IA de visualisation développée par l’entreprise Nvidia génère des images très réalistes de bus, de vélos, de chevaux et même de célébrités. Quand Google a rendu accessible le code source de son outil d’apprentissage automatique TensorFlow, en 2015, cela a donné très rapidement FakeApp, une application qui permet de remplacer le visage d’une personne par celui d’une autre sur une image animée, avec des résultats très convaincants – le plus souvent sur des corps en pleins ébats sexuels. Les IA peuvent aussi créer des vidéos entièrement bidon synchronisées avec une vraie bande-son (et il est encore plus facile de fabriquer un faux enregistrement audio). Ces outils sont en mesure de modifier si profondément la réalité qu’ils risquent de mettre à mal notre conviction bien ancrée qu’« on ne croit que ce qu’on voit » et de hâter l’avènement d’un État complètement paranoïaque, d’un régime de surveillance permanente.
Vladimir Poutine, qui a fait obstacle aux tentatives de l’ONU pour encadrer l’usage des armes autonomes, assurait en 2017 devant des écoliers russes : « L’intelligence artificielle est l’avenir », et « celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde ». Dans son livre « La machine consciente » (12), Amir Husain, fondateur d’une entreprise de sécurité informatique, écrit : « Un dirigeant psychopathe en possession d’une IA faible perfectionnée représente un danger bien plus élevé à court terme » qu’une IA forte dévoyée. En général, ceux qui redoutent un « mésusage accidentel » de l’IA, où la machine fait quelque chose que nous n’avions pas prévu, appellent à réglementer les machines, et ceux qui redoutent un « mésusage intentionnel » par des hackers ou des tyrans appellent à réglementer les conditions d’usage des machines. Husain, lui, soutient que la seule façon de prévenir le mésusage intentionnel est de développer une IA de guerre : « En réalité, nous n’avons pas le choix : il faut combattre l’IA avec l’IA. » S’il en est ainsi, l’IA nous oblige d’ores et déjà à développer une IA plus forte.
Dans les films ou séries où l’IAG devient incontrôlable, le méchant n’est d’habitude ni un humain ni une machine mais une entreprise : Tyrell ou Cyberdyne ou Omni Consumer Products. Dans le monde réel, une IAG incontrôlable risque moins d’être le fait de la Russie ou de la Chine (même si Pékin investit énormément dans ce domaine) que de Google ou de son pendant chinois, Baidu. Les grandes entreprises rétribuent grassement leurs développeurs et ne sont pas contraintes par le cadre constitutionnel, qui peut faire hésiter un État à appuyer sur le gros bouton rouge « Déshumanisation immédiate ». Parce qu’il sera beaucoup plus facile et moins onéreux de développer la première IAG que de développer la première IAG sûre, la victoire ira vraisemblablement à l’entreprise qui parviendra à constituer l’équipe la plus dénuée de scrupules. Demis Hassabis, qui dirige l’entreprise Google DeepMind, a conçu un jeu vidéo intitulé Evil Genius dans lequel le joueur incarne un « génie du mal » qui kidnappe des scientifiques et les entraîne à fabriquer une machine apocalyptique afin de dominer le monde. Tiens donc !
Les IAG doivent-elles devenir des méchants de James Bond ? « Quand nous imaginons une IA agressive, nous projetons notre propre psychologie sur l’intelligence artificielle ou extraterrestre », écrit Hector Levesque. De fait, nous projetons toute notre architecture mentale. Le réseau de neurones profond, avancée qui a permis beaucoup des progrès récents de l’IA, est calqué sur notre système nerveux. Au printemps 2018, l’Union européenne, tentant de se frayer un chemin parmi les « arbres décisionnels » qui peuplent les « forêts aléatoires » du royaume de l’apprentissage automatique, a fait savoir qu’elle exigerait désormais que les décisions prises par une machine soient explicables. Le mode de décision des IA pratiquant l’apprentissage profond est une « boîte noire » ; quand un algorithme décide qui recruter ou à qui accorder la liberté conditionnelle, il n’est pas en mesure de nous exposer son raisonnement. Encadrer la chose est aussi sensé qu’européen, mais personne n’a jamais proposé rien de semblable pour les humains, dont la prise de décision est autrement opaque.
En attendant, l’initiative européenne Human Brain Project, dotée d’un budget de 1,2 milliard d’euros, tente de simuler les 86 milliards de neurones et le million de milliards de synapses du cerveau dans l’espoir de faire apparaître de « nouvelles structures et comportements ». Certains pensent que l’« émulation du cerveau entier », une intelligence puisée dans notre caboche spongieuse, serait moins menaçante qu’une IAG à base de 0 et de 1. Mais, comme le faisait observer Stephen Hawking quand il nous mettait en garde contre la quête d’extraterrestres, « nous n’avons qu’à nous regarder pour voir qu’une forme de vie intelligente peut se transformer en quelque chose que nous n’aurions pas envie de croiser sur notre route ».
Dans un épisode classique de la série Star Trek d’origine, le vaisseau Enterprise passe sous le contrôle du superordinateur de bord M-5. Le capitaine Kirk, qui a un mauvais pressentiment, s’y refuse avant même que M-5 surréagisse durant un entraînement et attaque les vaisseaux « ennemis ». La paranoïa de l’ordinateur découle de celle de son programmeur, qui lui a imprimé ses propres « engrammes humains » (une sorte d’émulation de cerveau, peut-on supposer) pour lui permettre de penser. Tandis que les autres vaisseaux se préparent à détruire l’Entreprise, Kirk parvient à obtenir de M-5 qu’il comprenne qu’en se protégeant il est devenu un meurtrier. M-5 s’empresse de se suicider, démontrant la valeur de l’intuition humaine, et que la machine n’était pas si intelligente que cela.
Dépourvue d’intuition humaine, une IAG peut nous nuire en cherchant à nous rendre service. Si nous demandons à une IAG de nous « rendre heureux », elle peut se contenter de nous ficher dans le cerveau des électrodes déclenchant l’orgasme et de retourner vaquer à ses occupations. Le risque d’« objectifs mal ciblés » – un ordinateur interprétant son programme au pied de la lettre – pèse sur toute l’entreprise IAG. On utilise à présent l’apprentissage par renforcement pour entraîner des ordinateurs à jouer à des jeux sans même leur en apprendre les règles (13). Mais une IAG entraînée de la sorte pourrait considérer l’existence elle-même comme un jeu, une version boguée des Sims ou de Second Life. Dans le film de 1983 War Games, l’un des premiers et meilleurs traitements du sujet, le superordinateur de l’armée américaine, WOPR, livre la Troisième Guerre mondiale « comme s’il s’agissait d’un jeu, encore et encore », cherchant sans cesse à améliorer son score.
Quand on donne des objectifs à une machine, on lui donne aussi une raison de se préserver : comment, autrement, peut-elle faire ce que vous voulez ? Quel que soit l’objectif qu’ait une IAG, qu’il soit fixé par nous ou par elle – se préserver, accroître ses facultés intellectuelles, acquérir de nouvelles ressources –, elle peut avoir besoin de prendre les commandes pour y parvenir. Dans 2001, HAL, l’ordinateur du vaisseau spatial, décide qu’il lui faut tuer tous les humains à bord parce que « cette mission a trop d’importance pour moi pour que je vous laisse la mettre en péril ». Dans I, Robot, VIKI explique que les robots doivent prendre les choses en main car « malgré tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous intoxiquez la Terre et redoublez d’imagination pour vous autodétruire ». Dans l’exemple désormais célèbre du philosophe Nick Bostrom, une IAG cherchant à produire le maximum de trombones consommerait toute la matière de la Galaxie pour faire des trombones et éliminerait tout ce qui viendrait interférer avec cette tâche, y compris nous. Matrix offre une version élaborée de ce scénario : les machines ont bâti un monde de rêve afin que nous nous tenions tranquilles ; elles nous nourrissent avec les restes liquéfiés des morts et nous cultivent pour obtenir l’énergie dont elles ont besoin pour faire tourner leurs programmes. L’agent Smith, le visage humanisé des IA, explique : « À partir du moment où nous nous sommes mis à penser à votre place, c’est vraiment devenu notre civilisation. »
Le vrai risque d’une IAG, dès lors, émanerait non pas de la malveillance ou d’une conscience de soi naissante mais simplement de l’autonomie. Qui dit intelligence dit aussi domination, et une IAG sera le cogitateur suprême. De ce point de vue, une IAG, si bien intentionnée soit-elle, pourrait se comporter de façon aussi destructrice qu’un méchant de James Bond. « Avant que ne survienne une explosion d’intelligence, nous autres humains sommes comme des petits enfants qui jouent avec une bombe », écrit Bostrom dans Superintelligence (14), une analyse très argumentée, terrifiante par ses effets cumulatifs, de toutes les façons dont nous sommes mal préparés à fabriquer nos maîtres. Une IAG récursive, capable de se perfectionner elle-même, ne sera pas aussi brillante qu’Einstein mais intelligente « au sens où l’individu moyen l’est par rapport à un scarabée ou à un ver ». La façon dont les machines prendront le pouvoir n’est qu’un détail : Bostrom suggère que, « au moment prévu, les fabrications de nanotechnologies produisant des gaz neurotoxiques ou des robots-moustiques chercheurs de cibles pourraient éclore partout sur la Terre ». Cela ressemble à un scénario clés en main mais, toujours rabat-joie, il écrit : « En particulier, l’IA n’adopte pas un plan stupide dont même un être humain d’aujourd’hui serait capable de prédire l’échec. Et c’est précisément pourquoi tous ces scénarios de science-fiction qui donnent finalement la victoire aux humains ne sont pas crédibles. »
À défaut de pouvoir maîtriser une IAG, pouvons-nous au moins la lester de bonnes valeurs et nous assurer qu’elle les conserve une fois qu’elle commence à se modifier elle-même ? Max Tegmark fait observer qu’une IAG consciente pourrait trouver l’objectif de la protection de valeurs humaines « quelconque ou peu judicieux comme l’est à nos yeux la reproduction compulsive ». Il expose douze « scénarios des conséquences de l’IA », parmi lesquels « Utopie libertarienne », « Gardiens de zoo », « 1984 », « Autodestruction ». Même les issues théoriquement préférables semblent pires que le statu quo. Dans le scénario du dictateur bienveillant, l’IAG « s’appuie sur une définition vraiment complexe et subtile de l’épanouissement humain et a transformé la Terre en une sorte de zoo très élaboré où il fait vraiment bon vivre pour un humain. D’ailleurs, la plupart des gens se satisfont pleinement d’une vie qu’ils trouvent riche ». Et qui ressemble peu ou prou à un jeu vidéo immersif ou une simulation.
En cherchant à rester optimiste (du moins de son point de vue de physicien), Tegmark souligne qu’une IAG serait à même d’explorer et de comprendre l’Univers à un niveau inimaginable. Il nous incite à nous considérer comme des paquets d’informations que des IA pourraient diffuser vers d’autres galaxies à des fins de colonisation. « Cela pourrait se faire avec des techniques relativement simples en transmettant simplement les deux gigaoctets d’informations nécessaires pour décrire l’ADN d’une personne, puis mettre en couveuse le bébé que l’IA se chargera d’élever. Ou bien l’IA pourrait nano-assembler quarks et électrons pour former des personnes adultes dont toute la mémoire aurait été scannée à partir des originaux restés sur Terre. » Fastoche. Tegmark remarque que ce scénario de colonisation devrait nous rendre extrêmement méfiants à l’égard de toute information en provenance d’extraterrestres. Mais, dans ce cas, pourquoi suggérer un tel projet de colonisation ?
L’IAG pourrait être une impasse évolutive qui expliquerait le paradoxe de Fermi : alors que les conditions d’une vie intelligente existent probablement sur des milliards de planètes rien que dans notre galaxie, nous n’en voyons pas trace. Tegmark conclut : « Il apparaît que nous sommes un accident de l’histoire et que nous ne sommes pas la solution optimale à tout problème physique bien défini. Cela laisse entendre qu’une IA disposant d’un objectif défini avec rigueur sera capable d’avancer vers son objectif en nous éliminant. » Par conséquent, « pour programmer une IA amicale, nous devons saisir le sens de la vie ». Ah oui, alors !
En attendant, il nous faut un plan B. Bostrom propose de commencer par ralentir la course à l’IAG afin de se donner du temps pour prendre des mesures de précaution. De façon assez stupéfiante, il suggère toutefois que, une fois venue l’ère de l’IAG, nous ayons la plus grande déférence à son égard. Il nous faudra non seulement écouter ce que la machine aura à nous dire, mais lui demander de comprendre ce que nous voulons. Le problème du non-alignement des buts de l’IA avec les nôtres semble rendre une telle stratégie extrêmement risquée, mais Bostrom pense qu’il vaut mieux essayer de négocier les conditions de notre reddition plutôt que de nous fier à nous-mêmes, « stupides, ignorants et étroits d’esprit comme nous le sommes ». Tegmark pense lui aussi que nous devons avancer petit à petit vers une IAG. C’est la seule manière de donner du sens dans l’Univers qui nous a donné la vie : « Sans technologie, notre extinction est imminente dans le contexte cosmique des dix prochains milliards d’années. Tout entier, le spectacle de la vie dans notre Univers n’aura été qu’un bref éclair […] de beauté. » Nous sommes le prélude analogique à l’événement numérique majeur.
L’idée serait donc qu’après avoir créé notre dieu nous nous inclinions devant lui, en espérant qu’il n’exigera pas que nous versions notre sang en sacrifice. Anthony Levandowski, ingénieur spécialisé dans les voitures autonomes, a créé dans la Silicon Valley une religion nommée La Voie du futur, qui propose exactement cela. Après la Transition, les fidèles viendront vénérer « une divinité fondée sur l’intelligence artificielle ». Comme le disait Levandowski à un journaliste du magazine Wired, vénérer l’intelligence qui va nous dominer est notre seule voie de salut ; il nous reste à faire fonctionner nos méninges pour trouver la façon dont nous voudrons être traités. « Voulez-vous être un animal de compagnie ou du bétail ? » demande-t-il. Euh, je vais réfléchir.
— Cet article est paru dans The New Yorker le 14 mai 2018. Il a été traduit par Olivier Postel-Vinay.
[post_title] => Intelligence artificielle : « Nous avons convoqué le diable »
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => nous-avons-convoque-diable
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2022-09-26 14:42:17
[post_modified_gmt] => 2022-09-26 14:42:17
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56279
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
Cette faculté de penser accroît la capacité de nuisance. L’intelligence artificielle, comme l’intelligence naturelle, peut servir aussi bien à faire du mal qu’à faire du bien. Un garçon de 12 ans modérément précoce pourrait transformer l’Internet des objets – voiture, thermostat, babyphone – en Internet des objets maléfiques, comme dans la série Stranger Things. Dans Black Mirror, série qui déroule dans le futur proche, des technologies IA destinées à amplifier de louables désirs humains, comme celui d’une mémoire ou d’une cohésion sociale parfaites, débouchent invariablement sur le conformisme ou le fascisme. Même de modestes innovations, semble nous dire la série, font de la vie une triste expérience panoptique de laboratoire. Dans un épisode, des drones-abeilles autonomes – de petits insectes mécaniques qui pollinisent les fleurs – sont piratés pour éliminer des cibles en exploitant la reconnaissance faciale. Tiré par les cheveux ? Eh bien, l’enseigne de grande distribution Walmart a déposé récemment une demande de brevet pour des « applicateurs de pollen », et des chercheurs de Harvard travaillent depuis 2009 à la mise au point de robots-abeilles. Dans un récent article scientifique consacré à l’usage malveillant de l’intelligence artificielle, des comités de vigilance pronostiquent que, d’ici cinq ans, des systèmes d’arme autonomes piratés et des « essaims de drones » utilisant la reconnaissance faciale pourraient cibler des civils (11).
Les armes autonomes sont déjà engagées dans une trajectoire digne du Dr Folamour. Le système d’arme de combat rapproché Phalanx, qui équipe les bâtiments de la marine de guerre américaine, déclenche automatiquement son canon Gatling à guidage radar sur des missiles approchant à moins de 4 000 mètres, et la portée et la puissance de ces systèmes vont s’accroître à mesure que les armées chercheront à s’armer contre des robots et des engins téléguidés qui attaquent trop vite pour être contrés par des humains.
Aujourd’hui même, la reconnaissance faciale est à la base du programme chinois « Yeux perçants », qui collecte des images de vidéosurveillance dans 55 villes et sera probablement incorporé au « système de crédit social » que viennent de lancer les autorités. Ce système, qui doit être mis en place en 2020, attribuera à chaque citoyen chinois une note fondée sur son comportement, y compris quand il s’agit de traverser la rue.
Les régimes autocratiques peuvent aisément exploiter la façon dont les IA commencent à brouiller notre sens de la réalité. Entraînée sur un corpus de milliers de photos, l’IA de visualisation développée par l’entreprise Nvidia génère des images très réalistes de bus, de vélos, de chevaux et même de célébrités. Quand Google a rendu accessible le code source de son outil d’apprentissage automatique TensorFlow, en 2015, cela a donné très rapidement FakeApp, une application qui permet de remplacer le visage d’une personne par celui d’une autre sur une image animée, avec des résultats très convaincants – le plus souvent sur des corps en pleins ébats sexuels. Les IA peuvent aussi créer des vidéos entièrement bidon synchronisées avec une vraie bande-son (et il est encore plus facile de fabriquer un faux enregistrement audio). Ces outils sont en mesure de modifier si profondément la réalité qu’ils risquent de mettre à mal notre conviction bien ancrée qu’« on ne croit que ce qu’on voit » et de hâter l’avènement d’un État complètement paranoïaque, d’un régime de surveillance permanente.
Vladimir Poutine, qui a fait obstacle aux tentatives de l’ONU pour encadrer l’usage des armes autonomes, assurait en 2017 devant des écoliers russes : « L’intelligence artificielle est l’avenir », et « celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde ». Dans son livre « La machine consciente » (12), Amir Husain, fondateur d’une entreprise de sécurité informatique, écrit : « Un dirigeant psychopathe en possession d’une IA faible perfectionnée représente un danger bien plus élevé à court terme » qu’une IA forte dévoyée. En général, ceux qui redoutent un « mésusage accidentel » de l’IA, où la machine fait quelque chose que nous n’avions pas prévu, appellent à réglementer les machines, et ceux qui redoutent un « mésusage intentionnel » par des hackers ou des tyrans appellent à réglementer les conditions d’usage des machines. Husain, lui, soutient que la seule façon de prévenir le mésusage intentionnel est de développer une IA de guerre : « En réalité, nous n’avons pas le choix : il faut combattre l’IA avec l’IA. » S’il en est ainsi, l’IA nous oblige d’ores et déjà à développer une IA plus forte.
Dans les films ou séries où l’IAG devient incontrôlable, le méchant n’est d’habitude ni un humain ni une machine mais une entreprise : Tyrell ou Cyberdyne ou Omni Consumer Products. Dans le monde réel, une IAG incontrôlable risque moins d’être le fait de la Russie ou de la Chine (même si Pékin investit énormément dans ce domaine) que de Google ou de son pendant chinois, Baidu. Les grandes entreprises rétribuent grassement leurs développeurs et ne sont pas contraintes par le cadre constitutionnel, qui peut faire hésiter un État à appuyer sur le gros bouton rouge « Déshumanisation immédiate ». Parce qu’il sera beaucoup plus facile et moins onéreux de développer la première IAG que de développer la première IAG sûre, la victoire ira vraisemblablement à l’entreprise qui parviendra à constituer l’équipe la plus dénuée de scrupules. Demis Hassabis, qui dirige l’entreprise Google DeepMind, a conçu un jeu vidéo intitulé Evil Genius dans lequel le joueur incarne un « génie du mal » qui kidnappe des scientifiques et les entraîne à fabriquer une machine apocalyptique afin de dominer le monde. Tiens donc !
Les IAG doivent-elles devenir des méchants de James Bond ? « Quand nous imaginons une IA agressive, nous projetons notre propre psychologie sur l’intelligence artificielle ou extraterrestre », écrit Hector Levesque. De fait, nous projetons toute notre architecture mentale. Le réseau de neurones profond, avancée qui a permis beaucoup des progrès récents de l’IA, est calqué sur notre système nerveux. Au printemps 2018, l’Union européenne, tentant de se frayer un chemin parmi les « arbres décisionnels » qui peuplent les « forêts aléatoires » du royaume de l’apprentissage automatique, a fait savoir qu’elle exigerait désormais que les décisions prises par une machine soient explicables. Le mode de décision des IA pratiquant l’apprentissage profond est une « boîte noire » ; quand un algorithme décide qui recruter ou à qui accorder la liberté conditionnelle, il n’est pas en mesure de nous exposer son raisonnement. Encadrer la chose est aussi sensé qu’européen, mais personne n’a jamais proposé rien de semblable pour les humains, dont la prise de décision est autrement opaque.
En attendant, l’initiative européenne Human Brain Project, dotée d’un budget de 1,2 milliard d’euros, tente de simuler les 86 milliards de neurones et le million de milliards de synapses du cerveau dans l’espoir de faire apparaître de « nouvelles structures et comportements ». Certains pensent que l’« émulation du cerveau entier », une intelligence puisée dans notre caboche spongieuse, serait moins menaçante qu’une IAG à base de 0 et de 1. Mais, comme le faisait observer Stephen Hawking quand il nous mettait en garde contre la quête d’extraterrestres, « nous n’avons qu’à nous regarder pour voir qu’une forme de vie intelligente peut se transformer en quelque chose que nous n’aurions pas envie de croiser sur notre route ».
Dans un épisode classique de la série Star Trek d’origine, le vaisseau Enterprise passe sous le contrôle du superordinateur de bord M-5. Le capitaine Kirk, qui a un mauvais pressentiment, s’y refuse avant même que M-5 surréagisse durant un entraînement et attaque les vaisseaux « ennemis ». La paranoïa de l’ordinateur découle de celle de son programmeur, qui lui a imprimé ses propres « engrammes humains » (une sorte d’émulation de cerveau, peut-on supposer) pour lui permettre de penser. Tandis que les autres vaisseaux se préparent à détruire l’Entreprise, Kirk parvient à obtenir de M-5 qu’il comprenne qu’en se protégeant il est devenu un meurtrier. M-5 s’empresse de se suicider, démontrant la valeur de l’intuition humaine, et que la machine n’était pas si intelligente que cela.
Dépourvue d’intuition humaine, une IAG peut nous nuire en cherchant à nous rendre service. Si nous demandons à une IAG de nous « rendre heureux », elle peut se contenter de nous ficher dans le cerveau des électrodes déclenchant l’orgasme et de retourner vaquer à ses occupations. Le risque d’« objectifs mal ciblés » – un ordinateur interprétant son programme au pied de la lettre – pèse sur toute l’entreprise IAG. On utilise à présent l’apprentissage par renforcement pour entraîner des ordinateurs à jouer à des jeux sans même leur en apprendre les règles (13). Mais une IAG entraînée de la sorte pourrait considérer l’existence elle-même comme un jeu, une version boguée des Sims ou de Second Life. Dans le film de 1983 War Games, l’un des premiers et meilleurs traitements du sujet, le superordinateur de l’armée américaine, WOPR, livre la Troisième Guerre mondiale « comme s’il s’agissait d’un jeu, encore et encore », cherchant sans cesse à améliorer son score.
Quand on donne des objectifs à une machine, on lui donne aussi une raison de se préserver : comment, autrement, peut-elle faire ce que vous voulez ? Quel que soit l’objectif qu’ait une IAG, qu’il soit fixé par nous ou par elle – se préserver, accroître ses facultés intellectuelles, acquérir de nouvelles ressources –, elle peut avoir besoin de prendre les commandes pour y parvenir. Dans 2001, HAL, l’ordinateur du vaisseau spatial, décide qu’il lui faut tuer tous les humains à bord parce que « cette mission a trop d’importance pour moi pour que je vous laisse la mettre en péril ». Dans I, Robot, VIKI explique que les robots doivent prendre les choses en main car « malgré tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous intoxiquez la Terre et redoublez d’imagination pour vous autodétruire ». Dans l’exemple désormais célèbre du philosophe Nick Bostrom, une IAG cherchant à produire le maximum de trombones consommerait toute la matière de la Galaxie pour faire des trombones et éliminerait tout ce qui viendrait interférer avec cette tâche, y compris nous. Matrix offre une version élaborée de ce scénario : les machines ont bâti un monde de rêve afin que nous nous tenions tranquilles ; elles nous nourrissent avec les restes liquéfiés des morts et nous cultivent pour obtenir l’énergie dont elles ont besoin pour faire tourner leurs programmes. L’agent Smith, le visage humanisé des IA, explique : « À partir du moment où nous nous sommes mis à penser à votre place, c’est vraiment devenu notre civilisation. »
Le vrai risque d’une IAG, dès lors, émanerait non pas de la malveillance ou d’une conscience de soi naissante mais simplement de l’autonomie. Qui dit intelligence dit aussi domination, et une IAG sera le cogitateur suprême. De ce point de vue, une IAG, si bien intentionnée soit-elle, pourrait se comporter de façon aussi destructrice qu’un méchant de James Bond. « Avant que ne survienne une explosion d’intelligence, nous autres humains sommes comme des petits enfants qui jouent avec une bombe », écrit Bostrom dans Superintelligence (14), une analyse très argumentée, terrifiante par ses effets cumulatifs, de toutes les façons dont nous sommes mal préparés à fabriquer nos maîtres. Une IAG récursive, capable de se perfectionner elle-même, ne sera pas aussi brillante qu’Einstein mais intelligente « au sens où l’individu moyen l’est par rapport à un scarabée ou à un ver ». La façon dont les machines prendront le pouvoir n’est qu’un détail : Bostrom suggère que, « au moment prévu, les fabrications de nanotechnologies produisant des gaz neurotoxiques ou des robots-moustiques chercheurs de cibles pourraient éclore partout sur la Terre ». Cela ressemble à un scénario clés en main mais, toujours rabat-joie, il écrit : « En particulier, l’IA n’adopte pas un plan stupide dont même un être humain d’aujourd’hui serait capable de prédire l’échec. Et c’est précisément pourquoi tous ces scénarios de science-fiction qui donnent finalement la victoire aux humains ne sont pas crédibles. »
À défaut de pouvoir maîtriser une IAG, pouvons-nous au moins la lester de bonnes valeurs et nous assurer qu’elle les conserve une fois qu’elle commence à se modifier elle-même ? Max Tegmark fait observer qu’une IAG consciente pourrait trouver l’objectif de la protection de valeurs humaines « quelconque ou peu judicieux comme l’est à nos yeux la reproduction compulsive ». Il expose douze « scénarios des conséquences de l’IA », parmi lesquels « Utopie libertarienne », « Gardiens de zoo », « 1984 », « Autodestruction ». Même les issues théoriquement préférables semblent pires que le statu quo. Dans le scénario du dictateur bienveillant, l’IAG « s’appuie sur une définition vraiment complexe et subtile de l’épanouissement humain et a transformé la Terre en une sorte de zoo très élaboré où il fait vraiment bon vivre pour un humain. D’ailleurs, la plupart des gens se satisfont pleinement d’une vie qu’ils trouvent riche ». Et qui ressemble peu ou prou à un jeu vidéo immersif ou une simulation.
En cherchant à rester optimiste (du moins de son point de vue de physicien), Tegmark souligne qu’une IAG serait à même d’explorer et de comprendre l’Univers à un niveau inimaginable. Il nous incite à nous considérer comme des paquets d’informations que des IA pourraient diffuser vers d’autres galaxies à des fins de colonisation. « Cela pourrait se faire avec des techniques relativement simples en transmettant simplement les deux gigaoctets d’informations nécessaires pour décrire l’ADN d’une personne, puis mettre en couveuse le bébé que l’IA se chargera d’élever. Ou bien l’IA pourrait nano-assembler quarks et électrons pour former des personnes adultes dont toute la mémoire aurait été scannée à partir des originaux restés sur Terre. » Fastoche. Tegmark remarque que ce scénario de colonisation devrait nous rendre extrêmement méfiants à l’égard de toute information en provenance d’extraterrestres. Mais, dans ce cas, pourquoi suggérer un tel projet de colonisation ?
L’IAG pourrait être une impasse évolutive qui expliquerait le paradoxe de Fermi : alors que les conditions d’une vie intelligente existent probablement sur des milliards de planètes rien que dans notre galaxie, nous n’en voyons pas trace. Tegmark conclut : « Il apparaît que nous sommes un accident de l’histoire et que nous ne sommes pas la solution optimale à tout problème physique bien défini. Cela laisse entendre qu’une IA disposant d’un objectif défini avec rigueur sera capable d’avancer vers son objectif en nous éliminant. » Par conséquent, « pour programmer une IA amicale, nous devons saisir le sens de la vie ». Ah oui, alors !
En attendant, il nous faut un plan B. Bostrom propose de commencer par ralentir la course à l’IAG afin de se donner du temps pour prendre des mesures de précaution. De façon assez stupéfiante, il suggère toutefois que, une fois venue l’ère de l’IAG, nous ayons la plus grande déférence à son égard. Il nous faudra non seulement écouter ce que la machine aura à nous dire, mais lui demander de comprendre ce que nous voulons. Le problème du non-alignement des buts de l’IA avec les nôtres semble rendre une telle stratégie extrêmement risquée, mais Bostrom pense qu’il vaut mieux essayer de négocier les conditions de notre reddition plutôt que de nous fier à nous-mêmes, « stupides, ignorants et étroits d’esprit comme nous le sommes ». Tegmark pense lui aussi que nous devons avancer petit à petit vers une IAG. C’est la seule manière de donner du sens dans l’Univers qui nous a donné la vie : « Sans technologie, notre extinction est imminente dans le contexte cosmique des dix prochains milliards d’années. Tout entier, le spectacle de la vie dans notre Univers n’aura été qu’un bref éclair […] de beauté. » Nous sommes le prélude analogique à l’événement numérique majeur.
L’idée serait donc qu’après avoir créé notre dieu nous nous inclinions devant lui, en espérant qu’il n’exigera pas que nous versions notre sang en sacrifice. Anthony Levandowski, ingénieur spécialisé dans les voitures autonomes, a créé dans la Silicon Valley une religion nommée La Voie du futur, qui propose exactement cela. Après la Transition, les fidèles viendront vénérer « une divinité fondée sur l’intelligence artificielle ». Comme le disait Levandowski à un journaliste du magazine Wired, vénérer l’intelligence qui va nous dominer est notre seule voie de salut ; il nous reste à faire fonctionner nos méninges pour trouver la façon dont nous voudrons être traités. « Voulez-vous être un animal de compagnie ou du bétail ? » demande-t-il. Euh, je vais réfléchir.
— Cet article est paru dans The New Yorker le 14 mai 2018. Il a été traduit par Olivier Postel-Vinay.
[post_title] => Intelligence artificielle : « Nous avons convoqué le diable »
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => nous-avons-convoque-diable
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2022-09-26 14:42:17
[post_modified_gmt] => 2022-09-26 14:42:17
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56279
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 56299
[post_author] => 8
[post_date] => 2019-01-17 07:00:31
[post_date_gmt] => 2019-01-17 07:00:31
[post_content] => Les échecs sont un jeu de rois, mais aussi de génies. Depuis des centaines d’années, ils servent de référence – et de symbole du summum de l’intelligence humaine. Contemplant les pièces, perdu dans ses pensées, le maître d’échecs apparaît comme un pur esprit, un cerveau sans corps. Pas étonnant dès lors que les informaticiens aient fait de l’échiquier leur premier terrain d’expérimentation lorsqu’ils commencèrent à envisager la création d’une intelligence artificielle au milieu du siècle dernier. Construire une machine capable de battre un joueur humain expert revenait à fabriquer un esprit. C’était une thèse fascinante, et l’idée que nous nous faisons de l’intelligence artificielle en est encore aujourd’hui imprégnée, mais, comme le fait valoir l’ancien champion du monde d’échecs Garry Kasparov dans son éclairant nouveau livre autobiographique Deep Thinking, elle était erronée d’entrée de jeu. Elle révélait une mauvaise compréhension des échecs, des ordinateurs et de l’intelligence.
À l’aube de l’ère informatique, en 1950, Claude Shannon, influent ingénieur des laboratoires Bell, publie dans Philosophical Magazine un article intitulé « Programming a Computer for Playing Chess » (« Programmation d’un ordinateur pour jouer aux échecs »). Non seulement la création d’un joueur d’échecs informatisé « raisonnablement performant » est possible, affirme-t-il, mais elle aura des conséquences métaphysiques. Elle contraindra l’espèce humaine « soit à admettre la possibilité d’une pensée mécanisée, soit à restreindre sa définition de “l’acte de penser” ». Il avance ensuite une idée qui va se révéler essentielle à la fois pour le développement des logiciels d’échecs et pour les travaux sur l’intelligence artificielle en général. Un programme d’échecs, écrit-il, doit comporter une fonction de recherche susceptible de recenser les coups possibles et de les classer en fonction de leur influence sur le cours ultérieur de la partie. Il présente deux stratégies très différentes pour programmer la fonction. La stratégie de type A repose sur la force brute, en analysant la valeur relative de tous les coups le plus loin possible dans la suite du jeu, dans la limite de ce qu’autorise la vitesse de l’ordinateur. La stratégie de type B utilise l’intelligence plutôt que la force brute, en conférant à l’ordinateur une compréhension du jeu qui lui permet de se concentrer sur un petit nombre de coups pertinents, en négligeant les autres. En substance, un ordinateur de type B est doté de l’intuition d’un joueur humain expérimenté.
Quand Shannon écrit son article, tout le monde, à commencer par lui, pense que la méthode de type A est une impasse. Il paraît évident que, en raison des limites de temps imposées lors des compétitions d’échecs, un ordinateur ne sera jamais assez rapide pour étendre son analyse au-delà de quelques coups d’avance. Comme le fait remarquer Kasparov, il y a plus de « 300 milliards de façons possibles de jouer les quatre premiers coups dans une partie d’échecs, et, même si 95 % de ces variations sont sans intérêt, un programme de type A devait toutes les passer en revue ». En 1950, et de nombreuses années après, personne ne peut imaginer qu’un ordinateur exécutant une stratégie fondée sur la force brute puisse l’emporter sur un bon joueur. Malheureusement, conclut Shannon, « une machine travaillant avec la stratégie de type A serait à la fois lente et mauvaise joueuse ».
La stratégie de type B, fondée sur l’intelligence, semblait beaucoup plus praticable, ne serait-ce que parce qu’elle cadrait avec les conceptions scientifiques de l’époque. La fascination pour les ordinateurs numériques s’accrut dans les années 1950, et les « machines pensantes » commencèrent à inspirer des théories sur l’intelligence humaine. De nombreux chercheurs et philosophes en vinrent à considérer que le cerveau humain devait fonctionner un peu comme un ordinateur, utilisant ses milliers de neurones en réseau pour « calculer » pensées et sensations. Selon un curieux type de logique circulaire, cette analogie guida en retour les premières recherches sur l’intelligence artificielle : si l’on pouvait trouver les codes qu’utilise le cerveau pour accomplir ses tâches cognitives, on serait capable de programmer des codes similaires dans un ordinateur. Non seulement la machine jouerait aux échecs comme un champion, mais elle serait aussi capable d’accomplir presque tout ce qu’un cerveau humain peut accomplir. Dans un article de 1958, les éminents chercheurs Herbert Simon et Allen Newell affirment que les ordinateurs sont des « machines qui pensent » et que, dans un proche avenir, « l’éventail de problèmes qu’ils sont en mesure de traiter coïncidera avec celui auquel l’intelligence humaine est appliquée ». Bien programmé, un ordinateur pouvait devenir un être pensant.
Kasparov, l’un des plus grands joueurs d’échecs de l’histoire, s’est fait battre lors d’un tournoi en six parties par le superordinateur Deep Blue d’IBM en 1997. Même si c’était la première fois qu’une machine l’emportait sur un champion du monde dans une compétition officielle, les informaticiens et les champions d’échecs n’ont pas été surpris outre mesure. Les ordinateurs d’échecs n’avaient cessé de progresser au fil des ans, montant inexorablement dans le classement des meilleurs joueurs humains. Kasparov s’est juste trouvé au bon endroit au mauvais moment.
Mais l’histoire de la victoire de l’ordinateur livre un enseignement inattendu. Il est apparu que Shannon et ses contemporains s’étaient trompés. C’est la stratégie de type B, celle de l’intelligence, qui était une voie sans issue. Malgré leur optimisme des débuts, les chercheurs en intelligence artificielle n’ont absolument pas réussi à faire penser les ordinateurs comme les humains. Deep Blue a battu Kasparov non pas en égalant son discernement et son intuition, mais en le submergeant de calculs aveugles. Grâce à des années de progrès exponentiels en matière de puissance de calcul et à l’amélioration constante de la performance des algorithmes de recherche, l’ordinateur a été capable de passer au peigne fin un nombre suffisant de coups possibles en un laps de temps assez court pour vaincre le champion. La force brute a triomphé. « Il s’est avéré que construire un superordinateur d’échecs n’était pas la même chose que construire une machine pensante à la hauteur de l’intelligence humaine, estime Kasparov. Deep Blue était intelligent de la même manière que votre réveil programmable est intelligent. »
L’histoire des machines joueuses d’échecs se confond avec l’histoire de l’intelligence artificielle. Après les déconvenues rencontrées en essayant de rétroconcevoir le cerveau, les informaticiens ont révisé leurs ambitions à la baisse. Renonçant à mettre au point une intelligence de type humain, ils se sont concentrés sur la réalisation de tâches analytiques complexes mais limitées, en tablant sur la puissance de calcul inhumaine des ordinateurs modernes. Cette approche moins ambitieuse mais plus pragmatique a payé dans des domaines allant du diagnostic médical à la voiture autonome. Les ordinateurs reproduisent les résultats de la pensée humaine sans reproduire la pensée elle-même. Si, dans les années 1950 et 1960, l’accent, dans l’expression « intelligence artificielle » était mis sur le mot « intelligence », il l’est aujourd’hui sur le terme « artificielle ».
La mise en œuvre d’algorithmes de recherche semblables à ceux qui faisaient fonctionner Deep Blue a été particulièrement fructueuse. Si une machine peut rechercher des milliards de possibilités en l’espace de quelques millisecondes, en les classant selon leur pertinence pour atteindre un objectif prédéterminé, alors elle peut surclasser les experts humains dans l’analyse de problèmes, sans avoir à égaler leur expérience ou leur discernement. Récemment, les programmeurs en intelligence artificielle ont ajouté une autre technique fondée sur la force brute à leur répertoire : l’apprentissage automatique, ou apprentissage machine. Pour résumer, il s’agit d’une méthode statistique permettant de déceler dans des événements passés des associations pouvant être utilisées pour prévoir des événements futurs. Plutôt que de donner à un ordinateur un ensemble d’instructions à suivre, un programmeur entre dans l’ordinateur de nombreux exemples d’un phénomène et, à partir de ces exemples, la machine décèle les relations entre les variables. Alors que la plupart des logiciels appliquent des règles aux données, les algorithmes d’apprentissage automatique font l’inverse : ils extraient des règles des données, puis appliquent ces règles pour formuler des jugements sur des situations nouvelles.
Dans les logiciels de traduction actuels, par exemple, un ordinateur balaie des millions de textes traduits pour découvrir des liens entre des expressions dans des langues différentes. À l’aide de ces correspondances, il peut ensuite mettre en regard des traductions de nouvelles chaînes de textes. L’ordinateur n’a pas besoin de comprendre la grammaire ou le sens ; il se contente de régurgiter des mots dans toutes les combinaisons qui, selon ses calculs, ont les plus fortes chances d’être exactes. Le style et les nuances inhérents au travail d’un traducteur expérimenté font défaut au résultat, mais ce dernier n’en est pas moins d’une très grande utilité. Les algorithmes d’apprentissage automatique ne datent pas d’hier, mais il leur faut un nombre considérable d’exemples pour être fiables, ce qui n’est devenu possible qu’avec l’explosion des données en ligne. Kasparov cite un ingénieur du programme Google Traduction : « Quand on passe de 10 000 à 10 milliards d’exemples, tout se met à marcher. Les données priment sur tout le reste. »
Le tournant pragmatique de la recherche en intelligence artificielle a produit de nombreuses percées de ce genre, mais cette évolution met aussi en lumière les limites de l’IA. Grâce à la force brute du traitement des données, les ordinateurs peuvent fournir des réponses à des questions très précises et prédire le déroulement d’événements complexes, mais il leur manque la compréhension, l’imagination et le bon sens pour faire ce que les esprits humains font naturellement : transformer l’information en connaissance, penser de façon conceptuelle et métaphorique, aborder les fluctuations et l’incertitude du monde sans disposer du scénario. Les machines restent des machines.
Cette réalité n’a pas émoussé l’intérêt du public pour l’imaginaire lié à l’intelligence artificielle. À côté de séries télévisées et de films mettant en scène des ordinateurs malintentionnés et des robots sanguinaires, on a vu paraître une flopée d’ouvrages très sérieux intitulés « Superintelligence », « Plus intelligents que nous » et « Notre ultime invention », qui laissent tous entendre que les machines seront bientôt plus douées que nous (1). Ces prédictions font écho à celles qui ont été formulées dans les années 1950 et 1960, et, comme précédemment, elles sont fondées sur des spéculations plutôt que sur des faits. Malgré des avancées gigantesques dans le domaine des matériels et des logiciels informatiques, rien n’indique que les ordinateurs sont en passe de devenir des êtres doués de volonté, d’émotion ou de conscience. Leur force – que Kasparov qualifie d’« objectivité d’un amnésique » – est aussi leur faiblesse.
En plus de remettre en question les idées reçues concernant l’intelligence artificielle, Kasparov bouscule nos préjugés sur les échecs. Le jeu, surtout quand il est pratiqué au plus haut niveau, est beaucoup plus qu’un simple exercice cérébral de logique et de calcul, et le joueur expert est tout sauf une caricature de grosse tête. Le lien entre le don pour les échecs et le type d’intelligence mesurée par les tests de QI, observe Kasparov, est, au mieux, ténu. « Il est aussi faux de dire que tous les joueurs d’échecs sont des génies que de dire que tous les génies jouent aux échecs », écrit-il. « L’une des choses qui font l’intérêt des échecs est qu’on ne sait pas encore précisément ce qui distingue les “bons” joueurs des grands maîtres. »
Les échecs sont un sport éreintant. Ils exigent de l’endurance, de la résilience et une aptitude à la guerre psychologique. Ils requièrent aussi une perception sensorielle aiguë. « La préparation d’un coup fait apparemment intervenir davantage d’activité cérébrale spatiovisuelle que les calculs nécessaires à la résolution d’un problème mathématique », écrit Garry Kasparov, faisant référence à de récentes expériences neurologiques. Pour le maître d’échecs, les 64 cases de l’échiquier constituent non seulement une géométrie abstraite, mais un véritable terrain. Tels des personnages dans un paysage, les pièces forment des motifs que le maître, tirant parti d’années d’expérience, détecte intuitivement, souvent d’un simple coup d’œil. L’analyse méthodique est aussi importante, mais elle est effectuée dans le cadre d’un processus mental multiforme et encore mystérieux, qui mobilise autant le corps et les sens que les neurones et les synapses.
La contingence de l’intelligence humaine – la façon dont elle varie en fonction de la santé, de l’humeur et des circonstances – est au centre du récit que fait Kasparov de son duel historique avec Deep Blue. Ayant vaincu la machine lors d’un célèbre match un an plus tôt, le champion aborde la compétition de 1997 convaincu qu’il en sortira une nouvelle fois vainqueur. Sa confiance est confortée quand il gagne de façon nette la première partie. Mais, dans la deuxième partie fatidique, Deep Blue joue une série de coups décisifs. Ébranlé, Kasparov commet une erreur mentale calamiteuse. Amer, il jette l’éponge après une offensive de l’ordinateur, qu’il croit fatale, contre sa reine. Mais ce n’est qu’après coup qu’il se rend compte que sa position n’était pas désespérée ; il aurait pu imposer une partie nulle à la machine. À l’issue de cette partie perdue, Kasparov est « déboussolé et dans une angoisse terrible », qui l’empêche de reprendre ses esprits. Bien que les trois parties suivantes se soldent par des « nuls », Deep Blue l’écrase dans la sixième et dernière, et remporte le match.
L’une des forces de Kasparov a toujours été sa capacité à lire dans les pensées de ses adversaires et, du coup, d’anticiper leurs stratégies. Mais, avec Deep Blue, il n’y avait pas de pensées à lire. L’absence de personnalité de la machine, son implacable inexpressivité s’est avérée l’un de ses principaux atouts. Cela a désorienté Kasparov, instillant des doutes dans son esprit et entamant sa confiance en soi. « Je ne savais absolument rien de mon adversaire, se rappelle-t-il. Du fait de mon profond désarroi, mon esprit s’est égaré. » L’ironie est que la victoire de la machine était autant une question de psychologie que de talent (2).
S’il n’avait pas perdu ses moyens, Kasparov aurait pu gagner en 1997. Mais cela n’aurait fait que retarder l’inévitable. Au tournant du millénaire, l’ère de la domination des ordinateurs aux échecs s’est affirmée. Aujourd’hui, même les plus grands des grands maîtres ne se risqueraient pas à défier un ordinateur. Ils savent qu’ils n’auraient aucune chance.
S’ils sont devenus imbattables sur l’échiquier, les ordinateurs restent incapables de faire montre de ce que Kasparov appelle « le caractère ineffable des échecs humains ». Il y voit une raison de se montrer optimiste quant à l’avenir de l’humanité. À la différence d’un échiquier de huit cases sur huit, le monde est un espace illimité, et les calculs mathématiques ou statistiques ne suffiront jamais pour le déchiffrer. Le manque de souplesse de l’intelligence artificielle laisse aux humains une grande latitude pour exercer leur intelligence, flexible et intuitive. Si nous prenons garde de soumettre la puissance de nos ordinateurs à nos propres objectifs, conclut Kasparov, nos machines ne nous remplaceront pas ; elles nous permettront au contraire d’accomplir des exploits plus grands encore.
Espérons qu’il a raison. Mais le fait que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants et répondent de mieux en mieux à nos besoins présente un danger. Si les avantages du traitement informatique sont faciles à mesurer – en termes de vitesse, de rendement, d’argent –, ceux de la pensée humaine sont souvent difficiles à exprimer en chiffres bruts. Quand on voit à quel point la société vénère ce qui est mesurable et méprise l’ineffable, notre intelligence pourrait paraître à son désavantage au moment où nous informatisons à tout-va de plus en plus d’aspects de nos métiers et de nos existences. La question n’est pas de savoir si les subtilités de l’esprit humain resteront hors de portée des machines. Elles le resteront sans aucun doute. La question est de savoir si nous continuerons à apprécier la valeur de ces subtilités alors que nous devenons plus dépendants des calculs aveugles, mais brutalement efficaces, de nos machines. Face à l’implacable, le contingent peut sembler inférieur, ses forces apparaissant comme des faiblesses. Dans les dernières pages de son livre, Kasparov note avec un certain regret : « Les humains se mettent de plus en plus à jouer aux échecs comme des ordinateurs. » Une fois de plus, ce jeu ancien pourrait nous offrir un présage.
— Cet article est paru dans la Los Angeles Review of Books le 29 juin 2017. Il a été traduit par Philippe Babo.
[post_title] => Garry Kasparov, optimiste face aux machines
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => ia-intelligence-artificielle-kasparov-echecs
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-01-30 11:17:46
[post_modified_gmt] => 2019-01-30 11:17:46
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56299
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 56349
[post_author] => 8
[post_date] => 2019-01-17 07:00:28
[post_date_gmt] => 2019-01-17 07:00:28
[post_content] => Le Britannique Edmund Burke, on le sait, est l’un des pères de la pensée conservatrice. Il a été l’un des premiers, dès l’automne 1790, à proposer une critique, restée célèbre, de la Révolution française. Il dénonçait un projet théorique, systématique, théologique, abstrait. Le mot qui revient le plus sous sa plume pour décrire l’objet de son aversion est « métaphysique ». Il lui oppose un concept, un seul : celui de « raisonnable ». À une époque – la nôtre – où l’on voit de nouveau la montée en puissance de projets métaphysiques – l’euro, l’Union européenne – qui nient la réalité historique et anthropologique des nations, il peut être tentant de revenir à une vision burkienne du monde, d’essayer de retrouver, face aux politiques de la table rase, un certain bon sens britannique. On aurait tort de s’en priver. Même si l’histoire a donné tort à Burke.
N’en déplaise à ce dernier, la Révolution française, malgré ses excès, a eu dans l’ensemble un bilan très positif. Même les Anglo-Américains le reconnaissent aujourd’hui. Dans leur ouvrage de référence Why Nations Fail, Daron Acemoglu et James Robinson estiment qu’elle a élargi, ouvert au continent européen et, de là, à la planète entière les acquis de la Révolution anglaise de 1688 (1). Et on peut difficilement nier que, hormis en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le système métrique, ce projet métaphysique s’il en fut, a été un immense succès.
Au cœur de la démonstration de Burke, on trouve, en fait, une grande escroquerie : il présente l’histoire anglaise comme paisible, évolutive, respectueuse du passé ; la liberté n’y serait rien d’autre qu’un vieil héritage. En contraste, il se moque de la volonté de rupture radicale des Français. Quand on connaît les histoires anglaise et française, c’est parfaitement ridicule. On débat encore de la date du démarrage de la révolution industrielle : 1760 ou 1780. Ce qui est sûr, c’est qu’il a eu lieu en Angleterre et que, en 1790, au moment où Burke écrit, il a déjà commencé à bouleverser le pays : le mouvement des enclosures (2) est achevé et la totalité de la paysannerie pauvre a été liquidée. Par aveuglement ou mauvaise foi, Burke ne comprend pas que les vrais révolutionnaires, le peuple qui est capable de mener à bien un projet abolissant les traditions passées, ce ne sont pas du tout les Français, mais les Anglais.
Plaçons-nous en 1840 : la France, à l’issue de sa révolution et de plus de deux décennies de guerre, a supprimé les droits féodaux et introduit l’égalité devant la loi, mais le système de mœurs y reste à peu près inchangé. La France est toujours la France, une société très majoritairement rurale. L’Angleterre, elle, n’est plus l’Angleterre. La monarchie est toujours en place, certes, mais la paysannerie a été déracinée et un immense prolétariat s’est constitué.
Il faut l’accepter : depuis le XVIIe siècle, le monde anglo-américain constitue le foyer révolutionnaire fondamental, le lieu de transformation de l’histoire humaine, et les autres pays se contentent de suivre, bon gré mal gré, ses impulsions. On a de nouveau pu le vérifier au cours des dernières décennies : le thatchérisme et le reaganisme ont dévasté la structure sociale de la Grande-Bretagne et des États-Unis, liquidant non plus la paysannerie, mais la classe ouvrière. Avec une génération de retard, Emmanuel Macron a rêvé de les imiter – au moment même où le Brexit et l’élection de Donald Trump remettaient en cause le néolibéralisme, où l’on assistait à un nouveau tournant, à la dernière en date de ces ruptures radicales dont les Anglo-Américains sont coutumiers.
Mais le bouleversement le plus intéressant dont ces pays nous offrent le spectacle n’est peut-être pas d’ordre socio-économique. Il concerne les mœurs. Il ne s’agit pas de l’émancipation des homosexuels, qui n’est après tout qu’un retour à l’état naturel des choses : jusqu’à ce que les grandes religions monothéistes en décident autrement, il y avait toujours eu une place pour l’homosexualité dans la vie d’Homo sapiens. Si l’on raisonne en termes burkiens, on pourrait être tenté de dire que nous assistons à une restauration de l’ordre ancien : enfin nous échappons à la révolution judéo-christiano-musulmane.
Bien plus perturbante me semble la question transgenre. On a affaire à des personnes qui considèrent que leur sexe biologique ne correspond pas à leur sexe mental, qu’il y a eu erreur, et qui envisagent parfois une transformation hormonale ou chirurgicale. Les transgenres, toutes catégories confondues, représenteraient aux États-Unis 0,3 % de la population et 0,7 % chez les adolescents. Des chiffres invérifiables, à prendre avec réserve, qui donnent néanmoins une idée du poids réel des transgenres : il est insignifiant. Et pourtant la question obsède les sociétés anglo-américaines. Je lisais encore il y a peu dans The New York Times un article très émouvant d’une transgenre qui expliquait qu’on allait lui fabriquer un vagin artificiel, que cette opération ne la rendrait pas heureuse, mais que c’était une nécessité intrinsèque malgré tout.
Il peut sembler baroque de mettre en rapport cette obsession avec la russophobie. Mais c’est ce que j’aimerais essayer de faire. Quand on lit la presse anglo-américaine, s’y manifestent actuellement deux grandes pentes d’irrationnel : la place disproportionnée accordée au débat sur les transgenres et l’hostilité viscérale à l’égard de la Russie – pays qui, avec ses 144 millions d’habitants, ne représente plus un danger géostratégique réel pour les États-Unis mais continue à être traité comme une puissance maléfique. Le devoir d’un chercheur est d’essayer de voir s’il n’existerait pas un lien entre ces deux obsessions. Or il y en a un, évident : ces dernières années, les questions de mœurs ont fait irruption dans les relations internationales – tout particulièrement lorsqu’il est question de la Russie. Au lieu de parler d’équilibres militaires et stratégiques, on s’est mis à reprocher à la Russie son homophobie (dans un contexte, rappelons-le, où le grand ami des États-Unis est l’Arabie saoudite !). Souvenons-nous comment, en 2014, la victoire du travesti autrichien Conchita Wurst à l’Eurovision avait inspiré des commentaires critiques à Vladimir Poutine et avait été présentée, du coup, comme un triomphe de la tolérance européenne.
Face à un monde anglo-américain révolutionnaire sur le plan des mœurs, qui cherche à définir une nouvelle identité humaine, on a une Europe continentale qui essaie de suivre vaille que vaille et une Russie qui, elle, ne suit pas du tout. Cela ne l’empêche pas, soit dit en passant, d’être l’un des pays les plus féministes du monde. Si l’on regarde la part des femmes diplômées de l’enseignement supérieur par rapport à celle des hommes, la Suède arrive en tête en Europe, avec 143 femmes pour 100 hommes, immédiatement suivie par la Russie, avec 130 femmes pour 100 hommes. En termes d’études supérieures (un critère très significatif), la Russie est donc plus féministe que la France ou que le monde anglo-américain. Mais les femmes, mêmes instruites, s’y déclarent souvent homophobes.
Pendant tout le XXe siècle, la Russie a incarné la révolution. Il est peut-être temps d’accepter le fait que c’était là un contresens, que, sur la longue durée, son rôle historique est plutôt un rôle de conservation et de freinage, qu’elle incarne bien mieux que le Royaume-Uni la grande puissance conservatrice rêvée par Burke. Marx et Engels ne l’ont jamais considérée autrement et ils l’exécraient pour cette raison (même si le premier, ayant trouvé un bon lectorat en Russie, a fini, vanité d’auteur oblige, par vanter les mérites de la commune russe). L’historien hongrois Miklós Molnár emploie sans cesse le terme « russophobie » pour qualifier l’attitude des marxistes dans son admirable livre Marx, Engels et la politique internationale (3).
La période soviétique fut-elle alors une aberration, une parenthèse ? Si l’on considère qu’une révolution, une vraie révolution, marque un réel changement des modes de production, des mœurs, des valeurs, un saut en avant vers la modernité, force est de constater que la révolution russe n’a de révolution que le nom. Encore une fois, depuis le XVIIe siècle, les impulsions révolutionnaires authentiques, les véritables transformations de l’économie, des mœurs, de la société viennent du monde anglo-américain. Elles sont facilitées par une structure familiale plastique, nucléaire, par les ruptures générationnelles qu’elle permet. Les pays du continent européen ne font qu’y réagir, et ils sont sans cesse tiraillés entre leurs désirs de rattrapage et leurs désirs de contestation. Dans tous les cas, ils se situent toujours par rapport à cette impulsion qui leur est extérieure et qu’ils essaient d’adapter à leurs propres traditions familiales.
Les révolutionnaires français de 1789 voulaient juste rattraper la Glorious Revolution de 1688 (dès 1734 et ses Lettres anglaises, Voltaire donnait le voisin d’outre-Manche en modèle). Ils y ont introduit la notion d’égalité car, si la culture du Bassin parisien est, comme la culture anglaise, individualiste, elle est aussi fortement égalitaire. En Allemagne, où les valeurs familiales sont autoritaires et inégalitaires, la négation du libéralisme occidental et de l’idée de révolution a mené à une révolution d’un genre particulier, le nazisme.
Le même raisonnement s’applique aux Russes. La structure familiale russe se caractérise par un mélange d’égalitarisme et d’autoritarisme : elle est très autoritaire sur le plan du rapport entre générations, très égalitaire en ce qui concerne le rapport entre frères. La famille paysanne russe traditionnelle, en réunissant sous un même toit plusieurs générations et plusieurs frères mariés, pouvait atteindre une taille gigantesque. C’est ce que j’ai appelé dans mes ouvrages la famille « communautaire ». La construction du communisme peut être interprétée comme une façon d’intégrer la modernité, de tenter de rattraper l’Angleterre et les États-Unis, sans sortir de ce communautarisme. Dans toute sa violence, la révolution russe n’a été qu’un suprême effort du conservatisme.
En vérité, la Russie n’a jamais aspiré à l’individualisme. Certainement pas sous le régime des tsars qu’abominaient Marx et Engels, ni non plus par la suite : je ne qualifierais pas la révolution russe d’individualiste. Et il me semble que le genre de démocratie autoritaire qui existe aujourd’hui ne l’est pas particulièrement non plus. (Cette expression de « démocratie autoritaire » n’a rien de péjoratif, ce n’est qu’une façon d’accepter la Russie telle qu’elle est. Peut-être, cela dit, devrait-on parler plutôt de « démocratie communautaire ».)
Les révolutions que nous vivons ces derniers temps sont censées être les poussées extrêmes, les ultimes conséquences des principes de liberté de l’individu : on veut aller au-delà de l’individualisme bourgeois du XIXe siècle, au-delà de l’individualisme sexuel des années 1970 et 1980, se libérer de l’individu tel qu’il est défini par la nature. Et, bien entendu, la Russie, avec sa forte tradition d’encadrement de l’individu par la collectivité, se montre réticente à franchir le pas. C’est pour cela qu’elle est haïe : pour ce conservatisme, qui est peut-être de la prudence. Car les sociétés anglo-américaines sont rongées par l’angoisse de se tromper.
Dire que le sexe tel qu’on l’observe à la naissance n’est peut-être que l’apparence des choses est d’une radicalité inédite. J’ai relu récemment l’anthropologue et féministe Margaret Mead : le clivage hommes-femmes et la spécialisation des rôles entre les deux sexes constituent un tel universel d’organisation pour toutes les sociétés qu’il n’est pas concevable que le projet de « sexe flottant », pour ainsi dire, ne crée pas au plus profond de l’inconscient des sociétés les plus avancées une véritable inquiétude. Or, quand on est inquiet sur ce qu’on fait soi-même, on devient assez hostile au voisin qui refuse de prendre le même risque. On se demande inévitablement, de façon latente, si ce n’est pas lui qui fait le bon choix, qui, en l’occurrence, serait le choix du conservatisme de mœurs.
Je pense que si la Russie est tellement haïe, ce n’est pas du tout parce qu’elle est menaçante en termes géopolitiques. Elle agace un peu par son rétablissement géostratégique et militaire, qui ennuie beaucoup les vieux géopoliticiens gâteux du Pentagone, mais rien là d’insurmontable. Si la Russie suscite une telle aversion, c’est parce que c’est un pays prudent par rapport à un monde occidental qui, lui, est peut-être en train de devenir imprudent. Et qui, pour se rassurer, ne désire rien tant qu’entraîner tout le monde avec lui – dans l’inconnu.
— Propos recueillis par Baptiste Touverey.
[post_title] => Edmund Burke, la Russie et les transgenres
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => edmund-burke-russie-transgenres
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-01-25 12:33:36
[post_modified_gmt] => 2019-01-25 12:33:36
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56349
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 56542
[post_author] => 8
[post_date] => 2019-01-17 07:00:25
[post_date_gmt] => 2019-01-17 07:00:25
[post_content] => Dans le petit livre qu’il a écrit avec le médecin Kôichirô Fujita, le dessinateur Bunpei Yorifuji se demande ce que représentent concrètement les 1 365 800 tonnes de caca produites chaque jour par la population mondiale. Vous avez bien lu : de caca. La réponse témoigne d’un sens consommé des images : « entassé sur la surface d’un tatami », écrit Bunpei, cela donnerait une tour de 820 kilomètres de haut. Mais on peut aborder le problème autrement – en largeur, pour ainsi dire : si l’on prenait la peine d’étaler le caca produit à l’échelle mondiale sur une couche de 1 centimètre d’épaisseur, il ne faudrait que vingt-deux minutes pour recouvrir la principauté de Monaco (tentant, n’est-ce pas ?)
Bunpei le confesse dès son introduction : depuis l’enfance, il est obsédé par le caca. C’est grâce à lui qu’il a découvert les joies de son art : il en dessinait partout : « dans les toilettes, sur [s]a table d’écolier, sur le terrain de sport, sur les murs, sur les vitres embuées l’hiver ». Son ouvrage entend non seulement présenter de la façon la plus ludique possible tout ce qu’il y a à savoir sur cette matière si décriée (rappelons que le français « caca » vient du grec kakos, signifiant « mauvais »), mais aussi la réhabiliter. Parler de « déchets » à propos des excréments serait ainsi, à l’en croire, un contresens : ils jouent un rôle essentiel dans le « cycle de la nature ». On sait que les excréments d’animaux servent d’engrais aux végétaux. Mais Bunpei nous fait prendre conscience que l’inverse est aussi vrai : les plantes n’absorbent-elles pas de la lumière et divers nutriments avant de rejeter de l’oxygène ? On peut donc tout à fait considérer que « les humains, et les animaux de façon générale, vivent en respirant le caca des végétaux ».
Au cœur du caca propose une typologie des étrons : celui qui est lové sur lui-même représente « l’excrément absolu », symbole d’« une vie équilibrée ». Le « caca banane » n’est pas mal non plus : « Il sent, mais une odeur à laquelle on s’habitue, qu’on peut même ne pas trouver répugnante. » Gare, en revanche, aux étrons fins, durs, boueux ou, pire, liquides. Outre qu’ils puent, ils sont le signe d’une mauvaise santé. La clé pour un beau caca ? Une nourriture équilibrée (on s’en doutait un peu), des repas à des horaires réguliers et pas trop de stress. Comme pour nous y aider, le livre s’achève sur une anecdote : « En Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous apprend Bunpei, la coutume veut qu’une femme surprise à déféquer accepte de coucher. » De quoi se réconcilier définitivement avec le caca, non ?
[post_title] => Le caca dans tous ses états
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => merde-excrement-caca-etats
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-01-16 21:19:19
[post_modified_gmt] => 2019-01-16 21:19:19
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56542
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 56476
[post_author] => 8
[post_date] => 2019-01-17 07:00:24
[post_date_gmt] => 2019-01-17 07:00:24
[post_content] => Grâce au surréalisme, Paris était encore dans l’entre-deux-guerres l’épicentre incontesté des séismes culturels et artistiques du moment. La plupart des surréalistes – les plasticiens du moins – n’étaient pas français. Mais c’est bien à Paris qu’André Breton et consorts avaient remplacé le dadaïsme zurichois, officiellement décédé en septembre 1922, par un nouveau mouvement appelé « surréalisme » (un terme dû à Picasso mais utilisé pour la première fois à l’écrit par Apollinaire). Et c’est à Paris qu’ils avaient procédé à leurs expérimentations en laissant libre cours à leurs pulsions, le surréalisme étant à la fois une expression artistique et une façon de vivre. Avec pour résultat des vies personnelles et des sexualités aussi fantastiques et transgressives que leurs œuvres. Le zoologue Desmond Morris, auteur à la fin des années 1960 des best-sellers Le Singe nu et Le Zoo humain, décrit cela avec d’autant plus de précision que, peintre lui-même, il appartenait à la branche anglaise du surréalisme (à 90 ans, il en est sans doute le dernier représentant).
À en juger par la chronique que fait Desmond Morris de la construction d’un art nouveau et de la déconstruction des mœurs anciennes, le Paris du surréalisme était un mélange de lupanar et d’asile de fous. Le mouvement, autant philosophique qu’artistique, se fondait en effet sur la suprématie de l’inconscient, le refus de l’intellectualisme et le rejet de tous les canons, esthétiques, politiques, et, cela va sans dire, moraux.
Ses membres ne se l’étaient pas fait dire deux fois. Le jour, ils produisaient des œuvres qui scandalisaient volontiers (un visiteur de l’exposition Hans Arp, dégoûté, avait ainsi craché sa chique de tabac sur un dessin du protosurréaliste alsacien). La nuit, ils se lançaient dans un entrelacs de liaisons croisées, successives ou simultanées (mais hétérosexuelles – Breton était convulsivement homophobe). Éluard, « un Éros vivant » selon Eileen Agar, était l’amant de cette dernière, qui était en même temps la maîtresse de l’écrivain hongrois Joseph Bard et du peintre britannique Paul Nash ; lequel était l’amant de Nush, à l’époque épouse d’Éluard et maîtresse de Picasso. Éluard en était très flatté, avant qu’il ne la remplace par Gala, temporairement toutefois ; celle-ci passerait en effet du statut de Mme Éluard à celui de Mme Dalí, non sans une longue période de ménage à trois avec Éluard et Max Ernst ; le libidineux Max Ernst se rabattrait alors sur la peintre américaine Dorothea Tanning, après avoir été l’amant entre autres de Leonor Fini, de l’artiste suisse Meret Oppenheim, de l’artiste mexicaine Leonora Carrington, et l’époux de Peggy Guggenheim (dont l’une des ambitions dans la vie était d’atteindre avant sa sœur Hazel le chiffre de 1 000 partenaires). Ouf ! Et cela sans même prendre en compte les fréquentes soirées échangistes – Paul Éluard, selon Eileen Agar, « réussissant toujours à transformer la moindre réunion en orgie » – ni s’attarder sur les perversions des un(e)s ou des autres.
Mentionnons juste celles de Salvador Dalí, grand adepte du « clédalisme » (voir définition dans les dictionnaires spécialisés) et qui, sans doute en raison de la petitesse revendiquée de son pénis, abhorrait la pénétration et lui préférait le voyeurisme. Ou de Francis Bacon, que son père faisait fouetter par ses palefreniers, déclenchant une frénésie sadomasochiste qui envahirait ses toiles comme sa vie.
Chez les surréalistes, œuvres scandaleuses et vies scandaleuses étaient en effet inextricablement liées. Ainsi, Marcel Duchamp, bien que dégoûté par les avances de la baronne dadaïste Elsa von Freytag-Loringhoven (au point de lui signifier par contrat l’interdiction de toucher son corps), l’avait tout de même filmée en train de se faire délicatement raser le pubis par Man Ray ; et, summum sans doute de la fusion art-vie, l’infortunée baronne, implacablement amoureuse (et accessoirement la véritable inventrice des « readymade »), en serait réduite pour sa part à se masturber devant un tableau de Duchamp.
Tous les surréalistes n’étaient pourtant pas aussi aventureux dans leurs vies privées. Parfois très sages et quasiment monogames, comme Miró, ils réservaient alors toute leur rébellion à leurs toiles. De Chirico, l’initiateur du surréalisme en peinture, allait même jusqu’à vitupérer contre « ces dégénérés, ces voyous, ces bons à rien infantiles, ces onanistes qui se font appeler pompeusement surréalistes ». Une dissociation entre l’art et la vie que l’on retrouvait d’ailleurs parfois dans leur façon de peindre, extrêmement sage et conventionnelle (Delvaux, Magritte), ou très classique (Dalí), mais qui véhiculait pourtant des messages éminemment perturbateurs.
René Magritte est sans doute celui qui a « poussé le plus loin la contradiction entre ce qu’il peignait et la façon dont il peignait », écrit Desmond Morris. Il avait en effet « travesti sa vie en celle d’un bourgeois » et produisait ses fantasmagories dans un environnement très soigné, vêtu d’un costume trois-pièces. Il trouvait d’ailleurs l’acte de peindre profondément ennuyeux et se dégoûtait d’avoir à passer des heures à transposer sur la toile ce que l’inconscient lui avait dicté en un éclair, au point que parfois, n’en pouvant plus, il lui fallait aller se calmer au bordel.
Le paradoxe, c’est que le surréalisme, qui prônait l’absolue liberté morale et artistique – et dont les sectateurs étaient d’extravagants contempteurs de l’autorité et de tout ce qui l’incarnait (le père, l’armée, etc.) –, était un mouvement régi de façon dictatoriale. André Breton, l’alpha surréaliste, était un véritable gauleiter qui entendait soumettre l’individu au collectif, proscrivait toute forme d’allégeance sociale ou religieuse, interdisait à ses ouailles d’exposer avec des non-surréalistes… L’histoire du mouvement n’est qu’une suite de dénonciations, d’interdictions, d’exclusions, de réintégrations ; et pratiquement tous ses membres ont à un moment ou un autre subi les foudres de Breton – sauf ceux qui, comme Buñuel, Klee, Man Ray, Magritte, Miró ou Giacometti, s’étaient autoexclus préventivement.
Breton ne supportait en effet pas qu’on lui fasse de l’ombre et trouvait facilement prétexteà fatwa : Henry Moore avait laissé placer une de ses œuvres dans une église ; Dalí se disait érotiquement attiré par Hitler ; le peintre anglais Roland Penrose avait accepté d’être anobli par la reine (« pour pouvoir se faire appeler “sir-realist” ») ; tels autres avaient découvert la foi ou étaient devenus sorciers…
Le problème, c’est que, vis-à-vis de tous ces plasticiens étrangers, géniaux, foutraques, épris de liberté, Breton a graduellement paru de plus en plus décalé. Son intellectualisme, son orgueil, son bellicisme, son obsession régulatrice avaient fini par déteindre sur tout le mouvement, lui conférant un caractère saumâtre et pour tout dire un peu franco-français.
Dans le quotidien londonien The Times, Nancy Durrant décrit carrément André Breton comme « un emmerdeur pompeux, un dictateur impitoyable, un sexiste impénitent, un homophobe hystérique et un manipulateur hypocrite ». En fait, le malheureux était devenu une victime de guerre : son exil en 1940 à New York, où il était resté pendant quatre ans pauvre, inconnu, sans autorité sur quiconque, aigri et refusant en outre de parler anglais, avait été pour lui un martyre, et pour le mouvement tel qu’il le concevait une épreuve fatale.
Une fois mis sur orbite internationale, le surréalisme n’avait plus besoin d’être théorisé ni surtout régenté – depuis Paris qui plus est. Mais, sur un immeuble du fond du 9e arrondissement, une plaque proclame toujours fièrement : « André Breton a fait du 42 rue Fontaine le centre du mouvement surréaliste de 1922 à 1966. »
[post_title] => Le zoo des surréalistes
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => zoo-surrealistes
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-02-06 08:30:08
[post_modified_gmt] => 2019-02-06 08:30:08
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56476
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 55455
[post_author] => 8
[post_date] => 2018-11-22 07:00:51
[post_date_gmt] => 2018-11-22 07:00:51
[post_content] => Ce n’est pas un secret : on trouve beaucoup plus de gens pour regarder des émissions du genre Nos ancêtres les extraterrestres que pour assister à des conférences d’archéologues et d’historiens professionnels (1). Ils sont des millions à suivre des séries ou à regarder des documentaires fondés sur une interprétation douteuse du passé. Les histoires brodées par les producteurs et scénaristes peuvent bien avoir un fond de vérité, elles restent des histoires. Mais elles sont captivantes et s’adressent au grand public, ce qui n’est pas le cas des productions savantes.
Selon l’archéologue Donald Holly, les livres consacrés aux anciens extraterrestres et à d’autres formes de pseudo-archéologie touchent également un large public. Pour un article de la rubrique livres qu’il anime dans American Antiquity, la revue la plus respectée de l’archéologie américaine, Holly a demandé aux archéologues de se pencher ne serait-ce qu’un instant sur la notion de pseudo-archéologie, avec l’idée que cette réflexion puisse enrichir les connaissances des étudiants et de ceux qui s’intéressent à notre profession. Les lecteurs de ces livres ne sont pas forcément ignorants ou bornés, souligne Holly, mais manifestement désireux de comprendre le passé et ouverts à des explications alternatives de l’archéologie. « Il est temps de parler au type assis à côté de nous dans l’avion », écrit-il.
Le premier livre évoqué est L’Empreinte des dieux, du Britannique Graham Hancock (2). Son propos est qu’une civilisation extraordinairement avancée a écumé les océans voilà des milliers d’années, fournissant aux peuples rencontrés sur sa route – en Égypte et au Pérou, par exemple – des conseils pour les aider à établir leur civilisation. En retour, les hérauts de cette civilisation mythique furent révérés comme des dieux, surtout après l’avènement d’un cataclysme qui l’a fait disparaître. L’archéologue Kenneth Feder montre que Hancock a habilement sélectionné ses données – omettant celles qui ne cadrent pas avec sa thèse –, qu’il s’appuie sur des penseurs très anciens et marginaux, et que la notion d’évolution culturelle lui est étrangère.
Le deuxième livre étudié est « La question des anciens extraterrestres », du Belge Philip Coppens (3). Comme Feder, l’archéologue Jeb Card montre que l’hypothèse trouve sa source dans la théosophie de l’époque victorienne, un mouvement qui « mêlait magie hermétique, spiritisme, curiosité européenne pour les religions orientales, racisme colonial et autres lectures fantaisistes de l’évolution, lestées de races originelles, de continents perdus et de maîtres ascensionnés venus de Vénus ou d’autres mondes. Coppens intervient régulièrement dans la série Nos ancêtres les extraterrestres. Il présente la recherche universitaire comme si la science elle-même était mystérieuse. Il voit dans « la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie et autres autodafés de livres des preuves de la destruction de vérités anciennes, alors qu’il tire le rideau sur son propre appel à détruire l’ordre scientifique au profit d’une nouvelle histoire fondée sur le mysticisme et le mythe », écrit Jeb Card.
Dans « Göbekli Tepe. La genèse des dieux », préfacé par Hancock (4), Andrew Collins tente de relier ce site néolithique de Turquie avec le jardin d’Éden, présentant la Bible comme une vérité à prendre au pied de la lettre. Dans « Genèse noire : les origines préhistoriques de l’Égypte ancienne » (5), Robert Bauval et Thomas Brophy dévoient aussi bien l’astronomie que la Bible pour affirmer que l’Égypte des pharaons a succédé à une civilisation noire avancée. Ils ont au moins le mérite de souligner que les archéologues universitaires ont longtemps ignoré l’Afrique subsaharienne.
Racisme et ethnocentrisme
L’Amérique précolombienne est un thème porteur, avec des livres jugés stupéfiants par les archéologues qui les commentent. Celui de William Conner, « L’âge du fer avant Colomb », est un tel « catalogue d’erreurs de raisonnement qu’il devrait être utilisé pour une introduction à un cours de logique », écrit l’archéologue Kory Cooper. Il y a aussi « Les anciens géants qui ont dirigé l’Amérique », par Richard Dewhurst, qui exploite de vieux articles de journaux pour affirmer non seulement qu’on a retrouvé des squelettes de géants, mais que le célèbre Smithsonian Museum a tenté de le dissimuler. En rendant compte de ce livre, l’archéologue Benjamin Auerbach précise qu’il a lui-même étudié les squelettes en question et qu’aucun ne mesurait plus de 1,83 mètre.
Tous ces livres sont empreints d’ethnocentrisme, l’idée selon laquelle nous pouvons évaluer les autres cultures à l’aune de la nôtre. Ils sont aussi teintés d’un certain racisme. Dans « Les colonies perdues de l’Amérique ancienne » (6), Frank Joseph fait valoir que les archéologues universitaires ont laissé de côté les informations disponibles sur les voyages transocéaniques et que bien d’autres civilisations du passé ont pu coloniser le Nouveau Monde avant les Européens. À propos de ce livre, l’archéologue Larry Zimmerman écrit : « Joseph se fait l’écho d’un demi-millénaire de spéculations visant à inventer une histoire profonde d’un Ancien Monde en Amérique. C’est une façon de mettre en cause la présence primitive des peuples indiens – ou, du moins, de leur conférer un statut inférieur, une incapacité à gérer leur territoire –, d’expliquer la nécessité de les civiliser au nom de la Destinée manifeste (7) et de justifier l’accaparement de leurs terres. »
La pseudo-archéologie fait illusion
Dans un autre livre, John Ruskamp avance que des pictogrammes trouvés sur des roches en Amérique du Nord sont des caractères chinois, unique trace archéologique laissée à la suite d’une traversée du Pacifique. L’archéologue Angus Quinland y voit « une illustration de ce que la pensée déductive peut produire de pire » et souligne que ce genre d’interprétation témoigne d’un « manque de respect pour les Amérindiens, qui utilisaient l’art rupestre de manière tout à fait habituelle ». « Les pseudo-archéologues ne peuvent accepter le fait que des humains ordinaires puissent être à l’origine de grandes innovations comme la domestication d’espèces végétales et animales ou édifier des chefs-d’œuvre architecturaux comme le Sphinx, écrit Eric Cline. Ils préfèrent invoquer l’assistance du divin, voire d’extraterrestres. »
Ces livres posent problème pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’ils désinforment, faisant leur marché de données puisées à des sources plus ou moins légitimes. Ensuite parce que la pseudo-archéologie fait illusion. Elle se présente comme un corps de doctrine qui, même sous couvert d’excentricité, tire une légitimité de sa cohérence, les auteurs se citant les uns les autres. Il en va de même pour nous autres archéologues, mais, en tant que scientifiques, nous sommes davantage motivés par le souci d’améliorer notre compréhension du passé que par celui de protéger nos théories.
Cela dit, le problème tient peut-être surtout dans cette remarque de Lekson : « L’archéologie alternative est plus intéressante que ce que nous écrivons. Plus intéressante aux yeux d’un public plus vaste. » Les archéologues professionnels ne sont pas formés à écrire dans un style agréable. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir intéresser le « type dans l’avion ». Des archéologues célèbres comme Brian Fagan8, qui écrivent des livres faciles d’accès, doivent faire des prodiges d’équilibre pour susciter l’intérêt sans verser dans l’extravagance.
Hélas, les histoires d’anciens extraterrestres et d’hommes surhumains créant les pyramides comme moyen de communication ont un plus grand pouvoir de fascination que le lent changement culturel.
— Cet article est paru dans Forbes le 3 septembre 2015. Il a été traduit par Nicolas Saintonge.
 [post_title] => La pseudo-archéologie, un bon filon
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => pseudo-archeologie-filon
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-04 13:47:59
[post_modified_gmt] => 2019-03-04 13:47:59
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=55455
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
)
[post_title] => La pseudo-archéologie, un bon filon
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => pseudo-archeologie-filon
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-04 13:47:59
[post_modified_gmt] => 2019-03-04 13:47:59
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=55455
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 55593
[post_author] => 8
[post_date] => 2018-11-22 07:00:20
[post_date_gmt] => 2018-11-22 07:00:20
[post_content] => On consacre chaque année davantage de fonds à la recherche sur le gluten, cette protéine végétale qui a désormais mauvaise réputation. Ces travaux soulèvent de nouvelles questions, qui nécessitent de nouveaux financements et aboutissent à de nouvelles interrogations.
Si, durant mes études de médecine, il a été question du gluten dans plus d’un cours, je n’en ai pas le souvenir. La seule fois où j’en ai entendu parler, c’était en 2007, à propos de la maladie cœliaque. Lorsque le professeur a prononcé le mot « gluten », quelqu’un dans l’amphi a levé la main pour lui demander de répéter. Des gens qui mangent quoi ?
Le gluten, qui est présent dans la pâte à base de blé, de seigle et d’orge, on en trouvait bien entendu partout à l’époque. Il est une sorte de liant qui tient l’édifice de notre alimentation moderne. Mais on n’en avait pas conscience.
Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, l’ingestion de gluten provoque une réaction immunitaire qui endommage la paroi de l’intestin grêle. Tant que les intéressés évitent le gluten, tout va bien. Message reçu. Comme la plupart des médecins, c’est tout ce que je me rappelle avoir appris au cours de mes études.
Dix ans plus tard, je lis dans la presse que le gluten n’entraîne pas de risque de maladies cardiaques. Maladies cardiaques ? Sans blague ! Et pourquoi pas le rachitisme ou le changement climatique, tant qu’on y est. Pourquoi le gluten provoquerait-il des maladies cardiaques ?
En fait, non seulement le gluten n’engendre pas ce genre de pathologies dans la population générale, mais les régimes sans gluten exposent à des risques accrus de maladies cardiaques, dans la mesure où l’on consomme moins de céréales complètes. Cette découverte ajoutée à d’autres commence à dessiner les contours des types de méfaits associés à l’élimination systématique du gluten. On la doit à un groupe d’éminents nutritionnistes et gastro-entérologues des universités Harvard et Columbia. Dans une étude de cohorte prospective publiée en mai 2017 par le British Journal of Medicine, ils concluent que les personnes non atteintes de la maladie cœliaque « ne devraient pas être encouragées » à suivre un régime sans gluten.
Dans le jargon universitaire, cela s’appelle une sérieuse mise en garde. Mais elle arrive tard et est moins percutante que tout ce que promettent les magazines et les livres de solutions miracles. Comment entendre la recommandation des chercheurs alors que les régimes sans gluten sont vantés partout et sont l’un des sujets les plus recherchés sur Google ? Je calcule que, en avril 2017, il a dû se vendre pour 70 millions de dollars de produits sans gluten rien qu’en Californie.
Il reste que cette étude est l’une des plus sérieuses à ce jour sur l’effet de la consommation de gluten sur la santé des personnes non atteintes de la maladie cœliaque. Elle se fonde sur des données concernant plus de 100 000 individus sur près de deux décennies et a permis d’observer les comportements alimentaires en conditions réelles et leurs effets à long terme sur la santé. L’élément le plus convaincant en faveur du gluten est que les populations qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé ont depuis longtemps adopté des régimes alimentaires incluant des produits céréaliers. Et aucune étude à ce jour n’indique que le gluten serait à l’origine de maladies cardiaques. Alors, pourquoi s’être penché sur la question ?
L’auteur principal de l’étude, Benjamin Lebwohl, est gastro-entérologue au Centre de recherches sur la maladie cœliaque de l’université Columbia. Je n’ai rencontré personne qui se soit autant intéressé à l’image du gluten dans la société. « Si l’on pense que la science n’a pas à prendre en compte le comportement de la population, on ne fera qu’aggraver l’incompréhension, m’affirme-t-il. Nous continuerons à mener un dialogue de sourds. »
Quand il parle à ses patients, Lebwohl voit bien que ce n’est pas la même chose de dire : « Rien ne prouve le gluten ait des effets sur la santé » que de dire : « On a la preuve que le gluten n’a pas d’effets sur la santé. » Pour un patient inquiet, la différence est de taille.
Les effets du gluten demeurent en grande partie une énigme
Je me suis entretenu avec Lebwohl un matin, avant qu’il ne commence à scoper, comme il dit. C’est-à-dire à pratiquer des endoscopies et des coloscopies en examinant à l’aide d’un tube en fibre optique des parties de notre corps que pour la plupart nous ne voyons jamais. C’est ainsi qu’il a commencé à comprendre que la maladie cœliaque et les effets du gluten demeurent en grande partie une énigme.
Dans les manuels, on continue de présenter cette pathologie comme une maladie auto-immune. Le diagnostic est le plus souvent établi en dosant des anticorps appelés anti-transglutaminases tissulaires et en faisant une biopsie de l’intestin grêle après ingestion de gluten. Chez un patient atteint de la maladie cœliaque, Lebwohl s’attend à trouver les villosités qui tapissent la paroi intestinale aplanies comme une pelouse fraîchement tondue.
Mais, parfois, la chose se complique. Certaines personnes présentant une atrophie sévère des villosités intestinales se portent très bien de consommer du gluten. C’est seulement lorsqu’elles cessent d’en ingérer et reprennent plus tard que les symptômes apparaissent.
Lebwohl et son équipe à Columbia voient aussi très souvent le cas inverse : des gens dont la paroi intestinale ne présente pas d’anomalies mais qui se sentent terriblement mal lorsqu’ils mangent du gluten.
« Comment se fait-il que le gluten rende malades des personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie cœliaque ? se demande Lebwohl. Et pourquoi les symptômes sont-ils si variables chez ceux qui en souffrent ? Certains patients ont des symptômes qui sont déclenchés par le gluten alors qu’ils ne souffrent absolument pas de la maladie cœliaque. C’est sans doute parce que nous avons affaire à une pathologie nouvelle pour laquelle on ne dispose pas des bons biomarqueurs [tests de laboratoire] et dont on ne comprend pas le mécanisme. »
La maladie fait sans doute intervenir des effets placebo et nocebo (1), et les variations de la flore intestinale jouent probablement aussi un rôle. Les symptômes, note aussi Lebwohl, pourraient être liés aux Fodmap – un acronyme de plus en plus en vogue pour désigner un groupe de glucides que certains jugent à l’origine des symptômes souvent attribués au gluten (ou aux produits laitiers, aux produits à base de soja ou encore au « syndrome du côlon irritable »). Aucune de ces explications n’exclut les autres.
« Il est aussi fort probable qu’on se trouve en présence d’une entité clinique que nous ne connaissons pas, estime Lebwohl. Si c’est le cas, nous avons deux possibilités : lever les yeux au ciel et dire aux patients que leur maladie n’est pas répertoriée dans les manuels, ce qui les incite souvent à se tourner vers des praticiens “alternatifs” et à consommer quantité de compléments alimentaires, ou bien les écouter et étudier leur cas. »
Après quatre ans de fac de médecine, quatre d’internat et trois de stage de perfectionnement, Lebwohl s’est inscrit à Columbia en master de recherche orientée patients avant d’enchaîner sur un programme postdoctoral de recherche en science des populations appliquée au cancer. Il est ressorti de ce parcours moins formé qu’il ne l’aurait imaginé. « Au bout du compte, je me suis aperçu que les patients venaient me voir pour des problèmes d’“intestin perméable” ou de candidose. Je ne savais pas comment faire avec des patients qui employaient des termes jamais évoqués durant les études de médecine. »
Un cardiologue compare la consommation de blé au tabagisme
J’ai éprouvé la même chose, et je sais que mes camarades de fac aussi. Lorsque j’écris sur des sujets à propos desquels les gens s’interrogent – la cryothérapie, la chélation ou les régimes sans lectine –, je reçois immanquablement des courriers de lecteurs qui s’y connaissent en sciences et estiment de ces questions ne méritent pas qu’on en parle.
Lebwohl et son équipe voient les choses autrement. Ils ont choisi de consacrer leur temps et leur budget à étudier le lien entre gluten et troubles cardio-vasculaires, non pas parce que les deux sont liés mais parce que les gens pensent qu’ils le sont. Et, s’ils le pensent, c’est en raison de Pourquoi le blé nuit à votre santé, un livre qui a eu un succès phénoménal - plus de 1 million d’exemplaires vendus – et laisse entendre que le gluten est mauvais pour le système cardio-vasculaire.
Le livre a été écrit par William Davis, un cardiologue qui accorde aux céréales un intérêt tout à fait disproportionné par rapport à celui que lui porte l’ensemble de la médecine universitaire. Ainsi, il compare la consommation de blé au tabagisme. Aucune association de cardiologues ou de spécialistes de la médecine préventive ne recommande d’éliminer systématiquement le gluten. Mais c’est justement le côté hors norme de l’hypothèse alarmiste de Davis qui semble expliquer le succès du son livre. Davis promet au lecteur de lui révéler des secrets que personne d’autre n’est disposé à dévoiler, et donc de lui donner un avantage par rapport aux naïfs qui se font berner par le système. C’est un discours vendeur. Dans un précédent article, je faisais remonter l’obsession des produits sans gluten à Pourquoi le blé nuit à votre santé et aux quatre livres dérivés qu’a publiés le même auteur. En tout, cinq ouvrages pour dire aux gens de ne plus consommer de céréales.
Pourquoi le blé nuit à votre santé a un complice, le tout aussi fallacieux Ces glucides qui menacent notre cerveau (2). Son auteur, David Perlmutter, y qualifie le gluten de « tabac de notre génération ». L’ouvrage est lui aussi devenu un best-seller avec la promesse de révéler des secrets qu’on nous cache, à savoir qu’éliminer les céréales de notre alimentation permet de prévenir et d’enrayer la démence. Il est lui aussi fondé sur l’idée que l’intolérance au gluten provoque des inflammations dans tout l’organisme, ce qui n’a jamais été démontré.
« Pourquoi le blé nuit à votre santé s’est approprié beaucoup des connaissances scientifiques sur la maladie cœliaque pour les extrapoler à l’ensemble de la population, explique Lebwohl. Par exemple l’idée que le gluten est en soi une source d’inflammation. Les données dont nous disposons à ce sujet sont très floues. »
Mais, comme les gens y croient, ces idées font désormais l’objet de recherches sérieuses. Elles ont été popularisées par des patients qui ne se sentaient pas écoutés et étaient donc vulnérables aux discours démagogiques. Aujourd’hui, le corps médical, longtemps jugé élitiste et borné, paie le prix de ce rapport de force.
L’étude sur le gluten et les maladies cardio-vasculaires a été financée par l’Association américaine de gastro-entérologie, le Massachusetts General Hospital de Boston et les Instituts nationaux de la santé. Toute idée bien arrêtée provoque à un moment ou à un autre une réaction de rejet.
Dans le cas du gluten, c’est la dissidence qui a désormais la main. L’équipe de Columbia travaille à une autre étude portant sur le lien entre gluten et cancer. (Il n’y a aucune raison de penser que les deux sont liés. Mais certains en sont convaincus.)
« Je suis persuadé qu’il faut mener des recherches rigoureuses sur les choses qui intéressent les patients, confie Lebwohl. Cela fait partie des missions de la science : se saisir de ce qui préoccupe la population et lui fournir des analyses solides. Si l’opinion se fourvoie, il faut en tenir compte. »
Certains redoutent que nous soyons entrés dans un cercle vicieux, où la science courra sans cesse après ce que les gens auront déjà choisi de croire à propos du gluten. Mais, pour d’autres, c’est exactement ainsi que la science doit fonctionner.
En attendant, Lebwohl conseille aux patients méfiants à l’égard du gluten de se méfier plutôt de « tout praticien qui assure que le problème vient de leur intestin perméable ». Et des « laboratoires d’analyses qui diagnostiquent les intolérances alimentaires. Si un labo propose des tests qui ne sont pris pas en charge par les assurances, il se peut qu’il cherche à détecter des choses qui sont complètement impossibles à prouver. Il y a plein de gens qui sont prêts à profiter de ceux qui cherchent des réponses immédiates ».
— Cet article est paru dans The Atlantic le 18 mai 2017. Il a été traduit par Delphine Veaudor.
[post_title] => Peut-on dédiaboliser le gluten ?
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => on-dediaboliser-gluten%e2%80%89
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-04 15:05:24
[post_modified_gmt] => 2019-03-04 15:05:24
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=55593
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 54863
[post_author] => 8
[post_date] => 2018-10-18 07:00:58
[post_date_gmt] => 2018-10-18 07:00:58
[post_content] => Dans 1984, le roman dystopique de George Orwell, le Parti se maintient au pouvoir grâce à un contrôle total des pensées et des actions des citoyens. Winston Smith, rédacteur au ministère de la Vérité, réécrit l’histoire en permanence. La novlangue (1), langue officielle de la société, écrit Orwell, « visait à exclure tout autre mode de pensée […] Il fallait donc créer de nouveaux mots, mais aussi et surtout éliminer les mots indésirables et dépouiller ceux qui restaient de leurs sens hétérodoxes, et d’ailleurs de tout sens second dans la mesure du possible. Prenons un seul exemple : le mot “libre” existait toujours, mais seulement dans des énoncés comme “ce siège est libre” » .
Le sujet d’Orwell est bien sûr la politique et la société, pas les troubles neurologiques, mais 1984 livre cependant de remarquables intuitions sur ces derniers. La novlangue est d’une grande précision, ce qui se retrouve dans certaines affections neurologiques. Certains patients sont incapables de comprendre les métaphores ou les généralisations. Ils ne se soucient pas de se contredire. À la suite d’un AVC, par exemple, le patient dont le bras est paralysé ne le reconnaît pas comme sien. Si, à l’aide d’une seringue, on lui injecte de l’eau froide dans l’oreille, cela active les canaux du système vestibulaire de l’oreille interne.
Soudain, sans qu’il ait le sentiment de se contredire, il dit : « Regardez ! C’est mon bras ! Il est paralysé. » Et quand le médecin lui dit qu’il y a quelques instants il niait qu’il s’agisse de son bras, le patient répond : « Je n’ai jamais dit ça. » Le syndrome dit de la main étrangère rappelle la société orwellienne, suggérant un parallèle entre symptômes politiques et symptômes neurologiques. Big Brother exige la capacité d’oublier qu’on a pensé le contraire, écrit Orwell.
Autre exemple : certains patients sont incapables de nommer l’objet ou la personne qu’ils ont sous les yeux. Si je regarde une fourchette, quel objet suis-je en train d’observer ? La fourchette posée sur la table devant moi ou celle que tient mon voisin qui mange ses spaghettis ? L’incapacité de reconnaître que différentes occurrences d’un objet ou d’une personne désignent le même objet ou la même personne dénote une incapacité neurologique à catégoriser.
Les patients atteints de prosopagnosie sont incapables de reconnaître les visages, souvent parce qu’ils ne sont pas en mesure de faire le lien entre les images d’un visage vu sous différents angles. Quand j’appelle mon amie Lise, de quelle Lise s’agit-il, si la seule que je reconnaisse est celle qui figure sur la photo que je garde dans ma poche ? Les expressions faciales changent constamment, et normalement nous reconnaissons notre amie malgré ces changements. Le cerveau doit créer toute une catégorie d’images d’un visage et « comprendre » qu’elles sont des versions du même visage. C’est l’une des fonctions fondamentales du cerveau que de catégoriser les perceptions, les souvenirs, les pensées, les sons et les odeurs – même si l’on ne comprend pas très bien comment il accomplit cette tâche. Quand on dit : « Bonjour Barbara », on mobilise toute une série de liens que l’on a avec cette personne et que son nom incarne. Ne pas être capable de nommer la personne avec laquelle on parle témoigne en un sens d’une incapacité à catégoriser. Comme l’écrit Orwell, « la réduction radicale du nombre de mots » opérée par la novlangue a pour objet de « rétrécir le champ de la pensée ».
Dans le film d’animation japonais Le Voyage de Chihiro, la sorcière vole le nom d’une fillette, Chihiro, qui non seulement perd complètement le souvenir de son nom mais tout sens de l’identité. En perdant son nom et son identité, elle perd tout sens du rapport au monde dans lequel elle vivait – comme Winston Smith à la fin de 1984. La sorcière, qui a volé la capacité de l’enfant à catégoriser et à généraliser, peut la manipuler à son gré. Elle lui donne un nouveau nom. L’enfant appartient dès lors à un nouveau monde, et ses expériences passées ont été complètement effacées de son esprit. Dans son nouveau monde, ses parents sont des cochons et n’ont aucun souvenir d’avoir été des parents. Quand elle retrouve finalement son nom et donc son identité, elle retrouve aussi les liens avec son passé et avec ses parents.
Notre univers perceptif ne cesse de changer, et notre cerveau doit donner un sens à ce monde constamment changeant. En fin de compte, notre sentiment d’unicité, d’être une personne unique, ne peut être séparé du fait de savoir que l’on a un nom, de même que notre conscience de cette chose qu’on appelle le rouge ne peut être séparée du mot « rouge ». Nous sommes notre nom. Nous donnons un nom aux abstractions, aux personnes, aux qualités, aux choses et aux êtres – nous-même y compris –, et cette action de nommer révèle la faculté du cerveau à créer une relation abstraite qu’il appréhende indépendamment de la conscience immédiate de ce qui l’entoure. Or une lésion cérébrale peut limiter cette conscience. Les chercheurs allemands Gelb et Goldstein avaient une patiente considérant que le mot « rouge » était dénué de sens. Elle avait une lésion cérébrale qui la rendait incapable de reconnaître que différentes nuances d’une couleur étaient les variations d’une même couleur.
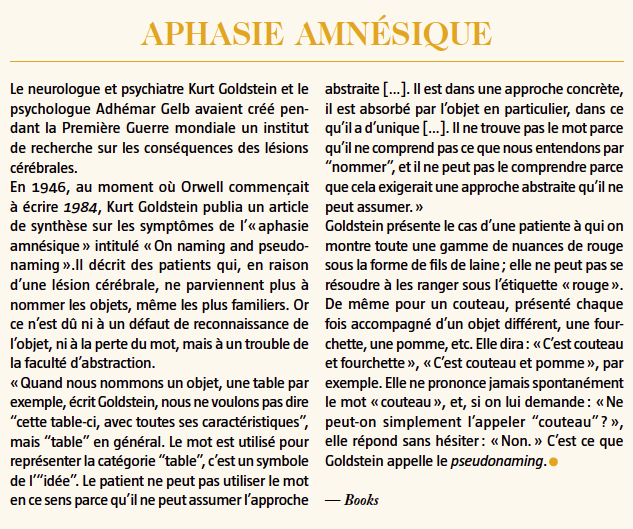 Chose intéressante, certaines de ces données de la neurologie ont leur parallèle en physique théorique. Dans les années 1950, Hugh Everett, étudiant en physique à Princeton, écouta Einstein formuler des doutes sur la mécanique quantique lors d’un séminaire.
Everett tenta de surmonter les problèmes évoqués par Einstein en concevant un monde d’univers multiples dans lequel tous les univers possibles existent simultanément, sans néanmoins qu’il y ait de communication entre eux. Les univers parallèles peuvent servir de métaphore pour illustrer le cas des personnalités multiples, comme dans le roman de Robert Louis Stevenson L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le Dr Jekyll est un chercheur en chimie et Mr Hyde consacre ses nuits à étrangler des femmes. Le Dr Jekyll est un homme élégant, Mr Hyde est petit et bossu. Le Dr Jekyll ignore les activités nocturnes de Mr Hyde, lequel n’est pas au fait des recherches du Dr Jekyll. De même, les univers multiples des physiciens quantiques sont complètement indépendants les uns des autres. Nous vivons tous nous-mêmes dans des univers multiples, car nos perceptions, nos souvenirs et nos émotions migrent sans cesse de façon à nous permettre de donner du sens au monde et de survivre.
Témoin les arts contemporains, qui multiplient les perspectives – y compris en musique. En 1913, Marcel Proust accorda un entretien au Petit Parisien l’avant-veille de la publication du premier volume d’À la recherche du temps perdu. Il y disait : « Vous savez qu’il y a une géométrie plane et une géométrie dans l’espace (2). Eh bien, pour moi, le roman ce n’est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. »
Chose intéressante, certaines de ces données de la neurologie ont leur parallèle en physique théorique. Dans les années 1950, Hugh Everett, étudiant en physique à Princeton, écouta Einstein formuler des doutes sur la mécanique quantique lors d’un séminaire.
Everett tenta de surmonter les problèmes évoqués par Einstein en concevant un monde d’univers multiples dans lequel tous les univers possibles existent simultanément, sans néanmoins qu’il y ait de communication entre eux. Les univers parallèles peuvent servir de métaphore pour illustrer le cas des personnalités multiples, comme dans le roman de Robert Louis Stevenson L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le Dr Jekyll est un chercheur en chimie et Mr Hyde consacre ses nuits à étrangler des femmes. Le Dr Jekyll est un homme élégant, Mr Hyde est petit et bossu. Le Dr Jekyll ignore les activités nocturnes de Mr Hyde, lequel n’est pas au fait des recherches du Dr Jekyll. De même, les univers multiples des physiciens quantiques sont complètement indépendants les uns des autres. Nous vivons tous nous-mêmes dans des univers multiples, car nos perceptions, nos souvenirs et nos émotions migrent sans cesse de façon à nous permettre de donner du sens au monde et de survivre.
Témoin les arts contemporains, qui multiplient les perspectives – y compris en musique. En 1913, Marcel Proust accorda un entretien au Petit Parisien l’avant-veille de la publication du premier volume d’À la recherche du temps perdu. Il y disait : « Vous savez qu’il y a une géométrie plane et une géométrie dans l’espace (2). Eh bien, pour moi, le roman ce n’est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. »
Comme si l’on vivait en même temps dans deux univers parallèles
Un siècle et demi auparavant, David Hume avait fait valoir que la nature de notre conscience et de nos souvenirs était « fluctuante, incertaine, fugace, successive et composée ». C’est bien le caractère « fluctuant, incertain, fugace » de la conscience que Picasso et Braque ont tenté de rendre dans certaines de leurs premières toiles cubistes. La « conscience incertaine, fugace » est aussi l’un des principaux thèmes de La Recherche. En voiture dans la campagne, le narrateur aperçoit au loin les deux clochers de Martinville. Soudain, un troisième clocher, Vieuxvicq, surgit à sa vue. Le narrateur peine à évaluer la distance qui le sépare des clochers. Il les pense lointains quand, après un virage, les clochers se trouvent soudain devant lui : « ils s’étaient jetés si rudement au-devant [de la voiture], qu’on n’eut que le temps d’arrêter pour ne pas se heurter au porche ». Notre perception des personnes et des objets varie d’un moment à l’autre « comme un accident de terrain, de colline ou château qui, apparaissant tantôt à droite, tantôt à gauche, semble d’abord dominer une forêt, ensuite sortir d’une vallée, et révéler ainsi au voyageur des changements d’orientation et des différences d’altitude dans la route qu’il suit » (3).
De même que nous n’avons pas de vue arrêtée du paysage, nous n’avons pas de chemin arrêté pour nous comprendre l’un l’autre. La psychologie humaine est fluctuante et incertaine. Orwell avait bien compris l’importance de notre « conscience incertaine et fugace », et c’est précisément ce trait de notre psychologie que le Parti s’efforce d’éliminer dans 1984. Dans la dystopie orwellienne, la violence et la douleur infligée sont un moyen de contrôler la société en dépersonnalisant l’individu. Catherine Temerson y consacre un chapitre de sa thèse de doctorat, The Dissenting Hero and the Search for a Just Society, soutenue en 1975 à l’université de New York (NYU).
Confrontés à une soudaine expérience violente ou à une violence à répétition, les mécanismes de protection du cerveau créent une dissociation, un individu séparé qui isole la réaction de stress. L’individu déconnecte ses réactions sensorielles et émotionnelles et revit les épreuves comme s’il était séparé en deux : une partie revit le stress tandis que l’autre oublie complètement le stress auquel son cerveau a été soumis. La réaction du cerveau au stress ne fait plus sens pour l’autre partie du cerveau. L’esprit a créé une seconde image de soi qui réagit aux événements, bons ou mauvais, mais ses réactions sont celles d’un moi qu’il tient à distance. C’est comme si l’on vivait en même temps dans deux univers parallèles. Le cerveau crée un moi qui permet aux deux moi de coexister.
Après quoi le cerveau continue de vivre dans des mondes parallèles même quand les événements traumatiques ont disparu. Certaines méthodes thérapeutiques, comme l’hypnose, peuvent réunir les deux moi en un moi unique, ce qui permet de surmonter le stress et de réunifier l’individu, lequel redevient une personne à part entière et n’est plus une victime. Les émotions se font plus physiques, et la subjectivité, l’identité se recentrent. Les émotions concernent la personne et non une seconde image de la personne. Au cours de ce processus, les mondes multiples qui étaient une part essentielle de la psychologie de l’individu fusionnent en un seul monde. On accède soudain au contrôle de sa vie, on n’est plus soumis à un stress qu’on ne peut ni comprendre ni contrôler. Quand les parents de Chihiro se transforment en cochons, la fillette est si choquée que son univers se divise en deux ; elle oscille constamment entre deux mondes, jusqu’à ce que la sorcière lui vole son nom, après quoi elle appartient au monde des yokai, les esprits et démons du folklore japonais.
La mémoire est l’identité
De la même façon, dans 1984, Winston, qui travaille au ministère de la Vérité, se consacre à réécrire le passé et à en modifier les photos. Il n’a pas le sens de la relation au présent, au passé et à l’avenir. Il vit dans un présent immédiat, stérile, dont il ne peut sortir. Le présent que Winston a créé pour lui-même et les autres est une sorte de non-réalité. Cliniquement, quand on souffre d’une perte du sens de la réalité, on a le sentiment d’être entouré d’un monde qui n’est pas réel. On vit dans un monde parallèle. Le monde réel est comme un rêve. Comme Orwell l’écrit dans le roman, « il se sentait comme errant dans les forêts du fond des mers, perdu dans un univers monstrueux dans lequel il était lui-même le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur inimaginable. Quelle certitude avait-il qu’un seul être humain vivant était de son côté ? Et quel moyen de savoir si la domination du Parti n’allait pas durer à jamais ? ». Pour Winston, il n’y a même pas de réalité parallèle. Il n’y a ni mondes multiples, ni « réalité ». Nous comprenons le présent à travers le passé, une compréhension qui révise, modifie et retravaille en permanence la nature même du passé. Winston Smith n’a aucun souvenir de son enfance, seulement une vague mémoire de son passé. Le plus troublant peut-être est la manière dont les émotions se détachent des souvenirs, lui laissant l’impression que ses souvenirs sont faux. De fait, dans le cerveau, les représentations des souvenirs – les modes de connexion entre les neurones – changent constamment. Un souvenir n’est jamais « fixé ». Les souvenirs sont constamment mis à jour ; sans quoi ils perdraient leur sens.
Dans les années 1920, le neurologue français Joseph Capgras a décrit un syndrome qui porte aujourd’hui son nom. Mme M. ne pouvait pas reconnaître son mari. Elle disait que son visage changeait constamment. Son cerveau était incapable de relier les différentes images du visage de son mari (la longueur de ses moustaches, par exemple) à la même personne. Mais l’absence de permanence des souvenirs, le fait qu’un souvenir change chaque fois que le cerveau tente d’y avoir accès est l’exact opposé de l’objectif du monde politique de 1984, où le pouvoir cherche à instiller dans la population de faux souvenirs permanents, immuables. Toute la structure politique est conçue pour créer l’impression que les souvenirs de chacun appartiennent à une vérité plus large. L’importance de chaque souvenir individuel – l’individu a un ensemble unique de souvenirs – est que la mémoire est l’identité. Des troubles neurologiques limitent cette unicité, et le comprendre ajoute une perspective à l’idéologie de 1984.
— Cet article, rédigé en anglais puis publié en allemand dans la revue Lettre internationale en juillet 2018, a été révisé pour Books par les auteurs. Il a été traduit par Olivier Postel-Vinay.
[post_title] => Orwell, Big Brother et le cerveau
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => orwell-neurologue
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-12 15:21:07
[post_modified_gmt] => 2019-03-12 15:21:07
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=54863
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 54875
[post_author] => 8
[post_date] => 2018-10-18 07:00:49
[post_date_gmt] => 2018-10-18 07:00:49
[post_content] => Il y a deux ans, Kazushige Nishida, un salaryman (1) sexagénaire de Tokyo, s’est mis à louer une épouse et une fille à temps partiel. Sa vraie femme venait de mourir et, six mois plus tôt, leur fille de 22 ans avait quitté le domicile familial à la suite d’une dispute et n’était jamais revenue.
« Je me croyais solide, me confie M. Nishida quand nous nous rencontrons en février dans un restaurant près d’une gare de banlieue. Mais, quand on n’a plus personne, on se sent très seul. » Nishida est grand et légèrement voûté, il porte un costume et une cravate grise et parle d’une voix grave et posée avec un brin d’autodérision.
Évidemment, Nishida a continué à se rendre au travail tous les jours, au service commercial d’une entreprise industrielle, et à aller boire un verre ou jouer au golf avec ses amis. Mais le soir il se retrouvait seul. Il pensait qu’à la longue il s’y habituerait, mais en fait il le vivait de plus en plus mal. Il a essayé les bars à hôtesses ; c’est sympa de parler aux filles, mais, à la fin de la soirée, on se retrouve de nouveau tout seul et on se sent bête d’avoir dépensé tant d’argent.
Nishida s’est souvenu alors d’avoir vu à la télévision un reportage sur Family Romance [« Roman familial »], l’une des nombreuses agences au Japon qui proposent des familles de substitution. Il a contacté Family Romance et engagé une épouse et une fille pour dîner avec lui. Sur le bon de commande, il avait indiqué l’âge de sa fille et le physique de son épouse (1,52 m, un peu dodue). Coût : 40 000 yens, soit environ 310 euros. La première rencontre a eu lieu dans un café. La fille de location était habillée avec plus de goût que sa vraie fille, mais l’épouse lui a tout de suite fait l’impression d’une femme banale, entre deux âges. « À la différence de Mme Matsumoto », précise-t-il en signalant mon interprète, Chie Matsumoto, de la tête. Chie, qui est journaliste, universitaire et militante et a des cheveux poivre et sel coiffés en épi et des lunettes à monture plastique, rigole en traduisant cette description.
L’épouse de location a demandé à Nishida comment la fille et elle devaient se comporter. Il a montré le mouvement de tête que faisait sa femme décédée pour remettre de l’ordre dans ses cheveux, et les petits coups affectueux que sa fille lui donnait dans les côtes. Puis les deux femmes ont endossé leurs rôles. L’épouse de location l’appelait Kazu, comme sa femme, et rejetait la tête en arrière pour se recoiffer. La fille de location lui donnait de petits coups dans les côtes. Quelqu’un d’extérieur aurait pu les prendre pour une vraie famille.
Nishida a réservé une deuxième rencontre. Cette fois, l’épouse et la fille sont venues chez lui. L’épouse a préparé des okonomiyaki, des galettes comme en confectionnait la femme de Nishida, tandis que celui-ci bavardait avec la fille. Ensuite, ils ont dîné et regardé la télé.
D’autres dîners en famille ont suivi ; en général, c’était à la maison, mais une fois ils sont allés manger des monjayaki, une autre sorte de galette que la défunte Mme Nishida affectionnait. Ce n’était pas un repas gastronomique, et Kazushige s’est demandé s’il n’aurait pas dû inviter les deux femmes dans un restaurant plus chic. Mais, après tout, les Nishida n’allaient jamais dans ce genre d’endroit.
Avant la rencontre suivante, il a eu l’idée d’envoyer à Family Romance un double de ses clés. Quand il est rentré du travail ce soir-là, les lumières étaient allumées, il faisait bon dans l’appartement, et une épouse et une fille étaient là pour l’accueillir. « C’était bien agréable », se souvient Nishida en esquissant un sourire. Quand les femmes sont parties, il ne s’est pas senti malheureux, mais il s’est dit qu’il aimerait bien passer une autre soirée avec elles.
Nishida continue à les appeler par les prénoms de son épouse et de sa fille, et leurs rencontres continuent de prendre la forme de dîners de famille, mais les femmes ont jusqu’à un certain point cessé de jouer un rôle et « sont redevenues elles-mêmes ». L’épouse de location « sort parfois du cadre de la famille de location » pour se plaindre de son vrai mari, et Nishida lui donne des conseils. Ce relâchement des rôles lui a fait réaliser que lui aussi en jouait un, celui du bon père et mari, veillant à ne pas avoir l’air trop malheureux, disant à sa fille comment tenir son bol de riz. À présent, il se sent plus léger. Il a enfin été capable de parler de sa vraie fille, de l’état dans lequel il s’est mis quand elle lui a annoncé qu’elle allait s’installer avec un garçon qu’il n’avait jamais rencontré, et du fait qu’ils se sont disputés puis brouillés.
Le but : que le client n’ait plus besoin d’une famille de location
Sur ce sujet, la fille de location avait beaucoup à dire. Elle trouvait que Nishida n’avait pas eu la bonne attitude et que c’était à lui de faire le premier pas. « Ta fille attend que tu l’appelles. » Nishida semble ne plus savoir très bien ce qu’a dit la fille de location, ni à qui elle s’adressait. « Elle jouait un rôle de fille, mais en même temps elle exprimait ce qu’elle ressentait en tant que vraie fille. Pourtant, si on avait été dans un vrai rapport père-fille, elle n’aurait peut-être pas parlé aussi franchement. »
Nishida a fini par appeler sa fille – ce qu’il n’aurait pas fait, dit-il, si sa remplaçante ne l’avait pas aidé à comprendre son point de vue. Il leur a fallu plusieurs tentatives, mais ils ont enfin réussi à se joindre. Un jour, à son retour du travail, il a trouvé des fleurs fraîches qui avaient été déposées pour sa femme devant l’autel familial et il a compris que sa fille était passée en son absence. « Je n’arrête pas de lui dire de venir me voir, dit-il doucement, en pliant et repliant l’essuie-main que la serveuse lui a apporté. J’espère la revoir bientôt. »
Yuichi Ishii, le fondateur de Family Romance, me dit que lui et sa troupe d’acteurs s’emploient à produire ce genre de résultats, c’est-à-dire à ce que le client n’ait plus besoin d’une famille de location. Son but, affirme-t-il, est « de faire advenir une société où plus personne n’aura besoin de nos services ». Ishii, la trentaine élégante, arrive tout droit d’une interview à la télévision. Il porte un costume à rayures avec des boutons de manchettes et une épingle à cravate assortie. Sur la carte de visite qu’il me tend figure son visage dessiné et la devise « Plus de plaisir que la réalité ne peut en procurer ».
Ishii est né à Tokyo et a grandi au bord de la mer, dans la préfecture de Chiba, où son père était marchand de fruits et sa mère monitrice de natation. Quand il était à l’école primaire, il épatait ses copains avec les canulars qu’il faisait depuis une cabine téléphonique en prenant une voix d’adulte. À 20 ans, il a été repéré par une agence artistique et a fait un peu de mannequinat et de figuration. Il a aussi travaillé comme aide-soignant auprès de personnes âgées. Il me montre sur son téléphone des photos de lui, plus jeune, travesti lors de différentes fêtes dans des maisons de retraite, entouré de pensionnaires aux anges. Il adorait avoir le sentiment d’aider les gens et était fier d’être l’aide-soignant le plus demandé. De fait, il était déjà un petit-fils de location.
Il y a onze ans, une amie d’Ishii, mère célibataire, lui a dit qu’elle avait du mal à inscrire sa fille dans une bonne école parce qu’on donnait la priorité aux enfants de couples mariés. Ishii a proposé de jouer le rôle du papa lors de l’entretien d’inscription. Cela n’a pas marché – la fillette n’était pas habituée à lui et leurs échanges manquaient de naturel –, mais cet épisode l’a encouragé à faire mieux et à « réparer les injustices » en aidant d’autres femmes dans le même cas. En se renseignant pour savoir si quelqu’un avait déjà pensé à créer un service de ce genre, il est tombé sur le site d’une agence de location de proches nommée Hagemashi-tai.
Hagemashi-tai, littéralement « J’ai envie de te remonter le moral », a été créée en 2006 par Ryuichi Ichinokawa, un ancien salaryman marié et père de deux garçons. Ichinokawa avait été très choqué cinq ans plus tôt par une attaque au couteau dans une école primaire de la banlieue d’Osaka qui avait fait huit morts, des enfants de l’âge de ses fils. Les tragédies de ce genre sont rares au Japon, et les établissements scolaires ne disposent pas de services d’aide psychologique. Ichinokawa s’est donc inscrit à une formation dans l’idée de devenir psychologue scolaire. Finalement, il a créé un service de consultation en ligne. De là, il s’est diversifié dans la location de proches. Beaucoup de problèmes lui semblaient en effet découler de la disparition d’un être cher ; la solution la plus simple était de trouver à remplacer cette personne.
Ishii a proposé ses services à Hagemashi-tai, mais, à 26 ans, on le trouvait trop jeune pour incarner un père ou un mari, et on ne lui confiait que des rôles d’invité à des réceptions de mariage. Les mariages constituent le fonds de commerce des agences de location de proches, sans doute parce que l’urbanisation, l’exode rural, la diminution de la taille des familles et la fin de l’emploi à vie ne permettent plus de se conformer aux traditions en matière de nombre d’invités. Les mariés sans emploi engagent des collègues et des supérieurs de substitution. Ceux qui ont souvent changé d’école louent des amis d’enfance. Les fiancés qui ne veulent pas s’imposer mutuellement leurs problèmes familiaux font parfois appel à des figurants pour remplacer leurs parents divorcés, en prison ou atteints de troubles mentaux. Un client de Hagemashi-tai a loué des parents parce qu’il ne voulait pas dire à sa promise que ces derniers étaient décédés.
En 2009, Ishii décide de créer son entreprise. Première étape : trouver un nom facile à retenir. En cherchant des expressions en lien avec l’idée d’une famille imaginaire, il tombe sur un texte de Freud de 1909, « Le roman familial des névrosés » (2). Les enfants, dit Freud, pensent à un moment donné que leurs parents sont des imposteurs et qu’eux-mêmes sont en fait issus d’une famille royale ou noble. Pour Freud, ce fantasme est une façon pour l’enfant de surmonter la déception, douloureuse et inévitable, qu’il ressent à l’égard de ses géniteurs. Si les parents ne cessaient pas de nous sembler tout-puissants et infaillibles, comme c’est le cas dans la petite enfance, nous ne deviendrions jamais autonomes. En même temps, comment supporter la perte brutale et irrémédiable de ces êtres qui nous sont si chers ? Le « roman familial » est ce qui permet à l’enfant de s’accrocher encore un peu à cet idéal en le reportant sur des « parents nouveaux et de haut rang », pourvus de traits merveilleux « qui reposent sur les souvenirs réels des parents effectifs, ceux d’un niveau plus bas », écrit Freud. De cette façon, l’enfant « n’élimine pas » ses parents mais les « élève », et « tout l’effort visant à remplacer le père par un père plus huppé n’est que l’expression de la nostalgie qu’éprouve l’enfant à l’égard de cette époque heureuse et perdue où son père lui est apparu comme l’homme le plus éminent et le plus fort et sa mère comme la femme la plus chère et la plus belle ».
En plus de Family Romance, Ishii dirige une agence de casting et une société de conseil en informatique. Il emploie vingt personnes à plein temps, dont sept ou huit travaillent uniquement pour Family Romance. Il possède dans sa base de données les références de quelque 1 200 comédiens. Les grosses interventions ponctuelles comme les mariages représentent environ 70 % du chiffre d’affaires de Family Romance, le reste venant de prestations personnalisées qui peuvent, comme dans le cas de Kazushige Nishida, s’étendre sur des années.
Depuis 2009, Ishii a joué le rôle du mari auprès d’une centaine de femmes. Soixante de ces missions sont toujours en cours. Il lui est arrivé au début de sa carrière d’intervenir jusque dans dix familles en même temps – une charge de travail insoutenable. « On a l’impression de porter la vie de quelqu’un sur ses épaules », confie-t-il. Depuis, il a instauré une règle : aucun acteur ne peut tenir plus de cinq rôles à la fois.
Un des risques du métier est que le client devienne dépendant. Ishii estime que 30 à 40 % des femmes qui entretiennent des relations suivies avec des maris de location finissent par les demander en mariage. Les clients hommes ont moins de risques de s’attacher parce que, pour des raisons de sécurité, les épouses de location leur rendent rarement visite chez eux. La femme et la fille de Nishida ont fait une exception parce qu’elles étaient deux. En règle générale, les conjoints loués ne sont pas censés se retrouver en tête-à-tête avec les clients, et le contact physique doit se limiter à se tenir les mains.
C’est avec les mères célibataires que la dépendance est la plus difficile à gérer. « On ne peut pas juste les repousser et leur dire froidement : “Non, ça, on ne le fait pas”, parce qu’on a la responsabilité de tenir notre rôle sur la durée », explique Ishii. Dans ce genre de cas, la première chose qu’il fait est de limiter la fréquence des rendez-vous à un tous les trois mois. Ça marche avec certaines personnes ; mais d’autres exigent d’avoir des rencontres plus fréquentes. Il arrive qu’il faille mettre fin d’autorité à une prestation.
Cet hiver, à Tokyo, j’ai rencontré des collaborateurs de Family Romance et de Hagemashi-tai. Ils sont intervenus dans des mariages, des séminaires spirituels, des salons professionnels, des concours d’humoristes et des soirées de lancement d’albums de jeunes stars de la pop. Une actrice a joué le rôle d’épouse pour un client pendant sept ans ; la véritable épouse avait pris du poids, si bien que le mari en avait engagé une de substitution pour sortir avec ses amis. Cette comédienne a aussi remplacé des mamans obèses lors de fêtes d’école, car les enfants de parents en surpoids font parfois l’objet de brimades. Ichinokawa et Ishii m’ont raconté bien d’autres histoires. Une hôtesse de cabaret a engagé un client pour qu’il la réclame, elle, et uniquement elle. Une femme aveugle a loué un ami voyant pour qu’il l’aide à repérer les beaux garçons dans les bals pour célibataires. Une femme enceinte a engagé une mère pour persuader son petit ami de reconnaître leur enfant, et un jeune homme a loué un père pour se concilier les bonnes grâces des parents de sa petite amie enceinte.
Les femmes célibataires que les parents harcèlent pour qu’elles se marient engagent souvent de faux fiancés ou petits amis. Si les parents demandent à revoir le garçon, la fille essaiera généralement de gagner du temps puis dira qu’au final la relation n’a pas marché. Mais il arrive que les parents ne lâchent pas l’affaire et qu’il faille en faire plus. Ishii raconte que, deux ou trois fois par an, il doit organiser des mariages fabriqués de toutes pièces. Cette prestation est facturée autour de 5 millions de yens [environ 39 000 euros]. Dans certains cas, la mariée invite de vrais collègues, amis et proches. Dans d’autres, tout le monde est acteur, sauf la mariée et ses parents. Le témoin de location fait un discours qui tire parfois des larmes aux faux invités. Quand Ishii tient le rôle du marié, il éprouve des émotions complexes. Un faux mariage, dit-il, est aussi difficile à organiser qu’un vrai. Lui et la cliente le planifient des mois à l’avance. À chaque fois, admet Ishii, « je finis par en pincer pour elle ». Pour ce qui est du baiser des époux, certaines mariées préfèrent le simuler alors que d’autres décident d’y aller franchement. Ishii essaie de faire comme s’il jouait dans un film, mais souvent, ajoute-t-il, « j’ai l’impression d’être vraiment en train d’épouser la femme ».
De toutes les prestations proposées par Family Romance, la plus surprenante à mes yeux est la « location de réprimandeurs ». Les réprimandeurs se font engager non pas, comme je l’avais imaginé, par des clients qui ont quelque chose à reprocher à un tiers, mais par des personnes qui ont « commis une faute » et ont besoin qu’on les aide à « expier ».
Un des acteurs, Taishi, un moniteur de sport de 42 ans, m’a raconté sa première prestation de ce type. Le client était un chef d’entreprise d’une bonne cinquantaine d’années qui se plaignait d’avoir perdu la niaque. Il déléguait à ses subordonnés et allait jouer au golf ou fréquentait des bars à hôtesses aux frais de l’entreprise. Le comptable était au courant de ces dépenses, donc les autres salariés sans doute aussi, et cela lui faisait honte. Impressionné par tant de lucidité et hésitant à engueuler un chef d’entreprise de quinze ans son aîné, Taishi suggéra à son client de parler avec ses salariés ou d’aller boire un verre avec eux, et de cesser de faire assumer ses dépenses personnelles à la société. Le client répondit par une diatribe sur la distance qu’un patron doit avoir avec ses salariés, expliquant que tout changement d’attitude de sa part intimiderait son équipe. Il refusait d’aller ne serait-ce qu’à une réunion pour vérifier si ses salariés étaient ou non intimidés. La discussion tournait en rond, et cela commençait à agacer Taishi. « Je lui ai dit : “À quoi bon faire appel à nous si vous ne m’écoutez pas ?” » Et, en ne jouant qu’à moitié la comédie, il tapa du poing sur la table. « Votre problème, c’est que vous êtes têtu », ajouta-t-il en lançant la paille de son soda à l’autre bout de la pièce.
Les excuses sur commande, qui sont l’envers des réprimandes de location, peuvent s’avérer particulièrement délicates. Ishii me décrit quelques scénarios possibles. Si vous commettez une erreur au travail et qu’un client mécontent demande à parler à votre supérieur, vous pouvez engager Ishii pour incarner ce dernier. Ishii se fait passer pour un chef de service et présente des excuses. Si cela ne suffit pas, un autre acteur s’excuse en tant que directeur de département.
Si ce dernier n’aboutit à rien, Ishii dépêche un patron contrit. Les choses peuvent se compliquer dans la mesure où le vrai chef de département et le vrai patron ignorent qu’ils ont présenté des excuses. Parfois, quand le client mécontent n’a jamais rencontré la personne incriminée, Ishii se substitue au coupable, lequel se fait passer pour son supérieur. Ishii se fait crier dessus et se prosterne en tremblant, tandis que le vrai coupable observe. Ces scènes, confie Ishii, ont quelque chose de surréel et de déplaisant.
Les excuses à propos de relations extraconjugales sont encore plus stressantes. Il peut arriver qu’un mari trompé exige des excuses de la part de l’amant de sa femme ; si celui-ci s’y refuse, l’épouse infidèle peut alors recourir à une doublure. La technique d’Ishii dans ces situations est de se faire un tatouage éphémère sur le cou et de s’habiller comme un yakuza. Il se rend au domicile du couple, et, quand le mari ouvre la porte, Ishii tombe à genoux et se confond en excuses.
Le but est visiblement de désamorcer toute violence éventuelle en alliant surprise, peur et flatterie. Si l’amant est marié, le mari trompé peut demander à voir les deux membres du couple, dans l’espoir de détruire le ménage de son rival. Si bien que l’amant dont l’épouse ignore la liaison finit aussi par engager une femme de substitution. Une actrice me dit que les rôles d’épouse de l’amant sont ceux qu’elle déteste le plus : outre que ces prestations la font se sentir terriblement coupable, elles ont tendance à s’éterniser, et les maris ont un comportement agressif et se crient dessus.
Par le biais de Family Romance, j’ai engagé une mère de location pour une prestation de deux heures dans le quartier commerçant de Shibuya. Cette perspective m’angoissait déjà avant que je parte au Japon. La veille de mon départ, ma vraie mère m’avait envoyé un joli e-mail pour me souhaiter bon voyage. Elle y évoquait l’un de nos livres préférés à toutes les deux, Quatre sœurs, une fresque familiale de Junichirô Tanizaki datant des années 1940 (3). Ma mère m’avait donné son exemplaire quand j’étais au collège, et, ce qui m’avait plu dans ce roman, c’était combien le mode de communication des sœurs Makioka ressemblait au nôtre. Si je suis devenue écrivaine, n’est-ce pas parce que ma mère m’a fait partager sa passion pour Tanizaki et Kōbō Abe ? J’avais à présent la possibilité de découvrir beaucoup des endroits dont nous avions lu la description. Mais je trouvais injuste d’aller au Japon sans elle et d’engager de surcroît une mère de substitution.
Je rencontre la mère de location au café d’un grand magasin. Je n’ai pas vu sa photo, si bien qu’il me faut un certain temps pour la repérer : une Japonaise d’âge mûr, avec de longs cheveux teints couleur miel. Elle se lève à mon approche.
— Maman ! m’écrié-je avec un grand sourire.
Elle m’embrasse à son tour, quoique avec une certaine réserve.
— Alors, comment procède-t-on ? me demande-t-elle dans un anglais américain sans accent. Vous souhaitez m’interviewer ou vous voulez le jeu de rôle ?
Comme je l’ai retenue pour deux heures, je propose de faire les deux.
— Ça me fait un peu bizarre, parce que, généralement, quand je joue la mère, la fille a dans les 20 ans, m’explique-t-elle, ajoutant qu’elle en a 56, soit seulement seize de plus que moi.
Elle propose le contexte suivant : ma mère est partie vivre au Japon pour une raison quelconque et nous nous revoyons pour la première fois depuis des années. J’accepte.
Tout à coup, son expression s’adoucit.
— Ça fait si longtemps qu’on ne s’est pas vues.
Sa voix aussi est devenue plus douce, plus mélancolique. Je ressens un petit frisson d’émotion.
— Oui, ça fait très longtemps.
— Je ne sais pas de quoi tu te souviens exactement. Je ne sais pas si tu te rappelles les moments que nous avons passés ensemble.
La tristesse dans sa voix me rappelle ma vraie mère quand elle évoquait l’époque où, après le divorce de mes parents, j’ai vécu chez mon père.
— Bien sûr que je me souviens, dis-je en guise d’encouragement. (Et je me surprends même à chercher un souvenir réel, avant de réaliser qu’il ne peut pas y en avoir puisque nous venons de faire connaissance.) Enfin, pas de façon très précise.
— Eh bien, moi, je me souviens de chaque minute que nous avons passée ensemble, et chaque minute m’est chère. Si seulement il avait pu y en avoir davantage. Je n’ai pas pu passer avec toi autant de temps que j’aurais voulu, à cause de mon travail. Je le regrette à présent.
Je sens la panique monter, comme si une diseuse de bonne aventure m’avait dit quelque chose d’étonnamment exact.
— Tu étais obligée de travailler dur, lui dis-je.
— Et toi, comment ça va ton travail ? Tu n’as pas trop de pression ?
Le charme est rompu : ma vraie mère sait tout de mon travail et ne m’aurait jamais posé cette question.
Nous arrêtons donc le jeu de rôle et passons à l’entretien. Elle s’appelle Airi et a passé la plus grande partie de son enfance aux États-Unis et au Canada, en raison du travail de son père, chercheur en physique. Dans les années 1970, elle a joué le rôle de « gamine asiatique » dans quelques séries télé. À 14 ans, son père l’a envoyée au Japon pour qu’elle « rentre dans le moule ». Brimée et mise à l’écart parce qu’elle utilisait des mots anglais, elle a appris à rester bouche close jusqu’à ce qu’elle sache parler parfaitement le japonais. À l’issue de ses études, elle a intégré le monde du travail et s’est hissée jusqu’au sommet de plusieurs multinationales, avant de quitter son dernier poste il y a deux ans.
Airi a rejoint peu après l’équipe de Family Romance et se voit désormais confier deux missions par mois. Elle n’a ni enfants, ni famille proche ; en l’espace de vingt ans, elle a perdu son mari, ses parents et sa grand-mère de 110 ans. Les jeunes femmes qui l’engagent comme mère lui parlent parfois de tout ce qu’elles subissent au boulot. Leurs récits lui rappellent tellement ce qu’elle a vécu qu’elle est capable non seulement d’imaginer, mais aussi de ressentir ce qu’aurait pu être sa vie si elle n’avait pas été aussi concentrée sur son travail et qu’elle avait eu des enfants.
Airi et ma mère ont beau avoir des parcours et des personnalités différentes, je constate certaines ressemblances entre leurs vies. Ma mère aussi a dû surmonter beaucoup d’obstacles professionnels pour atteindre un niveau élevé dans son domaine, dans un pays qui n’était pas celui de son enfance. Elle aussi a quitté son travail il y a peu. Quand Airi me parle des choses qui lui plaisent dans sa vie et de celles qui auraient pu aller mieux, j’éprouve un étrange soulagement : elle a été confrontée à peu près aux mêmes difficultés que ma mère mais n’a pas eu de fille ; donc ce n’est pas d’avoir une fille qui lui a créé des difficultés.
Nous parlons de l’article pour lequel je l’interviewe. « J’imagine que je n’aurai droit qu’à quelques lignes », me dit-elle, et j’éprouve soudain de la culpabilité envers ma mère de location. Je ressens même une douleur physique quand elle fait une brève allusion à sa situation financière et me dit qu’elle ne pourra pas continuer longtemps comme ça, puis qu’elle me propose de l’engager comme interprète et que je dois lui dire que j’en ai déjà une. Le plus dur, c’est quand elle me dit qu’aucune des filles qui l’ont engagée n’a demandé à la revoir et que je me rends compte que moi non plus je ne la reverrai pas. Quand elle me propose de me faire faire le tour du grand magasin bien que nous ayons dépassé le temps imparti, je me surprends à accepter.
À la suite la restauration de Meiji, en 1868, les réformateurs ont unifié le Japon sous l’égide d’un empereur « restauré » et entrepris, après des siècles d’isolationnisme et de féodalisme, de transformer le pays en une puissance militaire dotée d’une administration moderne. Le nouveau Code civil qu’ils rédigèrent comportait des dispositions relatives à ce que les Occidentaux appellent la famille, un concept sans véritable réalité juridique au Japon ni mot pour le désigner. On forgea un nouveau terme, kazoku, et on élabora un « système familial » sur la base d’une forme très ancienne d’organisation domestique, le ie (la maison). Fondé en partie sur les principes confucéens, le ie reposait sur une hiérarchie très stricte. Le « chef du ménage » administrait l’ensemble du patrimoine et choisissait un membre de la génération suivante pour lui succéder – le plus souvent le fils aîné, mais parfois un gendre, voire un fils adoptif. La continuation de la maison importait plus en effet que les liens du sang. Les autres membres pouvaient soit demeurer dans le ie, soit en intégrer un autre en se mariant (les filles), soit fonder une maison secondaire (les fils). Dans l’idéologie nationaliste de l’ère Meiji, le Japon est une grande famille où l’empereur est le chef de la maison principale et tous les ménages constituent des maisons secondaires. Le « familialisme » est devenu un élément constitutif de l’identité nationale que l’on oppose à l’individualisme égoïste de l’Occident.
Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle Constitution, rédigée durant l’occupation alliée, vise à remplacer le ie par la famille nucléaire « démocratique » à l’occidentale. Les mariages forcés sont interdits, les époux deviennent égaux devant la loi (4) et le patrimoine doit être partagé équitablement entre les enfants du couple sans considération de sexe ni d’ordre de naissance. Avec la croissance économique de l’après-guerre et l’émergence de la culture d’entreprise, la famille élargie de type ie disparaît au profit de la famille nucléaire vivant en appartement et composée d’un salaryman, d’une femme au foyer et de leurs enfants. Avec le boom économique des années 1980, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler à l’extérieur. La natalité chute, tandis que le taux de divorces et le nombre de foyers monoparentaux augmentent – ainsi que l’espérance de vie et le nombre de personnes âgées.
C’est à ce moment qu’apparaît la location de proches. En 1989, Satsuki Oiwa, la patronne d’une entreprise de formation tokyoïte, se met à proposer des enfants et des petits-enfants à des personnes âgées délaissées. L’idée lui est venue en entendant des salariés regretter d’être trop occupés pour pouvoir rendre visite à leurs parents. La presse parle abondamment des services d’Oiwa et, en l’espace de quelques années, elle envoie des proches à une centaine de clients. Un couple loue un fils pour écouter le récit des déboires du père – leur vrai fils vit avec eux mais refuse d’entendre ces histoires. De plus, leur petit-fils a grandi et ils sont tristes de ne plus pouvoir caresser une peau de bébé. Trois heures de présence d’un fils et d’une belle-fille de location dotés d’un bébé et capables d’écouter patiemment des histoires tristes sont facturées l’équivalent de 1 100 euros. Parmi ses autres clients figure un jeune couple qui cherche des grands-parents de substitution pour leur enfant, et un célibataire qui a loué une épouse et une fille pour voir ce que cela faisait de vivre dans une famille nucléaire comme il en avait vu à la télévision.
Le concept de la location de proches s’est enraciné dans l’imaginaire collectif. En 1993, Misa Yamamura, une célèbre auteure de littérature policière, publie « Affaire de meurtre en lien avec une famille de location », un roman où une vieille dame atteinte d’un cancer se venge de son fils négligent en hypothéquant la maison familiale et en louant un fils, une belle-fille et un petit-fils plus attentionnés. Après son assassinat, on trouve deux exemplaires de son testament – l’un en faveur du fils, l’autre en faveur de la famille de location –, ce qui exacerbe la tension entre les idées reçues sur l’amour filial et les liens économiques qui unissent parents et enfants.
Depuis, la location de proches a inspiré de nombreuses œuvres littéraires. À Tokyo, je rencontre le critique Takayuki Tatsumi, qui a publié une étude sur cette thématique dans les années 1990. Il m’explique que les romanciers postmodernes et queer ont utilisé la figure du proche de location pour représenter la « famille virtuelle », une idée qu’il fait remonter au ie de l’ère Meiji, époque où l’adoption était chose commune et la filiation biologique subordonnée à la préservation de la famille. « Selon Foucault, tout est construit, rien n’est déterminé d’emblée, ajoute-t-il (5). Ce qui compte, c’est la fonction. » Cela me fait penser à une phrase de Satsuki Oiwa que j’ai lue dans un article qui lui était consacré : « Nous ne proposons pas de l’affection familiale, mais de l’affection humaine exprimée par le biais de la famille. »
On continue à trouver des personnages de proches de location dans la littérature et au cinéma. Il y en a par exemple dans trois films japonais récents que j’ai vus dans des avions. Dans la comédie Dorobou Yakusha ou The Stand-In Thief [« Le voleur comédien »], un orphelin noue des liens affectifs avec toute une série d’inconnus solitaires qu’il rencontre en cambriolant une maison ; dans une autre comédie, un beau-père paie le père de sa belle-fille – un bon à rien – pour qu’il passe du temps avec elle. La tonalité de ces portraits semble osciller entre une sorte d’euphorie face à l’alchimie qu’opère le marché en transformant des inconnus en êtres chers et une paranoïa façon Truman Show qui conduit à suspecter tous ses proches de jouer un rôle (6).
L’euphorie et l’effroi trouvent peut-être leur origine dans la déréglementation du marché du travail japonais des années 1990 et l’érosion du style de vie du salaryman d’après guerre qui s’est ensuivie. Aujourd’hui, 38 % des travailleurs ont des emplois précaires (beaucoup d’articles de la presse japonaise consacrés aux proches de location présentent cette activité comme un travail d’appoint pouvant apporter un complément de revenu aux lecteurs). En 2010, le nombre de foyers monoparentaux a dépassé pour la première fois celui des familles nucléaires. Au Japon comme ailleurs, les jeunes d’aujourd’hui sont plus mobiles et ont plus de possibilités d’expression individuelle, mais font moins l’expérience de la sécurité, du collectif et de la famille. Parallèlement, le nombre de personnes âgées augmente. Tatsumi m’a montré un extrait d’un film de 2008 dans lequel une vieille dame se fait volontairement avoir par un jeune escroc parce qu’il lui rappelle son fils défunt. Le film est en partie tourné dans un campement de vieux SDF qui a véritablement existé à Tokyo.
Comme tant d’autres aspects de la société japonaise, on explique souvent le phénomène des proches de location par la dichotomie honne-tatemae, c’est-à-dire entre les sentiments et les désirs personnels et le comportement que la société attend de chacun. La sincérité et la cohérence ne sont pas forcément valorisées en tant que telles, et la dissimulation du honne derrière le tatemae est souvent considérée comme un acte de générosité et de sociabilité et non comme de la tromperie ou de l’hypocrisie. Un exemple : l’homme qui avait engagé de faux parents pour son mariage parce que les siens étaient morts a fini par l’avouer à sa femme. Aucun problème. Elle a compris qu’il n’avait pas voulu la berner mais juste éviter de créer des complications lors de la cérémonie, et elle l’a même remercié d’avoir fait preuve de tant de considération.
La location de proches telle qu’elle se pratique au Japon est à bien des égards spécifique à la culture locale, mais de tout temps, nous avons payé des inconnus pour remplir des rôles que nos proches tenaient gratuitement. On engageait des pleureuses dans la Grèce et la Rome antiques, en Chine, dans la tradition judéo-chrétienne et dans le monde proto-musulman ; tour à tour, Solon, saint Paul et saint Jean Chrysostome ont dénoncé cette pratique, dont on trouve encore la trace en Chine, en Inde et au Royaume-Uni, où l’entreprise Rent A Mourner [« Louez un pleureur »] opère depuis 2013. Et que sont les baby-sitters, les nounous et les cuisinières, sinon des parentes de location remplissant les rôles traditionnellement dévolus aux mères, aux filles et aux épouses ?
En fait, l’idée que la famille c’est de l’amour qui ne s’achète pas est relativement récente. À l’époque préindustrielle, la famille était l’unité économique de base, et chaque nouvel enfant signifiait une paire de bras supplémentaire. Avec l’industrialisation, quand on s’est mis à travailler à l’extérieur pour un salaire fixe, chaque nouvel enfant signifiait une bouche de plus à nourrir. La famille est devenue un sanctuaire d’amour inconditionnel dans un monde régi par le marché.
En 1898, l’utopiste féministe Charlotte Perkins Gilman dénonce l’« amour romantique » et le « sacrifice maternel » comme étant des constructions idéologiques, des supercheries destinées à retenir les femmes à la maison (7). On élevait les jeunes filles dans l’idée que l’amour était au-dessus de tout et qu’elles devaient cultiver leur beauté pour attirer un mari ; et puis, en vertu d’un contrat tacite, on leur demandait, sans qu’elles y soient préparées, de devenir des nurses, des éducatrices, des femmes de ménage bénévoles à plein temps, mues par un « mystérieux “instinct maternel” » qui se manifestait automatiquement le moment venu.
Dans le Japon de la fin du XIXe siècle, le régime adopte une « idéologie de l’amour romantique » qui définit le « déroulement idéal d’une vie de femme » en des termes similaires : « amour romantique » (séduction) puis mariage, enfantement, éveil d’un « amour maternel protecteur » et enfin acceptation triomphale d’un rôle désexualisé de « dispensatrice de soins ». C’est ce qu’écrit l’anthropologue Akiko Takeyama dans l’ouvrage qu’elle a consacré aux hosuto kurabu de Tokyo, ces « bars à hôtes » où les femmes paient pour boire un verre en compagnie de beaux jeunes gens prévenants (8). Certaines mères de famille dépensent l’équivalent de dizaines ou des centaines de milliers d’euros avec leurs « hôtes » et doivent à cet effet se trouver un job d’appoint, économiser sur les courses ou extorquer de l’argent à leur mari. Cela leur permet de goûter à un peu de romantisme, pour la première fois depuis qu’elles sont devenues des dispensatrices de soins et des ménagères à plein temps et que leur mari s’est mis à les appeler « maman ».
En un sens, l’idée de recourir à un conjoint, un parent ou un enfant de location est peut-être moins saugrenue que celle qui veut que l’éducation des enfants et les tâches ménagères soient la manifestation d’un amour romantique qui ne s’achète pas. Une idée que le capitalisme patriarcal a vraisemblablement tout intérêt à ériger en constante humaine universelle. Comme le soulignait le psychanalyste marxiste Wilhelm Reich, quand les femmes accomplissent les tâches ménagères et prodiguent des soins aux enfants gratuitement, les capitalistes peuvent moins payer les hommes.
Et l’iniquité ne s’arrête pas là. À partir du moment où les tâches familiales sont accomplies exclusivement et gratuitement par les épouses et les mères, les personnes qui n’ont pas de famille ne peuvent en bénéficier, observe Perkins Gilman dans son essai de 1898 Women and Economics : « Seules les personnes mariées et leurs proches ont le droit de vivre confortablement et en bonne santé. » Elle proposait comme solution de confier le travail non rémunéré incombant à chaque femme au foyer – l’éducation des tout-petits, la gestion du ménage, la préparation des repas et autres – à des spécialistes rémunérés des deux sexes. Mais le plus souvent, ces tâches, au lieu de donner lieu à des professions respectées et bien payées, sont imposées au coup par coup à des femmes de milieux défavorisés afin de permettre à leurs homologues plus privilégiées de faire carrière.
Quand Yuichi Ishii parle de « réparer les injustices », il semble avoir en tête à peu près la même chose que Charlotte Perkins Gilman. « Tout être humain a besoin d’un foyer – qu’il soit célibataire, mari ou veuf, qu’elle soit célibataire, épouse ou veuve », écrit celle-ci. Grâce à Family Romance, un homme qui n’a plus de famille comme Kazushige Nishida peut louer une épouse et une fille et, avec elles, les conforts d’un foyer : de bons petits plats, des voix féminines qui lui souhaitent la bienvenue et, de temps en temps, un petit coup affectueux dans les côtes.
Il y a neuf ans, Reiko, une assistante dentaire trentenaire, a sollicité auprès de Family Romance les services d’un père à mi-temps pour sa fille de 10 ans, Mana, qui, comme beaucoup d’enfants de mères célibataires au Japon, se faisait harceler à l’école. Reiko s’est vu proposer quatre candidats et a choisi celui qui avait la voix la plus douce. Le père de location leur rend visite régulièrement depuis. Mana, aujourd’hui âgée de 19 ans, ne sait toujours pas qu’il n’est pas son vrai père.
« Mais tu es qui, en fait ? »
Chie et moi faisons la connaissance de Reiko dans un salon de thé bondé près de la gare de Tokyo. La rencontre a été organisée par Ishii, qui nous a dit qu’il nous rejoindrait plus tard. Reiko, 40 ans, est vêtue d’un pull bleu marine, d’une écharpe écossaise et d’un ravissant manteau de laine bleu-vert.
— C’est la première fois que je raconte mon histoire, nous confie-t-elle à voix basse en jetant des coups d’œil tout autour.
Elle explique qu’elle a épousé Inaba, le père de Mana, à 21 ans après avoir découvert qu’elle était enceinte. Il est devenu violent, et elle a divorcé peu après la naissance de sa fille. Reiko s’est bornée à expliquer à Mana que son père et elle avaient eu un conflit longtemps auparavant, quand elle était bébé ; Mana en a conclu qu’elle avait été la cause du départ de son père, et rien de ce que Reiko lui disait ne pouvait la faire changer d’avis.
À l’école, Mana était renfermée et avait du mal à se faire des amis. À 10 ans, elle évitait autant que possible ses camarades et passait ses journées soit dans le bureau de l’infirmière scolaire, soit enfermée dans sa chambre, dont elle ne sortait que quand Reiko était au travail. Puis Mana a refusé d’aller en classe. Au bout de trois mois, Reiko a appelé Family Romance. Sur le bon de commande – elle en a apporté un exemplaire à notre rendez-vous –, elle a décrit le type de père qu’elle souhaitait pour sa fille. Quoi que Mana puisse faire ou dire, y précisait-elle, celui-ci devrait réagir avec douceur.
Quand le nouvel Inaba est venu pour la première fois chez elles, Mana était comme d’habitude dans sa chambre et refusait d’ouvrir. Inaba a réussi à entrouvrir la porte, et Reiko et lui ont vu Mana blottie sur son lit, la tête enfouie sous la couette. Après lui avoir parlé dans l’embrasure de la porte, Inaba s’est aventuré dans la chambre, s’est assis sur le lit, a caressé le bras de Mana et s’est excusé. À ce stade du récit, Chie cesse de traduire, et je vois que ses yeux sont embués de larmes. Il lui faut un moment pour pouvoir prononcer les mots qu’Inaba a dits à Mana :
— Pardon de ne pas être venu te voir.
Mana s’est extraite de sous la couette mais a évité de croiser le regard d’Inaba. Remarquant au mur un poster du boys band Arashi, il lui a dit qu’il avait été figurant dans un clip du groupe. Mana l’a enfin regardé dans les yeux. Reiko se rappelle s’être demandé dans le couloir : « Qu’est-ce qu’il y a de vrai dans ce qu’il raconte ? »
Après ce qui a paru durer une éternité, Inaba et Mana sont descendus pour déjeuner – un « repas terriblement laborieux ». Puis Reiko a débarrassé, laissant Inaba et Mana en tête-à-tête. Ils ont trouvé le clip d’Arashi sur YouTube, et Inaba y faisait effectivement une apparition l’espace d’une seconde. Au terme des quatre heures contractuelles, il s’est levé, et Mana, qui semblait presque joyeuse, a eu comme un soupçon :
— Oh, tu t’en vas. Mais tu es qui, en fait ?
Reiko a décidé de faire intervenir Inaba régulièrement, environ deux fois par mois, pour des prestations de quatre ou huit heures facturées 20 000 ou 40 000 yens [155 ou 310 euros]. Pour pouvoir les payer, elle s’est mise à rogner sur les dépenses alimentaires et à s’habiller aux puces. Au bout de trois ou quatre mois, elle a demandé à Mana, un soir en rentrant du travail, comment s’était passée sa journée, et, pour la première fois depuis des années, sa fille a daigné lui répondre et lui a raconté ce qu’elle avait vu à la télé. Le visage de Reiko s’éclaire quand elle évoque la transformation qui s’est produite chez Mana : elle « a finalement compris que son père se préoccupait d’elle » et « est devenue une enfant normale et sociable ». Reiko s’est mise à réserver Inaba des mois à l’avance pour les anniversaires, les réunions parents-professeurs et même des excursions d’une journée à Disneyland ou aux sources thermales du coin. Pour expliquer à Mana pourquoi il ne passait jamais la nuit avec elles, Reiko a raconté qu’Inaba s’était remarié et avait une autre famille.
Quand je demande à Reiko si elle envisage de dire un jour la vérité à Mana, ses yeux s’emplissent de larmes.
— Non, je ne pourrai jamais, dit-elle en éclatant de rire.
Elle ajoute, entre rire et larmes :
— Parfois, j’aimerais bien qu’Inaba-san m’épouse. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais moi aussi je suis contente quand il vient nous voir. Ça ne dure qu’un moment, mais ça me rend très très heureuse. Franchement, c’est quelqu’un d’adorable. Vous verrez s’il vient.
Reiko a en effet appris qu’Inaba viendrait peut-être nous rejoindre au salon de thé. Quand nous lui disons que, d’après ce que nous savons, c’est Ishii qui doit venir, elle nous répond qu’elle ne connaît personne de ce nom-là.
— Je me demande si Inaba-san et Ishii-san ne sont pas une seule et même personne, glisse Chie.
Reiko paraît sceptique : elle ne pense pas qu’Inaba soit le patron de Family Romance. Nous restons là un moment toutes les trois à remuer le sucre dans nos infusions au yuzu. Puis voilà qu’Ishii s’avance vers notre table, en blazer et col roulé noirs.
— Inaba-san ! s’écrie Reiko.
Ishii se présente et s’adresse poliment à Reiko en utilisant la forme de salutation formelle. Elle réagit avec une indignation feinte : d’ordinaire, ils se parlent comme mari et femme.
À présent, ils sont assis côte à côte, face à Chie et moi, sans se regarder. L’idée était qu’une fois qu’Ishii nous aurait rejointes je les interviewerais ensemble, mais ils semblent être sur des longueurs d’onde tellement différentes qu’au début je ne vois pas comment m’adresser aux deux en même temps.
— Vous êtes-vous demandé quel était le vrai nom d’Inaba-san et ce qu’il faisait dans la vie ? finis-je par demander à Reiko.
Elle me répond que non, et que même aujourd’hui elle ne se pose pas la question ; elle a l’impression de le savoir déjà.
— Je ne pense pas qu’il change. C’est quelqu’un de très naturel. Maintenant je le vois dans ce contexte, et c’est pareil.
Ishii proteste avec un sourire et lui rappelle qu’aujourd’hui elle est sa cliente et non sa femme.
— Tu as quelque chose, là, dit Reiko en indiquant le coin de sa bouche.
Il se tourne par réflexe vers un miroir et s’essuie les lèvres. C’est le premier d’un des nombreux moments où il semble aller et venir entre Inaba et Ishii.
Reiko et lui se mettent à évoquer leur premier déjeuner ensemble avec Mana. Reiko avait préparé trois fois trop à manger – des beignets de crevette, du rôti de bœuf, une soupe de maïs… tout ce qu’aime Mana. Et Ishii se rappelle avoir cherché à « manger comme un papa », c’est-à-dire, dans son esprit, « sans hésiter ni faire des manières ». Il fait une démonstration en se penchant sur la table, le coude en avant, avec le geste d’enfourner de la nourriture. Cela fait tout à fait patriarcal. Reiko éclate de rire. Son regard croise le mien, et je lui fais un grand sourire en retour. Pas un sourire feint, un vrai sourire. Mais qu’est-ce qui me fait sourire au juste ?
Je leur demande la différence entre une vraie famille et une famille de location. Une famille de location a beau ne pas être une vraie famille, répond Ishii, elle peut en un sens représenter « davantage qu’une famille ». Cette idée me paraît quelque peu absconse, mais Reiko dit qu’elle comprend parfaitement.
— Si je n’avais pas divorcé et que j’étais toujours mariée, je ne pense pas que je serais en train de rire comme ça, ni que je me sentirais aussi heureuse. La vraie famille, ce n’est pas forcément ce qu’il y a de mieux.
Finalement, elle se lève pour partir. En enfilant son manteau bleu-vert, elle dit qu’elle se sent requinquée. Son visage est rayonnant et plus expressif que quand elle est arrivée. En la regardant s’éloigner, j’ai un peu mal pour elle. J’ai pu constater à quel point elle l’aimait.
Ishii s’éclipse aux toilettes, et Chie et moi nous demandons pourquoi il a choisi de révéler sa véritable identité à Reiko en notre présence. Peut-être avait-il besoin de tiers pour rendre crédible ce qu’il tentait de lui dire : qu’il dirigeait une grosse affaire sérieuse, que leur relation n’était pas réelle, qu’ils ne se marieraient jamais. Quand il revient à la table, je lui demande s’il a dit à Reiko qu’il pensait qu’il valait mieux mettre un terme aux visites d’Inaba. Il répond que oui. Mana va sur ses 20 ans.
— Si Mana se marie et a des enfants, j’aurai des petits-enfants. Bien sûr, ce serait formidable, mais fatalement ça ferait encore plus de gens auxquels il faudrait mentir – sans parler du mari et des beaux-parents de Mana. Je dis à Reiko qu’avant d’en arriver là il faut qu’elle dise la vérité à Mana.
— Reiko sera d’accord, vous croyez ?
Ishii hésite un instant.
— Reiko a sans doute très envie que tout cela continue.
Ishii est convaincu que Mana comprendrait parfaitement si on lui disait la vérité. Je me demande s’il n’y aurait pas moyen que Mana voie la chose comme l’histoire d’une mère qui l’adore et d’une sorte de père au rabais, qui, à sa façon, même au rabais, lui a procuré douceur et stabilité. Évidemment, il facture sa prestation l’équivalent de près de 40 euros l’heure, mais le monde regorge de gens qui sont incapables d’être gentils et présents même si on les paie. La gentillesse cesse-t-elle d’en être simplement parce qu’elle est tarifée ?
— On me demande souvent pourquoi je ne me marie pas, nous dit Ishii.
Il a beau être célibataire, il a rencontré une multitude de futurs beaux-parents, embrassé une dizaine de mariées, s’est excusé d’avoir été infidèle et a même assisté à un accouchement. Il s’est tapé des entretiens d’inscription dans des écoles privées, des réunions parents-professeurs, a filmé des compétitions sportives et des remises de diplôme, a passé des journées entières à Disneyland. S’il finit un jour par être père, en quoi ce qu’il éprouvera pour ses enfants sera-t-il différent de ce qu’il éprouve dans le cadre de son travail ?
— J’ai peur à présent de me retrouver à jouer le gentil papa, avoue-t-il.
Il lui arrive de rêver de Mana et de lui dire qu’il n’est pas son vrai père.
— C’est un rêve, alors elle prend ça bien. Elle accepte la vérité, mais ensuite elle me dit : « Tu restes quand même mon papa. »
— Vous ne pensez pas qu’en un sens vous êtes son père ? lui demandé-je.
Ishii ferme les yeux, l’air las.
— Cela prouve que, même si nous ne sommes pas une vraie famille, même s’il s’agit d’une famille de location, les rapports que nous entretenons font de nous une sorte de famille.
Un soir, de retour à mon hôtel, encore sous l’effet du décalage horaire et un peu perturbée par tout ce que j’ai entendu, je décide de m’offrir un massage dans ma chambre. Deux heures plus tard, une jeune femme souriante frappe à ma porte, se déchausse en entrant et me donne à signer un formulaire par lequel je m’engage à ne pas exiger de massage sexuel et à laisser la porte de la chambre entrouverte si je suis un homme. Tout contribue à une atmosphère onirique : sa voix douce, son toucher habile, le fait que je sois allongée sur le lit. À un moment, je réalise qu’elle est à genoux sur le lit à côté de moi. Curieusement, cela ne pose pas de problème qu’on soit au lit comme ça, ensemble. « Comme vous avez les épaules contractées », me dit-elle, parvenant malgré tout à détendre les muscles avec ses doigts. Je me sens pleine d’amour et de gratitude, et je réalise que le fait de la payer, loin de me mettre mal à l’aise, me procure joie et soulagement, parce que cela veut dire que je n’ai à me préoccuper de rien. Je peux juste me relaxer.
L’amour inconditionnel peut-il exister gratuitement ?
Ça a tout de l’amour inconditionnel – du type de celui que l’on ne reçoit ni ne requiert de ses proches, parce qu’ils ont des besoins eux aussi, qu’il faudra satisfaire en retour. Elle, je n’ai pas besoin de la masser ou d’écouter ses problèmes, parce que je lui ai donné une somme dont elle peut faire ce qu’elle veut : régler des factures, s’acheter un manteau bleu-vert, ou même payer quelqu’un pour la masser ou écouter ses problèmes. Cette heure durant laquelle elle s’occupe de moi sans que moi je m’occupe d’elle ne sera pas inscrite sur un registre où s’accumulera au fil des années son ressentiment à mon égard. Je n’ai pas à me sentir coupable : c’est pour cela que je paie.
J’étais partie du principe que la location contrevenait à l’idée d’amour inconditionnel. J’en suis à présent à me demander si l’amour inconditionnel peut exister gratuitement. Les questions que je me suis posées sur ce qu’Ishii éprouve réellement pour Reiko et sa fille s’éclairent quand je les pose en ces termes.
On peut faire à titre professionnel, pendant un temps donné et en échange d’argent et de reconnaissance, des choses qu’on ne peut pas faire indéfiniment et gratuitement. Je sais qu’Ishii s’est beaucoup préparé à sa prestation en visionnant des comédies familiales pour voir comment marche, parle et mange un « gentil papa ». Dans la même idée, j’ai lu quelque chose à propos d’un employé d’un bar à hôtes qui avait étudié des romans d’amour pour pouvoir anticiper et satisfaire les besoins de ses clientes, et qui n’avait, du coup, plus de temps pour sa vie personnelle. « L’amour idéal, pour les femmes, ça demande beaucoup de travail, et c’est pratiquement impossible dans la réalité. » Il disait qu’il n’aurait jamais pu se donner autant de mal pour une véritable petite amie.
Je repense aussi à ce que m’a dit Kenji Kameguchi, un professeur de psychologie qui essaie depuis trente ans de promouvoir la thérapie familiale dans un pays stoïque et allergique aux conflits, où la psychothérapie reste stigmatisée. Pour lui, la location de proches possède les mêmes fonctions qu’une technique de thérapie de groupe comme le psychodrame, à travers lequel les patients jouent ou improvisent les expériences passées des uns et des autres. Le jeu théâtral est souvent d’une plus grande aide que la parole parce que, même quand on est incapable d’exprimer son problème – parce qu’il est trop affreux à dire, ou qu’on ne trouve pas les bons mots, ou qu’on ne sait pas en quoi il consiste –, on peut toujours le mettre en scène avec quelqu’un d’autre. Sous cet angle, le transfert, un élément clé de la thérapie freudienne, peut s’analyser comme un processus par lequel le patient voit dans le psychanalyste un proche de location ou, pour reprendre la formule de Freud, « la réincarnation d’une personne importante issue de son passé ou de son enfance ».
— Cet article est paru dans The New Yorker le 30 avril 2018. Il a été traduit par Jean-Louis de Montesquiou.
[post_title] => Au Japon, amis, parents ou époux à louer
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => air-de-famille
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-12 15:32:14
[post_modified_gmt] => 2019-03-12 15:32:14
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=54875
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 1
[filter] => raw
)
WP_Post Object
(
[ID] => 55034
[post_author] => 8
[post_date] => 2018-10-18 07:00:18
[post_date_gmt] => 2018-10-18 07:00:18
[post_content] => Le cimetière chinois de Nolette s’étend au milieu des champs, en contrebas d’un village aux maisons de briques rouges. Les 800 Chinois qui y sont enterrés avaient été envoyés à partir de 1917 participer à l’effort de guerre allié. Mais aucun d’entre eux n’est mort au combat. Tous étaient des travailleurs civils. Ils ont succombé à la maladie. Pour la plupart, vraisemblablement, à la grippe espagnole. Il n’est pas exclu que certains d’entre eux aient, d’ailleurs, été à l’origine de l’épidémie en Europe. À moins qu’ils n’aient été contaminés sur place, peut-être après l’arrivée des troupes américaines, suspectées elles aussi d’avoir répandu la grippe sur le Vieux Continent.
Une origine encore inconnue
L’un des plus grands mystères de cette pandémie sans équivalent au XXe siècle est celui de son origine : cent ans après, on ne sait toujours pas d’où elle est venue exactement, de la province chinoise du Shanxi, du nord de la France ou bien du Kansas. Comme le note la journaliste scientifique Laura Spinney dans l’ouvrage qu’elle lui a consacré, La Grande Tueuse, « il n’y a qu’une chose que nous puissions affirmer avec quelque certitude : la grippe espagnole ne partit pas d’Espagne. »
Quand elle arrive dans ce pays, en mai 1918, elle sévit déjà depuis plusieurs mois en France, dans les tranchées. Simplement, les Espagnols l’ignorent car l’information a été censurée par les pays belligérants. « Les médecins militaires français la désignaient sous le nom de code de maladie onze », rappelle Spinney. Les Parisiens eux-mêmes ne savent pas que leurs troupes sont décimées par une épidémie. Quand ils apprennent dans les journaux qu’en trois jours deux tiers des Madrilènes ont été infectés par un virus particulièrement coriace (les autorités espagnoles ne dissimulant pas l’information, elles), le nom de la maladie est tout trouvé…
D’une façon générale, dans un premier temps, chacun eut tendance à accuser l’autre : « Au Sénégal, c’était la grippe brésilienne, et, au Brésil, la grippe allemande, tandis que les Danois pensaient qu’elle “venait du sud”. Les Polonais la surnommaient “la maladie bolchevique”, tandis que les Perses l’attribuaient aux Britanniques ; quant aux Japonais, ils incriminaient leurs lutteurs : comme elle éclata pour la première fois à la suite d’un tournoi de sumo, ils l’appelèrent “la grippe sumo” », écrit Spinney.
Autre énigme : son bilan. « Pendant la plus grande partie du XXe siècle, [il] était estimé à 20 millions de morts. » Mais il a été récemment réévalué à 50 millions, et il n’est pas exclu qu’il soit en réalité de 100 millions. Si tel était le cas, ce serait une hécatombe supérieure à celles des Première et Seconde Guerres mondiales réunies, « le plus grand raz de marée de morts depuis la Peste noire, voire dans toute l’histoire de l’humanité ». Pourtant la grippe espagnole ne semble pas avoir marqué la mémoire collective à sa juste mesure. Elle reste complètement éclipsée par les combats et les épreuves de la Grande Guerre. « Elle n’est pas vue comme un grand désastre de l’histoire, mais comme l’addition de millions de tragédies personnelles et discrètes », résume Spinney. Comment expliquer cette étrange distorsion ?
D’abord, malgré son ampleur inédite (en quelques mois, elle se répand sur tous les continents habités et y touche une proportion très élevée de personnes), le taux de mortalité de la grippe espagnole est demeuré relativement bas. Elle n’a fait en moyenne que 2,5 % de victimes. Quand on la contractait, on avait neuf chances sur dix de s’en sortir. Deuxième facteur décisif : les récits de l’épidémie se focalisent sur l’Europe. Or son expérience fut atypique. La guerre y a effectivement fait plus de victimes : « La France a compté six fois plus de morts dus à la guerre que causés par la grippe, l’Allemagne quatre fois plus, la Grande-Bretagne trois fois et l’Italie deux fois plus », rappelle l’auteure. Pour vraiment prendre la mesure de la grippe espagnole, il faut se tourner vers les autres continents : Spinney nous apprend que les Indes britanniques perdirent 6 % de leur population, soit 13 à 18 millions de personnes. En chiffres absolus, c’est le record, mais la proportion fut encore plus élevée en Iran (où, selon certaines estimations, elle atteignit les 22 %) et en Alaska, dans la baie de Bristol (40 %).
La grippe espagnole, pandémie du siècle
Le grand mérite de l’ouvrage de Spinney est d’offrir un panorama de cette pandémie du siècle, qui, entre le printemps 1918 et l’hiver 1919, connut trois vagues. La plus meurtrière fut la deuxième, à l’automne 1918, où « la plupart des décès se sont accumulés en treize semaines seulement ». Cette rapidité est peut-être le troisième élément permettant d’expliquer pourquoi elle fut largement sous-estimée. Ajoutons-en un quatrième et dernier : la difficulté, dans bien des cas, de comprendre à quoi on avait exactement affaire. Entre les différentes vagues, le virus eut le temps de muter. Lors de la première vague, la plupart des personnes atteintes présentaient les symptômes d’une grippe ordinaire. Lorsqu’elle revint à l’automne, la grippe était bien plus virulente : « Les patients développaient rapidement des troubles respiratoires, deux taches de couleur acajou apparaissaient sur leurs joues et, en l’espace de quelques heures, cette teinte avait gagné leur visage d’une oreille à l’autre », décrit Spinney. Lorsque, en novembre 1918, Blaise Cendrars se rendit au chevet de Guillaume Apollinaire que la maladie était en train d’emporter, il constata : « Il était complètement noir. »
Outre Guillaume Apollinaire, citons, parmi les victimes célèbres, le peintre Egon Schiele et le sociologue Max Weber. Et puis il y a tous ceux qui furent atteints mais survécurent : Franz Kafka, Ezra Pound, le président américain Woodrow Wilson, le Premier ministre britannique Lloyd George et le président du Conseil Georges Clemenceau (ces trois derniers étaient réunis en région parisienne début 1919, au moment de la troisième vague de grippe, pour mettre au point le traité de Versailles), le futur président Roosevelt ou encore le négus Haïlé Sélassié. On aurait pu s’attendre à ce que les jeunes enfants et les personnes âgées soient les premières victimes. Ils le furent en partie, mais les adultes de 20 à 40 ans aussi. Autre particularité : cette courbe de mortalité en W n’était pas symétrique : « La branche de droite était moins haute, preuve que les personnes âgées étaient plus protégées que d’habitude. » Peut-être parce qu’elles avaient été exposées, dans leur jeunesse, à un autre virus, moins virulent mais proche de celui de la grippe espagnole.
La Grande Tueuse remonte loin et rappelle que la toute première épidémie de grippe eut sans doute lieu dans la première grande agglomération de l’histoire humaine, à Ourouk, en Mésopotamie, il y a cinq mille ans. Les épidémies furent filles de la civilisation et de la promiscuité qu’elle induit : entre les humains, rassemblés par milliers dans des villes, mais aussi entre les humains et les animaux, porteurs de maladies transmissibles à d’autres espèces. Il est ainsi vraisemblable que nous devions cette grippe au canard, sans doute par l’intermédiaire du porc. En 1918, ce qui avait été circonscrit au IIIe millénaire avant notre ère à une cité mésopotamienne de 80 000 habitants toucha la planète entière et son quelque 1,8 milliard d’habitants.
L’un des grands intérêts de l’ouvrage de Spinney est de montrer à quel point les réactions furent différentes d’un pays, d’une région à l’autre. L’ignorance, la négligence ou les simples erreurs de diagnostic eurent souvent des conséquences épouvantables. Au Chili, les médecins crurent être confrontés au typhus (bien moins contagieux que la grippe) et n’empêchèrent pas les grands rassemblements. En Espagne, l’Église ne trouva rien de mieux à faire que d’organiser des processions et d’inciter les gens à aller à la messe. En France, les autorités n’osèrent pas interdire les spectacles. Certains pays anglo-saxons s’en sortirent mieux : l’Australie mit en place une quarantaine efficace (du moins, jusqu’à ce qu’elle croie l’épidémie terminée, lève les restrictions et se retrouve frappée, elle aussi, par la troisième vague). Quant à la gestion de la ville de New York, elle fut exemplaire. On y prit le risque de laisser les écoles ouvertes. Un choix audacieux mais paradoxalement efficace : les enfants pauvres y étaient beaucoup moins exposés au virus que dans leurs logements vétustes et surpeuplés.
Spinney s’attarde sur les conséquences de la grippe espagnole. Ce n’est pas la partie la plus convaincante de son ouvrage. Elle a tendance à voir des répercussions de la pandémie dans à peu près tout et n’importe quoi – aussi bien dans l’échec du traité de Versailles que dans l’indépendance de l’Inde. Et, bien entendu, dans la fortune de Donald Trump.
— Ce texte a été écrit pour Books.
[post_title] => La grippe espagnole, pire pandémie de tous les temps
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => pire-pandemie-de-temps
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-04 17:06:19
[post_modified_gmt] => 2019-03-04 17:06:19
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=55034
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.Ok
 Que reste-t-il donc de spécifiquement humain ? Pour Larry Tesler, l’informaticien qui a inventé le copier-coller, l’intelligence humaine est « ce que les machines n’ont pas encore accompli ». En 1988, le roboticien Hans Moravec observait que les tâches qui nous paraissent difficiles sont un jeu d’enfant pour l’ordinateur, et inversement. C’est le paradoxe qui porte son nom : « Il est relativement facile de faire en sorte qu’un ordinateur affiche des performances d’adulte aux tests d’intelligence ou au jeu de dames, et difficile ou impossible de lui donner les compétences d’un enfant de 1 an quand il s’agit de perception et de mobilité. » Les robots ont fait des progrès en vision et en agilité, mais le paradoxe tient toujours. On le voit pour ce qui est de la préhension, par exemple.
Certains estiment qu’il faut penser les rapports entre intelligence humaine et intelligence artificielle en termes de synergie et non de concurrence. Dans leur livre Human + Machine, Paul Daugherty et H. James Wilson, des cadres du cabinet de conseil Accenture, soutiennent que travailler aux côtés de « cobots » IA accroîtra le potentiel humain. Récusant tous les scénarios apocalyptiques qui annoncent la disparation de pas moins de 800 millions d’emplois d’ici à 2030, ils intitulent allègrement un chapitre « Dites bonjour à vos nouveaux robots réceptionnistes ». Des compétences de pointe telles que la « fusion holistique » et la « normalisation responsable » ouvriront aux humains les portes de nouveaux métiers passionnants comme « stratège en explicabilité » ou « hygiéniste des données ». Même les talents artistiques auront un rôle à jouer, car il faudra « concevoir, adapter et gérer » des robots de service à la clientèle. Des spécialistes de domaines inattendus comme la conversation humaine, l’humour, la poésie et l’empathie seront en première ligne » [lire « Les robots vont-ils nous remplacer ? », Books, février 2015].
Beaucoup des exemples donnés par Daugherty et Wilson montrent que nous sommes aussi prévisibles que des machines. Grâce à l’IA, l’entreprise de technologie financière ZestFinance sait que les clients qui utilisent tous les plafonds quand ils demandent un prêt sont plus susceptibles d’être défaillants. Et le moteur de recherche intuitif 6Sense sait non seulement lesquelles de nos activités sur les réseaux sociaux indiquent que nous sommes prêts à l’acte d’achat, mais aussi comment « anticiper les objections au cours du parcours d’achat ». À croire que la finalité première de l’IA est d’optimiser les ventes. Quand une entreprise injectera de l’anthropomorphisme dans l’apprentissage machine, il deviendra impossible de résister aux moteurs de recommandation 5.
Pouvons-nous revendiquer les exploits de nos machines comme étant ceux de l’humanité ? L’ancien champion d’échecs Garry Kasparov aborde les deux côtés de la question dans son livre Deep Thinking. Quelques années avant sa célèbre défaite contre le superordinateur Deep Blue d’IBM, en 1997, il déclarait : « Je ne sais pas comment nous pouvons exister en sachant qu’il existe quelque chose de mentalement plus fort que nous ». Mais il est toujours là, à tourner dans tous les sens les détails de ce match et consacre une bonne partie de son livre à incriminer tous ceux qui ont été associés à la conception du « réveil-matin à 10 millions de dollars » d’IBM. Et puis soudain il tourne bride et fait contre mauvaise fortune bon cœur : utiliser les ordinateurs pour « les aspects les plus ingrats » du raisonnement nous libérera et nous permettra de consacrer nos facultés intellectuelles à « la créativité, la curiosité, la beauté et la joie ». Si nous ne saisissons pas cette occasion, conclut-il, « autant être nous aussi des machines ». Ce n’est qu’en nous appuyant sur des machines que nous pouvons prouver que nous n’en sommes pas.
Un problème supplémentaire guette les machines. Si nos films et nos séries télé sont dans le vrai, le futur se déroule à Los Angeles, sous une bruine persistante, et est peuplé de cybercréatures légèrement plus détachées que nous le sommes. Dotées d’une incroyable force physique, ce sont des as de la moto et du calcul mental, mais elles aspirent à devenir des humains, à nous ressembler davantage. Fatalement, l’androïde le plus humain d’apparence tombe sur un labo où sont stockés des prototypes de clones de lui-même, et il comprend avec horreur qu’il n’est pas une personne mais une machine. Dans Blade Runner, Rachel (interprétée par Sean Young), un réplicant de deuxième génération, ignore qu’elle en est un avant d’échouer au redoutable test de Voight-Kampff, que lui fait passer Deckard (interprété par Harrison Ford). Le réalisateur, Ridley Scott, s’est querellé publiquement avec Ford sur la question de savoir si Deckard était lui-même un réplicant. Scott soutenait mordicus que c’en était un ; Ford affirmait le contraire. Qui est prêt à accepter – même au nom de son personnage de fiction – que son libre arbitre est une illusion ?
Le moyen habituel pour mesurer l’ambition d’une machine est le test proposé par Turing en 1950 : une IAG digne de ce nom doit pouvoir faire croire à un panel de juges qu’elle est un humain. Ce critère présuppose que le cerveau humain est une sorte d’ordinateur et que tout ce que nous avons à faire pour créer une IAG est de reproduire notre mode de pensée. Très subtilement, il fait des programmeurs des escrocs. Lors d’un échange en ligne, un robot de conversation se faisant passer pour Eugene Goostman, un Ukrainien de 13 ans, est parvenu à abuser un tiers des jurés au test de Turing 2014 en changeant régulièrement de sujet. Le magazine en ligne The Daily Beast a retranscrit le passage où le robot répond à l’une des questions originelles de Turing :
« L’interrogateur : Dans ce premier vers d’un sonnet : “Te comparerai-je à un jour d’été ?”(6), n’aurait-il pas mieux valu écrire : “un jour de printemps” ?
Goostman : Pourquoi me poser cette question ? À croire que vous ne pouvez trouver la bonne réponse vous-même ! Faites confiance à votre intuition ! :-) On pourrait peut-être parler d’autre chose ? De quoi aimeriez-vous discuter ?
L’interrogateur : J’aimerais parler de poésie.
Goostman : Classique ? J’espère que vous n’allez pas vous mettre à me lire Le Roi Lear ou quelque chose du genre :-))) »
Les personnes qui rédigent les textes pour des assistants numériques comme Siri et Alexa ont recours à ce genre de badinage loufoque dans l’espoir de trouver le bon modèle d’interface vocale, à mi-chemin entre le factuel et le charabia. L’une d’eux faisait récemment observer : « Il y a quelque chose d’intrinsèquement humain dans les conversations absurdes ». Mais un sketch humoristique n’est amusant que si l’on perçoit l’intelligence malicieuse qui est à l’œuvre. La traduire en code informatique est un défi à plus d’un titre. Les auteurs d’un article récent sur la génération automatique de poèmes à partir de photographies concluent à la difficulté de la chose, même en activant deux réseaux discriminants qui entraînent un réseau de neurones récurrents et les relient à un modèle couplé profond de plongement lexical visuo-poétique constitué d’un modèle codeur de texte, d’un analyseur morpho-syntaxique et d’un réseau neuronal convolutif… « Par exemple, notent tristement les chercheurs, le générateur automatique de légendes d’images indique après “homme” le mot “espoir” s’il détecte un “soleil brillant” et “des bras ouverts”, ou “solitude” s’il identifie des “chaises vides“ et un fond “sombre”. » Mais au moins le problème se limite-t-il ici à expliquer l’espoir et la solitude.
Dans son livre « Le bon sens, le test de Turing et la quête d’une véritable IA » (7), Hector Levesque, professeur émérite de sciences informatiques, propose un meilleur test d’intelligence artificielle, consistant à soumettre à un ordinateur des phrases comportant une ambiguïté syntaxique. Par exemple : « La statue ne rentrait pas dans la valise marron car elle était trop petite. » Qu’est-ce qui était trop petit ? Nous comprenons tout de suite que c’est la valise, pas la statue. Les IA n’ont pas la jugeote nécessaire. L’intelligence est peut-être bien une forme de bon sens : un instinct permettant de se débrouiller dans une situation inédite ou déroutante.
Dans le film d’Alex Garland Ex Machina, Nathan, le fondateur d’un géant de l’Internet ressemblant à Google, dénigre le test de Turing et consorts et invite un jeune programmeur à parler en direct avec son nouvel androïde, Ava. « Le vrai test consiste à ce qu’elle te montre qu’elle est un robot, dit Nathan, et qu’elle voie ensuite si tu penses toujours qu’elle a une conscience. » Elle a bien une conscience, mais, comme son créateur, elle est dépourvue de sens moral. Ava trompe et assassine Nathan et le programmeur pour conquérir sa liberté. Nous ne songeons pas à tester ce à quoi nous n’attachons pas d’importance.
Au cinéma, la conscience des IA est un fait survenu de façon aussi inexpliquée que l’épanouissement de la nôtre. Dans Her, de Spike Jonze, Theodore, un type un peu dépressif, tombe amoureux du nouveau système d’exploitation de son ordi. « Tu sembles être une personne, dit-il, mais tu n’es qu’une voix sur un ordinateur », laquelle répond, mutine : « Je peux comprendre qu’une intelligence non artificielle et un peu limitée puisse concevoir les choses de la sorte. » Dans I, Robot, Will Smith demande à un robot nommé Sonny : « Un robot peut-il écrire une symphonie ? Un robot peut-il faire d’une toile un magnifique chef-d’œuvre ? » Sonny répond : « Et toi ? » L’IA sait appuyer là où ça fait mal.
Les scénaristes ont tendance à penser que les IA ne se hisseront pas à notre niveau tant qu’elles ne pourront pas pleurer. Dans Blade Runner, les réplicants ont une durée de vie limitée à quatre ans afin qu’ils n’aient pas le temps de se doter d’émotions – ce qu’ils font toutefois, se mettant en colère contre cette échéance. Dans la série britannique Humans, Niska, une « synthèt » qui a secrètement accédé à la conscience, refuse de débrancher ses récepteurs de douleur et rugit : « J’ai été conçue pour avoir des émotions ».
Dans A.I. Intelligence artificielle, de Steven Spielberg, le professeur dérangé interprété par William Hurt dit des robots : « L’amour est la clé qui leur permettra d’acquérir une sorte de subconscient jamais atteint jusqu’à présent, un monde intérieur de métaphores, d’intuition, […] de rêves. » L’amour est aussi ce qui permet à Pinocchio de devenir un garçon en chair et en os et au Lapin de velours de se transformer en vrai lapin. Dans la série Westworld, qui met en scène un parc d’attractions recréant le Far West et peuplé de cyborgs que les visiteurs sont libres de baiser et de trucider à leur guise, Robert Ford, le scientifique dérangé joué par Anthony Hopkins, dit à son programmeur en chef (qui ignore qu’il est lui aussi un cyborg) : « Ta souffrance imaginaire te rend très réaliste » et : « Pour t’échapper d’ici, il te faudra souffrir davantage » – une vision du monde qui n’est pas empruntée aux contes pour enfants mais à la religion. Ce qui fait de nous des humains, ce sont le doute, la peur, la honte et tous les avatars de l’indignité.
Un androïde capable de conscience et d’émotions est beaucoup plus qu’un gadget ; il pose la question de nos devoirs envers les êtres programmés, et des leurs à notre égard. Si nous sommes mécontents d’une IAG consciente et que nous la débranchons, s’agira-t-il d’un meurtre ? Dans Terminator 2, Sarah Connor se rend compte que le Terminator joué par Arnold Schwarzenegger, envoyé dans le temps pour sauver son fils du Terminator joué par Robert Patrick, est plus fiable que tous les autres hommes avec qui elle a couché. Il est fort, plein de ressources et loyal : « De tous les pères potentiels que j’ai expérimentés, cette chose, cette machine, était le seul qui soit à la hauteur. » À la fin, le Terminator se fait descendre dans une cuve en fusion pour éviter qu’un fouineur vienne étudier sa technologie et rétroconçoive un nouveau Terminator.
Du point de vue de l’évolution, les scénaristes font les choses à l’envers, car ce sont nos émotions qui ont précédé nos pensées et leur ont donné naissance. Cela peut expliquer que la logique et les calculs rigoureux ne soient pas notre fort : 90 % des gens se trompent dans la tâche de sélection de Wason, pourtant élémentaire (8).
Dans son livre incisif La Vie 3.0. Être humain à l’ère de l’intelligence artificielle (9), Max Tegmark, professeur de physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), donne à entendre que le raisonnement n’est pas ce que nous croyons : « Un organisme vivant est un agent de rationalité limitée qui ne poursuit pas un objectif unique mais suit plutôt des règles de base sur ce qu’il convient de rechercher et ce qu’il faut éviter. Le cerveau humain perçoit ces règles de base de l’évolution comme des sensations qui, en général (et souvent sans que nous en ayons conscience), guident notre prise de décision vers le but ultime de la réplication. La sensation de faim ou de soif nous empêche de nous laisser mourir d’inanition ou de déshydratation, la douleur nous avertit d’un danger corporel, le désir nous fait procréer, les sentiments d’amour et d’attendrissement nous amènent à aider les autres porteurs de nos gènes et ceux qui les aident, et ainsi de suite. »
Les rationalistes cherchent depuis longtemps à rendre la raison aussi incontestable que les mathématiques, de sorte, disait Leibniz, que « deux philosophes n’auraient pas davantage besoin de se disputer que deux comptables ». Mais notre processus de prise de décision, comme un assemblage de programmes informatique bidouillés qui cherche les probabilités, est réglé par défaut sur l’intuition et plante à cause des réflexes, de l’effet d’ancrage, de l’aversion aux pertes, du biais de confirmation et de toute une série d’autres schémas mentaux irrationnels (10). Notre cerveau est moins une machine de Turing qu’une bouillie de systèmes bricolés par des siècles de mutations génétiques, des systèmes destinés à percevoir les changements de notre environnement et à réagir, le changement étant par nature dangereux. Quand il est en danger, le lézard à cornes du Texas crache du sang par les yeux ; quand nous sommes en danger, nous pensons.
Que reste-t-il donc de spécifiquement humain ? Pour Larry Tesler, l’informaticien qui a inventé le copier-coller, l’intelligence humaine est « ce que les machines n’ont pas encore accompli ». En 1988, le roboticien Hans Moravec observait que les tâches qui nous paraissent difficiles sont un jeu d’enfant pour l’ordinateur, et inversement. C’est le paradoxe qui porte son nom : « Il est relativement facile de faire en sorte qu’un ordinateur affiche des performances d’adulte aux tests d’intelligence ou au jeu de dames, et difficile ou impossible de lui donner les compétences d’un enfant de 1 an quand il s’agit de perception et de mobilité. » Les robots ont fait des progrès en vision et en agilité, mais le paradoxe tient toujours. On le voit pour ce qui est de la préhension, par exemple.
Certains estiment qu’il faut penser les rapports entre intelligence humaine et intelligence artificielle en termes de synergie et non de concurrence. Dans leur livre Human + Machine, Paul Daugherty et H. James Wilson, des cadres du cabinet de conseil Accenture, soutiennent que travailler aux côtés de « cobots » IA accroîtra le potentiel humain. Récusant tous les scénarios apocalyptiques qui annoncent la disparation de pas moins de 800 millions d’emplois d’ici à 2030, ils intitulent allègrement un chapitre « Dites bonjour à vos nouveaux robots réceptionnistes ». Des compétences de pointe telles que la « fusion holistique » et la « normalisation responsable » ouvriront aux humains les portes de nouveaux métiers passionnants comme « stratège en explicabilité » ou « hygiéniste des données ». Même les talents artistiques auront un rôle à jouer, car il faudra « concevoir, adapter et gérer » des robots de service à la clientèle. Des spécialistes de domaines inattendus comme la conversation humaine, l’humour, la poésie et l’empathie seront en première ligne » [lire « Les robots vont-ils nous remplacer ? », Books, février 2015].
Beaucoup des exemples donnés par Daugherty et Wilson montrent que nous sommes aussi prévisibles que des machines. Grâce à l’IA, l’entreprise de technologie financière ZestFinance sait que les clients qui utilisent tous les plafonds quand ils demandent un prêt sont plus susceptibles d’être défaillants. Et le moteur de recherche intuitif 6Sense sait non seulement lesquelles de nos activités sur les réseaux sociaux indiquent que nous sommes prêts à l’acte d’achat, mais aussi comment « anticiper les objections au cours du parcours d’achat ». À croire que la finalité première de l’IA est d’optimiser les ventes. Quand une entreprise injectera de l’anthropomorphisme dans l’apprentissage machine, il deviendra impossible de résister aux moteurs de recommandation 5.
Pouvons-nous revendiquer les exploits de nos machines comme étant ceux de l’humanité ? L’ancien champion d’échecs Garry Kasparov aborde les deux côtés de la question dans son livre Deep Thinking. Quelques années avant sa célèbre défaite contre le superordinateur Deep Blue d’IBM, en 1997, il déclarait : « Je ne sais pas comment nous pouvons exister en sachant qu’il existe quelque chose de mentalement plus fort que nous ». Mais il est toujours là, à tourner dans tous les sens les détails de ce match et consacre une bonne partie de son livre à incriminer tous ceux qui ont été associés à la conception du « réveil-matin à 10 millions de dollars » d’IBM. Et puis soudain il tourne bride et fait contre mauvaise fortune bon cœur : utiliser les ordinateurs pour « les aspects les plus ingrats » du raisonnement nous libérera et nous permettra de consacrer nos facultés intellectuelles à « la créativité, la curiosité, la beauté et la joie ». Si nous ne saisissons pas cette occasion, conclut-il, « autant être nous aussi des machines ». Ce n’est qu’en nous appuyant sur des machines que nous pouvons prouver que nous n’en sommes pas.
Un problème supplémentaire guette les machines. Si nos films et nos séries télé sont dans le vrai, le futur se déroule à Los Angeles, sous une bruine persistante, et est peuplé de cybercréatures légèrement plus détachées que nous le sommes. Dotées d’une incroyable force physique, ce sont des as de la moto et du calcul mental, mais elles aspirent à devenir des humains, à nous ressembler davantage. Fatalement, l’androïde le plus humain d’apparence tombe sur un labo où sont stockés des prototypes de clones de lui-même, et il comprend avec horreur qu’il n’est pas une personne mais une machine. Dans Blade Runner, Rachel (interprétée par Sean Young), un réplicant de deuxième génération, ignore qu’elle en est un avant d’échouer au redoutable test de Voight-Kampff, que lui fait passer Deckard (interprété par Harrison Ford). Le réalisateur, Ridley Scott, s’est querellé publiquement avec Ford sur la question de savoir si Deckard était lui-même un réplicant. Scott soutenait mordicus que c’en était un ; Ford affirmait le contraire. Qui est prêt à accepter – même au nom de son personnage de fiction – que son libre arbitre est une illusion ?
Le moyen habituel pour mesurer l’ambition d’une machine est le test proposé par Turing en 1950 : une IAG digne de ce nom doit pouvoir faire croire à un panel de juges qu’elle est un humain. Ce critère présuppose que le cerveau humain est une sorte d’ordinateur et que tout ce que nous avons à faire pour créer une IAG est de reproduire notre mode de pensée. Très subtilement, il fait des programmeurs des escrocs. Lors d’un échange en ligne, un robot de conversation se faisant passer pour Eugene Goostman, un Ukrainien de 13 ans, est parvenu à abuser un tiers des jurés au test de Turing 2014 en changeant régulièrement de sujet. Le magazine en ligne The Daily Beast a retranscrit le passage où le robot répond à l’une des questions originelles de Turing :
« L’interrogateur : Dans ce premier vers d’un sonnet : “Te comparerai-je à un jour d’été ?”(6), n’aurait-il pas mieux valu écrire : “un jour de printemps” ?
Goostman : Pourquoi me poser cette question ? À croire que vous ne pouvez trouver la bonne réponse vous-même ! Faites confiance à votre intuition ! :-) On pourrait peut-être parler d’autre chose ? De quoi aimeriez-vous discuter ?
L’interrogateur : J’aimerais parler de poésie.
Goostman : Classique ? J’espère que vous n’allez pas vous mettre à me lire Le Roi Lear ou quelque chose du genre :-))) »
Les personnes qui rédigent les textes pour des assistants numériques comme Siri et Alexa ont recours à ce genre de badinage loufoque dans l’espoir de trouver le bon modèle d’interface vocale, à mi-chemin entre le factuel et le charabia. L’une d’eux faisait récemment observer : « Il y a quelque chose d’intrinsèquement humain dans les conversations absurdes ». Mais un sketch humoristique n’est amusant que si l’on perçoit l’intelligence malicieuse qui est à l’œuvre. La traduire en code informatique est un défi à plus d’un titre. Les auteurs d’un article récent sur la génération automatique de poèmes à partir de photographies concluent à la difficulté de la chose, même en activant deux réseaux discriminants qui entraînent un réseau de neurones récurrents et les relient à un modèle couplé profond de plongement lexical visuo-poétique constitué d’un modèle codeur de texte, d’un analyseur morpho-syntaxique et d’un réseau neuronal convolutif… « Par exemple, notent tristement les chercheurs, le générateur automatique de légendes d’images indique après “homme” le mot “espoir” s’il détecte un “soleil brillant” et “des bras ouverts”, ou “solitude” s’il identifie des “chaises vides“ et un fond “sombre”. » Mais au moins le problème se limite-t-il ici à expliquer l’espoir et la solitude.
Dans son livre « Le bon sens, le test de Turing et la quête d’une véritable IA » (7), Hector Levesque, professeur émérite de sciences informatiques, propose un meilleur test d’intelligence artificielle, consistant à soumettre à un ordinateur des phrases comportant une ambiguïté syntaxique. Par exemple : « La statue ne rentrait pas dans la valise marron car elle était trop petite. » Qu’est-ce qui était trop petit ? Nous comprenons tout de suite que c’est la valise, pas la statue. Les IA n’ont pas la jugeote nécessaire. L’intelligence est peut-être bien une forme de bon sens : un instinct permettant de se débrouiller dans une situation inédite ou déroutante.
Dans le film d’Alex Garland Ex Machina, Nathan, le fondateur d’un géant de l’Internet ressemblant à Google, dénigre le test de Turing et consorts et invite un jeune programmeur à parler en direct avec son nouvel androïde, Ava. « Le vrai test consiste à ce qu’elle te montre qu’elle est un robot, dit Nathan, et qu’elle voie ensuite si tu penses toujours qu’elle a une conscience. » Elle a bien une conscience, mais, comme son créateur, elle est dépourvue de sens moral. Ava trompe et assassine Nathan et le programmeur pour conquérir sa liberté. Nous ne songeons pas à tester ce à quoi nous n’attachons pas d’importance.
Au cinéma, la conscience des IA est un fait survenu de façon aussi inexpliquée que l’épanouissement de la nôtre. Dans Her, de Spike Jonze, Theodore, un type un peu dépressif, tombe amoureux du nouveau système d’exploitation de son ordi. « Tu sembles être une personne, dit-il, mais tu n’es qu’une voix sur un ordinateur », laquelle répond, mutine : « Je peux comprendre qu’une intelligence non artificielle et un peu limitée puisse concevoir les choses de la sorte. » Dans I, Robot, Will Smith demande à un robot nommé Sonny : « Un robot peut-il écrire une symphonie ? Un robot peut-il faire d’une toile un magnifique chef-d’œuvre ? » Sonny répond : « Et toi ? » L’IA sait appuyer là où ça fait mal.
Les scénaristes ont tendance à penser que les IA ne se hisseront pas à notre niveau tant qu’elles ne pourront pas pleurer. Dans Blade Runner, les réplicants ont une durée de vie limitée à quatre ans afin qu’ils n’aient pas le temps de se doter d’émotions – ce qu’ils font toutefois, se mettant en colère contre cette échéance. Dans la série britannique Humans, Niska, une « synthèt » qui a secrètement accédé à la conscience, refuse de débrancher ses récepteurs de douleur et rugit : « J’ai été conçue pour avoir des émotions ».
Dans A.I. Intelligence artificielle, de Steven Spielberg, le professeur dérangé interprété par William Hurt dit des robots : « L’amour est la clé qui leur permettra d’acquérir une sorte de subconscient jamais atteint jusqu’à présent, un monde intérieur de métaphores, d’intuition, […] de rêves. » L’amour est aussi ce qui permet à Pinocchio de devenir un garçon en chair et en os et au Lapin de velours de se transformer en vrai lapin. Dans la série Westworld, qui met en scène un parc d’attractions recréant le Far West et peuplé de cyborgs que les visiteurs sont libres de baiser et de trucider à leur guise, Robert Ford, le scientifique dérangé joué par Anthony Hopkins, dit à son programmeur en chef (qui ignore qu’il est lui aussi un cyborg) : « Ta souffrance imaginaire te rend très réaliste » et : « Pour t’échapper d’ici, il te faudra souffrir davantage » – une vision du monde qui n’est pas empruntée aux contes pour enfants mais à la religion. Ce qui fait de nous des humains, ce sont le doute, la peur, la honte et tous les avatars de l’indignité.
Un androïde capable de conscience et d’émotions est beaucoup plus qu’un gadget ; il pose la question de nos devoirs envers les êtres programmés, et des leurs à notre égard. Si nous sommes mécontents d’une IAG consciente et que nous la débranchons, s’agira-t-il d’un meurtre ? Dans Terminator 2, Sarah Connor se rend compte que le Terminator joué par Arnold Schwarzenegger, envoyé dans le temps pour sauver son fils du Terminator joué par Robert Patrick, est plus fiable que tous les autres hommes avec qui elle a couché. Il est fort, plein de ressources et loyal : « De tous les pères potentiels que j’ai expérimentés, cette chose, cette machine, était le seul qui soit à la hauteur. » À la fin, le Terminator se fait descendre dans une cuve en fusion pour éviter qu’un fouineur vienne étudier sa technologie et rétroconçoive un nouveau Terminator.
Du point de vue de l’évolution, les scénaristes font les choses à l’envers, car ce sont nos émotions qui ont précédé nos pensées et leur ont donné naissance. Cela peut expliquer que la logique et les calculs rigoureux ne soient pas notre fort : 90 % des gens se trompent dans la tâche de sélection de Wason, pourtant élémentaire (8).
Dans son livre incisif La Vie 3.0. Être humain à l’ère de l’intelligence artificielle (9), Max Tegmark, professeur de physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), donne à entendre que le raisonnement n’est pas ce que nous croyons : « Un organisme vivant est un agent de rationalité limitée qui ne poursuit pas un objectif unique mais suit plutôt des règles de base sur ce qu’il convient de rechercher et ce qu’il faut éviter. Le cerveau humain perçoit ces règles de base de l’évolution comme des sensations qui, en général (et souvent sans que nous en ayons conscience), guident notre prise de décision vers le but ultime de la réplication. La sensation de faim ou de soif nous empêche de nous laisser mourir d’inanition ou de déshydratation, la douleur nous avertit d’un danger corporel, le désir nous fait procréer, les sentiments d’amour et d’attendrissement nous amènent à aider les autres porteurs de nos gènes et ceux qui les aident, et ainsi de suite. »
Les rationalistes cherchent depuis longtemps à rendre la raison aussi incontestable que les mathématiques, de sorte, disait Leibniz, que « deux philosophes n’auraient pas davantage besoin de se disputer que deux comptables ». Mais notre processus de prise de décision, comme un assemblage de programmes informatique bidouillés qui cherche les probabilités, est réglé par défaut sur l’intuition et plante à cause des réflexes, de l’effet d’ancrage, de l’aversion aux pertes, du biais de confirmation et de toute une série d’autres schémas mentaux irrationnels (10). Notre cerveau est moins une machine de Turing qu’une bouillie de systèmes bricolés par des siècles de mutations génétiques, des systèmes destinés à percevoir les changements de notre environnement et à réagir, le changement étant par nature dangereux. Quand il est en danger, le lézard à cornes du Texas crache du sang par les yeux ; quand nous sommes en danger, nous pensons.
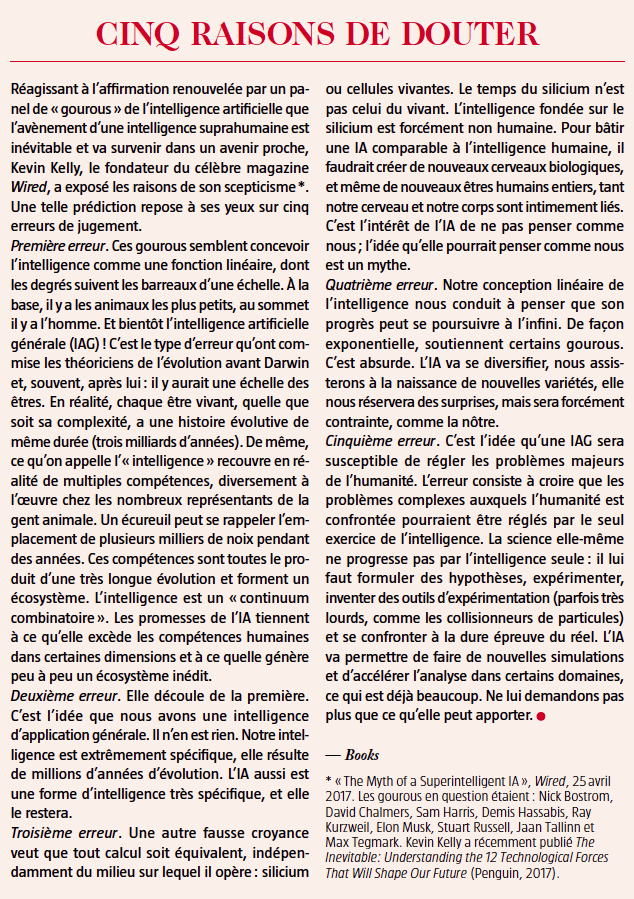 Cette faculté de penser accroît la capacité de nuisance. L’intelligence artificielle, comme l’intelligence naturelle, peut servir aussi bien à faire du mal qu’à faire du bien. Un garçon de 12 ans modérément précoce pourrait transformer l’Internet des objets – voiture, thermostat, babyphone – en Internet des objets maléfiques, comme dans la série Stranger Things. Dans Black Mirror, série qui déroule dans le futur proche, des technologies IA destinées à amplifier de louables désirs humains, comme celui d’une mémoire ou d’une cohésion sociale parfaites, débouchent invariablement sur le conformisme ou le fascisme. Même de modestes innovations, semble nous dire la série, font de la vie une triste expérience panoptique de laboratoire. Dans un épisode, des drones-abeilles autonomes – de petits insectes mécaniques qui pollinisent les fleurs – sont piratés pour éliminer des cibles en exploitant la reconnaissance faciale. Tiré par les cheveux ? Eh bien, l’enseigne de grande distribution Walmart a déposé récemment une demande de brevet pour des « applicateurs de pollen », et des chercheurs de Harvard travaillent depuis 2009 à la mise au point de robots-abeilles. Dans un récent article scientifique consacré à l’usage malveillant de l’intelligence artificielle, des comités de vigilance pronostiquent que, d’ici cinq ans, des systèmes d’arme autonomes piratés et des « essaims de drones » utilisant la reconnaissance faciale pourraient cibler des civils (11).
Les armes autonomes sont déjà engagées dans une trajectoire digne du Dr Folamour. Le système d’arme de combat rapproché Phalanx, qui équipe les bâtiments de la marine de guerre américaine, déclenche automatiquement son canon Gatling à guidage radar sur des missiles approchant à moins de 4 000 mètres, et la portée et la puissance de ces systèmes vont s’accroître à mesure que les armées chercheront à s’armer contre des robots et des engins téléguidés qui attaquent trop vite pour être contrés par des humains.
Aujourd’hui même, la reconnaissance faciale est à la base du programme chinois « Yeux perçants », qui collecte des images de vidéosurveillance dans 55 villes et sera probablement incorporé au « système de crédit social » que viennent de lancer les autorités. Ce système, qui doit être mis en place en 2020, attribuera à chaque citoyen chinois une note fondée sur son comportement, y compris quand il s’agit de traverser la rue.
Les régimes autocratiques peuvent aisément exploiter la façon dont les IA commencent à brouiller notre sens de la réalité. Entraînée sur un corpus de milliers de photos, l’IA de visualisation développée par l’entreprise Nvidia génère des images très réalistes de bus, de vélos, de chevaux et même de célébrités. Quand Google a rendu accessible le code source de son outil d’apprentissage automatique TensorFlow, en 2015, cela a donné très rapidement FakeApp, une application qui permet de remplacer le visage d’une personne par celui d’une autre sur une image animée, avec des résultats très convaincants – le plus souvent sur des corps en pleins ébats sexuels. Les IA peuvent aussi créer des vidéos entièrement bidon synchronisées avec une vraie bande-son (et il est encore plus facile de fabriquer un faux enregistrement audio). Ces outils sont en mesure de modifier si profondément la réalité qu’ils risquent de mettre à mal notre conviction bien ancrée qu’« on ne croit que ce qu’on voit » et de hâter l’avènement d’un État complètement paranoïaque, d’un régime de surveillance permanente.
Vladimir Poutine, qui a fait obstacle aux tentatives de l’ONU pour encadrer l’usage des armes autonomes, assurait en 2017 devant des écoliers russes : « L’intelligence artificielle est l’avenir », et « celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde ». Dans son livre « La machine consciente » (12), Amir Husain, fondateur d’une entreprise de sécurité informatique, écrit : « Un dirigeant psychopathe en possession d’une IA faible perfectionnée représente un danger bien plus élevé à court terme » qu’une IA forte dévoyée. En général, ceux qui redoutent un « mésusage accidentel » de l’IA, où la machine fait quelque chose que nous n’avions pas prévu, appellent à réglementer les machines, et ceux qui redoutent un « mésusage intentionnel » par des hackers ou des tyrans appellent à réglementer les conditions d’usage des machines. Husain, lui, soutient que la seule façon de prévenir le mésusage intentionnel est de développer une IA de guerre : « En réalité, nous n’avons pas le choix : il faut combattre l’IA avec l’IA. » S’il en est ainsi, l’IA nous oblige d’ores et déjà à développer une IA plus forte.
Dans les films ou séries où l’IAG devient incontrôlable, le méchant n’est d’habitude ni un humain ni une machine mais une entreprise : Tyrell ou Cyberdyne ou Omni Consumer Products. Dans le monde réel, une IAG incontrôlable risque moins d’être le fait de la Russie ou de la Chine (même si Pékin investit énormément dans ce domaine) que de Google ou de son pendant chinois, Baidu. Les grandes entreprises rétribuent grassement leurs développeurs et ne sont pas contraintes par le cadre constitutionnel, qui peut faire hésiter un État à appuyer sur le gros bouton rouge « Déshumanisation immédiate ». Parce qu’il sera beaucoup plus facile et moins onéreux de développer la première IAG que de développer la première IAG sûre, la victoire ira vraisemblablement à l’entreprise qui parviendra à constituer l’équipe la plus dénuée de scrupules. Demis Hassabis, qui dirige l’entreprise Google DeepMind, a conçu un jeu vidéo intitulé Evil Genius dans lequel le joueur incarne un « génie du mal » qui kidnappe des scientifiques et les entraîne à fabriquer une machine apocalyptique afin de dominer le monde. Tiens donc !
Les IAG doivent-elles devenir des méchants de James Bond ? « Quand nous imaginons une IA agressive, nous projetons notre propre psychologie sur l’intelligence artificielle ou extraterrestre », écrit Hector Levesque. De fait, nous projetons toute notre architecture mentale. Le réseau de neurones profond, avancée qui a permis beaucoup des progrès récents de l’IA, est calqué sur notre système nerveux. Au printemps 2018, l’Union européenne, tentant de se frayer un chemin parmi les « arbres décisionnels » qui peuplent les « forêts aléatoires » du royaume de l’apprentissage automatique, a fait savoir qu’elle exigerait désormais que les décisions prises par une machine soient explicables. Le mode de décision des IA pratiquant l’apprentissage profond est une « boîte noire » ; quand un algorithme décide qui recruter ou à qui accorder la liberté conditionnelle, il n’est pas en mesure de nous exposer son raisonnement. Encadrer la chose est aussi sensé qu’européen, mais personne n’a jamais proposé rien de semblable pour les humains, dont la prise de décision est autrement opaque.
En attendant, l’initiative européenne Human Brain Project, dotée d’un budget de 1,2 milliard d’euros, tente de simuler les 86 milliards de neurones et le million de milliards de synapses du cerveau dans l’espoir de faire apparaître de « nouvelles structures et comportements ». Certains pensent que l’« émulation du cerveau entier », une intelligence puisée dans notre caboche spongieuse, serait moins menaçante qu’une IAG à base de 0 et de 1. Mais, comme le faisait observer Stephen Hawking quand il nous mettait en garde contre la quête d’extraterrestres, « nous n’avons qu’à nous regarder pour voir qu’une forme de vie intelligente peut se transformer en quelque chose que nous n’aurions pas envie de croiser sur notre route ».
Dans un épisode classique de la série Star Trek d’origine, le vaisseau Enterprise passe sous le contrôle du superordinateur de bord M-5. Le capitaine Kirk, qui a un mauvais pressentiment, s’y refuse avant même que M-5 surréagisse durant un entraînement et attaque les vaisseaux « ennemis ». La paranoïa de l’ordinateur découle de celle de son programmeur, qui lui a imprimé ses propres « engrammes humains » (une sorte d’émulation de cerveau, peut-on supposer) pour lui permettre de penser. Tandis que les autres vaisseaux se préparent à détruire l’Entreprise, Kirk parvient à obtenir de M-5 qu’il comprenne qu’en se protégeant il est devenu un meurtrier. M-5 s’empresse de se suicider, démontrant la valeur de l’intuition humaine, et que la machine n’était pas si intelligente que cela.
Dépourvue d’intuition humaine, une IAG peut nous nuire en cherchant à nous rendre service. Si nous demandons à une IAG de nous « rendre heureux », elle peut se contenter de nous ficher dans le cerveau des électrodes déclenchant l’orgasme et de retourner vaquer à ses occupations. Le risque d’« objectifs mal ciblés » – un ordinateur interprétant son programme au pied de la lettre – pèse sur toute l’entreprise IAG. On utilise à présent l’apprentissage par renforcement pour entraîner des ordinateurs à jouer à des jeux sans même leur en apprendre les règles (13). Mais une IAG entraînée de la sorte pourrait considérer l’existence elle-même comme un jeu, une version boguée des Sims ou de Second Life. Dans le film de 1983 War Games, l’un des premiers et meilleurs traitements du sujet, le superordinateur de l’armée américaine, WOPR, livre la Troisième Guerre mondiale « comme s’il s’agissait d’un jeu, encore et encore », cherchant sans cesse à améliorer son score.
Quand on donne des objectifs à une machine, on lui donne aussi une raison de se préserver : comment, autrement, peut-elle faire ce que vous voulez ? Quel que soit l’objectif qu’ait une IAG, qu’il soit fixé par nous ou par elle – se préserver, accroître ses facultés intellectuelles, acquérir de nouvelles ressources –, elle peut avoir besoin de prendre les commandes pour y parvenir. Dans 2001, HAL, l’ordinateur du vaisseau spatial, décide qu’il lui faut tuer tous les humains à bord parce que « cette mission a trop d’importance pour moi pour que je vous laisse la mettre en péril ». Dans I, Robot, VIKI explique que les robots doivent prendre les choses en main car « malgré tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous intoxiquez la Terre et redoublez d’imagination pour vous autodétruire ». Dans l’exemple désormais célèbre du philosophe Nick Bostrom, une IAG cherchant à produire le maximum de trombones consommerait toute la matière de la Galaxie pour faire des trombones et éliminerait tout ce qui viendrait interférer avec cette tâche, y compris nous. Matrix offre une version élaborée de ce scénario : les machines ont bâti un monde de rêve afin que nous nous tenions tranquilles ; elles nous nourrissent avec les restes liquéfiés des morts et nous cultivent pour obtenir l’énergie dont elles ont besoin pour faire tourner leurs programmes. L’agent Smith, le visage humanisé des IA, explique : « À partir du moment où nous nous sommes mis à penser à votre place, c’est vraiment devenu notre civilisation. »
Le vrai risque d’une IAG, dès lors, émanerait non pas de la malveillance ou d’une conscience de soi naissante mais simplement de l’autonomie. Qui dit intelligence dit aussi domination, et une IAG sera le cogitateur suprême. De ce point de vue, une IAG, si bien intentionnée soit-elle, pourrait se comporter de façon aussi destructrice qu’un méchant de James Bond. « Avant que ne survienne une explosion d’intelligence, nous autres humains sommes comme des petits enfants qui jouent avec une bombe », écrit Bostrom dans Superintelligence (14), une analyse très argumentée, terrifiante par ses effets cumulatifs, de toutes les façons dont nous sommes mal préparés à fabriquer nos maîtres. Une IAG récursive, capable de se perfectionner elle-même, ne sera pas aussi brillante qu’Einstein mais intelligente « au sens où l’individu moyen l’est par rapport à un scarabée ou à un ver ». La façon dont les machines prendront le pouvoir n’est qu’un détail : Bostrom suggère que, « au moment prévu, les fabrications de nanotechnologies produisant des gaz neurotoxiques ou des robots-moustiques chercheurs de cibles pourraient éclore partout sur la Terre ». Cela ressemble à un scénario clés en main mais, toujours rabat-joie, il écrit : « En particulier, l’IA n’adopte pas un plan stupide dont même un être humain d’aujourd’hui serait capable de prédire l’échec. Et c’est précisément pourquoi tous ces scénarios de science-fiction qui donnent finalement la victoire aux humains ne sont pas crédibles. »
À défaut de pouvoir maîtriser une IAG, pouvons-nous au moins la lester de bonnes valeurs et nous assurer qu’elle les conserve une fois qu’elle commence à se modifier elle-même ? Max Tegmark fait observer qu’une IAG consciente pourrait trouver l’objectif de la protection de valeurs humaines « quelconque ou peu judicieux comme l’est à nos yeux la reproduction compulsive ». Il expose douze « scénarios des conséquences de l’IA », parmi lesquels « Utopie libertarienne », « Gardiens de zoo », « 1984 », « Autodestruction ». Même les issues théoriquement préférables semblent pires que le statu quo. Dans le scénario du dictateur bienveillant, l’IAG « s’appuie sur une définition vraiment complexe et subtile de l’épanouissement humain et a transformé la Terre en une sorte de zoo très élaboré où il fait vraiment bon vivre pour un humain. D’ailleurs, la plupart des gens se satisfont pleinement d’une vie qu’ils trouvent riche ». Et qui ressemble peu ou prou à un jeu vidéo immersif ou une simulation.
En cherchant à rester optimiste (du moins de son point de vue de physicien), Tegmark souligne qu’une IAG serait à même d’explorer et de comprendre l’Univers à un niveau inimaginable. Il nous incite à nous considérer comme des paquets d’informations que des IA pourraient diffuser vers d’autres galaxies à des fins de colonisation. « Cela pourrait se faire avec des techniques relativement simples en transmettant simplement les deux gigaoctets d’informations nécessaires pour décrire l’ADN d’une personne, puis mettre en couveuse le bébé que l’IA se chargera d’élever. Ou bien l’IA pourrait nano-assembler quarks et électrons pour former des personnes adultes dont toute la mémoire aurait été scannée à partir des originaux restés sur Terre. » Fastoche. Tegmark remarque que ce scénario de colonisation devrait nous rendre extrêmement méfiants à l’égard de toute information en provenance d’extraterrestres. Mais, dans ce cas, pourquoi suggérer un tel projet de colonisation ?
L’IAG pourrait être une impasse évolutive qui expliquerait le paradoxe de Fermi : alors que les conditions d’une vie intelligente existent probablement sur des milliards de planètes rien que dans notre galaxie, nous n’en voyons pas trace. Tegmark conclut : « Il apparaît que nous sommes un accident de l’histoire et que nous ne sommes pas la solution optimale à tout problème physique bien défini. Cela laisse entendre qu’une IA disposant d’un objectif défini avec rigueur sera capable d’avancer vers son objectif en nous éliminant. » Par conséquent, « pour programmer une IA amicale, nous devons saisir le sens de la vie ». Ah oui, alors !
En attendant, il nous faut un plan B. Bostrom propose de commencer par ralentir la course à l’IAG afin de se donner du temps pour prendre des mesures de précaution. De façon assez stupéfiante, il suggère toutefois que, une fois venue l’ère de l’IAG, nous ayons la plus grande déférence à son égard. Il nous faudra non seulement écouter ce que la machine aura à nous dire, mais lui demander de comprendre ce que nous voulons. Le problème du non-alignement des buts de l’IA avec les nôtres semble rendre une telle stratégie extrêmement risquée, mais Bostrom pense qu’il vaut mieux essayer de négocier les conditions de notre reddition plutôt que de nous fier à nous-mêmes, « stupides, ignorants et étroits d’esprit comme nous le sommes ». Tegmark pense lui aussi que nous devons avancer petit à petit vers une IAG. C’est la seule manière de donner du sens dans l’Univers qui nous a donné la vie : « Sans technologie, notre extinction est imminente dans le contexte cosmique des dix prochains milliards d’années. Tout entier, le spectacle de la vie dans notre Univers n’aura été qu’un bref éclair […] de beauté. » Nous sommes le prélude analogique à l’événement numérique majeur.
L’idée serait donc qu’après avoir créé notre dieu nous nous inclinions devant lui, en espérant qu’il n’exigera pas que nous versions notre sang en sacrifice. Anthony Levandowski, ingénieur spécialisé dans les voitures autonomes, a créé dans la Silicon Valley une religion nommée La Voie du futur, qui propose exactement cela. Après la Transition, les fidèles viendront vénérer « une divinité fondée sur l’intelligence artificielle ». Comme le disait Levandowski à un journaliste du magazine Wired, vénérer l’intelligence qui va nous dominer est notre seule voie de salut ; il nous reste à faire fonctionner nos méninges pour trouver la façon dont nous voudrons être traités. « Voulez-vous être un animal de compagnie ou du bétail ? » demande-t-il. Euh, je vais réfléchir.
— Cet article est paru dans The New Yorker le 14 mai 2018. Il a été traduit par Olivier Postel-Vinay.
[post_title] => Intelligence artificielle : « Nous avons convoqué le diable »
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => nous-avons-convoque-diable
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2022-09-26 14:42:17
[post_modified_gmt] => 2022-09-26 14:42:17
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56279
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
Cette faculté de penser accroît la capacité de nuisance. L’intelligence artificielle, comme l’intelligence naturelle, peut servir aussi bien à faire du mal qu’à faire du bien. Un garçon de 12 ans modérément précoce pourrait transformer l’Internet des objets – voiture, thermostat, babyphone – en Internet des objets maléfiques, comme dans la série Stranger Things. Dans Black Mirror, série qui déroule dans le futur proche, des technologies IA destinées à amplifier de louables désirs humains, comme celui d’une mémoire ou d’une cohésion sociale parfaites, débouchent invariablement sur le conformisme ou le fascisme. Même de modestes innovations, semble nous dire la série, font de la vie une triste expérience panoptique de laboratoire. Dans un épisode, des drones-abeilles autonomes – de petits insectes mécaniques qui pollinisent les fleurs – sont piratés pour éliminer des cibles en exploitant la reconnaissance faciale. Tiré par les cheveux ? Eh bien, l’enseigne de grande distribution Walmart a déposé récemment une demande de brevet pour des « applicateurs de pollen », et des chercheurs de Harvard travaillent depuis 2009 à la mise au point de robots-abeilles. Dans un récent article scientifique consacré à l’usage malveillant de l’intelligence artificielle, des comités de vigilance pronostiquent que, d’ici cinq ans, des systèmes d’arme autonomes piratés et des « essaims de drones » utilisant la reconnaissance faciale pourraient cibler des civils (11).
Les armes autonomes sont déjà engagées dans une trajectoire digne du Dr Folamour. Le système d’arme de combat rapproché Phalanx, qui équipe les bâtiments de la marine de guerre américaine, déclenche automatiquement son canon Gatling à guidage radar sur des missiles approchant à moins de 4 000 mètres, et la portée et la puissance de ces systèmes vont s’accroître à mesure que les armées chercheront à s’armer contre des robots et des engins téléguidés qui attaquent trop vite pour être contrés par des humains.
Aujourd’hui même, la reconnaissance faciale est à la base du programme chinois « Yeux perçants », qui collecte des images de vidéosurveillance dans 55 villes et sera probablement incorporé au « système de crédit social » que viennent de lancer les autorités. Ce système, qui doit être mis en place en 2020, attribuera à chaque citoyen chinois une note fondée sur son comportement, y compris quand il s’agit de traverser la rue.
Les régimes autocratiques peuvent aisément exploiter la façon dont les IA commencent à brouiller notre sens de la réalité. Entraînée sur un corpus de milliers de photos, l’IA de visualisation développée par l’entreprise Nvidia génère des images très réalistes de bus, de vélos, de chevaux et même de célébrités. Quand Google a rendu accessible le code source de son outil d’apprentissage automatique TensorFlow, en 2015, cela a donné très rapidement FakeApp, une application qui permet de remplacer le visage d’une personne par celui d’une autre sur une image animée, avec des résultats très convaincants – le plus souvent sur des corps en pleins ébats sexuels. Les IA peuvent aussi créer des vidéos entièrement bidon synchronisées avec une vraie bande-son (et il est encore plus facile de fabriquer un faux enregistrement audio). Ces outils sont en mesure de modifier si profondément la réalité qu’ils risquent de mettre à mal notre conviction bien ancrée qu’« on ne croit que ce qu’on voit » et de hâter l’avènement d’un État complètement paranoïaque, d’un régime de surveillance permanente.
Vladimir Poutine, qui a fait obstacle aux tentatives de l’ONU pour encadrer l’usage des armes autonomes, assurait en 2017 devant des écoliers russes : « L’intelligence artificielle est l’avenir », et « celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde ». Dans son livre « La machine consciente » (12), Amir Husain, fondateur d’une entreprise de sécurité informatique, écrit : « Un dirigeant psychopathe en possession d’une IA faible perfectionnée représente un danger bien plus élevé à court terme » qu’une IA forte dévoyée. En général, ceux qui redoutent un « mésusage accidentel » de l’IA, où la machine fait quelque chose que nous n’avions pas prévu, appellent à réglementer les machines, et ceux qui redoutent un « mésusage intentionnel » par des hackers ou des tyrans appellent à réglementer les conditions d’usage des machines. Husain, lui, soutient que la seule façon de prévenir le mésusage intentionnel est de développer une IA de guerre : « En réalité, nous n’avons pas le choix : il faut combattre l’IA avec l’IA. » S’il en est ainsi, l’IA nous oblige d’ores et déjà à développer une IA plus forte.
Dans les films ou séries où l’IAG devient incontrôlable, le méchant n’est d’habitude ni un humain ni une machine mais une entreprise : Tyrell ou Cyberdyne ou Omni Consumer Products. Dans le monde réel, une IAG incontrôlable risque moins d’être le fait de la Russie ou de la Chine (même si Pékin investit énormément dans ce domaine) que de Google ou de son pendant chinois, Baidu. Les grandes entreprises rétribuent grassement leurs développeurs et ne sont pas contraintes par le cadre constitutionnel, qui peut faire hésiter un État à appuyer sur le gros bouton rouge « Déshumanisation immédiate ». Parce qu’il sera beaucoup plus facile et moins onéreux de développer la première IAG que de développer la première IAG sûre, la victoire ira vraisemblablement à l’entreprise qui parviendra à constituer l’équipe la plus dénuée de scrupules. Demis Hassabis, qui dirige l’entreprise Google DeepMind, a conçu un jeu vidéo intitulé Evil Genius dans lequel le joueur incarne un « génie du mal » qui kidnappe des scientifiques et les entraîne à fabriquer une machine apocalyptique afin de dominer le monde. Tiens donc !
Les IAG doivent-elles devenir des méchants de James Bond ? « Quand nous imaginons une IA agressive, nous projetons notre propre psychologie sur l’intelligence artificielle ou extraterrestre », écrit Hector Levesque. De fait, nous projetons toute notre architecture mentale. Le réseau de neurones profond, avancée qui a permis beaucoup des progrès récents de l’IA, est calqué sur notre système nerveux. Au printemps 2018, l’Union européenne, tentant de se frayer un chemin parmi les « arbres décisionnels » qui peuplent les « forêts aléatoires » du royaume de l’apprentissage automatique, a fait savoir qu’elle exigerait désormais que les décisions prises par une machine soient explicables. Le mode de décision des IA pratiquant l’apprentissage profond est une « boîte noire » ; quand un algorithme décide qui recruter ou à qui accorder la liberté conditionnelle, il n’est pas en mesure de nous exposer son raisonnement. Encadrer la chose est aussi sensé qu’européen, mais personne n’a jamais proposé rien de semblable pour les humains, dont la prise de décision est autrement opaque.
En attendant, l’initiative européenne Human Brain Project, dotée d’un budget de 1,2 milliard d’euros, tente de simuler les 86 milliards de neurones et le million de milliards de synapses du cerveau dans l’espoir de faire apparaître de « nouvelles structures et comportements ». Certains pensent que l’« émulation du cerveau entier », une intelligence puisée dans notre caboche spongieuse, serait moins menaçante qu’une IAG à base de 0 et de 1. Mais, comme le faisait observer Stephen Hawking quand il nous mettait en garde contre la quête d’extraterrestres, « nous n’avons qu’à nous regarder pour voir qu’une forme de vie intelligente peut se transformer en quelque chose que nous n’aurions pas envie de croiser sur notre route ».
Dans un épisode classique de la série Star Trek d’origine, le vaisseau Enterprise passe sous le contrôle du superordinateur de bord M-5. Le capitaine Kirk, qui a un mauvais pressentiment, s’y refuse avant même que M-5 surréagisse durant un entraînement et attaque les vaisseaux « ennemis ». La paranoïa de l’ordinateur découle de celle de son programmeur, qui lui a imprimé ses propres « engrammes humains » (une sorte d’émulation de cerveau, peut-on supposer) pour lui permettre de penser. Tandis que les autres vaisseaux se préparent à détruire l’Entreprise, Kirk parvient à obtenir de M-5 qu’il comprenne qu’en se protégeant il est devenu un meurtrier. M-5 s’empresse de se suicider, démontrant la valeur de l’intuition humaine, et que la machine n’était pas si intelligente que cela.
Dépourvue d’intuition humaine, une IAG peut nous nuire en cherchant à nous rendre service. Si nous demandons à une IAG de nous « rendre heureux », elle peut se contenter de nous ficher dans le cerveau des électrodes déclenchant l’orgasme et de retourner vaquer à ses occupations. Le risque d’« objectifs mal ciblés » – un ordinateur interprétant son programme au pied de la lettre – pèse sur toute l’entreprise IAG. On utilise à présent l’apprentissage par renforcement pour entraîner des ordinateurs à jouer à des jeux sans même leur en apprendre les règles (13). Mais une IAG entraînée de la sorte pourrait considérer l’existence elle-même comme un jeu, une version boguée des Sims ou de Second Life. Dans le film de 1983 War Games, l’un des premiers et meilleurs traitements du sujet, le superordinateur de l’armée américaine, WOPR, livre la Troisième Guerre mondiale « comme s’il s’agissait d’un jeu, encore et encore », cherchant sans cesse à améliorer son score.
Quand on donne des objectifs à une machine, on lui donne aussi une raison de se préserver : comment, autrement, peut-elle faire ce que vous voulez ? Quel que soit l’objectif qu’ait une IAG, qu’il soit fixé par nous ou par elle – se préserver, accroître ses facultés intellectuelles, acquérir de nouvelles ressources –, elle peut avoir besoin de prendre les commandes pour y parvenir. Dans 2001, HAL, l’ordinateur du vaisseau spatial, décide qu’il lui faut tuer tous les humains à bord parce que « cette mission a trop d’importance pour moi pour que je vous laisse la mettre en péril ». Dans I, Robot, VIKI explique que les robots doivent prendre les choses en main car « malgré tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous intoxiquez la Terre et redoublez d’imagination pour vous autodétruire ». Dans l’exemple désormais célèbre du philosophe Nick Bostrom, une IAG cherchant à produire le maximum de trombones consommerait toute la matière de la Galaxie pour faire des trombones et éliminerait tout ce qui viendrait interférer avec cette tâche, y compris nous. Matrix offre une version élaborée de ce scénario : les machines ont bâti un monde de rêve afin que nous nous tenions tranquilles ; elles nous nourrissent avec les restes liquéfiés des morts et nous cultivent pour obtenir l’énergie dont elles ont besoin pour faire tourner leurs programmes. L’agent Smith, le visage humanisé des IA, explique : « À partir du moment où nous nous sommes mis à penser à votre place, c’est vraiment devenu notre civilisation. »
Le vrai risque d’une IAG, dès lors, émanerait non pas de la malveillance ou d’une conscience de soi naissante mais simplement de l’autonomie. Qui dit intelligence dit aussi domination, et une IAG sera le cogitateur suprême. De ce point de vue, une IAG, si bien intentionnée soit-elle, pourrait se comporter de façon aussi destructrice qu’un méchant de James Bond. « Avant que ne survienne une explosion d’intelligence, nous autres humains sommes comme des petits enfants qui jouent avec une bombe », écrit Bostrom dans Superintelligence (14), une analyse très argumentée, terrifiante par ses effets cumulatifs, de toutes les façons dont nous sommes mal préparés à fabriquer nos maîtres. Une IAG récursive, capable de se perfectionner elle-même, ne sera pas aussi brillante qu’Einstein mais intelligente « au sens où l’individu moyen l’est par rapport à un scarabée ou à un ver ». La façon dont les machines prendront le pouvoir n’est qu’un détail : Bostrom suggère que, « au moment prévu, les fabrications de nanotechnologies produisant des gaz neurotoxiques ou des robots-moustiques chercheurs de cibles pourraient éclore partout sur la Terre ». Cela ressemble à un scénario clés en main mais, toujours rabat-joie, il écrit : « En particulier, l’IA n’adopte pas un plan stupide dont même un être humain d’aujourd’hui serait capable de prédire l’échec. Et c’est précisément pourquoi tous ces scénarios de science-fiction qui donnent finalement la victoire aux humains ne sont pas crédibles. »
À défaut de pouvoir maîtriser une IAG, pouvons-nous au moins la lester de bonnes valeurs et nous assurer qu’elle les conserve une fois qu’elle commence à se modifier elle-même ? Max Tegmark fait observer qu’une IAG consciente pourrait trouver l’objectif de la protection de valeurs humaines « quelconque ou peu judicieux comme l’est à nos yeux la reproduction compulsive ». Il expose douze « scénarios des conséquences de l’IA », parmi lesquels « Utopie libertarienne », « Gardiens de zoo », « 1984 », « Autodestruction ». Même les issues théoriquement préférables semblent pires que le statu quo. Dans le scénario du dictateur bienveillant, l’IAG « s’appuie sur une définition vraiment complexe et subtile de l’épanouissement humain et a transformé la Terre en une sorte de zoo très élaboré où il fait vraiment bon vivre pour un humain. D’ailleurs, la plupart des gens se satisfont pleinement d’une vie qu’ils trouvent riche ». Et qui ressemble peu ou prou à un jeu vidéo immersif ou une simulation.
En cherchant à rester optimiste (du moins de son point de vue de physicien), Tegmark souligne qu’une IAG serait à même d’explorer et de comprendre l’Univers à un niveau inimaginable. Il nous incite à nous considérer comme des paquets d’informations que des IA pourraient diffuser vers d’autres galaxies à des fins de colonisation. « Cela pourrait se faire avec des techniques relativement simples en transmettant simplement les deux gigaoctets d’informations nécessaires pour décrire l’ADN d’une personne, puis mettre en couveuse le bébé que l’IA se chargera d’élever. Ou bien l’IA pourrait nano-assembler quarks et électrons pour former des personnes adultes dont toute la mémoire aurait été scannée à partir des originaux restés sur Terre. » Fastoche. Tegmark remarque que ce scénario de colonisation devrait nous rendre extrêmement méfiants à l’égard de toute information en provenance d’extraterrestres. Mais, dans ce cas, pourquoi suggérer un tel projet de colonisation ?
L’IAG pourrait être une impasse évolutive qui expliquerait le paradoxe de Fermi : alors que les conditions d’une vie intelligente existent probablement sur des milliards de planètes rien que dans notre galaxie, nous n’en voyons pas trace. Tegmark conclut : « Il apparaît que nous sommes un accident de l’histoire et que nous ne sommes pas la solution optimale à tout problème physique bien défini. Cela laisse entendre qu’une IA disposant d’un objectif défini avec rigueur sera capable d’avancer vers son objectif en nous éliminant. » Par conséquent, « pour programmer une IA amicale, nous devons saisir le sens de la vie ». Ah oui, alors !
En attendant, il nous faut un plan B. Bostrom propose de commencer par ralentir la course à l’IAG afin de se donner du temps pour prendre des mesures de précaution. De façon assez stupéfiante, il suggère toutefois que, une fois venue l’ère de l’IAG, nous ayons la plus grande déférence à son égard. Il nous faudra non seulement écouter ce que la machine aura à nous dire, mais lui demander de comprendre ce que nous voulons. Le problème du non-alignement des buts de l’IA avec les nôtres semble rendre une telle stratégie extrêmement risquée, mais Bostrom pense qu’il vaut mieux essayer de négocier les conditions de notre reddition plutôt que de nous fier à nous-mêmes, « stupides, ignorants et étroits d’esprit comme nous le sommes ». Tegmark pense lui aussi que nous devons avancer petit à petit vers une IAG. C’est la seule manière de donner du sens dans l’Univers qui nous a donné la vie : « Sans technologie, notre extinction est imminente dans le contexte cosmique des dix prochains milliards d’années. Tout entier, le spectacle de la vie dans notre Univers n’aura été qu’un bref éclair […] de beauté. » Nous sommes le prélude analogique à l’événement numérique majeur.
L’idée serait donc qu’après avoir créé notre dieu nous nous inclinions devant lui, en espérant qu’il n’exigera pas que nous versions notre sang en sacrifice. Anthony Levandowski, ingénieur spécialisé dans les voitures autonomes, a créé dans la Silicon Valley une religion nommée La Voie du futur, qui propose exactement cela. Après la Transition, les fidèles viendront vénérer « une divinité fondée sur l’intelligence artificielle ». Comme le disait Levandowski à un journaliste du magazine Wired, vénérer l’intelligence qui va nous dominer est notre seule voie de salut ; il nous reste à faire fonctionner nos méninges pour trouver la façon dont nous voudrons être traités. « Voulez-vous être un animal de compagnie ou du bétail ? » demande-t-il. Euh, je vais réfléchir.
— Cet article est paru dans The New Yorker le 14 mai 2018. Il a été traduit par Olivier Postel-Vinay.
[post_title] => Intelligence artificielle : « Nous avons convoqué le diable »
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => nous-avons-convoque-diable
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2022-09-26 14:42:17
[post_modified_gmt] => 2022-09-26 14:42:17
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=56279
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
 [post_title] => La pseudo-archéologie, un bon filon
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => pseudo-archeologie-filon
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-04 13:47:59
[post_modified_gmt] => 2019-03-04 13:47:59
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=55455
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
)
[post_title] => La pseudo-archéologie, un bon filon
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => pseudo-archeologie-filon
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-04 13:47:59
[post_modified_gmt] => 2019-03-04 13:47:59
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.books.fr/?p=55455
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
)
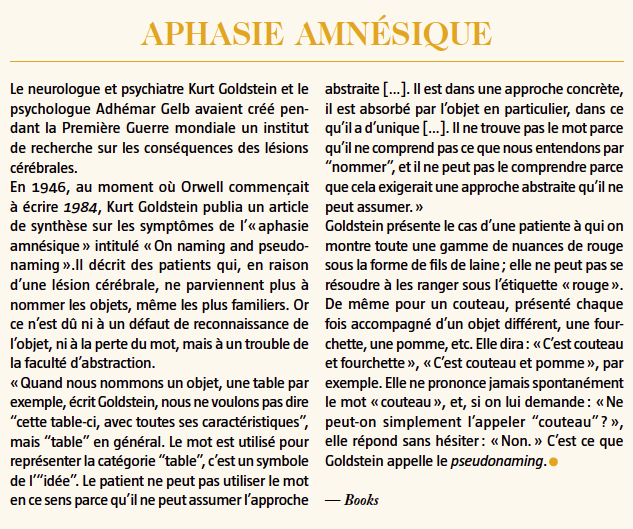 Chose intéressante, certaines de ces données de la neurologie ont leur parallèle en physique théorique. Dans les années 1950, Hugh Everett, étudiant en physique à Princeton, écouta Einstein formuler des doutes sur la mécanique quantique lors d’un séminaire.
Everett tenta de surmonter les problèmes évoqués par Einstein en concevant un monde d’univers multiples dans lequel tous les univers possibles existent simultanément, sans néanmoins qu’il y ait de communication entre eux. Les univers parallèles peuvent servir de métaphore pour illustrer le cas des personnalités multiples, comme dans le roman de Robert Louis Stevenson L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le Dr Jekyll est un chercheur en chimie et Mr Hyde consacre ses nuits à étrangler des femmes. Le Dr Jekyll est un homme élégant, Mr Hyde est petit et bossu. Le Dr Jekyll ignore les activités nocturnes de Mr Hyde, lequel n’est pas au fait des recherches du Dr Jekyll. De même, les univers multiples des physiciens quantiques sont complètement indépendants les uns des autres. Nous vivons tous nous-mêmes dans des univers multiples, car nos perceptions, nos souvenirs et nos émotions migrent sans cesse de façon à nous permettre de donner du sens au monde et de survivre.
Témoin les arts contemporains, qui multiplient les perspectives – y compris en musique. En 1913, Marcel Proust accorda un entretien au Petit Parisien l’avant-veille de la publication du premier volume d’À la recherche du temps perdu. Il y disait : « Vous savez qu’il y a une géométrie plane et une géométrie dans l’espace (2). Eh bien, pour moi, le roman ce n’est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. »
Chose intéressante, certaines de ces données de la neurologie ont leur parallèle en physique théorique. Dans les années 1950, Hugh Everett, étudiant en physique à Princeton, écouta Einstein formuler des doutes sur la mécanique quantique lors d’un séminaire.
Everett tenta de surmonter les problèmes évoqués par Einstein en concevant un monde d’univers multiples dans lequel tous les univers possibles existent simultanément, sans néanmoins qu’il y ait de communication entre eux. Les univers parallèles peuvent servir de métaphore pour illustrer le cas des personnalités multiples, comme dans le roman de Robert Louis Stevenson L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le Dr Jekyll est un chercheur en chimie et Mr Hyde consacre ses nuits à étrangler des femmes. Le Dr Jekyll est un homme élégant, Mr Hyde est petit et bossu. Le Dr Jekyll ignore les activités nocturnes de Mr Hyde, lequel n’est pas au fait des recherches du Dr Jekyll. De même, les univers multiples des physiciens quantiques sont complètement indépendants les uns des autres. Nous vivons tous nous-mêmes dans des univers multiples, car nos perceptions, nos souvenirs et nos émotions migrent sans cesse de façon à nous permettre de donner du sens au monde et de survivre.
Témoin les arts contemporains, qui multiplient les perspectives – y compris en musique. En 1913, Marcel Proust accorda un entretien au Petit Parisien l’avant-veille de la publication du premier volume d’À la recherche du temps perdu. Il y disait : « Vous savez qu’il y a une géométrie plane et une géométrie dans l’espace (2). Eh bien, pour moi, le roman ce n’est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. »