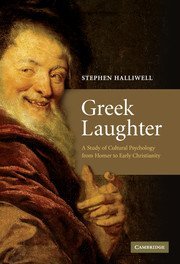Drôle comme un Grec
Publié le 26 juin 2015. Par la rédaction de Books.
« C’est un intellectuel qui, apprenant qu’un certain escalier comporte vingt marches à la montée, demande s’il y en a autant à la descente. » Cette innocente blague nous est léguée par les Grecs de l’Antiquité. Aujourd’hui, la Grèce semble, avec ses dettes, plutôt empêtrée dans l’une des terribles tragédies dont les Anciens avaient aussi le secret. Au point de nous faire oublier que ses auteurs nous ont également appris l’humour. Dans cet article du Times Literary Supplement traduit par Books en juin 2009, Mary Beard nous invite à revenir aux sources du rire.
Au IIIe siècle avant J.-C., tandis que les ambassadeurs de Rome négociaient avec la cité grecque de Tarente, un éclat de rire malvenu coupa court à tout espoir de paix (1). Les auteurs de l’Antiquité ne sont pas tous d’accord sur la cause exacte de l’hilarité grecque, mais tous pensent que ce fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase romain, conduisant à la guerre.
L’un des récits de la scène incrimine le mauvais grec parlé par Postumius, le chef de la délégation romaine. Les Tarentins n’auraient pu dissimuler leur amusement devant cet homme au très singulier accent et à la grammaire pour le moins défaillante. L’historien Dion Cassius, lui, fait porter la responsabilité de l’affaire sur l’habit romain. « Bien loin de recevoir leurs hôtes correctement, écrit-il, les Tarentins se moquèrent de la toge, entre autres choses. C’était le costume par excellence de la Cité, celui que l’on portait pour se rendre au Forum. Les émissaires l’avaient revêtu pour faire honneur à l’événement, ou par peur – pensant s’assurer ainsi le respect des Tarentins. Au lieu de quoi ils essuyèrent les railleries de bandes de joyeux drilles. » L’un d’entre eux, poursuit-il, alla même jusqu’à « s’accroupir et chier » sur le vêtement incriminé. Si la chose est vraie, elle pourrait bien aussi avoir contribué à l’indignation romaine. Pourtant, c’est le rire que Postumius releva dans sa menaçante et prophétique réponse : « Riez, riez tant qu’il en est encore temps ; car vous pleurerez longtemps quand le moment sera venu de laver ce vêtement de votre sang. »
L’épisode offre un précieux aperçu de la façon dont ces pontifiants Romains enveloppés de leur toge étaient vus par leurs voisins de la Méditerranée antique. Et confirme – occasion rare – que ces encombrantes et ondoyantes robes paraissaient aussi comiques aux Grecs d’Italie du Sud qu’à nous. Mais l’anecdote a aussi le mérite de réunir quelques-uns des principaux ingrédients du rire antique : le pouvoir, l’identité, et le sentiment tenace que ceux qui ridiculisent leurs ennemis seront bientôt eux-mêmes l’objet de leur risée. C’était, à vrai dire, l’une des règles de la « gélastique » (ou « art du rire »), pour emprunter un terme à la nouvelle somme que Stephen Halliwell consacre au rire en Grèce : le blagueur n’était jamais bien loin d’être la cible de ses propres blagues. L’adjectif latin ridiculus s’appliquait ainsi à la fois à quelque chose de risible – « ridicule » au sens moderne – et aux personnes ou aux choses faisant rire à dessein.
Le comique fut toujours l’une des techniques préférées des monarques et des tyrans, tout comme une arme dirigée contre eux. Un bon roi savait, bien sûr, faire preuve d’humour. Quatre siècles après sa mort, l’empereur Auguste était encore loué pour sa tolérance envers les quolibets et autres plaisanteries dont il faisait l’objet. L’un des plus célèbres bons mots de l’Antiquité, dont la postérité s’est étendue jusqu’au XXe siècle – il a été repris à la fois par Freud et par Iris Murdoch dans son roman La Mer, la mer –, était une insinuation ironique concernant la paternité d’Auguste : un jour, apercevant un homme venu d’une province et lui ressemblant beaucoup, l’empereur lui demanda si sa mère avait jamais travaillé au Palais. « Non. Mais mon père, oui » obtint-il en guise de réponse. Il eut la sagesse de le prendre avec le sourire.
Une exquise torture
Les tyrans, eux, ne voyaient pas d’un bon œil les plaisanteries faites à leurs dépens, même s’ils aimaient rire de leurs sujets. Sylla, le dictateur sanguinaire du Ier siècle avant J.-C., était ainsi un philogelos (« amoureux du rire ») bien connu ; et les blagues de potache faisaient partie des techniques d’humiliation utilisées par le despote Élagabal. On raconte qu’il s’amusait à faire asseoir ses invités sur des coussins gonflables pour les voir ensuite disparaître sous la table, à mesure que l’air s’échappait. Mais c’est le désir de contrôler le rire qui fut véritablement la marque de distinction des autocrates antiques (et le signe – désopilant – d’un pouvoir devenu fou). Certains essayèrent de l’interdire, comme Caligula, lors du deuil public de sa sœur [qui était aussi sa maîtresse]. D’autres l’imposèrent à leurs malheureux subalternes aux moments les plus inopportuns. Caligula, encore lui, avait le chic pour en faire une exquise torture : il obligea, dit-on, un vieil homme à assister à l’exécution de son fils un matin, et l’invita le soir même à dîner en sa compagnie, le pressant de rire et plaisanter. Pourquoi, se demande Sénèque, la victime se prêta-t-elle au jeu ? Réponse : l’homme avait un autre fils.
Ces stupides Abdéritains
L’identité, aussi, était source de dérision, comme en témoigne l’anecdote des Tarentins et de la toge. De très nombreux exemples de ce type sont rapportés dans l’unique livre d’histoires drôles antiques qui nous soit parvenu. Connu sous le nom de Philogelos, il s’agit d’un recueil d’environ 260 blagues probablement rassemblées au IVe siècle, certaines d’entre elles étant bien antérieures. Certes, la chose est controversée : le Philogelos nous offre-t-il un aperçu du comique populaire sous l’Antiquité (le genre de livre qu’on emportait chez le barbier) ou s’agit-il, comme c’est plus probable, d’une somme encyclopédique réunie par quelque savant de l’Empire tardif ? Quoi qu’il en soit, on y trouve des plaisanteries sur les médecins, les hommes à l’haleine puante, les eunuques, les barbiers, les malades, les chauves, les diseurs de bonne aventure véreux, et autres personnages hauts en couleur de l’époque (des hommes pour la plupart).
Le Philogelos fait une place de choix aux intellectuels, cible de près de la moitié des blagues, pour leur prosaïsme scolastique : « Une tête d’œuf de médecin reçoit un patient. “Docteur, lui dit-il, j’ai des vertiges pendant vingt minutes quand je me lève le matin. – Eh bien, levez-vous vingt minutes plus tard.” » Juste après les histoires d’intellectuels viennent les blagues ethniques. Les habitants des trois cités grecques d’Abdère, de Cymé et de Sidon sont tournés en dérision pour leur bêtise singulière. Ils sont dépeints comme aussi prosaïques que les « têtes d’œuf », et encore plus obtus. « Un Abdéritain aperçoit un eunuque en compagnie d’une femme et lui demande s’il s’agit de son épouse. Quand il se voit répondre qu’un eunuque ne peut avoir de femme, l’Abdéritain lui demande : « “Dans ce cas, est-ce votre fille ?” » Et il y a bien d’autres histoires de la même eau.
Le plus curieux, dans les blagues du Philogelos, c’est qu’elles sont si nombreuses à paraître encore drôles aujourd’hui. Après deux millénaires, elles réussissent à nous faire davantage sourire que la plupart des livres humoristiques modernes. Le comique [britannique] Jim Bowen est ainsi récemment parvenu à faire rire de bon cœur le public du XXIe siècle avec un spectacle entièrement tiré du Philogelos. Pourquoi ces histoires semblent-elles si modernes ? Dans le cas du spectacle de Jim Bowen, le soin apporté à la sélection et à la traduction y est pour beaucoup (je doute que le public d’aujourd’hui se torde de rire en écoutant celle de l’athlète crucifié qui avait plus l’air de voler que de courir). De plus, comprendre ces plaisanteries ne requiert pas de connaissance particulière du contexte.
Mais ce n’est pas tout. Si ces facéties nous parlent encore, je subodore que cela n’a guère à voir avec le caractère supposé « universel » des sujets de dérision (bien que la mort ou l’erreur d’identité aient tenu une aussi grande place alors qu’aujourd’hui), et beaucoup à voir avec l’ascendance antique de nos propres traditions comiques. Quiconque a eu des enfants, ou a vu des parents avec les leurs, sait que les êtres humains apprennent comment et de quoi on peut rire – les clowns, oui ; les handicapés, non. Or c’est en grande partie de la culture du rire issue de la Renaissance que l’Occident moderne a appris comment rire, et cette culture s’inspirait directement de l’Antiquité. L’une des blagues récurrentes des livres d’histoires drôles de la Renaissance était cette fameuse réplique sur la paternité : « Ma mère, non. Mais mon père, oui. » En d’autres termes, nous pouvons encore nous amuser de ces plaisanteries grecques parce qu’elles nous ont appris ce que « rire » veut dire. Cela ne signifie pas, bien sûr, que notre humour soit le parfait décalque de celui des Anciens. Loin de là. Même dans le Philogelos, quelques histoires sont très déroutantes. Mais, d’une façon générale, les Grecs et les Romains pouvaient s’amuser de différentes choses (des aveugles, par exemple – mais rarement des sourds, contrairement à nous), et ils pouvaient rire et provoquer le rire en différentes circonstances, dans différents buts. La dérision était ainsi une arme couramment utilisée dans les tribunaux, alors qu’elle ne l’est plus que rarement de nos jours. Cicéron, le plus grand orateur de l’Antiquité, passait aussi pour son plus grand blagueur ; bien trop drôle pour son propre intérêt, pensaient des citoyens plus sérieux.
Mourir de rire
Et puis il subsiste aussi quelques énigmes particulières, au premier rang desquelles la comédie antique. Il ne fait guère de doute que le public athénien riait de bon cœur aux pièces d’Aristophane, comme nous aujourd’hui. Mais très peu de lecteurs modernes ont été capables de trouver matière à rire dans les comédies très populaires écrites au IVe siècle av. J.-C. par le dramaturge Ménandre, d’un style aussi convenu que moralisateur. Est-ce parce nous n’en saisissons plus aujourd’hui le sens comique ? Ou bien n’étaient-elles tout simplement pas « drôles » au sens d’« hilarantes » ? Étudiant ces pièces, Halliwell nous livre une hypothèse. Concédant que « l’humour de Ménandre, au sens large du terme, résiste à tout diagnostic définitif » (c’est-à-dire que nous ne savons pas si, ni comment, c’était drôle), il renverse habilement le problème. Ces pièces n’ont pas vocation à faire rire, dit-il ; « elles portent sur le rire ». Leurs complexes intrigues « comiques », et les contrastes entre les personnages dont nous pourrions vouloir rire et ceux avec qui nous voulons rire ont pour but d’inciter le public ou le lecteur à réfléchir à ce qui rend le rire possible ou impossible, socialement acceptable ou inacceptable. En d’autres termes, pour Halliwell, la « comédie » de Ménandre fonctionne comme un essai dramatique sur les principes fondamentaux de la « gélastique » grecque.
Mais il n’est parfois pas facile de saisir clairement comment ou pourquoi les Anciens établissaient comme ils le faisaient l’échelle allant du vaguement amusant au franchement hilarant. Halliwell relève en passant une série d’anecdotes où il est question de personnages célèbres réputés être morts de rire. Zeuxis, peintre grec renommé du IVe siècle av. J.-C., est l’un d’entre eux ; il s’effondra, dit-on, après avoir contemplé le portrait d’une vieille femme qu’il venait d’achever. Le philosophe Chrysippe et le dramaturge Polémon, contemporain de Ménandre, en sont deux autres. Ils ont rendu l’âme, rapporte une histoire similaire, peu après avoir vu un âne goûter à quelques-unes des figues qui leur étaient destinées. Ils demandèrent à leurs domestiques de servir donc du vin à l’animal – à la vue de quoi ils moururent de rire.
Mais qu’avaient donc ces scènes de si drôle ? Dans le cas de Zeuxis, il n’est pas difficile d’y déceler une note de la fameuse misogynie antique. Dans les autres cas, c’est vraisemblablement la confusion des genres entre l’animal et l’humain qui provoque le rire – comme en témoignent d’autres histoires comparables datant de l’époque.
L’âne et les chimpanzés
C’est à une telle confusion que renvoie, par exemple, l’histoire d’un certain Marcus Crassus l’Ancien, Romain agelast (« non rieur », en grec ancien), qui n’aurait craqué qu’une seule fois dans sa vie : après avoir vu un âne manger des chardons. « Les chardons sont comme de la laitue aux lèvres d’un âne », songea-t-il, citant là un proverbe très connu de l’époque. Et d’éclater de rire. Cela n’est pas sans rappeler la façon dont on riait naguère à la vue des tea parties de chimpanzés organisées par les zoos traditionnels (spectacles appréciés de générations entières, jusqu’à ce qu’ils disparaissent sous les coups de l’extrême délicatesse moderne en la matière). Le rire antique jouait lui aussi, semble-t-il, sur les frontières entre l’homme et les autres espèces. En insistant sur les tentatives de franchir les limites, il défiait et réaffirmait tout à la fois la distinction entre l’homme et l’animal.
Halliwell insiste sur le fait que l’un des traits distinctifs de la culture « gélastique » est le rôle central du rire dans une vaste gamme de théories littéraires, culturelles et philosophiques. Dans l’Académie antique, on attendait des philosophes et des théoriciens qu’ils aient une conception du rire, de sa fonction et de sa signification. Et voilà bien le principal centre d’intérêt d’Halliwell. Son livre offre une vue d’ensemble du rire dans la Grèce antique, d’Homère aux premiers chrétiens (un groupe chaque jour plus lugubre, capable de voir dans le rire l’œuvre du diable). Et son introduction est probablement la meilleure synthèse qu’il m’ait été donné de lire sur le sujet. Mais Greek Laughter n’est pas fait pour ceux qui souhaitent savoir ce que les Grecs trouvaient drôle ou ce dont ils riaient. Il n’y est nullement question du Philogelos et l’index ne comporte pas d’entrée au mot « blagues ». L’auteur centre son attention sur le rire tel qu’il est traité dans les textes philosophiques et littéraires. De ce point de vue, certaines de ses analyses sont brillantes. Halliwell nous livre un exposé clair et prudent des thèses d’Aristote – utile antidote aux interprétations les plus extravagantes circulant depuis la disparition célèbre de son « Traité sur la comédie ».
Mais le temps fort du livre reste l’étude de Démocrite, le philosophe atomiste du Ve siècle av. J.-C., réputé rieur le plus invétéré de l’Antiquité (2). Un tableau du XVIIIe siècle représentant ce « riant philosophe » orne la couverture du livre. Démocrite y arbore un large sourire, tout en pointant son doigt décharné vers le lecteur, dans un mélange troublant de gaieté et de menace. L’analyse antique la plus révélatrice du rire de Démocrite émane d’un roman épistolaire de l’époque romaine, inclus dans les soi-disant Lettres d’Hippocrate – recueil attribué au légendaire père fondateur de la médecine grecque, mais écrites en vérité plusieurs siècles après sa mort. Les échanges fictifs contenus dans l’ouvrage racontent l’histoire de la rencontre entre Hippocrate et Démocrite. Les habitants de la ville natale du philosophe s’inquiétaient de sa tendance à rire de tout en toute circonstance (pour les funérailles comme pour les victoires politiques) et le pensaient fou. Ils sommèrent donc le plus célèbre médecin du monde de le soigner. Mais, une fois sur place, Hippocrate eut tôt fait de trouver Démocrite plus sain d’esprit que ses concitoyens. Car il avait, seul, reconnu l’absurdité de l’existence humaine, et avait donc toutes les raisons d’en rire.
À la lumière de l’analyse fouillée d’Halliwell, ce roman épistolaire s’avère être bien davantage que la simple histoire stéréotypée d’un malentendu dissipé, ou d’un fou passé sain d’esprit. Ne devrions-nous pas voir dans l’histoire de Démocrite, demande-t-il, l’équivalent grec de cette sorte d’« absurdité existentielle » qui nous est devenue familière sous la plume de Samuel Beckett ou Albert Camus. Là encore, comme dans son analyse de Ménandre, Halliwell explique que ce texte soulève des questions fondamentales sur le rire. Les débats entre Hippocrate et Démocrite débouchent sur une série de réflexions autour de l’interrogation suivante : jusqu’où peut-on tenir une position entièrement fondée sur l’absurde ? Les concitoyens de Démocrite le prennent à rire absolument de tout ; d’un point de vue plus philosophique, Hippocrate se demande si son patient n’a pas même décelé – comme l’écrit Halliwell – « une absurdité cosmique au cœur de l’infini ». Pourtant, ce n’est pas la posture qu’adopte au final Démocrite. Puisqu’il considère « exempte de toute moquerie » la position du sage, capable de percevoir l’absurdité générale du monde. Démocrite, en d’autres termes, ne rit pas de lui-même ou de sa propre théorie.
Le riant philosophe
Mais ce que ne dit pas Halliwell, c’est que la ville natale de Démocrite n’est autre qu’Abdère – cette cité de Thrace dont les habitants sont la cible de tant de blagues du Philogelos. Dans une note de bas de page, il rejette même sommairement l’idée selon laquelle la « proverbiale stupidité des Abdéritains devait son origine au rire démocritéen lui-même ». Mais ceux qui s’intéressent autant à la pratique qu’à la théorie du rire antique n’écarteront pas si vite ce lien. Car ce n’était pas seulement une question de « riant philosophe » ou de citoyens stupides ne sachant même pas ce qu’est un eunuque. Cicéron, aussi, utilisait le nom de la cité comme raccourci pour décrire une situation sens dessus dessous. « On se croirait à Abdère ici », écrit-il de Rome. Quelle qu’en fût la raison à l’origine, « Abdère » était devenu au Ier siècle av. J.-C. l’un de ces noms qui provoquait à coup sûr le rire des Anciens.
Ce texte est paru le 18 février 2009. Il a été traduit par Julien Charnay.
Notes
1| Tarente est une ville des Pouilles, dans le talon de la botte italienne. Dans l’Antiquité, c’était l’une des cités les plus riches de la Grande-Grèce (comprenant les colonies grecques du sud de l’Italie). Elle a connu son apogée au IVe siècle av. J.-C.
2| L’atomisme est une théorie matérialiste selon laquelle le monde qui nous entoure n’est qu’un assemblage d’infinies particules nommées « atomes », tous de même substance.