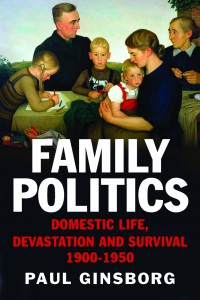Dans les
Principes de la philosophie du droit de Hegel, la famille est le premier moment de la vie éthique, l’étape initiale d’un processus dialectique dont l’aboutissement est l’État. On peut interpréter cette caractérisation de la famille comme la traduction, dans le langage très abstrait et théorique de la philosophie, d’une observation presque triviale. Dans les termes que commenceront à utiliser quelques dizaines d’années après Hegel les sociologues et les anthropologues, la famille, qui peut prendre de multiples formes dont la famille nucléaire moderne n’est que le dernier avatar, est une « institution primitive », l’une des premières structures stables de la vie sociale, qu’on retrouve à toutes les époques et dans toutes les civilisations.
Les rapports de la famille et de cette autre institution fondamentale, plus sophistiquée et tardive, qu’est l’État, sont complexes et loin d’avoir toujours été complètement harmonieux. Dans l’histoire, ils ont revêtu des aspects variés qui n’ont pas systématiquement bénéficié de l’attention qu’ils méritaient. L’histoire de la famille en général, de son évolution et des différents modèles familiaux qui se sont succédé ou ont coexisté est aujourd’hui assez bien documentée et connue. Mais celle de la famille dans ses rapports avec l’État l’est nettement moins. Dans la plupart des travaux d’histoire générale et politique du XXème siècle, relève Paul Ginsborg en ouverture de son ouvrage
Family Politics. Domestic Life, Devastation and Survival 1900-1950, la famille brille par son absence. C’est précisément dans le but de remédier partiellement à cette carence qu’il a rédigé ce gros livre, qu’il présente comme une histoire « des événements et des régimes de la première moitié du XXème siècle vus essentiellement à travers le prisme de la vie familiale ».
Paul Ginsborg n’a pas été amené par hasard à s’intéresser à l’histoire de la vie domestique. Établi en Italie depuis les années 1980 après avoir étudié et enseigné à Cambridge, professeur à l’Université de Florence depuis 1992, il est un spécialiste renommé de l’histoire de l’Italie contemporaine, à laquelle il a consacré deux ouvrages, le premier couvrant la période 1943-1980, le second les années 1980-2001. Dans ces deux livres, simultanément publiés en anglais et en italien et qui ont été salués comme figurant comme parmi les meilleurs jamais écrits sur ce thème, en Italie et dans le monde anglophone par d’excellents connaisseurs du sujet comme Perry Anderson ou Alexander Stille, Ginsborg (par ailleurs connu pour ses prises de position très critiques au sujet de la carrière et de la politique de Silvio Berlusconi, sa sympathie pour les idéaux de centre gauche et son intérêt pour la démocratie participative), prenant pleinement en compte le rôle notoirement central joué dans le fonctionnement de la société italienne par la famille, faisait à celle-ci une grande place dans ses analyses.
Family Politics prolonge, approfondit, systématise et étend cette approche en l’appliquant à cinq pays à des moments particulièrement tourmentés de leur histoire, marqués par des troubles politiques et révolutionnaires et l’installation de régime dictatoriaux : la Russie de la révolution d’Octobre et l’URSS de Staline, la Turquie de la révolution qui mit fin à l’Empire ottoman et de Mustafa Kemal Atatürk, l’Italie fasciste de Mussolini, l’Espagne de la guerre civile puis de la dictature franquiste, enfin l’Allemagne du Troisième Reich. Dans les pages consacrées à chacun de ces cas de figure, il est question des politiques familiales (
family policies) menées par les gouvernements concernés, mais aussi, plus largement, des familles dans la politique (
family politics). Original par son sujet et son approche d’histoire comparée,
Family Politics l’est aussi par sa méthode, plus exactement par la variété de méthodes qu’emploie Ginsborg dans un livre qui combine histoire sociale, politique, économique et juridique, réflexions sur une série de représentations artistiques et aperçus biographiques.
- Quelques figures emblématiques
Pour chacun des pays qu’il étudie, Paul Ginsborg utilise comme point d’entrée et fil conducteur de son récit la vie d’une personnalité illustrative à un titre ou un autre de l’histoire de la famille au moment considéré. Trois de ces cinq personnes sont de remarquables figures féminines, ferventes avocates des droits des femmes : Aleksandra Kollontai, intellectuelle proche de Lénine, l’unique femme commissaire du peuple dans la Russie révolutionnaire ; Halide Edib, romancière, journaliste et patriote turque ; et Margarita Nelken, elle aussi écrivain et la figure centrale du féminisme dans l’Espagne des années 1930. Dans le cas de l’Italie, Paul Ginsborg entame son récit par une évocation de la vie de Filippo Tommaso Marinetti, fondateur du futurisme, le fameux mouvement artistique et d’idées italien des années 1920, et sympathisant du fascisme jusqu’à la dernière heure. Et il ouvre le chapitre sur l’Allemagne par un portrait de Joseph Goebbels, bras droit d’Hitler, architecte et maître d’œuvre de la propagande nazie.
Dans une recension par ailleurs très élogieuse de
Family Politics, l’historien britannique Richard Overy s’étonne du choix de ces deux derniers personnages, qu’il estime peu indiqués comme supports d’une réflexion sur la famille. On pourrait en effet s’interroger sur l’opportunité de leur élection à ce titre. Porte-parole d’un mouvement qui, dans son fameux manifeste, célébrait « la virilité, la rapidité et la violence », Marinetti, dont le monde idéal, de son propre aveu, était un monde peuplé « de mâles ardents et de femelles inséminées », et qui n’hésitait pas à déclarer « la guerre démontre que les femmes ont besoin d’une copulation quotidienne », voyait dans la famille une institution préhistorique et « dévirilisante », qu’il décrivait comme « quasiment une prison [...] et souvent une tente de Bédouins avec son mélange sordide de vieillards fragiles, de femmes, d’enfants, de porcs, de mulets, de chameaux de poulets et d’excréments ». Quant à Goebbels, il fut l’artisan direct ou indirect du malheur de nombreuses familles allemandes et du massacre de millions de familles juives et, peu après le suicide d’Hitler, il n’hésita pas à exterminer la sienne en tuant les six enfants qu’il avait eus avec sa femme Magda, avant que le couple ne se donne la mort.
À l’évidence, les trois femmes dont Ginsborg a décidé d’exploiter la vie pour illustrer l’histoire de la famille dans leur pays sont des personnalités, non seulement plus attirantes, mais aussi plus riches et plus intéressantes. Eu égard à la problématique étudiée, le choix des deux hommes n’est cependant pas dépourvu de pertinence. Les vues de Marinetti étaient représentatives d’un culte de la virilité qui, au-delà du futurisme, caractérisait le fascisme et a influencé sa vision de la famille. Et dans l’imagerie nazie, la famille de Goebbels (qui incluait un fils de Magda issu d’un premier mariage), avait été transformée par le maître propagandiste en symbole et modèle de la vie domestique nazie : une famille ordonnée, disciplinée, riche d’enfants, d’hérédité saine et d’une pureté raciale hors de doute.
Ginsborg ne peut toutefois s’empêcher de souligner les contradictions entre les opinions professées par certaines de ces personnalités et leur propre vie, notamment dans leurs dernières années. Après avoir survécu aux purges staliniennes, Aleksandra Kollontai, qui préconisait la disparition de la famille, vit sa vieillesse éclairée par la découverte des joies de la vie familiale et la compagnie de ses quatre enfants. Margarita Nelken, qui dénonçait la famille bourgeoise comme « une hypocrisie et une farce », vivait comme une bourgeoise et éprouvait pour les membres de la sienne beaucoup d’affection. Et Marinetti, qui stigmatisait la salle à manger familiale comme « le réceptacle quotidien de la bile, de la mauvaise humeur et des préjugés », une fois marié avec une femme qu’il admirait et père de trois filles qu’il adorait, se comporta en père de famille des plus traditionnels au sein d’une famille fonctionnant comme « une structure aimante classique, avec à sa tête un patriarche vieillissant, bienveillant et jaloux, et à la barre une femme forte et dévouée ».
On trouvera aussi dans
Family Politics un aperçu de la vie familiale et des conceptions de la famille des différents dictateurs. De tous, Francesco Franco, mari attentif et fidèle et père affectueux, est le seul qu’on puisse décrire comme un authentique « bon père de famille » pouvant légitimement considérer sa propre famille comme une incarnation des valeurs qu’il prônait. C’est loin d’être le cas des quatre autres. Attaché à l’émancipation et l’éducation des femmes dans les limites de sa vision très paternaliste des rapports entre sexes dans la sphère privée, brièvement marié et rapidement divorcé, Kemal Atatürk appréciait surtout la société masculine de ses compagnons de beuverie, ses amis de l’armée, qui était sa véritable famille. Fameux pour ses multiples conquêtes et la façon très fanfaronne dont il les évoquait, Benito Mussolini était un homme à femmes dépourvu de toute sentimentalité, dont les incessantes et violentes disputes avec son épouse ont durablement marqué leurs enfants. Adolf Hitler, qui se décrivait comme l’opposé parfait d’un homme de famille et dont l’idéal féminin était « une jolie petite chose naïve, tendre, douce et stupide », ne fonda jamais de famille et entretenait avec les membres de celle dont il provenait des rapports sans la moindre aménité.
Quant à Staline, chez qui une enfance malheureuse avait encouragé le développement d’un caractère soupçonneux et le goût du secret (sauvagement battu par son père, un alcoolique violent, il n’avait échappé à l’enfer familial que pour se retrouver enfermé à l’initiative de sa mère dans un collège religieux où sévissaient une mentalité arriérée et des mœurs cruelles), il infligea à sa famille davantage de souffrances qu’il n’en avait lui-même subi. Sa seconde femme s’étant suicidée après qu’il l’eut insultée en public à l’occasion d’une querelle au sujet de la collectivisation forcée de la paysannerie à laquelle elle était opposée, basculant dans une méfiance paranoïaque à l’égard de tous ceux qui l’entouraient, le dictateur répudia, fit déporter en Sibérie ou exécuter la plupart des membres de sa famille, à l’exception de sa fille Svetlana à laquelle il était extrêmement attaché.
Dans l’esprit d’étude comparée qui est celui de son livre, Paul Ginsborg souligne souvent les traits que possèdent en commun certains de ces dictateurs, tout en mettant en lumière de façon subtile ce qui le sépare, comme dans cette observation au sujet du général Franco : « Peut-être la comparaison la plus intéressante à faire est-elle, non avec Mussolini, mais avec Mustafa Kemal, un autre homme extraordinairement dur et déterminé. Bien sûr, il y avait entre eux de profondes différences. Franco était le grand défenseur de la religion organisée, que Kemal fustigeait souvent. Franco voulait restaurer le passé et célébrer l’extraordinaire tradition impériale de l’Espagne, quand Kemal tournait dédaigneusement le dos à la tradition ottomane […] Kemal était un innovateur, Franco un partisan fanatique de la restauration. Mais les deux hommes étaient des soldats de métier, habitués à commander un grand nombre d’hommes sur les champs de bataille, à mener des guerres d’une indescriptible sauvagerie [et] à éliminer leurs opposants ».
- La famille dans la Russie communiste et la Turquie de Mustafa Kemal
Pour brosser le tableau de la situation de la famille dans la Russie communiste, Paul Ginsborg part des idées révolutionnaires d’Aleksandra Kollontai : « [Aleksandra Kollontai était] une romantique, mais une romantique d’une espèce assez particulière, parce que chez elle la relation entre le privé et le public qui caractérise le romantisme était inversée. Elle était terriblement romantique dans la sphère publique, avec sa foi extraordinaire dans la capacité de transformation de la révolution socialiste. Mais dans la sphère privée elle rejetait l’amour romantique, dans lequel elle voyait une base pernicieuse pour bâtir de nouvelles relations intimes ». Le modèle de relations qu’elle rêvait de voir advenir était celui d’hommes et de femmes placés sur pied d’égalité se comportant comme des amis et des camarades dans une société où ce serait la collectivité, non le couple, qui fournirait stabilité et identité à l’individu, dans l’esprit de cette commune de travailleurs décrite par Nikolaï Tchernychevski dans son célèbre roman
Que faire ?, dont la lecture l’avait fortement influencée. Seule parmi les marxistes à défendre cette position, Aleksandra Kollontai prônait de surcroît une grande liberté sexuelle, non dans un esprit d’encouragement à la promiscuité, mais comme l’expression de rapports égalitaires entre les sexes dans une société où la femme ne serait plus la propriété du mari, comme elle l’était dans la famille bourgeoise.
Des idées aussi radicales n’avaient guère de chance de séduire les leaders de la révolution communiste. Peu d’entre eux étaient prêts à aller jusqu’à collectiviser la vie privée. Et en matière de mœurs, la plupart étaient résolument conservateurs, à commencer par Lénine, que Ginsborg n’hésite pas à qualifier, en ces matières, de « victorien », avec tout ce que ce terme peut d’ailleurs impliquer d’hypocrisie puisque marié (sans enfants, son seul enfant, dit-on volontiers, ayant été la révolution russe), il a entretenu durant des années une liaison avec une femme nommé Inessa Armand, marxiste et féministe aussi ardente qu’Aleksandra Kollontai, dont il ne partageait bien sûr pas davantage les idées que celles de cette dernière.
Les vues plutôt traditionnelles des dirigeants communistes en matière familiale ne les empêchèrent cependant pas d’adopter, en septembre 1918, un code civil rompant résolument avec les dispositions en vigueur dans la Russie tsariste. À côté de changements profonds en matière d’héritage et de droits des enfants, il autorisait en effet le divorce par consentement mutuel et l’avortement. Surtout, il accordait à l’homme et la femme, au sein de la famille, des droits égaux qui ne seront instaurés dans les pays d’Europe occidentale que bien plus tard. Si radical qu’il fût, ce code n’envisageait cependant aucune forme d’organisation de la vie sociale alternative à la famille du type de celle qu’Aleksandra Kollontai appelait de ses vœux. Il attribuait par contre un large spectre de responsabilités et de pouvoirs à l’État bolchevique.
En 1926, un nouveau code familial, adopté après de longues discussions, entra en vigueur. Tout en renforçant certaines mesures décidées en 1918 (la procédure de divorce, par exemple, fut encore simplifiée), il revenait sur certaines autres, en matière d’héritage notamment, en augmentant le montant des biens qui pouvaient être transmis des parents aux enfants. De manière générale, malgré certaines dispositions qui, considérées superficiellement, semblaient remettre en cause l’existence de la famille, comme la reconnaissance de couples
de facto, ce nouveau code traduisait une claire volonté d’encourager la stabilité du mariage et de protéger les femmes et les enfants. Dix ans plus tard, après que Staline eut accédé au pouvoir, le gouvernement soviétique prenait une nouvelle série de mesures en matière familiale, en principe destinées à renforcer la famille comme structure de base de la société communiste, mais qu’on a aussi pu caractériser comme l’expression et le reflet de politiques « incohérentes et contradictoires ».
Quoi qu’ait pu ou voulu entreprendre Staline en faveur de la famille en général, ses politiques de collectivisation forcée de l’agriculture (et les famines qui s’en suivirent), d’industrialisation à marche forcée, de répression politique des soi-disant paysans riches (koulaks) et d’exécution ou de déportation de millions de non moins imaginaires « ennemis du peuple », victimes de la délation organisée, eurent sur les familles un effet dévastateur : « Staline mettait en avant la nécessité d’une famille qui soit une unité de production féconde, fertile et loyale. [Mais] beaucoup de familles réelles ou imaginaires ne se conformaient pas à ses critères et ceux de sa police secrète […] Le résultat fut une société fracturée en profondeur, ou après avoir exécuté les pères et les mères on pouvait reléguer leurs enfants dans des orphelinats, les déclarer « parents de traîtres à la patrie » et attendre qu’ils y meurent de chagrin, de maladie ou de faim ».
Quoique moins radicaux que ceux que les révolutionnaires russes ont entendu apporter à l’organisation et au fonctionnement de la vie familiale, les changements qui ont affecté à peu près à la même époque la famille en Turquie à la suite de la révolution de Kemal Atatürk n’en étaient pas moins assez profonds. Les pages que Paul Ginsborg consacre à la vie familiale en Turquie (dont il reconnaît qu’elles n’auraient pu être écrites sans l’aide de sa femme, une universitaire turque à qui l’ouvrage est dédié) font pénétrer le lecteur dans un univers qui lui est
a priori beaucoup moins familier. L’empire ottoman était un pays immense, cosmopolite et musulman. La République turque fondée par Kemal Atatürk, issue de la guerre d’indépendance menée suite au démembrement de l’Empire après la fin de la première guerre mondiale, était un État géographiquement limité à l’Anatolie, qui se voulait moderne et laïque et où dominait une idéologie fortement nationaliste. Dans le prolongement d’une évolution spontanée qu’on commençait à observer dans la population bourgeoise et intellectuelle d’Istanbul, sous l’influence directe ou indirecte des idées d’une des figures les plus originales du mouvement des « Jeunes Turcs » qui avait commencé à ébranler le sultanat, le penseur et politicien Ziya Gökalp, « inventeur » d’un modèle familial proprement turc en réalité tiré d’un passé largement imaginaire, Kemal Atatürk s’employa à encourager le développement d’un type de famille proche du modèle occidental, tout en étant adapté à ses objectifs politiques.
Le moyen essentiel utilisé à cette fin fut l’adoption du nouveau code civil curieusement calqué sur le code civil suisse. Pourquoi le code suisse ? Parce qu’il était récent, simple et court, mais peut-être aussi, suggère Ginsborg, parce que s’y exprimait une vision paternaliste des rapports entre hommes et femmes que Kemal, si épris de modernité qu’il fût, était incapable d’abandonner. Comme le code russe de 1918, le nouveau code civil turc rompait radicalement avec la tradition en bannissant la polygamie, autorisant le divorce et extrayant le mariage de la sphère de la religion. Tout en formalisant et renforçant le statut et les droits de la femme en matière économique et d’héritage, notamment, il maintenait cependant entre l’épouse et le mari des rapports asymétriques. De manière générale, loin de mettre en cause l’institution familiale, la politique de Kemal visait à la fortifier : « La révolution [kémalsite] avait pour objectif de rendre la famille républicaine turque plus solide [en la transformant en] une unité monogame et nucléaire dans laquelle les femmes et les hommes avaient des droits et des devoirs, un « nid » sûr servant de cellule de base dans la vie de la nation ». Ceci sous l’autorité d’un État dominé par l’institution militaire et investi de pouvoirs considérables.
- Politiques familiales du fascisme, du franquisme et du nazisme
En contraste avec les cas russe et turc, ce qui caractérise la politique familiale du régime mussolinien est la distance énorme entre les ambitions affichées et les résultats obtenus. Dans ce domaine comme ailleurs, peu dans les faits observables est venu faire écho à cette rhétorique grandiloquente et ces déclarations solennelles et théâtrales dont Mussolini et son gouvernement étaient coutumiers. Pour le philosophe officiel du régime Giovanni Gentile, les trois composantes de la triade de Hegel, la famille, la société et l’État, devaient fusionner au service de ce dernier en dehors duquel rien n’était censé exister. Mais les dirigeants fascistes n’iront jamais jusque-là, notamment parce que toute tentative en ce sens était condamnée à se heurter au puissant modèle familial de l’Église catholique.
Entre les deux conceptions de la famille existaient de fortes convergences : « L’Église et le régime voulaient l’un et l’autre des familles prolifiques et étaient complètement opposés à l’avortement et à l’homosexualité […] Tous les deux préféraient la société rurale à la société urbaine et craignaient la corruption des grandes villes ». Mais les ambitions respectives de deux protagonistes les mettaient en même temps en concurrence : « Mussolini aspirait à exercer un contrôle total sur la société, en préparation de l’expansion impérialiste de l’Italie […] Mais le programme de contrôle temporel et spirituel de l’Église n’était pas moins absolu. Les familles étaient censées servir Dieu par son intermédiaire ». En dépit du rapprochement opéré par le truchement de la signature du Concordat et des accords du Latran en 1929, l’Église et le gouvernement mussolinien ne cessèrent donc jamais de s’opposer sur des sujets comme la famille et l’éducation.
Très doués pour les déclarations fracassantes, les dirigeants fascistes étaient par ailleurs peu capables de traduire leurs paroles en actes. La réforme du code civil qu’ils souhaitaient mettre en œuvre ne fut promulguée qu’en 1942, et longtemps les seules dispositions légales nouvelles reflétant leurs vues sur la famille furent quelques articles répressifs du code pénal. L’idéal de virilité agressive que le fascisme avait hérité du futurisme se révéla par ailleurs peu compatible avec la faible propension à la bellicosité du mâle italien. Et lorsqu’il fut mis en pratique dans les territoires coloniaux par les militaires et les travailleurs expatriés, qui prenaient des concubines indigènes avec lesquelles ils fondaient des familles, la crainte de contamination de la race italienne que ces comportements suscitèrent conduisit le régime à stigmatiser et réprimer légalement de telles pratiques.
La politique nataliste et de soutien à l’enfance volontariste mise en place par Mussolini ne produisit pas non plus de résultats notables. L’action de l’Opera Nazionale per la Maternità e l’Infanzia n’eut que peu d’influence sur le taux de mortalité infantile, comme les mesures incitatives ou répressives (prohibition de l’avortement, taxe sur le célibat, forte limitation ou interdiction du travail des femmes) sur le taux de natalité. Au bout du compte, les deux domaines dans lesquels le régime fasciste manifesta un véritable savoir-faire et dans lesquels il obtint un réel succès furent : premièrement la mobilisation de la jeunesse dans des organisations de masse qu’il parvint à faire fonctionner sans créer d’insurmontables tensions avec les familles, parce que leurs activités, à l’opposé de celles des organisations équivalentes de l’Allemagne nazie et de la Russie stalinienne, étaient fondamentalement orientées vers le sport, le loisir et le bien-être ; deuxièmement et peut-être surtout la propagande et la mise en scène, avec des manifestations symboliques comme la « Giornata dell Fede » de 1935, au cours de laquelle des centaines de milliers de femmes mariées offrirent solennellement leur anneau nuptial au régime, afin qu’il soit fondu pour aider à financer la guerre en Éthiopie.
Dans le cas de l’Espagne, l’affrontement des conceptions traditionnelle et moderne de l’organisation familiale revêtit un caractère beaucoup plus violent, et les conséquences des événements qui précédèrent et accompagnèrent l’arrivée au pouvoir du régime dictatorial se révélèrent bien plus terribles pour les familles. En 1931, peu après l’effondrement du régime dictatorial du premier ministre Primo de Rivera, le roi Alphonse XIII abdiquait et la seconde république était proclamée. Peu de temps après, une nouvelle constitution était adoptée, dont l’entrée en vigueur était de nature à entraîner de profondes conséquences pour la vie familiale en Espagne.
L’article de cette constitution consacré à la famille, tout en plaçant celle-ci explicitement sous la protection de l’État (manifestation d’une volonté de la protéger qui prive de fondement les accusations ultérieurement portées à l’encontre des républicains de vouloir la détruire), établissait en effet le principe de la stricte égalité de l’homme et de la femme dans le mariage. Il introduisait également le principe du divorce par consentement mutuel, prévu on l’a vu dans le code civil de la Russie communiste, mais qui ne fera son apparition dans les autres pays européens que bien plus tard (en 1971 et 1975, respectivement, pour la Grande-Bretagne et la France). La constitution accordait aussi le droit de vote aux femmes, une disposition à laquelle certaines féministes, en premier lieu Margarita Nelken, s’étaient opposées pour des raisons tactiques, craignant qu’elle ne confère un avantage au parti catholique, en faveur duquel une majorité de femmes voteraient.
Suite à une période d’agitation et d’instabilité politiques, de troubles, de grèves, d’affrontements, de violences et d’assassinats, le soulèvement d’une partie de l’armée, en 1936, donna le coup d’envoi de la guerre civile, qui se terminera par la victoire des troupes commandées par le général Franco, puis l’instauration d’une dictature militaire sous l’autorité de ce dernier. Peu après son arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement abolissait les dispositions constitutionnelles adoptées par les républicains en matière de mariage et de divorce. Incapable, faute de moyens financiers dans un pays ruiné par la guerre, de mener une politique positive en faveur de la famille, qu’il avait à cœur de soutenir et de protéger, le régime franquiste défendit essentiellement cette dernière par l’intermédiaire de mesures négatives, comme la pénalisation de l’abandon de foyer et de l’adultère.
entre-temps, la guerre civile avait eu sur les familles espagnoles un impact terrible, à la description duquel Paul Ginsborg consacre plusieurs pages. Divisions entre familles, divisions à l’intérieur des familles et multiples conséquences des combats, qui furent d’une rare violence et accompagnés de manifestations de cruauté extrême : « Les deux camps commirent des atrocités. On ne peut oublier les évêques, prêtres, moines et religieuses massacrés durant les premiers mois de la guerre principalement par les anarchistes. […] Mais les horreurs perpétrées par les nationalistes [...] les dépassent tellement en étendue et en brutalité qu’une différence quantitative se mue [ici] en différence qualitative ».
La fin du conflit, rappelle Ginsborg, ne marqua de surcroît pas celle des souffrances accablant les familles, du fait des nombreuses exécutions après des procès sommaires qui eurent lieu durant les premières années de la dictature, ainsi que de la déportation des accusés qui avaient échappé à la condamnation à mort dans des camps de travail où un grand nombre d’entre eux périrent : « Les autorités permettaient que des colis de nourriture soient envoyés aux prisonniers par leurs familles.[...] Ceux dont les familles résidaient trop loin ou n’étaient pas en mesure de leur envoyer quelque chose n’avaient guère de chance de survivre, sauf si l’un ou l’autre de leurs codétenus partageait avec eux un peu de ses propres vivres. »
L’Allemagne nazie, enfin, offre un cas de figure encore différent. La vision de la famille qui y prévalait s’est développée dans le prolongement des inquiétudes qui se manifestaient dans la république de Weimar dans une atmosphère d’incertitudes et de tensions politiques engendrée par l’irruption de la modernité dans une société développée mais encore largement attachée aux valeurs traditionnelles, et par les conséquences désastreuses de la première guerre mondiale aux plans démographique, économique, social et psychologique.
Au cœur de la philosophie de la famille du régime nazi figurait, non l’État mais la «
Volksgemeinschaft » (la « communauté du peuple » ou « communauté nationale »). Contrairement à ceux de plusieurs autres régimes dictatoriaux de cette époque, les penseurs et dirigeants nazis ne souhaitaient en effet pas mettre directement la famille au service de l’État : « La société allemande devait trouver en elle-même l’énergie, le sens de la solidarité, la discipline et l’autorité nécessaires pour mener à bien un projet national de grande ampleur. Bien sûr, l’État continuait à exister, et sous une forme très puissante ; mais […] en dernière analyse, c’est la communauté nationale qui se voyait investie de ses pouvoirs ». De la famille, dans ce contexte, on attendait tout d’abord qu’elle soit fertile et prolifique. Pour cette raison, la procréation était encouragée, l’avortement interdit et deux des motifs de divorce autorisés étaient l’infertilité et le refus d’avoir des enfants. Mais la famille était aussi censée aider à développer par l’éducation les valeurs perçues comme indispensables à la réalisation du destin national : l’obéissance, la discipline et le sens du devoir.
Ces considérations ne valaient toutefois que pour une catégorie de familles, les familles aryennes. À côté de celles-ci, objet de grande attention et d’un fort soutien du régime, existait en effet un autre type de familles, celles qui menaçaient la pureté ethnique allemande et l’intégrité de la nation du fait de la présence en leur sein d’individus affectés de tares ou de leur appartenance à des races inférieures. Dans le cas des familles « aimées », l’intérêt dont elles bénéficiaient et les faveurs qui leur étaient accordées furent payés au prix fort d’une invasion de la vie privée par le régime, de la pénétration de la politique dans leur intimité et de la mobilisation des enfants et des adolescents dans des organisations de jeunesse paramilitaires comme la
Hitlerjungend, qui, sans prendre complètement le dessus sur les familles ainsi que l’auraient souhaité certains idéologues du régime comme Alfred Rosenberg, contribuaient à diffuser un idéal de camaraderie guerrière masculine et une certaine forme de culte de la mort héroïque très éloignés des valeurs familiales. Le sort des familles des groupes stigmatisés et exclus fut bien pire. On sait ce qu’il advint d’elles et la manière dont le régime organisa leur relégation hors de la communauté nationale, leur persécution et leur extermination.
Paul Ginsborg conclut son analyse de la place de la famille dans l’Allemagne nazie par quelques réflexions sur la thèse défendue par les penseurs marxistes Max Horkheimer et Erich Fromm selon laquelle le modèle traditionnel de la famille allemande, caractérisé par la domination de la figure paternelle et une division fortement asymétrique entre les rôles des deux sexes, aurait joué un rôle fondamental dans l’essor du nazisme, thèse qu’il commente avec une sympathie non exempte de réserves : « L’établissement, par l’école de Francfort, d’un lien entre la formation dans l’enfance de la personnalité autoritaire et le triomphe du nazisme était une idée importante et nouvelle, mais il ne faudrait pas exagérer son pouvoir d’explication ».
- L’histoire comparée des faits et des représentations
Dans l’article mentionné plus haut, Richard Overy s’interroge sur les limites dans lesquelles il est possible de comparer des pays aussi différents les uns des autres par l’histoire, la culture et le niveau de développement économique que l’étaient les cinq considérés dans
Family Politics. Et il se demande dans quelle mesure une analyse en termes de classes sociales n’aurait pas été plus pertinente, compte tenu des fortes ressemblances entre les vies familiales des paysans, des ouvriers et des élites possédantes dans les différents pays.
C’est faire injustice à Paul Ginsborg. Dans
Family Politics, une grande attention est en effet accordée aux éléments de la vie familiale qui étaient liés à l’appartenance à telle ou telle classe sociale (la paysannerie, le prolétariat, la bourgeoisie cultivée), dans le cadre d’une approche comparative mise en œuvre avec énormément d’intelligence, de doigté, de finesse et un sens aigu des nuances, comme le montre ce passage tiré du chapitre sur l’Allemagne, dont on pourrait trouver de nombreux équivalents ailleurs dans l’ouvrage : « Des différents types de famille rurale examinés dans ce livre, ce sont les plus riches des villageois de Körle (les éleveurs de chevaux et de bovins) qui ressemblent le plus aux métayers toscans d’Impruneta. Les uns et les autres jouissaient d’un bon niveau de vie, vivaient à proximité d’une ville, tiraient fierté de leur savoir-faire agricole et célébraient leur appartenance à une « maisonnée » basée sur un tissu complexe de relations familiales. Mais il y a aussi bien sûr des différences significatives. Les fermiers de Körle étaient propriétaires de leurs terres, ce que les métayers n’étaient pas […] Les paysans italiens vivaient dans des fermes isolées dispersées dans les collines, quand les familles allemandes étaient agrégées au sein du village […] Finalement, le respect de l’autorité établie à tous les niveaux, y compris celui des représentants de l’État, était très fort dans la vie des villages allemands [alors qu’en Italie] l’État, même l’État fasciste, était considéré avec indifférence ».
Richard Overy s’interroge aussi sur ce qu’il en était de la vie familiale ailleurs en Europe, en suggérant qu’un certain nombre de problèmes auxquels étaient confrontées les familles dans les dictatures (les pressions économiques, les conséquences de l’exode rural et celles de la présence généralisée de l’idéologie eugéniste) les affectaient également dans les pays démocratiques. Cette question, Overy le reconnaît, sort à l’évidence du cadre de
Family Politics, dont on pourra par contre regretter que Paul Ginsborg n’y ait pas fait une petite place, à côté des cinq dont il s’est occupé, à un régime autoritaire qui faisait de la famille une priorité si grande qu’elle figurait, encadrée par le travail et la patrie, au cœur de sa devise, celui de la France du maréchal Pétain.
Dans l’ensemble,
Family Politics est un livre dense, touffu, d’une exceptionnelle richesse et très éclairant. Parce qu’il affectionne les détails et ne redoute pas les digressions (le plus souvent bien plus apparentes que réelles), Paul Ginsborg offre aux lecteurs toute une série d’aperçus, d’informations et de réflexions sur une grande variété de sujets : les idées, dangereusement vagues, de Marx et Engels sur l’abolition de la famille dans la société post-capitaliste (les vues des Trotsky sur la famille, strictement opposées, étaient par contre très élaborées) ; la vie sociale et culturelle de Berlin à l’époque de la république de Weimar et la manière dont, dans l’esprit des Allemands provinciaux, « l’infertilité, la promiscuité et l’hédonisme [y] avaient remplacé les solides vertus familiales de la procréation, de la propreté et de la respectabilité » ; le contenu de la doctrine catholique au sujet du mariage et de la maternité telle qu’elle est formulée dans différentes encycliques papales, de la fin du XIXème siècle à celle du régime mussolinien, et bien d’autres sujets.
On soulignera aussi la variété et la solidité des références de l’ouvrage. Ginsborg s’appuie les meilleurs historiens des périodes considérées (Paul Preston pour la guerre civile espagnole, Robert Paxton pour le fascisme, Anne Appelbaum et Nicolas Werth pour l’histoire du goulag, Ian Kershaw pour la vie d’Hitler et Peter Longerich pour celle de Goebbels). Il cite abondamment et toujours avec beaucoup d’à-propos de nombreux écrivains et penseurs (Pouchkine, George Orwell, Antonio Gramsci, Victor Serge, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, Victor Klemperer, Max Aub, pour n’en mentionner que quelques-uns), dont il évoque les œuvres avec talent et justesse, comme dans cette observation au sujet de Federico García Lorca : « L’œuvre théâtrale de Lorca se distinguait par l’usage de métaphores frappantes, un sens de l’indéfini et du mystère, la manière dramatique dont elle rendait compte de passions violentes et obscures ».
Pour mettre en lumière les représentations de la famille en circulation durant ces années, Ginsborg commente de surcroît avec perspicacité quelques toiles de peintres de l’époque. À la suite du théoricien de l’art Rudolf Arnheim, il identifie au cœur de
Guernica de Picasso un thème familial, dont il met en rapport l’expression tragique avec à la fois le drame de la guerre civile, un épisode traumatisant de l’enfance du peintre et le désordre de sa vie privée. Il souligne le contraste entre l’image d’une famille détruite de l’extérieur qui ressort de cette célèbre toile et celle qui se dégage du tableau
Famiglia du peintre moderniste italien Mario Sironi, caractérisée par une intimité forte entre la mère et l’enfant dans la tradition des Madones de la peinture classique, mais aussi l’éloignement mutuel des figures de l’homme et de la femme, reflet de la vie matrimoniale malheureuse du peintre.
Ginsborg oppose aussi les images de la famille qu’on trouve dans les toiles des peintres de la république de Weimar Otto Dix, Max Beckmann et George Grosz, produit de la vision critique que jetaient ces artistes sur une société agitée et traversée de tensions, et le portrait « solennel et ordonné », caricaturalement harmonieux d’un groupe familial qu’offre aux regards un des plus fameux échantillons de l’art nazi, le tableau
La famille de paysans de Kahlenberg d’Adolf Wissel, dont la reproduction sert de couverture à l’ouvrage. Il attire l’attention à cet égard sur la différence d’attitude des différents régimes en matière artistique. Mussolini a encouragé le développement d’un « art fasciste », mais c’était sans donner d’instructions précises sur la forme qu’il devait prendre, au-delà de sa nécessaire connexion avec la grande tradition de l’art italien. Et si dans l’Italie mussolinienne l’art officiel, celui des monuments publics, était strictement encadré, le fascisme célébrait parallèlement les avant-gardes artistiques comme le futurisme. Dans l’Allemagne nazi, par contre, le régime exerçait un contrôle total sur l’activité artistique, en imposant des canons de beauté inspirés de l’esthétique «
völkisch », romantique, populiste et traditionaliste, et stigmatisait sous le nom d’« art dégénéré » toutes les formes d’expression nouvelles.
En complément des reproductions d’œuvres picturales rassemblées dans un cahier central en couleur, le livre est par ailleurs agrémenté de nombreuses illustrations en noir et blanc - portraits officiels, clichés de propagande, photos de famille, scènes saisies sur le vif, photos de presse anonymes ou dues à de grands noms du domaine comme Robert Capa et Willy Römer, toutes évocatrices, chacune à sa manière, et beaucoup carrément saisissantes, comme un étonnant portrait de Kemal Atatürk le visage dur et le regard féroce sous un chapeau haut de forme, ou les images poignantes de la guerre civile espagnole et de Berlin en ruines en 1945.
De manière générale,
Family Politics, si savant que soit l’ouvrage, se caractérise par l’empathie que Paul Ginsborg y témoigne envers les souffrances endurées par les familles au cours de ces années sanglantes, le ton de compassion sobre et sans emphase sur lequel il évoque la détresse des victimes des violences qui se sont déchaînées durant la première moitié du XXème siècle en Europe : millions d’orphelins sans logis qui hantaient l’Union soviétique dans les années qui ont suivi la guerre civile, femmes, enfants et vieillards arméniens abandonnés sur le chemin de l’exil forcé dans un désert inhospitalier, après que les troupes turques eurent exécuté les hommes jeunes et d’âge mûr, ou ces milliers de ressortissants des deux camps impitoyablement massacrés durant la guerre d’Espagne.
- La suite de l’histoire
À deux reprises, à la fin de l’introduction et de la conclusion, Paul Ginsborg fait état de son intention de prolonger cette étude de la famille sous les révolutions et les dictatures au cours de la première moitié du XXème siècle par un autre livre consacré à son histoire dans les démocraties durant la période commençant en 1945. On attend avec beaucoup d’intérêt la parution de ce deuxième ouvrage, en se disant toutefois qu’il sera plus difficile à écrire, en tout cas pour ce qui concerne les dernières années, du fait de l’ampleur des changements qui ont récemment affecté son objet. Des changements en vérité si profonds qu’on peut ne peut s’empêcher de se demander dans quelle mesure l’objet en question n’est pas en train de s’évanouir progressivement, et de s’interroger sérieusement sur son avenir.
Depuis qu’elle existe, l’institution familiale a résisté à la misère, aux épidémies et aux famines, aux guerres civiles et aux guerres mondiales, aux déportations et aux exodes. Elle est sortie des bouleversements révolutionnaires et des totalitarismes meurtrie mais à peu près intacte. Survivra-t-elle à la société d’abondance et à la marchandisation de toutes les activités de service, à l’essor de l’individualisme que permet et encourage le progrès économique et technique, parce qu’il rend les êtres humains moins dépendants les uns des autres, et aux possibilités de plus en plus nombreuses qu’il offre de s’affranchir des contraintes de la nature ?
Les deux fonctions primordiales de la famille sont la reproduction des individus et la transmission du nom et des biens. En autorisant et encourageant un large éventail de modes de vie, l’évolution des mentalités (l’idée que le couple et la famille sont essentiellement fondés sur les sentiments, en dehors de toute tradition historique, convention sociale ou limite naturelle), ainsi que le progrès des technologies du vivant, tendent à complexifier les conditions dans lesquelles ces deux fonctions sont exercées à un degré qui pourrait un jour devenir assez élevé pour priver l’institution familiale de son utilité et de sa signification.
Si la famille n’a pas été détruite par la violence de la nature et des hommes, c’est d’autre part parce qu’elle permettait de mieux leur résister, cette capacité constituant même une autre de ses raisons d’être et une explication complémentaire de son existence. Dans une des plus belles séquences du film
The Straight Story de David Lynch, le vieil homme qui en est le héros, lors d’une des étapes de l’étonnant périple à motoculteur à travers plusieurs États des États-Unis qu’il a entrepris pour retrouver son frère avec lequel il est en froid depuis de nombreuses années, rencontre une jeune fugueuse déterminée à ne jamais regagner son foyer. La famille, lui fait-il gentiment observer, c’est un peu comme un fagot de branchettes qu’on ne parvient pas à briser, alors qu’il est dérisoirement facile de rompre l’une d’entre elles si on la prend isolément.
Durant des siècles, la famille a de fait été un instrument de solidarité et un moyen de protection des individus contre l’adversité sous toutes ses formes. Mais dans les sociétés les plus prospères et avancées du début du XXIème, ces fonctions sont perçues comme pouvant être assurées par d’autres moyens, impliquant le plus souvent une relation de nature commerciale. Les institutions sont le produit du besoin. Elles n’existent que parce qu’elles sont nécessaires et sont considérées comme telles, et ne subsistent qu’autant qu’elles le demeurent. Le jour où elles cessent de l’être, elles disparaissent. Que va devenir la famille dans une société qui donne l’impression de pouvoir se passer d’elle à bien des égards ? De l’histoire de la famille dans les démocraties libérales d’après-guerre, Paul Ginsborg déclare - ce sont les derniers mots de son livre - qu’elle est « une autre histoire, qui reste à raconter ».
A fortiori le dira-t-on du destin de la famille au XXIème siècle.
Michel André