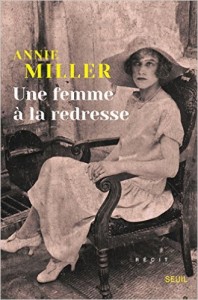La grand-mère sans pareille du Haut-Montreuil
Publié en mai 2016. Par Sandrine Tolotti – Dans la chair des livres.

« Il faut beaucoup de hardiesse pour oser être soi. »
Eugène Delacroix, Journal.
D’ordinaire, les grands-mères, ça vous a une odeur de sur ou de pain d’épice, c’est selon ; le plus souvent, c’est rond et moelleux, avec la consistance d’un petit pain Harrys où on s’enfonce de partout en se lovant ; et ça vous gronde avec un sourire en coin qu’on est censé ne pas voir, mais qu’on voit à tous les coups, c’est fatal. Bref, les grands-mères, ça vous tapisse l’enfance de duvet, histoire que les autres puissent vous éduquer avec ce qu’il faut, paraît-il, de rigueur ; d’ailleurs, tout le reste de la famille en profite un peu. Les filles découvrent par procuration une mère qu’elles n’ont pas eu, les gendres une belle-mère soudain coulée dans le sucre d’orge, les frères et sœurs une frangine plus amène. La grand-mère de nos souvenirs plus ou moins embellis est « amitieuse », comme dit ma tante Suzanne à propos de son petit-fils (« Ah, Yann, qu’est-ce qu’il est amitieux ! »), avec tout ce qu’il faut de soupirs enamourés. « Mémé Jeanne », c’est une autre affaire. Elle le disait tout de go, qu’elle n’aimait pas « les fricassées de museaux », et sa petite-fille nous en prévient dès la première page du petit livre amoureux qu’elle lui consacre, Une Femme à la redresse. Nous voilà au parfum, donc : Jeanne est du genre à ne pas faire étalage de sentiments ; la guimauve, c’est pas son truc. Elle n’a pas eu une vie de fête foraine. Jeanne, c’est le genre à mettre son amour dans la tarte aux pommes, sans prendre la peine d’y ajouter le sourire. A quoi bon, puisque tout le monde le sait bien, et Annie (alias « Blanchette », alias « Sauf la graisse », alias « P’tite Gueule », alias « ma cocotte en sucre ») la première, que Mémé a l’affection nourricière. Qu’il suffit de se goinfrer pour s’injecter une bonne dose de tendresse (quand les nutritionnistes en tiendront-ils enfin vraiment compte ?). Jeanne n’est pas ronde et moelleuse, non plus. Grande et mince toute sa vie, elle baladait avec une indifférence de reine sans apprêt sa beauté marmoréenne sur les hauts de Montreuil où elle était venue nicher sur le tard (et sa portée avec elle) chez « pépère », Paul Duseaux pour l’état civil, tourneur, décolleteur, outilleur, ajusteur de son état : « Une bonne pâte malicieuse, une gueule des faubourgs, un bon Français », écrit Annie Miller.Jeanne était donc une grand-mère qui n’avait pas le physique de l’emploi ; ni rien d’autre, ou presque. Une « mémé » pas comme les autres. Avec le numéro qu’elle avait tiré en naissant (pas bien folichon), elle s’est taillé un destin extraordinaire sans avoir l’air d’y toucher, puisqu’elle a fini par tourner avec Truffaut et Bresson, entre autres, après avoir pris de sacrés chemins de traverse pour fuir le sentier constellé d’orties qu’elle aurait dû suivre en théorie, vu qu’elle était née en 1900 dans une famille de verriers misérables du Nord, avec le nez sur le mâchefer. Notez bien que ce ne sont pas les orties ni les épines qui ont manqué. Simplement, elle s’est débrouillée pour qu’il n’y ait pas que ça. Auprès d’elle, du coup, les mômes apprenaient à vivre plus libre, en se souciant comme d’une guigne du qu’en-dira-t-on. Priorité aux élans du cœur et aux choix assumés, quoi qu’il en coûte. « A sa manière, elle va nous éduquer mon frère et moi, écrit Annie Miller. Elle va nous élever, c’est le moins qu’on puisse dire. Sans bêtise ni a priori, elle nous ouvrira à la nuance, aux contradictions, à la diversité, elle nous fera grandir. » Bon, soyons juste. Tout, bien sûr, n’était pas différent chez « Mémé Jeanne ». Les dimanches, par exemple, elle attendait avec une impatience mal dissimulée que débarquent ses enfants, leurs amours, leurs amis, pour le déjeuner de famille, avec ce que cela signifie de conversations entremêlées dans le brouhaha, de couverts qui tintinnabulent et de repas aux petits oignons. Comme dans toutes les familles, ces réjouissances qui s’étiraient quasiment l’après-midi entière connaissaient leur apogée rituelle quand l’oncle Louis, bel homme, se levait pour entonner de sa voix de stentor une chanson que l’assemblée écoutait religieusement, partagée entre émotion et rêverie, avec toujours ce léger embarras que provoquent les moments de ce type, où quelqu’un finit toujours par jouer avec les miettes sur la nappe en baissant les yeux. Sauf que, chez Jeanne, Louis ne chantait pas Le p’tit quinquin ou Les roses blanches, grands classiques du répertoire des familles, mais Old Man River. Parce que l’oncle Louis était noir, tout comme sa sœur, Lucille, enfants de Jeanne et de Henri-David Perkins, un jazzman américain qui avait craqué pour la belle fille du Nord, et vice versa, un jour de gourmandise qui l’avait mené jusqu’à la boulangerie de la place Villiers (« un quartier de rupins ») où elle servait – non sans escamoter une pièce de 5 sous par jour, direct dans la jarretelle. « Des années plus tard, ses yeux jubilent quand elle m’en parle, raconte Annie Miller. La pièce de 5 sous prise dans la caisse est pour elle un dû quotidien, un rituel fort convenable. C’est un devoir de la prendre parce que ce serait de la bêtise de ne pas le faire ». On vous avait dit qu’elle n’était pas banale. Jeanne a 20 ans, Henri-David Perkins en a 39, ils se mettent en ménage rue de Tocqueville.Jeanne, c’est le genre à mettre son amour dans la tarte aux pommes, sans prendre la peine d’y ajouter le sourire. A quoi bon, puisque tout le monde le sait bien, que Mémé a l’affection nourricière.
Il faut dire que, dans le berceau de Jeanne, il n’y avait peut-être pas de cuillère en argent, mais il n’y avait pas non plus le sens du conformisme et du « ça ne se fait pas ». Question de survie. Etre conventionnelle, quand on est fille d’ouvrier-verrier à l’aube du XXe siècle, c’est assez vite la faim assurée : « Vers 1909, j’avais guère plus que ton âge, je chantais dans les cafés d’Anor. Je ram’nais bien ». Evidemment, le père et la mère la croient à l’école. Cette initiative de gagneuse lui vaudra, le jour où l’instituteur vend la mèche, de voir « le Vieux » balancer par la fenêtre la couronne de pain achetée avec les sous du jour. Cinquante ans après, Jeanne en a encore une boule dans la gorge. Mais bon, il en reste qu’elle chante comme elle respire. Jeanne a le goût des complaintes réalistes à vous vriller le cœur ou des histoires espiègles qui vont bien à cette femme qui « méprise les conventions, aime provoquer et a une sincère attirance pour les hommes hors norme ». Elle vendait des p’tits gâteaux, par exemple (pour la version de Barbara, c’est ici) : « Elle vendait des petits gâteaux, Qu'elle pliait bien comme i' faut, Dans un joli papier blanc, Entouré d'un petit ruban, En servant tous les clients, Elle se trémoussait gentiment, Fallait voir comme elles sautaient, Ses petites brioches au lait. » Chez Jeanne, « jamais de niaiserie ni de fadaise réservées d’habitude aux enfants », commente sa petite fille. Pour jouer son rôle, en matière de transmission de connaissances, pas besoin de Françoise Dolto ou Laurence Pernoud, il suffit de puiser à l’eau de la vie. Gare aux « malavisés », explique-t-elle à Annie en chantant (toujours) La complainte de la Petite Marthe, môme de 11 ans partie au Bataclan avec un ami de ses parents qui l’a violée et tuée (le fait divers remonte à 1907) : « La complainte dégoulinait de compassion, d’angélisme et se terminait par une inquiétante mise en garde, se souvient sa petite-fille. Mais c’était chanté avec une émotion telle que je ne me moquais pas, j’étais captivée et comprenais sans me coltiner l’ennui d’une leçon de morale. » Le lecteur retrouve en abondance, dans la relation entre Jeanne et cette gamine, comme les traces de la conception pré-moderne de l’enfant, antérieure au XVIIe siècle selon l’historien Philippe Ariès, quand on ne voyait pas en lui un être d’une essence singulière – innocent, fragile, influençable – mais une grande personne miniature, avec qui il était naturel d’échanger des paillardises. Et croyez-moi, Mémé en raconte de plus salées que cette histoire de brioches au lait. Jeanne était encore adolescente au moment où elle a proféré ce qui fut peut-être sa plus grande insulte aux convenances, en se liant d’amour, pendant la Grande Guerre, en Flandres occupées, avec un officier allemand. Il lui avait tendu un quartier de viande alors qu’elle longeait le camp, séductrice déjà avec sa fichue allure. 14, 15, 16, 17, 18 ans… Elle en pince, lui aussi. A l’armistice, la jeune femme revient bredouille de Belgique où elle a tenté de le retrouver, et file tout droit vers Paris. C’est plus sûr pour échapper à ce cousin qui lui fait du gringue au prétexte qu’il « vaut bien un boche ». Elle met son grand amour dans sa poche et son mouchoir par-dessus – mais à l’approche de la mort, c’est un air romantique allemand, Oh Isabella !, qu’elle chantera à sa fille au téléphone en guise d’ultime message d’amour. [caption id="attachment_37390" align="alignnone" width="616"]Jeanne a le goût des complaintes réalistes à vous vriller le cœur ou des histoires espiègles qui vont bien à cette femme qui « méprise les conventions, aime provoquer et a une sincère attirance pour les hommes hors norme ».
 DR[/caption]
Pour l’instant, à la capitale, elle échappe à la vindicte. « Tout semble possible », écrit Annie Miller. Ce seront des années folles pour elle aussi. La rencontre avec Henri-David Perkins lui fait goûter à la vie d’artiste. Ils fréquentent la Revue nègre autour de Joséphine Baker, partent en tournée dans les villes balnéaires à la mode et viveraient une bohème plutôt heureuse si le saxophoniste ne cavalait un peu trop. Jeanne prend ses cliques, ses claques et ses enfants – ses « bouts d’zan », et se coltine quelques années de mouise à faire le ménage dans un hôtel de passe. Elle en sort grâce au mariage avec Raymond, « un courageux », fraiseur-outilleur dans la journée, chef de rang dans un restaurant des Halles le soir. Le courageux est terne, hélas, et les sept années suivantes (jusqu’à sa mort prématurée) sont aussi normales qu’ennuyeuses : « Je voyais vraiment la vie me passer sous le nez ». Heureusement que la tribu s’abiboche avec les Glenn, les voisins d’à côté dans ce « méchant coin insignifiant de la banlieue » (Bondy) où Jeanne, Raymond, Lucille et Louis viennent s’installer au milieu des années 1930. Jeanne est ravie de trouver « une famille aussi déstructurée et chahutée que la sienne ». Quatre garçons qui gravitent autour de leur mère, Fernande, la « grosse Normande », une originaire de Saint-Leu qui n’a rien à envier à la fille du Nord côté franc-parler : « Je préfère voir ses talons que ses pointes », dit-elle en parlant de son mari, Kenneth Wiltshire Glenn, journaliste américain qu’on ne voit que le week-end et qui vit sa (double) vie à Paris (avec la sœur de sa femme). Lucille épousera un fils Glenn, union qui donnera naissance à Annie.
On comprend la petite-fille qui, dans les années 1950, boit à pleines goulées les bribes de la vie hors les rails que Jeanne lui raconte mine de rien à la cuisine, avenue de La Boissière, à Montreuil-sous-Bois, donc, où elle s’est rangée après-guerre avec pépère et son mégot scotché au coin des lèvres toute la sainte journée. Annie a atterri là avec sa mère et son frère après que le père a dit au-revoir à tout le monde sur un quai de gare avant de prendre la poudre d’escampette.
DR[/caption]
Pour l’instant, à la capitale, elle échappe à la vindicte. « Tout semble possible », écrit Annie Miller. Ce seront des années folles pour elle aussi. La rencontre avec Henri-David Perkins lui fait goûter à la vie d’artiste. Ils fréquentent la Revue nègre autour de Joséphine Baker, partent en tournée dans les villes balnéaires à la mode et viveraient une bohème plutôt heureuse si le saxophoniste ne cavalait un peu trop. Jeanne prend ses cliques, ses claques et ses enfants – ses « bouts d’zan », et se coltine quelques années de mouise à faire le ménage dans un hôtel de passe. Elle en sort grâce au mariage avec Raymond, « un courageux », fraiseur-outilleur dans la journée, chef de rang dans un restaurant des Halles le soir. Le courageux est terne, hélas, et les sept années suivantes (jusqu’à sa mort prématurée) sont aussi normales qu’ennuyeuses : « Je voyais vraiment la vie me passer sous le nez ». Heureusement que la tribu s’abiboche avec les Glenn, les voisins d’à côté dans ce « méchant coin insignifiant de la banlieue » (Bondy) où Jeanne, Raymond, Lucille et Louis viennent s’installer au milieu des années 1930. Jeanne est ravie de trouver « une famille aussi déstructurée et chahutée que la sienne ». Quatre garçons qui gravitent autour de leur mère, Fernande, la « grosse Normande », une originaire de Saint-Leu qui n’a rien à envier à la fille du Nord côté franc-parler : « Je préfère voir ses talons que ses pointes », dit-elle en parlant de son mari, Kenneth Wiltshire Glenn, journaliste américain qu’on ne voit que le week-end et qui vit sa (double) vie à Paris (avec la sœur de sa femme). Lucille épousera un fils Glenn, union qui donnera naissance à Annie.
On comprend la petite-fille qui, dans les années 1950, boit à pleines goulées les bribes de la vie hors les rails que Jeanne lui raconte mine de rien à la cuisine, avenue de La Boissière, à Montreuil-sous-Bois, donc, où elle s’est rangée après-guerre avec pépère et son mégot scotché au coin des lèvres toute la sainte journée. Annie a atterri là avec sa mère et son frère après que le père a dit au-revoir à tout le monde sur un quai de gare avant de prendre la poudre d’escampette.
A cette saison, le lilas embaume ; en toutes saisons, les briques de la cour se carapatent un peu et les marches du perron se déchaussent ; il n’y a pas d’eau courante, les cabinets sont dans la cour, mais on n’est pas si mal ; après tout, c’est une maison en dur. Les Bretons, Italiens, chiffonniers et autres marchands de peaux de lapin de la ruelle de derrière n’ont pas ça, qui se sont construit au petit bonheur des cabanons en bois couverts de tôle ou de papier goudronné. Cette France ouvrière des années 1950, son univers à la Gabin, se trouve à quelques kilomètres de là où je vous parle mais à soixante ans de distance, ce qui suffit pour rendre le voyage très exotique. A la maison, on boit du « jus », au troquet du coin un « express ; George Clooney et ses capsules n’ont pas encore fait entrer l’espresso dans la culture générale. Dans ce pays d’avant les « trente glorieuses », on se lave à la bassine dans la cuisine et on n’en abuse pas (il faut aller remplir les brocs) - « C’est mauvais de se laver tous les jours, tu vas t’user à te briquer ainsi », dit Jeanne à Lucille, devenue première d’atelier chez Chanel, toujours impeccable. La mère Denis n’avait pas encore de machine à laver Vedette : avenue de La Boissière, le jeudi c’était lessive ; Annie Miller se souvient du « va-et-vient de la brosse en chiendent frottant le linge sur la planche à laver plongée dans la “bonne eau savonneuse” du baquet » qui la réveillait ce jour-là. C’est la France des boucheries chevalines, des affiches Dubo-Dubon-Dubonnet et des poêles à charbon, où le « lait de poule » – mélange de lait chaud, de porto et de jaune d’œuf battu – fait office de remède universel, pour les enfants comme pour les adultes. C’est la France d’avant l’achèvement de la nucléarisation des familles, où la prise en charge des petits par la grand-mère allait de soi, même au quotidien (il faut bien que Lucille soit tout à son « travail qui la grise » et aide sacrément à faire bouillir la marmite). La supermamie récréative n’a pas encore vraiment été inventée. A la lecture du livre tout en dévotion d’Annie Miller, on pourrait écrire comme Veronika Duprat-Kushtanina à propos des grands-mères soviétiques : « Pour de nombreux enfants de l’époque, les grands-mères ont été les références principales de leur enfance ». Mais pour Jeanne, on peut dire aussi l’inverse : sa petite-fille a été la référence principale de sa vieillesse. Car entretemps, « Blanchette » a épousé le futur cinéaste Claude Miller, et sa grand-mère est entrée dans la bande. « Notre entourage de réalisateurs, d’auteurs et de techniciens de cinéma l’adopte d’emblée. Son franc-parler les change de leurs soirées parisiennes, la rencontre les amuse et enrichit leur vocabulaire. Elle les étonne. » Comme dans un film, « Mémé Jeanne » achève sa vie mouvementée sur une carrière d’actrice, et quelle carrière : elle tourne notamment avec Bresson (Une Femme douce) Truffaut (Baisers volés, Domicile conjugal, Les Deux Anglaises et le continent, L’Argent de poche, La Chambre verte) et Claude Miller, bien sûr (Dites-lui que je l’aime). Cette sacrée bonne femme s’appelait Lobre. Jeanne Lobre.Dans cette France d’avant les « trente glorieuses », on se lave à la bassine dans la cuisine et on n’en abuse pas (il faut aller remplir les brocs) : « C’est mauvais de se laver tous les jours, tu vas t’user à te briquer ainsi », dit Jeanne.
Le moment fétiche
Je fais cette semaine, toutes les exceptions à mes règles : non seulement j’ai décidé de vous emmener à la rencontre d’un personnage de France, mais j’ai préféré à l’objet fétiche habituel un moment fétiche. C’était une journée dont le début avait été chambardé par une algarade entre Lucille (en retard pour aller au boulot dans son Aronde vert bouteille) et les éboueurs (qui lui bloquaient le passage, on s’en doute). Je vous passe les détails et, pour le reste, je laisse la parole à Annie Miller : « Après l’histoire des éboueurs, ce matin, je suis allée à l’école sans prendre de petit déjeuner. Je n’avais plus le temps. En cours de matinée, le gardien est monté me chercher en classe. Dans le hall d’entrée, ma grand-mère m’attendait, contrariée : “T’as pas avalé ton bol de chocolat…” Elle l’a sorti de son panier en parlant, me l’a fait boire comme ça devant le gardien surpris. C’était encore chaud. Elle l’avait transporté sans le renverser pendant le quart d’heure de marche sur le chemin de la communale. “Bon… remonte.” Gênée par la présence si singulière et embarrassante de Mémé, je file. Elle attend de me voir grimper l’escalier pour s’en aller. Sans rien dire, le gardien la regarde partir, elle le remercie. » « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour » : Jeanne Lobre pourrait l’avoir soufflé à Pierre Reverdy.A lire aussi
Je ne peux que conseiller aux amoureux des grands-mères qui ne l’auraient pas encore lu l’émouvant hommage rendu par le comédien Philippe Torreton à la sienne : Mémé, paru en 2014 chez L’Iconoclaste. Un autre hommage drôle et tendre est rendu par l’écrivain israélien Meir Shalev dans son roman : Ma grand-mère et son aspirateur américain (Gallimard, 2013). Un joli livre collectif sur toutes les figures et les représentations de nos grands-mères, avec des textes de petits-enfants : Grands-mères : Un amour tendre et féroce, a été publié dans la collection Mutations d’Autrement en 2005, sous la direction de Véronique Cohen. On y relèvera en particulier l’évocation d’une certaine Fine par Laurent Carpentier (figure que l’on a retrouvé depuis dans son roman publié chez Stock, Les Bannis). Le meilleur livre de référence sociologique sur le sujet est celui de Claudine Attias-Donfut et de Martine Segalen, paru en 2007 chez Odile Jacob : Grands-parents, la famille à travers les générations. Et pour compléter ce bagage, les anglophones pourront découvrir « l’hypothèse de la grand-mère », soutenue par l’anthropologue américaine Kristen Hawkes, par exemple ici : à ses yeux, les humains ont acquis par l’évolution une durée de vie adulte plus longue que les singes parce que les grands-mères (pourtant infertiles) aident à élever les enfants.Prochain rendez-vous le 19 mai : Je vous invite à une découverte stupéfiante d’une Riyad secrète, avec ses rodéos automobiles, ses séductions homosexuelles et ses cuites, en compagnie de jeunes Saoudiens dont on ne parle jamais.