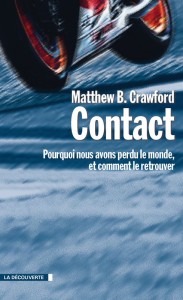Le temps du cerveau indisponible
Publié le 22 février 2016. Par La rédaction de Books.
Au secours, on nous a volé le droit à la concentration, à la rêverie, à l’ennui, même ! Au moment où s’ouvre à Barcelone le plus grand salon mondial consacré au téléphone mobile, le philosophe Matthew Crawford lance un puissant cri d’alarme sur le mal que font à l’intelligence et à la sociabilité les nouvelles technologies. Notre attention est désormais sollicitée, et détournée, en permanence et partout : par le smartphone qu’on ne lâche pas dans le métro, par le panneau publicitaire numérique qui nous agresse au petit matin à la gare, par le téléviseur qui vocifère dans une salle d’attente à l’hôpital… L’attention est le dernier bien commun que nous avons vendu, soutient Matthew Crawford dans Contact : pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, livre à paraître ce jeudi aux éditions La Découverte. La possibilité de réfléchir, ou simplement profiter du silence, devient un luxe, auquel peu d’élus accèdent.
Vous avez tous fait cette expérience : vous êtes assis dans un aéroport avec une heure de temps à tuer, et vous êtes incapable d’échapper au bavardage d’une chaîne d’information en continu. Pour ma part, même si le son est désactivé, il suffit que le téléviseur soit en vue pour que je n’arrive plus à détacher mes yeux de l’écran. L’introduction d’un élément de nouveauté dans le champ de vision entraîne ce que les psychologues de la cognition appellent une réaction d’orientation (soit une adaptation évolutive cruciale dans un monde de prédateurs) : l’animal tourne aussitôt le visage et les yeux vers cette nouvelle entité. Sur un écran de télévision, on voit apparaître une nouvelle figure à peu près à chaque seconde : la nouveauté suspend les expectatives routinières liées à une situation donnée. Les images qui surgissent à l’écran interrompent le flux habituel de l’expérience et nous interpellent. En leur présence, il est par exemple difficile de reproduire mentalement une conversation que nous aurions eue auparavant. Les divers processus mentaux des personnes présentes cèdent la place à une expérience fortement coordonnée : ce n’est pas le mouvement quasi simultané d’une troupe de macaques faisant face à la menace soudaine d’un python, mais la convergence involontaire des regards de voyageurs fatigués vers le « contenu » qui leur est présenté.
Une autre option, dans ce genre d’espace, c’est de consulter son téléphone ou de se plonger dans un roman, parfois justement pour se détourner de ce robinet à images. Un « multivers » d’expériences privées se trouve ainsi à portée de main. Mais, dans cette compétition entre diverses technologies de l’attention, ce qui se perd, c’est le type d’espace public que requiert un certain type de sociabilité. Le romancier Jonathan Franzen y fait allusion lorsqu’il écrit : « Arpentant la Troisième Avenue un samedi soir, je me sens complètement désorienté. Me voilà entouré de jeunes gens séduisants qui sont tous penchés sur l’écran de leur StarTac ou de leur Nokia, l’air tourmenté comme s’ils étaient aux prises avec un féroce mal de dent… Pourtant, tout ce que je leur demande, c’est qu’ils me voient et qu’ils se laissent voir… »
Un espace public où les gens ne sont pas renfermés sur eux-mêmes, comme c’est le cas lorsque notre esprit se détache de notre corps, offre un large éventail de possibilités de rencontres spontanées. Même si nous n’engageons pas la conversation nous avons le loisir d’expérimenter notre réserve réciproque en tant que réserve, du moins si notre attention n’est pas intensément absorbée mais flotte librement, disponible à la présence d’autrui et susceptible d’être prodiguée selon notre bon vouloir. Être confronté à la réserve ou à la réticence de nos semblables est tout à fait différent d’être invisible à leurs yeux ; l’absence de communication orale n’exclut pas l’expérience aiguë d’avoir fait une rencontre. Ce type de rencontre est toujours chargé d’ambiguïté et se prête à toutes sortes d’interprétations qui mobilisent notre fantaisie, souvent sur un mode érotique. C’est d’ailleurs ce qui rend les grandes villes aussi excitantes.
Les psychologues estiment qu’on peut définir deux catégories d’attention, selon que celle-ci est guidée par un objectif ou par un stimulus, c’est-à-dire selon qu’elle est volontaire ou non. Le premier type d’attention, ou attention « exécutive », est par exemple celui d’un enseignant qui essaie de compter ses élèves dans un bus scolaire où règne le chaos. En revanche, si j’entends une forte détonation près de chez moi, mon attention est induite par un stimulus. Je peux dès lors choisir éventuellement de me pencher à la fenêtre pour voir ce qui se passe, mais mon mouvement d’attention initiale est involontaire.
Résister à une simple réaction d’orientation exige un effort délibéré pour diriger son attention, sachant que notre capacité de résistance est limitée. Bien entendu, dans l’exemple de l’aéroport, je peux me contenter de changer de position sur mon siège et de détourner le regard des écrans. Sauf qu’il est de moins en moins fréquent que mon champ de vision soit complètement libre de toute incitation commerciale. La présence de plus en plus dense des technologies attentionnelles dans l’espace public exploite nos réactions d’orientation d’une manière qui fait obstacle à toute sociabilité, nous éloigne les uns des autres et nous oriente vers une réalité préfabriquée, dont le contenu est télécommandé par des intérêts privés motivés par l’appât du gain. Il n’y a là aucun complot, c’est juste comme ça que cela se passe.
Quand nous passons les contrôles de sécurité d’un aéroport, ce sont les pouvoirs publics qui mobilisent notre attention pour le bien commun. Il s’agit d’un moment emblématique de la fonction la plus fondamentale de l’autorité politique en démocratie — le maintien de la sécurité publique —, d’où une certaine solennité. Mais, ces dernières années, je me suis rendu compte qu’il fallait que je redouble de vigilance à la fin de cette procédure : le plateau gris sur lequel le voyageur doit placer son bagage à main pour qu’il passe aux rayons X s’est couvert de publicité et cet encombrement visuel risque fort, par exemple, de me faire oublier ma petite clé USB, perdue au milieu des rouges à lèvres L’Oréal qui en ornent la surface.
Tout cela alors que je suis déjà dans un état de quasi-panique en raison de l’heure de mon vol, d’un possible changement de porte d’embarquement et de toute une série de contingences à prendre en compte quand on voyage — sans parler du fait que ma mémoire est largement obnubilée par les détails du discours que je vais devoir prononcer dans quelques heures devant des inconnus. Cette exigence de vigilance exacerbée par la peur d’oublier ma présentation PowerPoint sur le plateau se présente ainsi comme un véritable conflit entre L’Oréal et moi.
Or il semble bien que L’Oréal ait mis les services de sécurité aéroportuaires de son côté. Mais qui a décidé d’exploiter commercialement la surface des plateaux destinés aux bagages à main ? Personne, bien entendu, du moins personne ne l’a fait au nom de la collectivité. Quelqu’un s’est contenté de faire une suggestion, suscitant la seule réponse raisonnable possible du point de vue de « personne », justement : des plateaux vierges de toute inscription trahissent l’usage « inefficace » d’un espace qui pourrait être utilisé pour « informer » le public d’une série d’« opportunités ». Ce genre de « justification » est tellement intégré dans le discours public aujourd’hui qu’il est même susceptible d’oblitérer notre propre expérience immédiate et de nous la rendre inintelligible. Certes, nous sommes agacés, mais cette irritation se dissipe dans un vague nuage d’impuissance, parce que nous n’avons pas les moyens de l’exprimer publiquement. Nous nous retournons dès lors contre nous-mêmes ; pourquoi suis-je tellement énervé ? Il est peut-être temps de renforcer ma dose d’anxiolytiques.
Les principaux courants de la recherche en psychologie traitent généralement l’attention comme une ressource rare — chaque individu en possède une quantité limitée. Il ne nous vient pourtant pas à l’idée de revendiquer notre droit à la préservation de cette ressource, pas plus qu’elle n’est l’objet d’une économie politique capable de prendre en compte les carences spécifiques de l’environnement cognitif moderne. À cette fin, je tiens à proposer le concept d’attention comme bien commun. Certaines ressources, comme l’air que nous respirons ou l’eau que nous buvons, sont des biens communs. Nous n’en sommes guère conscients, mais leur disponibilité généralisée est au fondement de toutes nos activités. De mon point de vue, l’absence de bruit est aussi une ressource de ce type. Plus précisément, le fait de ne pas être interpellé est un bien précieux qui nous semble aller de soi. De même que l’air pur nous permet de respirer, le silence, au sens large que je viens de définir, est ce qui nous permet de penser. Nous y renonçons volontiers lorsque nous sommes en compagnie de personnes avec lesquelles nous entretenons une relation, ou bien quand nous sommes d’humeur à échanger avec des inconnus. Mais c’est une tout autre affaire que d’être l’objet d’une interpellation automatisée. Les bienfaits du silence sont difficiles à évaluer ; ils ne sont pas mesurables en termes économétriques par des outils tels que le produit intérieur brut. Et pourtant, la quantité de silence disponible contribue certainement à la créativité et à l’innovation. Même si cela n’apparaît pas au niveau des statistiques de la réussite scolaire, par exemple, tout au long de son cursus éducatif un élève ou un étudiant consomme certainement une grande quantité de silence.
Si l’eau et l’air purs venaient à nous manquer, les conséquences économiques en seraient vraiment désastreuses. Nous le comprenons facilement, c’est pourquoi nous avons instauré des lois et des règlements pour protéger ces ressources collectives. Non seulement nous reconnaissons leur importance et leur fragilité, mais nous sommes bien conscients que, en l’absence de régulation vigoureuse, d’aucuns en feront usage aux dépens de leurs semblables, et ce non pas par malveillance ou simple négligence, mais parce que cet usage leur est économiquement profitable. On peut interpréter ce type de phénomène comme un transfert de ressources de l’espace public vers la sphère privée.
Une caractéristique notable des régimes mafieux qui gouvernent dans nombre de pays anciennement communistes est l’absence apparente, ou du moins l’inanité, d’une quelconque notion de bien public. Partout où le communisme a été établi par la contrainte avant de finir par s’effondrer, laissant les intérêts privés s’affirmer, on s’est aperçu qu’il n’existait pas de fondements intellectuels bien établis favorisant la défense de ressources collectives comme l’eau et l’air pur. Nombre des habitants de ces pays font aujourd’hui l’expérience de la dégradation de l’environnement qui devient inévitable lorsque la dynamique de la privatisation n’est pas contrebalancée par le civisme. Dans les sociétés libérales occidentales, nous vivons une situation similaire en ce qui concerne une autre ressource collective, l’attention, et ce justement parce que nous ne comprenons pas encore qu’il s’agit d’une ressource.
Mais peut-être me trompé-je ? On nous propose aujourd’hui de jouir du silence comme d’un produit de luxe. Dans le salon classe affaires de l’aéroport Charles-de-Gaulle, le seul bruit susceptible de vous déranger est le tintement occasionnel d’une petite cuillère contre la porcelaine : pas de télévision, pas de publicité sur les murs. Et c’est avant tout ce silence, plus que les autres dimensions de cet espace d’exclusivité, qui donne à ses usagers une sensation de luxe. Lorsque vous pénétrez dans ce sanctuaire et que les portes automatiques se referment hermétiquement derrière vous avec un chuintement discret, la différence est presque tactile, comme si l’on passait d’un habit de crin à un vêtement de satin. Vous vous sentez moins crispé, les muscles de votre cou se détendent ; au bout de vingt minutes, la fatigue s’est dissipée. Vous êtes délivré.
Dans le reste de l’aéroport règne la cacophonie habituelle. Parce que nous avons permis à notre attention d’être transformée en marchandise, il nous faut désormais payer pour la retrouver.
Lorsque les biens communs sont privatisés, ceux qui en ont les moyens peuvent abandonner l’espace public pour se retirer dans des clubs privés tels que le salon classe affaires. À partir du moment où nous réalisons que ce sont justement les décisions des occupants de ce salon qui façonnent l’environnement des passagers de la classe économique, nous commençons à percevoir les choses sous un angle plus politique. Pour pouvoir exercer ses facultés mentales de façon agréable, inventive et même éventuellement profitable sur le plan financier pendant les heures d’attente passées dans un aéroport, on a besoin de silence. Mais le cerveau du quidam de la classe économique (ou de celui qui attend à un arrêt de bus), lui, peut être traité comme une ressource — une réserve permanente de pouvoir d’achat vouée à être exploitée par le marketing innovant des « créatifs » du salon classe affaires. Lorsque des êtres humains traitent le cerveau d’autres êtres humains comme une simple ressource, il ne s’agit plus de « création de richesse », mais de dépossession. On a beaucoup parlé du déclin de la classe moyenne au cours des dernières décennies ; la concentration croissante de la richesse aux mains d’une élite toujours plus réduite a sans doute quelque chose à voir avec notre tolérance à l’égard de l’exploitation de plus en plus agressive de nos ressources attentionnelles collectives.
Cette hypothèse est particulièrement pertinente à l’ère du big data, alors que nous nous sommes assujettis à des techniques de captation de l’attention non seulement envahissantes mais de mieux en mieux ciblées. On parle beaucoup désormais d’un droit à la confidentialité dans l’espace numérique. Personnellement, au-delà du souci d’un minimum de sécurité en ligne et de protection contre le vol d’identité, je dois avouer que je ne m’inquiète guère d’essayer de dissimuler tel ou tel fait spécifique me concernant aux gros consommateurs de données ; en revanche, ce qui me préoccupe, c’est que ces données soient utilisées pour solliciter mon attention. Je crois qu’il nous faut remédier au caractère un peu vague du droit à la confidentialité en le complétant par un droit de ne pas être interpellé. Cela ne concerne évidemment pas la relation face à face entre individus, mais l’action de ceux qui ne montrent jamais leur visage et qui traitent mon cerveau comme une ressource à exploiter à grand renfort de technologie.
L’attention est la chose la plus personnelle qui soit en temps normal, c’est nous qui choisissons ce à quoi nous souhaitons prêter attention, et ce choix détermine de façon fondamentale ce qui est réel pour nous, ce qui est vraiment présent à notre conscience. L’appropriation de notre attention est donc une question qui nous affecte intimement.
Toutefois, notre attention se porte aussi vers un monde que nous partageons avec autrui ; elle n’est donc pas un phénomène exclusivement personnel, pour la simple raison que ses objets sont généralement présents à d’autres consciences. Et, de fait, on peut affirmer l’existence d’un impératif moral de prêter attention à ce monde commun et de ne pas rester complètement refermés sur nous-mêmes. Iris Murdoch écrit ainsi que, pour être quelqu’un de bien, un individu « doit avoir certaines connaissances sur son environnement, la plus évidente étant l’existence d’autres personnes et de leurs besoins ».
Prenons l’exemple d’un automobiliste absorbé par une conversation sur son téléphone portable alors qu’il circule dans un quartier commerçant très fréquenté et qu’un motard roule sur la voie latérale. Utiliser son portable en conduisant est tout aussi dangereux que conduire en état d’ivresse. Et peu importe que vous ayez les mains libres ; le fait même d’être engagé dans une conversation mobilise nos ressources attentionnelles, qui sont en quantité finie. Cela affecte notre capacité de percevoir et d’enregistrer la nouveauté lorsqu’elle se présente dans notre environnement ; c’est ce que les psychologues appellent la cécité d’inattention. Les piétons qui parlent dans leur portable tendent à marcher moins droit, à changer de direction plus souvent, à prendre plus de risques en traversant la rue, et sont moins attentifs à leurs semblables (moins sociables) ; une expérience récente a par exemple prouvé qu’ils étaient moins susceptibles de remarquer un clown chevauchant un monocycle qui venait de passer devant eux. Mettez un individu pâtissant d’un tel déficit d’attention au volant d’un bolide de 200 CV pesant deux tonnes et sa cécité devient une question morale : elle relève de ce que nous nous devons les uns aux autres. Dans l’économie des ressources attentionnelles, la circonspection littéralement, le fait de regarder autour de soi — est une des dimensions de la justice.
Une des conclusions les plus intéressantes des recherches sur la distraction au volant, c’est qu’alors que notre vigilance est affectée par une conversation téléphonique, elle ne l’est pas lorsque nous conversons avec un passager. Ce dernier est effet capable de coopérer en modulant la conversation en fonction des exigences de la conduite. Si le mauvais temps réduit la visibilité, par exemple, le passager aura tendance à se taire. Avoir un passager à ses côtés, c’est comme avoir une seconde paire d’yeux, et cette double vigilance tend à améliorer la capacité du conducteur à percevoir les situations qui sortent de l’ordinaire et d’y réagir rapidement.
Si la notion de ressource collective convient bien au phénomène de l’attention, c’est d’abord parce que l’empiétement des intérêts privés sur notre conscience passe le plus souvent par l’appropriation de notre attention dans les espaces publics, et ensuite parce que nous devons à nos semblables un minimum d’attention et de préoccupation éthique. Notons que les mots en italique relèvent à juste titre du lexique de l’économie politique, du moins si par « économie politique » nous entendons un souci de justice dans l’usage public d’une ressource privée.