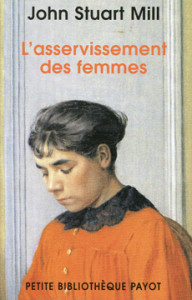Les Saoudiennes en conduite assistée
Publié le 29 septembre 2017. Par La rédaction de Books.
Les Saoudiennes pourront bientôt conduire. Les dernières femmes au monde interdites de volant y accéderont cependant uniquement avec l’accord de leur époux ou d’un gardien mâle. Qu’ils soient bien intentionnés ou pas, laisser aux hommes le soin de diriger la vie d’une femme dans ses moindres détails n’est pas un pas vers la liberté. Car le pouvoir corrompt son détenteur, tout comme celui sur qui il s’exerce, remarque le philosophe britannique John Stuart Mill dans L’asservissement des femmes publié en 1869.
Les lois de la plupart des pays sont bien pires que les gens qui les exécutent et beaucoup de ces lois ne doivent leur durée qu’à la rareté de leur application. Si la vie conjugale était tout ce qu’elle pourrait être, au point de vue légal seulement, la société serait un enfer sur la terre. Heureusement, il existe en même temps des sentiments et des intérêts qui chez beaucoup d’hommes excluent, et chez la plupart modèrent les impulsions et les penchants qui mènent à la tyrannie : de tous ces sentiments le lien qui unit un mari à sa femme est incomparablement le plus fort ; le seul qui en approche, celui qui attache un père à ses enfants, tend toujours, sauf les cas exceptionnels, à resserrer le premier au lieu de le relâcher. Mais parce que les choses se passent ainsi, parce qu’en général les hommes ne font pas subir aux femmes toutes les misères qu’ils pourraient leur faire souffrir, s’ils usaient du plein pouvoir qu’ils ont de les tyranniser, les défenseurs de la forme actuelle du mariage s’imaginent que tout ce qu’elle a d’inique est justifié, et que les plaintes qu’on en fait ne sont que de vaines récriminations à propos du mal dont il faut toujours payer un grand bien. Mais les adoucissements que la pratique peut concilier avec le maintien rigoureux de telle ou telle forme de tyrannie, au lieu de faire l’apologie du despotisme, ne servent qu’à démontrer la force de la nature humaine pour réagir contre les institutions les plus honteuses, et la vitalité avec laquelle les semences du bien comme celles du mal contenues dans le caractère de l’homme se répandent et se propagent. Tout ce qu’on peut dire du despotisme domestique s’applique au despotisme politique. Tous les rois absolus ne se mettent pas à la fenêtre pour se régaler des gémissements de leurs sujets qu’on torture, tous ne les dépouillent pas de leur dernier lambeau de vêtements pour les renvoyer se morfondre sur la voie publique. Le despotisme de Louis XVI n’était pas celui de Philippe le Bel, de Nadir-Schah ou de Caligula, mais il était assez mauvais pour justifier la Révolution française, et jusqu’à un certain point pour en faire excuser les horreurs. C’est en vain qu’on invoque l’attachement puissant de quelques femmes pour leurs maris ; on pourrait ainsi invoquer des exemples tirés de l’esclavage domestique. Dans la Grèce et à Rome, il n’était pas rare de voir des esclaves périr dans les tourments plutôt que de trahir leurs maîtres. Pendant les proscriptions qui suivirent les guerres civiles des Romains, on a remarqué que les femmes et les esclaves étaient fidèles jusqu’à l’héroïsme, et que bien souvent les fils étaient des traîtres. Pourtant nous savons avec quelle cruauté les Romains traitaient leurs esclaves. Mais on peut dire en toute vérité que nulle part ces sentiments individuels prononcés n’atteignent une aussi grande beauté que sous les institutions les plus atroces. C’est l’ironie de la vie, que les plus énergiques sentiments de reconnaissance et de dévouement, dont la nature humaine semble susceptible, se développent en nous à l’égard de ceux qui, pouvant anéantir notre existence terrestre, veulent bien s’en abstenir. Il y aurait de la cruauté à rechercher quelle place ce sentiment tient le plus souvent dans la dévotion religieuse elle-même. Nous avons fréquemment occasion de voir que ce qui développe le plus la reconnaissance des hommes pour le Ciel, c’est la vue de ceux de leurs semblables pour qui Dieu ne s’est pas montré aussi miséricordieux que pour eux-mêmes.
Quelle que soit l’institution despotique qu’on ait à défendre, l’esclavage, l’absolutisme politique, ou l’absolutisme du chef de la famille, on veut toujours que nous la jugions sur les exemples les plus favorables. On nous fait voir des tableaux où la tendresse de la soumission répond à la sollicitude de l’autorité, où un maître sage règle tout pour le plus grand bien des subordonnés, et vit entouré de bénédictions. Tout cela serait à propos, si nous prétendions qu’il n’existe pas d’hommes bons. Qui doute que le gouvernement absolu d’un homme bon ne puisse s’exercer avec une grande bonté, produire une grande somme de bonheur et exciter une grande reconnaissance ? Mais c’est en vue des hommes méchants qu’il faut établir des lois. Le mariage n’est pas une institution faite pour un petit nombre d’élus. On ne demande pas aux hommes, avant le mariage, de prouver par témoins qu’on peut se fier à leur façon d’exercer le pouvoir absolu. Les liens d’affection et d’obligation qui unissent un mari à sa femme et à ses enfants sont très forts pour ceux qui sentent fortement leurs obligations sociales, et même pour un grand nombre de ceux qui ne sont guère sensibles à leurs autres devoirs sociaux. Mais il y a tous les degrés dans la manière de sentir ces devoirs, comme on trouve tous les degrés dans la bonté ou la méchanceté, en descendant jusqu’aux individus qui ne respectent aucun lien, et sur lesquels la société n’a d’autre moyen d’action que l’ultima ratio, les pénalités édictées par la loi. À tous les degrés de cette échelle descendante, il y a des hommes qui possèdent tous les pouvoirs légaux d’un mari. Le plus vil malfaiteur a une misérable femme, sur laquelle il peut commettre toutes les atrocités, sauf le meurtre, et même, s’il est adroit, il peut la faire périr sans encourir le châtiment légal. Que de milliers d’individus n’y a-t-il pas dans les plus basses classes de chaque pays, qui, sans être des malfaiteurs au sens de la loi, à tous les autres points de vue, parce que leurs agressions rencontrent partout ailleurs de la résistance, s’abandonnent à tous les excès de la violence sur la malheureuse femme qui seule, avec ses enfants, ne peut ni repousser leur brutalité ni s’y soustraire ! L’excès de dépendance où la femme est réduite inspire à ces natures ignobles et sauvages non de généreux ménagements, ni le point d’honneur de bien traiter celle dont le sort d’ici-bas est confié entièrement à leur bienveillance, mais au contraire l’idée que la loi la leur a livrée comme leur chose, pour en user à discrétion, sans être tenus envers elle au respect qu’ils doivent avoir pour toute autre personne. La loi qui, récemment encore, essayait à peine de punir ces odieux excès d’oppression domestique, a fait ces dernières années de faibles efforts pour les réprimer. Ils ont produit peu d’effet, et on n’en doit guère attendre, parce qu’il est contraire à la raison et à l’expérience qu’on puisse mettre un frein à la brutalité en laissant la victime au pouvoir du bourreau. Tant qu’une condamnation pour voies de fait, ou, si l’on veut, pour une récidive, ne donnera pas à la femme, ipso facto, droit au divorce, ou au moins à la séparation judiciaire, les efforts pour réprimer les « sévices graves » par des pénalités resteront sans effet, faute d’un plaignant ou faute d’un témoin.
Que si l’on considère le nombre immense des hommes qui dans tous les grands pays ne s’élèvent guère au-dessus des brutes, et si l’on songe que rien ne s’oppose à ce qu’ils acquièrent par la loi du mariage la possession d’une victime, on verra l’effrayante profondeur de misère qui se creuse sous cette seule forme. Pourtant ce ne sont que les cas extrêmes, ce sont les derniers abîmes ; mais, avant d’y parvenir, que de gouffres sombres sur la pente ! Dans la tyrannie domestique comme dans la politique, les monstres font voir ce que vaut l’institution ; par eux on apprend qu’il n’y a pas d’horreur qui ne se puisse commettre sous ce régime, si le despote le veut, et l’on mesure avec exactitude la fréquence épouvantable de crimes un peu moins atroces. Les démons sont aussi rares dans l’espèce humaine que les anges, plus rares peut-être ; mais il est très fréquent de voir des sauvages féroces susceptibles d’accès d’humanité ; et dans l’intervalle qui les sépare des nobles représentants du genre humain, que de formes, que de degrés dans la bestialité et l’égoïsme se cachent souvent sous un vernis de civilisation et de culture ! Les individus y vivent en paix avec la loi ; ils s’offrent sous des dehors honorables à tous ceux qui ne sont pas en leur pouvoir ; ils ont pourtant assez de méchanceté pour rendre à ceux qui y sont la vie insupportable. Il serait fastidieux de répéter les lieux communs qu’on a débités sur l’incapacité des hommes en général pour l’exercice du pouvoir : après des siècles de discussions politiques, tout le monde les sait par cœur, mais presque personne ne songe à appliquer ces maximes au cas où plus qu’à tous les autres elles conviennent, à un pouvoir qui n’est pas confié aux mains d’un ou de plusieurs hommes, mais qui est livré à tout adulte du sexe masculin, jusqu’au plus vil et au plus féroce. De ce qu’un homme n’est pas connu pour avoir violé un des dix commandements, ou qu’il jouit d’une bonne réputation parmi ceux qu’il ne peut contraindre à avoir des relations avec lui, ou qu’il ne s’échappe pas en violents éclats contre ceux qui ne sont pas obligés de le supporter, il n’est pas possible de présumer le genre de conduite qu’il tiendra chez lui, quand il sera maître absolu. Les hommes les plus communs réservent le côté violent, morose, ouvertement égoïste de leur caractère pour ceux qui n’ont pas le pouvoir de leur résister. La relation de supérieur à subordonné est la pépinière de ces vices de caractère ; partout où ils existent, c’est de là qu’ils tirent leur sève. Un homme violent et morose avec ses égaux est assurément un homme qui a vécu parmi des inférieurs qu’il pouvait dominer par la crainte ou par les vexations. Si la famille est, comme on le dit souvent, une école de sympathie, de tendresse, d’un affectueux oubli de soi-même, c’est encore plus souvent pour son chef une école d’entêtement, d’arrogance, de laisser aller sans limite, et d’un égoïsme raffiné et idéalisé dont le sacrifice n’est lui-même qu’une forme particulière, puisqu’il ne prend intérêt à sa femme et à ses enfants que parce qu’ils sont une partie de ses propriétés, puisqu’il sacrifie de toutes les façons leur bonheur à ses plus légères préférences. Qu’attendre de mieux de la forme actuelle de l’union conjugale ? Nous savons que les mauvais penchants de la nature humaine ne restent dans leurs limites que lorsqu’il ne leur est pas permis de se donner carrière. On sait que par un penchant, ou par une habitude, sinon de propos délibéré, presque tout le monde empiète toujours sur celui qui cède jusqu’à le forcer à la résistance. C’est en présence de ces tendances actuelles de la nature humaine que nos institutions actuelles donnent à l’homme un pouvoir à peu près illimité sur un membre de l’humanité – celui avec lequel il demeure, qu’il a toujours avec lui. Ce pouvoir va chercher les germes latents d’égoïsme dans les replis les plus cachés du cœur de l’homme, y ranime les plus faibles étincelles, souffle sur le feu qui couvait, et lâche la bride à des penchants que dans d’autres circonstances l’homme aurait senti la nécessité de réprimer et de dissimuler au point de se faire avec le temps une seconde nature. Je sais qu’il y a un revers à la médaille, je reconnais que, si la femme ne peut résister, il lui reste au moins les représailles ; elle a le pouvoir de rendre la vie de l’homme très malheureuse, et s’en sert pour faire prévaloir sa volonté sur bien des points où elle doit l’emporter, et aussi sur beaucoup où elle ne le devrait pas. Mais cet instrument de protection personnelle, qu’on pourrait appeler la puissance de la criaillerie, la sanction de la mauvaise humeur, a un vice fatal ; c’est qu’il sert le plus souvent contre les maîtres les moins tyranniques, et en faveur des subordonnés les moins dignes. C’est l’arme des femmes irritables et volontaires qui feraient le plus mauvais usage du pouvoir, si elles l’avaient, et qui font un mauvais usage de celui dont elles s’emparent. Les femmes d’humeur douce ne peuvent recourir à cette arme, et celles qui ont le cœur haut placé la dédaignent. D’un autre côte, les maris contre qui on l’emploie avec le plus de succès sont les plus doux et les plus inoffensifs, ceux que nulle provocation ne peut résoudre à faite un usage un peu sévère de leur autorité. Le pouvoir qu’a la femme d’être désagréable a pour effet général d’établir une contre-tyrannie, et de faire des victimes dans l’autre sexe en s’exerçant surtout sur les maris les moins enclins à devenir des tyrans.
Qu’est-ce donc qui modère réellement les effets corrupteurs du pouvoir, et les rend compatibles avec la somme réelle de bien que nous voyons autour de nous ? Les caresses féminines, qui peuvent avoir un grand effet dans des cas particuliers, en ont très peu pour modifier les tendances générales de la situation. En effet, ce genre de pouvoir dure seulement tant que la femme est jeune et attrayante, ou tant que le charme est nouveau, et qu’il n’est pas détruit par la familiarité ; puis il y a beaucoup d’hommes sur qui ces moyens n’ont jamais beaucoup d’influence. Les causes qui contribuent réellement à adoucir l’institution sont l’affection personnelle que produit le temps dans la mesure où la nature de l’homme est capable d’en ressentir, et où le caractère de la femme est assez sympathique à celui de l’homme pour l’y faire naître ; leurs intérêts communs au sujet des enfants, et d’autres intérêts communs, mais soumis à de très grandes restrictions, au sujet de personnes tierces ; l’importance du rôle de la femme pour embellir la vie de son mari ; la valeur que le mari reconnaît à sa femme à son point de vue personnel, qui, chez un homme généreux, devient l’origine de l’affection qu’il lui porte pour elle-même ; l’influence acquise sur presque tous les êtres humains par ceux qui les approchent, qui, s’ils ne déplaisent pas, peuvent, à la fois par leurs prières et par la communication inconsciente de leurs sentiments et de leurs dispositions, obtenir sur la conduite de leurs supérieurs un empire excessif et déraisonnable, à moins d’être contre-carrés par quelque autre influence directe. C’est par ces divers moyens que la femme arrive souvent à exercer un pouvoir exorbitant sur l’homme et à influencer sa conduite sur les points mêmes où elle n’est pas capable de le faire pour le bien, où son influence peut non seulement manquer de lumière, mais s’employer en faveur d’une cause moralement mauvaise, alors que l’homme agirait mieux s’il était laissé à ses propres penchants. Mais, dans la famille comme dans l’État, le pouvoir ne peut remplacer la liberté. La puissance que la femme exerce sur son mari lui donne souvent ce qu’elle n’a aucun droit d’avoir, et ne lui donne pas les moyens d’assurer ses propres droits. L’esclave favorite d’un sultan possède elle-même des esclaves qu’elle tyrannise ; il vaudrait mieux qu’elle n’en eût pas, et ne fût pas elle-même esclave. En absorbant sa propre existence dans celle de son mari, en n’ayant aucune volonté, ou en lui persuadant qu’elle ne veut que ce qu’il veut dans toutes leurs affaires communes, et en employant toute sa vie à agir sur ses sentiments, elle peut se donner la satisfaction d’influencer et probablement de pervertir sa conduite dans les affaires dont elle ne s’est jamais rendue capable de juger ou dans lesquelles elle est totalement dominée par quelque motif personnel ou par quelque préjugé. En conséquence, dans l’état présent des choses, ceux qui en usent avec le plus de bienveillance avec leur femme sont tout aussi souvent corrompus que raffermis dans l’amour du bien par l’influence de leur femme, quand il s’agit d’intérêts qui s’étendent hors de la famille. On a appris à la femme qu’elle n’avait pas à s’occuper des choses placées hors de sa sphère ; elle n’a donc que rarement une opinion vraie et consciencieuse à leur sujet ; par conséquent elle ne s’en occupe jamais dans un but légitime et n’y touche guère que dans un but intéressé. En politique elle ignore où est le droit, et ne s’en soucie pas, mais elle sait ce qui peut procurer à son mari un titre, à son fils une place, à sa fille un beau mariage.