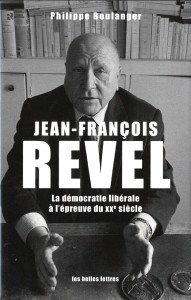«Le jour viendra où l’on consacrera des livres savants aux différents Revel, au philosophe, au politique, au polémiste, à l’historien de l’art, au mémorialiste, au moraliste. » Cette prédiction faite par Jean-Claude Casanova en ouverture du dossier publié par la revue
Commentaire à l’occasion de la mort de l’écrivain, en 2006, ne s’est pas réalisée. À ce jour, deux ouvrages seulement ont été publiés sur Jean-François Revel (1) : un essai biographique de son ami Pierre Boncenne, chaleureux panégyrique rempli d’anecdotes et de citations (2), et une remarquable analyse de sa pensée politique par l’historien des idées Philippe Boulanger.
Ce n’est pas beaucoup pour un homme présent au cœur de la vie intellectuelle française durant un demi-siècle, habitué des studios de radio et des plateaux de télévision, auteur d’une trentaine de livres dont la plupart, traduits dans plusieurs langues, ont été des succès de librairie et dont les analyses et les prises de position donnaient systématiquement lieu à de vives controverses.
Au cours de la dernière décennie, son souvenir a essentiellement été entretenu par un carré de fidèles, amis de longue date, anciens collègues et collaborateurs. Pour quelles raisons ? La société d’aujourd’hui vit au présent et a la mémoire courte. Certains intellectuels que Revel a influencés répugnent à mentionner son nom, en vertu de cette loi que l’intéressé énonçait dans ces termes : « Les Français adorent penser, mais un Français qui pense a généralement besoin d’être soutenu par le sentiment qu’il est le premier et le dernier à le faire. » Il reconnaîtra avoir cédé lui-même à ce travers en ne mentionnant pas, dans
La Tentation totalitaire,
L’Opium des intellectuels, de Raymond Aron, dont la lecture l’avait pourtant influencé. Surtout, iconoclaste et provocateur, auteur de pamphlets virulents et redoutable polémiste, Revel, en attaquant sans pitié les idées et les systèmes de pensée qu’il trouvait absurdes, stupides ou mensongers, s’est fait de nombreux ennemis, y compris
post mortem.
Esprit voltairien haïssant la censure et les dévots, animé par la passion de la liberté et de la vérité, il avait un tempérament naturellement rebelle : « En moi et malgré moi, il y aurait toujours eu, je pense, de toute manière, un noyau réfractaire à la tyrannie des milieux officiels et des idées reçues. »
Cet anticonformisme foncier, rien ne l’illustre mieux que l’ouvrage avec lequel, à peine agrégé, il fit une entrée fracassante sur la scène intellectuelle :
Pourquoi des philosophes ? Dans ce brûlot constellé de formules mémorables, écrit avec toute la fougue de la jeunesse d’une plume pleine de verve assassine, il s’en prenait avec brio à quelques gloires anciennes ou contemporaines. Ce livre et sa suite,
La Cabale des dévots, dans lequel il commente les réactions indignées qu’a suscitées le premier – notamment celles de Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty –, sont sans doute les seuls ouvrages traitant de philosophie que l’on lit en éclatant de rire à chaque page, excité par un mélange de vues profondes et de joyeux irrespect dont il n’existe que peu d’exemples dans la littérature d’idées.
Rationaliste épris de clarté et athée sans états d’âme, ainsi que l’atteste
Le Moine et le Philosophe, dialogue avec Matthieu Ricard – un de ses fils devenu moine bouddhiste –, Revel avait une profonde horreur du spiritualisme bon marché, du galimatias et de la prétention intellectuelle. Parmi ses pages les plus féroces figurent celles qu’il a consacrées à Bergson et à son disciple Teilhard de Chardin, aux membres du groupe Tel Quel, à Lacan, le « Sacha Guitry de la psychanalyse », débitant d’un « ton prophétique et dédaigneux » un ramassis de platitudes, de tautologies et de non-sens, et surtout à Heidegger, auteur d’« une philosophie d’avenir en ce sens qu’elle n’est pas terminée et que la partie qui manque est justement la partie essentielle », capable de « tenir sur la bombe atomique des propos dignes d’une vieille dame de province » et dont il décrit la méthode de la façon suivante : « [Elle] consiste à énoncer d’abord ce qui est à prouver ; puis à formuler la même idée de cinq ou six manières à peine différentes, en se bornant à juxtaposer les phrases les unes à la suite des autres. Enfin, au début de la dernière phrase, qui répète la première et toutes les autres, il écrit simplement le mot donc. »
Sous-jacente à cette charge jubilatoire figure l’idée, très sérieuse, que la philosophie, depuis l’essor de la science moderne, ne peut plus prétendre à constituer la forme ultime et absolue de connaissance. Une thèse que Revel développera dans son
Histoire de la philosophie occidentale. De Thalès à Kant. Parmi d’autres lumineux exposés, cette « histoire populaire » contient une présentation très critique du rationalisme métaphysique de Descartes, décrit comme une régression par rapport aux idées de l’époque, tournant le dos aux découvertes de Galilée et à l’idée du rationalisme expérimental (3). On y trouve aussi de belles pages sur ces philosophes antiques que Revel connaissait bien et appréciait beaucoup, à l’instar de Montaigne et pour les mêmes raisons : leur attachement à la conception de la réflexion philosophique comme source de sagesse.
Le goût de Jean-François Revel pour la démystification et le déboulonnage d’idoles s’est manifesté dans d’autres domaines. Souvent, ses victimes étaient des héros du panthéon français, objets d’un culte qui l’irritait : Saint-Exupéry, dont « [les] sornettes à hélice [ont] révélé aux Français qu’une ânerie verbeuse devient profonde si on la fait décoller du sol pour l’élever à sept mille pieds de haut » ; Alain, « illisible, affecté, précieux, archaïsant […] paysan génial [qui] a voulu labourer en dentelles » ; dans le domaine de la critique d’art, Élie Faure et André Malraux, accusés d’« encourager notre penchant national pour le verbiage historico-mondial de deuxième main et pour la vulgarisation ampoulée ». Dans l’anthologie de la poésie française qu’il a composée, Claudel, Aragon et Péguy brillent ostensiblement par leur absence.
Dans l’expression de ses admirations, Revel ne témoignait pas de moins de liberté d’esprit. Son pénétrant petit essai sur Proust, par exemple, largement ignoré ou dénigré par les spécialistes, présente l’auteur d’
À la recherche du temps perdu comme un écrivain réaliste et comique qu’il faut louer pour la subtilité de ses observations sur les mécanismes et les ravages du snobisme et de la passion amoureuse, pas du tout pour ses idées sur le temps et la mémoire, qui sont ce qu’il y a de moins original chez lui.
En politique, le nom de Jean-François Revel est associé à la lutte contre le communisme, qui fut la grande affaire de sa vie. Le premier combat qu’il a mené, c’était toutefois contre le gaullisme. Dans
Le Style du Général et la longue préface à sa réédition, tout en mettant en question la qualité, pourtant unanimement vantée, de l’expression écrite et orale de De Gaulle, il dénonce vigoureusement ses vues en politique étrangère, qu’il juge archaïques et obsessionnellement antiaméricaines, ainsi que sa conception du pouvoir et la Constitution qu’il a mise en place.
En France: la fin de l’opposition, Lettre ouverte à la droite et L’Absolutisme inefficace continueront à stigmatiser le régime « présidentialiste », monarchique sous des habits républicains, de la Ve République, auquel Revel reproche de concentrer trop de pouvoir dans les mains du chef de l’État et qu’il tirait fierté d’avoir blâmé « tant sous le gaullisme triomphant que sous le gaullisme déclinant ; puis, plus tard, tant sous le socialisme plastronnant que sous le socialisme délinquant et déliquescent ».
Proche, dans sa jeunesse, des socialistes et de François Mitterrand, Jean-François Revel s’en éloignera au milieu des années 1970 après l’adoption du programme commun de la gauche, dans lequel il vit le signe de l’opportunisme d’un homme qu’il peindra plus tard en ces termes : « Mitterrand se passionnait […] pour les instruments de la politique, pas pour ses objectifs ; pour ses moyens, pas pour ses fins ; pour la conquête et la conservation du pouvoir, par pour les éventuels desseins que le pouvoir permet de réaliser. » Son appréciation du partenaire communiste dudit programme est encore plus sévère : « En tant qu’individu, Marchais était borné, brutal, vaniteux et dissimulé. Comme dirigeant du PCF, ce fut un despote et, vis-à-vis de Moscou, un esclave. »
Un autre élément ayant contribué à le détacher du socialisme est le voyage qu’il effectua aux États-Unis, dont sortira son premier best-seller,
Ni Marx ni Jésus : un tableau enthousiaste de la « révolution libérale » dont l’Amérique était à ses yeux le laboratoire, qui lui semblait destinée à s’étendre au monde entier et dont il retrouvera plus tard, avec « des sentiments de complicité et d’agacement mêlés », un écho affaibli dans les événements de Mai 68. Des événements mal compris, dit-il, par leurs protagonistes, restés aveugles à la vocation de ce mouvement à devenir « le moteur d’une accélération de la civilisation libérale et individualiste opposée à l’étatisme et au collectivisme ». Dans
Ni Marx ni Jésus, Revel étudiait aussi les ressorts de l’antiaméricanisme des élites françaises, sur lequel il allait revenir à la fin de sa vie dans
L’Obsession anti-américaine. Rendant compte de ces deux ouvrages dans
The New York Review of Books, à trente ans d’intervalle, Mary McCarthy et Tony Judt auront quasiment les mêmes mots pour féliciter Revel de sa lucidité au sujet des sentiments de ses compatriotes à l’égard des États-Unis, tout en déplorant son incontestable propension à idéaliser l’Amérique.
À partir de ce moment, sa trajectoire politique ne s’infléchira plus.
La Tentation totalitaire, Comment les démocraties finissent, La Connaissance inutile (profond essai sur le rôle de l’information, l’idéologie et « la première de toutes les forces qui mènent le monde, […] le mensonge »),
Le Regain démocratique et La Grande Parade sont autant de jalons d’une double croisade : contre le totalitarisme, plus particulièrement sous sa forme communiste, et pour le libéralisme. Philippe Boulanger l’a bien montré, Revel n’est pas un théoricien du libéralisme, mais un diffuseur des idées libérales. Éclectique dans son inspiration, le libéralisme à la fois politique et économique qu’il prône s’appuie simultanément sur les idées de Friedrich Hayek et de Karl Popper et sur la tradition libérale française incarnée par Tocqueville ou Raymond Aron. Dans l’ensemble, les sociétés capitalistes et libérales lui apparaissent préférables parce qu’elles sont plus efficaces, donc mieux à même de produire des richesses pour en redistribuer davantage, et capables d’autocorrection. Mais, s’il était confiant dans le progrès, il ne l’était pas outre mesure dans la nature humaine : « Contrairement à ce que croyait Rousseau […] l’homme est mauvais et […] c’est la société qui le rend bon, quand cette société se constitue par le droit. »
L’originalité du regard jeté par Revel sur la vie politique et la société françaises tient notamment à son histoire personnelle. « Six ans de séjour à Mexico puis à Florence, faisait-il remarquer, m’ont fourni l’occasion d’une ouverture d’esprit qui m’est restée. Maîtriser des langues étrangères 4, se frotter à d’autres cultures, considérer la sienne de l’extérieur en échappant au parisianisme m’a procuré une façon de penser, une sensibilité particulière. » Avant de le faire dans son pays, il avait en effet enseigné en Algérie, au Mexique, où il avait observé le fonctionnement d’un régime de « dictature élue » dont il retrouvera beaucoup de traits en France, ainsi qu’en Italie, dont il ramènera un autre livre à scandale : avec « un sans-gêne et une muflerie calculés », écrira-t-il lui-même,
Pour l’Italie « [prenait] le contre-pied des attendrissements préconçus des Italiens sur eux-mêmes et des étrangers sur l’Italie ». L’ouvrage suscita un débat national dans la péninsule avant même d’être traduit. Mais il fut applaudi par le célèbre journaliste Indro Montanelli, toujours très critique envers ses compatriotes 5. Relisant le livre des années plus tard, Revel avouera être « atterré [...] par les simplifications, les généralisations, les exagérations » qu’il contenait.
Formidable machine intellectuelle, il impressionnait par l’étendue de ses connaissances. « Ce qu’il donnait à voir en vitrine, dit joliment Philippe Meyer, [il le tenait] en magasin. » Sa maîtrise des sujets qu’il traitait éclate dans
Contrecensures, Les Idées de notre temps et
Fin du siècle des ombres, sélections d’articles publiés dans
Le Figaro littéraire,
France-Observateur, Le Point et
L’Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, qu’il finira par diriger durant trois ans (6). Beaucoup de ces textes sont des éditoriaux ou des recensions de livres, et dans les deux cas ce sont des modèles du genre. Les premiers frappent par leur qualité pédagogique. « Qu’y a-t-il de commun entre composer un éditorial et faire la classe ? demande Revel, qui adorait enseigner. Il y a le souci essentiel et constant de se mettre à la place de ceux qui vous lisent ou vous écoutent, de parler non pour vous-même mais pour eux, de ne jamais supposer connu chez eux ce qu’ils ont le droit d’ignorer, ni compris à l’avance ce qu’on a le devoir de leur expliquer. » Il s’y appliquait constamment, avec un savoir-faire qu’illustre, entre mille exemples possibles, ce passage d’un texte tiré d’un autre recueil d’articles, celui-là consacré aux arts,
L’Œil et la connaissance : « Le cubisme consiste principalement en deux innovations : peindre l’espace comme du plein, du solide, et non pas comme un vide où baigne l’objet ; ensuite dresser de cet objet un inventaire complet, en y incorporant tous ses aspects, alors que la perspective classique consiste à se placer à un seul point de vue et à une distance déterminée. »
Ses recensions étaient autant d’occasions de mener une réflexion sur les thèmes traités dans des livres d’une étonnante variété : enquêtes sociologiques, correspondances politiques ou littéraires, études d’économie du développement, souvenirs de savants, traités de psychanalyse ou de sexologie. Dans
Fin du siècle des ombres, à côté de commentaires et portraits politiques et de quelques pages étincelantes sur l’historiographie de la Révolution française, on trouvera ainsi ses vues sur René Girard, saint Augustin, Nietzsche, Machiavel ou le culte délirant rendu à la princesse Diana. Dans l’ensemble, lue à dix, vingt ou trente années de distance, cette production journalistique atteste sa grande sensibilité à l’air du temps. Sur le désastre de l’école, la logique du terrorisme ou l’essor du « politiquement correct », il fit preuve d’une clairvoyance étonnamment précoce.
En Jean-François Revel, Philippe Raynaud voit une réincarnation d’Hippolyte Taine, qui, un siècle avant lui, a fustigé la philosophie officielle, accompli une carrière brillante en dehors de l’université, consacré un livre à l’Italie, publié des essais sur l’art et la littérature et fini par se rallier au modèle anglo-saxon de démocratie libérale dominant à son époque. Philippe Boulanger le compare à Benjamin Constant : à l’instar de l’auteur d’
Adolphe, Revel s’est formé chez les Jésuites et a beaucoup voyagé ; imprégné comme lui de l’esprit des Lumières, il croyait également au progrès et à la science ; intellectuels de terrain et « publicistes », tous deux défendaient un « libéralisme intégral » dans des articles de presse et des essais destinés au grand public.
Mario Vargas Llosa, Simon Leys et Henri Astier ont évoqué à son propos George Orwell. Se réclamant l’un et l’autre de la gauche, c’est à elle que les deux écrivains ont réservé leurs plus impitoyables critiques. Attachés aux faits, aux vérités de bon sens et à « la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre » (Orwell), tous deux dénonçaient inlassablement l’hypocrisie des intellectuels et leur propension à user à des fins douteuses d’un langage abscons et inélégant. Et certains de leurs procédés stylistiques étaient très proches. Mais la comparaison a ses limites. Conservateur sentimentalement lié à l’Angleterre, Orwell n’a jamais reconnu au libéralisme économique les mérites que lui attribuera plus tard Revel, progressiste et internationaliste. Sur le plan biographique, Revel a très tôt bénéficié d’une notoriété qu’Orwell n’a connue qu’à la fin de sa vie, et d’une aisance matérielle et de positions de pouvoir auxquelles il n’a jamais accédé. En termes de caractère, de goûts et d’apparence, on peut difficilement imaginer deux individus plus dissemblables. Quoi de commun entre le maigre auteur de
1984, austère jusqu’à l’ascétisme, farouche avec l’autre sexe et fermé aux autres arts que la littérature, et le corpulent journaliste français, épicurien curieux de peinture, de musique et de cinéma, dévorant tout ce que la vie peut offrir, attaché aux plaisirs de l’amitié (7), amateur de voyages, de compagnie féminine, de vins fins et de bonne chère (8) ? Sur ce dernier sujet, Revel a d’ailleurs publié sous le titre
Un festin en paroles une « histoire littéraire de la sensibilité gastronomique » émaillée d’observations judicieuses comme la suivante, où s’expriment de concert sa compétence de gourmet et sa passion pour le turf : « Si la cuisine régionale et paysanne a des qualités de fond et de sérieux qui permettent de la comparer au cheval de trait et de labour, si la haute gastronomie a les vertus élégantes et la fragilité du pur-sang, la cuisine bourgeoise est ce que les éleveurs de chevaux appellent un demi-sang : elle trotte, mais ne galope pas. »
« Le meilleur livre sur Revel, fait observer un de ses admirateurs anglo-saxons, l’essayiste Clive James, est de lui. » Il s’agit bien sûr du
Voleur dans la maison vide, l’autobiographie qui lui a ouvert les portes de l’Académie française en lui conférant le statut d’un véritable homme de lettres. À l’instar des
Souvenirs de Tocqueville ou des
Mémoires de Guizot, auxquels il ne serait pas absurde de le comparer, l’ouvrage est extrêmement bien écrit, comme en vérité le reste de son œuvre. On a souvent relevé le caractère robuste, direct, net, carré de son style, ce que Simon Leys appelait avec justesse son « implacable clarté ». Un autre de ses traits distinctifs est ce sens de l’image forte et du qualificatif insolite qui lui fait évoquer « Pompidou avec son air d’Auvergnat qui remonte de la cave » ou l’« usage dévoyé et théâtral des herbes » dans la cuisine des restaurants touristiques.
Mais il y a plus. Considérons cet aphorisme surgissant au beau milieu d’un développement sur l’enseignement : « La haine de la liberté prend souvent le masque de sa défense. » Ou cette réflexion désabusée sur la manière dont le caractère « grotesque autant qu’odieux » du communisme nous prémunit contre son retour : « Pour nous garder d’une rechute insidieuse, je compte, je l’avoue, plus sur les brûlures de notre vanité que sur les scrupules de notre conscience, et moins sur la lucidité de notre intelligence que sur les déboires de notre aveuglement. » Ou cette observation cruelle au sujet de Raymond Aron, dont il explique l’indécision dans un violent conflit qui secoua
L’Express par « ce mélange contradictoire d’amour-propre et de passivité qui le faisait aspirer à être consulté sur tout et à ne donner des conseils sur rien » (9). Enfin cette remarque sarcastique : « Les socialistes ont une si haute idée de leur propre moralité qu’on croirait presque, à les entendre, qu’ils rendent la corruption honnête en s’y livrant, loin qu’elle ternisse leur vertu quand ils y succombent. »
Dans de telles phrases résonnent des échos de la langue de La Rochefoucauld, Saint-Simon, Retz, La Bruyère, Pascal, Chamfort, Montesquieu, Valéry ou Cioran, auteurs que Revel affectionnait et relisait constamment : une langue classique dont, à côté de la vigueur de sa pensée, de son indépendance d’esprit et de la solidité de son information, un des grands mérites aura été de mettre toute la puissance, la souplesse, la précision et l’élégance au service de l’analyse des grandes questions actuelles.
Jean-François Revel s’est parfois laissé aller à des jugements excessifs, comme sur l’Italie, et à défendre des positions quelquefois discutables, comme sur les États-Unis. Son incapacité à résister au plaisir de la formule brillante, méchante et drôle qui fait mouche a pu le conduire à se montrer injuste et blessant. Mais, dans le débat d’idées, son intelligence aiguë, son robuste sens commun, sa profonde culture, sa lucidité et son courage faisaient de cet homme massif à la voix mate et un peu métallique une présence salutaire et précieuse qui nous serait à coup sûr bien utile aujourd’hui.
— Cet article a été écrit pour Books par
Michel André. Né et vivant en Belgique, ce philosophe de formation a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Il a publié en 2008
Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan).
Notes
1. De son vrai nom Jean-François Ricard. « Chez Revel » était le nom d’un restaurant où il avait ses habitudes. Dans la Résistance, à laquelle il a participé très jeune, son pseudonyme était Ferral, d’après le nom d’un personnage de La Condition humaine, de Malraux.
2. Pour Jean-François Revel, Plon, 2006.
3. Le chapitre sur le cartésianisme reprend le contenu d’un petit livre publié auparavant sous le titre Descartes inutile et incertain.
4. Sa première langue avait été le portugais parce que son père avait accepté un emploi au Mozambique. Il parlait couramment l’anglais, l’espagnol et l’italien,
et lisait l’allemand.
5. Qui deviendra son ami, à qui il a dédié plusieurs de ses livres et qui publiera des articles de lui dans son quotidien Il Giornale.
6. Revel a aussi été un contributeur régulier des revues intellectuelles Commentaire et Le Débat.
7. Le cercle d’intellectuels et d’artistes dont il a été proche comprend des personnalités aussi différentes qu’Octavio Paz, André Breton, Cioran, Emmanuel Berl, Bertrand de Jouvenel, Luis Buñuel et Louis Althusser – jusqu’à ce qu’il l’étrille dans la préface à une réédition de Pourquoi des philosophes ?.
8. Sa vie semble avoir été remplie d’épisodes très arrosés dont la succession continue n’a curieusement longtemps eu que peu d’effets sur la quantité et la qualité de sa production.
9. Le conflit opposa Revel à Jimmy Goldsmith, propriétaire de L’Express de 1977 à 1987, qui, pour des raisons politiques, avait licencié le journaliste Olivier Todd. Par solidarité avec son collaborateur, Revel démissionna.