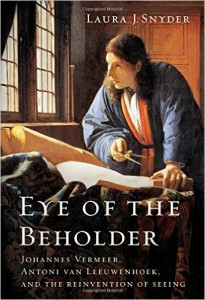Vermeer, Leuweenhoek et la révolution du regard
Publié en septembre 2015. Par Michel André.
Nés à une semaine d’intervalle la même année, 1632, dans la ville de Delft aux Pays-Bas, baptisés dans la même église et reposant dans deux tombes voisines, le peintre Johannes Vermeer et celui que l’on considère communément comme le père de la microbiologie, Antoni van Leeuwenhoek, habitaient à quelques centaines de mètres l’un de l’autre dans deux maisons situées à proximité de la place du marché. Ont-ils eu l’occasion de se rencontrer et se sont-ils connus ? Depuis plusieurs décennies cette question passionne les historiens. Delft, à l’époque, ne comptait qu’une vingtaine de milliers d’habitants. Les deux hommes évoluaient dans le même milieu et avaient beaucoup de connaissances communes. Et ils partageaient un intérêt prononcé pour les lentilles optiques. L’idée séduisante qu’ils aient pu entretenir des rapports personnels n’a donc rien d’incongru et est même assez plausible. Ainsi que le reconnaît Laura J. Snyder dans Eye of the Beholder, le très beau livre qu’elle vient de consacrer à une histoire du savant et du peintre, s’il existe certains éléments de présomption que leurs vies se sont croisées, aucune preuve formelle ne vient toutefois étayer cette idée : « Un écheveau de fils relie Leeuwenhoek et Vermeer […] Mais l’hypothèse qu’ils se sont connus ne doit demeurer que cela : une hypothèse ».
Si Laura Snyder s’est intéressée à ces deux personnalités, ce n’est pas avant tout dans le but de déterminer s’ils ont été davantage que de simples contemporains vivant au même endroit. Philosophe et historienne, professeur à la St John’s University de New York, Laura Snyder est une spécialiste de l’histoire intellectuelle, des idées et de la science. Dans son précédent ouvrage, The Philosophical Breakfast Club, une biographie groupée de Charles Babbage, John Herschel, Richard Jones et William Whewell (le « polymathe » qui a forgé et popularisé le terme « scientist »), elle étudiait le rôle joué par ces quatre savants anglais du XIXe siècle, qui avaient l’habitude de se réunir chaque dimanche à l’occasion de petits-déjeuners, dans l’organisation et la professionnalisation de la science dans leur pays. Dans ce nouveau livre, son ambition est de mettre en lumière la façon dont Vermeer et Leeuwenhoek, chacun dans son domaine, ont contribué, par l’usage qu’ils ont fait des instruments optiques, à cette révolution du regard qui a accompagné la révolution scientifique du XVIIe siècle : l’émergence d’une nouvelle manière de voir le monde, dont leurs travaux étaient à la fois le produit, l’instrument et le reflet.
Libéralisme politique et préoccupations sociales
Au siècle d’or hollandais, Amsterdam, Delft, Leiden, Haarlem et La Haye étaient des villes remarquablement modernes et prospères ; des villes exceptionnellement propres, aussi, à une époque où, dans les rues de grandes cités comme Londres ou Paris, on pataugeait le plus souvent dans la boue, les déchets alimentaires et les excréments. Dans toutes les Province-Unies – les futurs Pays-Bas – l’esprit des affaires régnait en maître, dans une société également caractérisée par un niveau élevé d’éthique du travail, de libéralisme politique et de préoccupations sociales se traduisant par un système d’aide aux plus démunis financé par d’assez lourdes taxes. Bouillonnantes d’activités industrielles et commerciales, Delft et les villes voisines étaient aussi des foyers d’effervescence artistique. À Delft, en plus de Vermeer ont vécu, travaillé ou sont passés Jan Steen, Gabriel Metsu, Pieter de Hooch et Gerard ter Borch, les plus fameux représentants de cette École hollandaise de peinture dont les œuvres se voulaient, selon la belle expression choisie par Tzvetan Todorov comme titre du livre qu’il lui a consacré, un « éloge du quotidien ».
Dans ces villes commerçantes et industrieuses s’exprimait aussi, dans de larges couches de la population, un très fort intérêt pour les progrès de la science et les réalisations techniques auxquels ils donnaient lieu, par exemple dans le domaine de l’optique. L’histoire des lentilles optiques est plus ancienne que la révolution scientifique. Depuis plusieurs siècles on employait en Occident des verres correcteurs pour la vue et des lentilles grossissantes pour la lecture. Mais le perfectionnement du télescope par Galilée et l’invention du microscope et la promotion de son utilisation à des fins scientifiques par Robert Hooke avaient ouvert des perspectives prometteuses à l’emploi des lentilles optiques, qui faisaient miroiter la possibilité d’accéder, grâce à elles, à de nouveaux mondes.
À Delft, on se servait notamment des lentilles pour déterminer la qualité des étoffes en les examinant de très près. C’est à ce titre que Leeuwenhoek a commencé à en manier. Comme beaucoup des grands noms de la science de cette époque, Leeuwenhoek était en effet un savant amateur. Fils d’un marchand de paniers, il était drapier de son métier, une activité qu’il a exercée dans des conditions dont on ignore presque tout. Peu à peu, il développa pour les lentilles un intérêt qui devint rapidement une véritable passion. À l’aide de différents procédés qu’il a toujours soigneusement tenus secrets, il se mit à en fabriquer et à les monter sur de petits microscopes, des plaques rectangulaires de cuivre ou d’argent de quelques centimètres carrés derrière lesquelles il plaçait un tube de verre contenant les matières qu’il étudiait, pour les observer par transparence à la lumière du jour ou d’une chandelle. Les plus puissants de ces dispositifs grossissaient plusieurs centaines de fois.
Un observateur infatigable
Leeuwenhoek était un manipulateur habile et un virtuose de la dissection, capable de réaliser, à l’aide de moyens rudimentaires, des coupes d’organes d’insectes d’une finesse comparable à celle des coupes qu’on effectue aujourd’hui avec des instruments sophistiqués. C’était aussi et surtout un observateur infatigable pouvant rester l’œil collé au microscope durant de très longues heures et avide d’examiner tout ce qui lui tombait sous la main : échantillons d’eau trouble et putride, produits fermentés, fragments d’organes et de tissus humains et animaux, poils, plumes et écailles, particules de poussière, déchets alimentaires coincés entre les dents, cheveux, urine, salive et sécrétions corporelles diverses. Ce qu’il contemplait par l’intermédiaire de son instrument le fascinait et le remplissait d’émerveillement. Dans des gouttes d’eau où personne ne soupçonnait qu’il y eût quoi que ce soit, il apercevait tout un grouillement d’« animalcules » étranges au comportement étonnant, que nous identifions aujourd’hui comme différentes variétés d’organismes unicellulaires et de protozoaires, notamment des protozoaires ciliés comme les paramécies, et certaines bactéries. C’est à Leeuwenhoek qu’on doit aussi la découverte des vacuoles cellulaires, celle de la structure des fibres musculaires ainsi que la première description des spermatozoïdes. Leeuwenhoek n’a jamais publié de livres ou d’articles scientifiques. Mais il a fidèlement rapporté toutes ses observations et ses découvertes à la Royal Society de Londres, dans une correspondance de cinquante-cinq ans qui ne prit fin qu’avec sa mort, à l’âge avancé de quatre-vingt-onze ans : trois cents lettres dans lesquelles vibrent son exaltation et son enthousiasme, les lettres d’un homme « pressé de faire part des observations excitantes qu’il a effectuées, pour pouvoir se remettre très vite au travail et en faire d’autres ».
Si Vermeer s’intéressait aux lentilles, c’est à première vue pour de tout autres raisons. Comme tous les peintres de son époque, dans sa poursuite de son idéal de réalisme il ne se satisfaisait pas des seules lois de la perspective telles qu’elles avaient été découvertes et formulées par les artistes et architectes de la Renaissance, en premier lieu Brunelleschi et Alberti. Dans le souci de restituer avec le plus de netteté, de précision et d’exactitude possibles la manière dont les objets, les paysages et les personnages se présentent et sont vus, à l’instar des autres peintres contemporains, il recourait souvent à des dispositifs optiques comme des miroirs ou des lentilles, pour mieux visualiser les lignes et les contours ou les dégradés de couleur. Le plus sophistiqué de ces dispositifs était la camera obscura, la chambre noire, ancêtre de l’appareil photographique : une boîte percée sur un côté d’un trou de petite taille par lequel les rayons lumineux en provenance d’un objet passent pour venir produire, sur la surface intérieure du côté opposé, une image, réduite et inversée mais très nette et conservant les couleurs, les formes, les proportions et la perspective. Au départ le trou était simplement creusé dans la paroi de la camera obscura. Au bout d’un certain temps, on l’équipa d’une lentille. Une autre amélioration fut l’introduction d’un miroir corrigeant l’inversion de l’image. Beaucoup plus tard, la mise au point de techniques permettant de fixer l’image donna naissance à la photographie.
Camera obscura
Que Vermeer ait employé une camera obscura est presque certain, même s’il n’en existe aucune preuve formelle. La question est toutefois : de quelle manière ? Plusieurs historiens de la peinture, dont Philip Steadman dans un ouvrage publié en 2002 qui a fait beaucoup de bruit, ont soutenu qu’il recopiait l’image obtenue par la projection sur la toile de celle engendrée à l’intérieur de la camera obscura. Steadman appuie cette affirmation sur l’analyse des motifs géométriques du pavement noir et blanc présent dans dix tableaux de Vermeer, apparemment tous peints dans la même pièce. Tout en qualifiant son analyse de « prouesse virtuose », Laura Snyder en récuse les conclusions. S’il est hors de doute que Vermeer a peint les dix toiles en question dans la même pièce, observe-t-elle, croire qu’elles reproduisent à l’identique le décor de cette pièce est erroné. Les pavements de marbre du type représenté, parce qu’ils étaient très chers, étaient plutôt réservés aux édifices publics et on n’en trouvait guère dans de modestes maisons privées comme celles dans laquelle Vermeer avait établi son atelier. Leur présence dans de très nombreuses toiles relève en réalité d’une convention de la peinture de genre, une tradition remontant à une époque plus ancienne que celle de Vermeer, ce qui enlève toute portée à la démonstration de Steadman. L’argument est puissant, mais il a peu de chances de clôturer définitivement le débat sur la question. Que la pièce dans laquelle Vermeer peignait n’avait pas de pavement noir et blanc (si c’est exact) prouve en effet seulement qu’on ne peut pas établir qu’il a utilisé la camera obscura pour copier des images existantes de la manière dont Steadman a tenté de le faire.
Mais si Vermeer n’a pas recouru à la camera obscura pour décalquer des images comme le postule Steadman, comment en usait-il ? « Comme les physiciens », répond Laura Snyder, il l’employait « pour expérimenter sur la lumière […] et découvrir ses propriétés », plus généralement pour améliorer et affiner son appréhension de la façon dont les objets sont effectivement vus et perçus. Dans des pages très éclairantes, Laura Snyder montre ainsi comment le recours à la camera obscura a pu aider Vermeer à saisir et rendre des nuances de couleur, d’ombre et de lumière, à distinguer différents plans de netteté, à maîtriser des perspectives difficiles et même à composer ses images : « Vermeer n’avait pas besoin d’un instrument optique pour composer ses images. Mais en considérant ses compositions avec une camera obscura, il pouvait apercevoir de nouvelles manière de cadrer une scène, y compris certains arrangements qu’il aurait été difficile de traduire dans un espace à deux dimensions sans l’effet d’aplatissement de la camera obscura ».
Conjuguée avec l’effacement délibéré, par le peintre, de toute trace de son travail (en contraste, par exemple, avec les marques ostensibles de pinceau qu’on observe chez Rembrandt), cette perfection dans le rendu des détails, le traitement de la lumière et l’organisation des scènes explique la qualité « photographique » des tableaux de Vermeer. Avec l’envoûtante impression de temps suspendu qui en émane, et la troublante atmosphère d’intimité qui les caractérise, cette qualité photographique est à l’origine de la fascination particulière qu’exercent ces toiles. Significativement, c’est l’invention de la photographie, deux siècles plus tard, qui a permis de prendre toute la mesure de cette qualité spéciale des œuvres de Vermeer, un fait qui n’est pas sans avoir facilité la redécouverte du peintre. Célèbre et célébré pour son grand talent de son vivant, Vermeer était en effet tombé dans l’oubli après sa mort. Ce n’est qu’au XIXe qu’on a de nouveau prêté attention à son œuvre, quantitativement limitée mais une des plus remarquables de l’histoire de la peinture. Foudroyé par une crise cardiaque à l’âge de quarante-trois ans, Vermeer, qui était de surcroît un peintre travaillant lentement, a relativement peu produit. On ne possède de lui que trente-cinq tableaux authentifiés sur le total de quarante-cinq qu’il a vraisemblablement réalisés. À quelques exceptions près, ce sont des scènes d’intérieur et des portraits. De La jeune fille à la perle à L’Art de la peinture en passant par La Laitière, presque tous sont des chefs-d’œuvre familiers de tous, et universellement appréciés.
Le monde réel derrière les apparences
Si différents qu’aient été à première vue les usages que faisaient Leeuwenhoek et Vermeer des lentilles, et si distinctes les finalités en vue desquelles ils y recouraient, au bout du compte, affirme Laura Snyder, leur démarche participait d’une même logique et attestait un même esprit. Pour l’un comme pour l’autre, il s’agissait de compléter les organes naturels de la vision par des sortes d’yeux artificiels permettant de voir le monde réel derrière les apparences. Dans un cas, c’était le monde microscopique, invisible en raison de sa taille ; dans l’autre, le monde tel que nous devrions le voir et le percevoir si nous témoignions plus d’attention à ce que nous apercevons et que notre cerveau n’interprétait pas constamment ce que nous voyons : « Leeuwenhoek et Vermeer utilisaient tous les deux des dispositifs optiques pour voir ce qui n’avait pas été vu avant eux. Leeuwenhoek a vu pour la première fois des créatures microscopiques. Il a aussi vu des composants des animaux et des plantes qui n’avaient jamais été vus : les corpuscules sanguins, les spores des moisissures, les composants du sperme. […] Vermeer, lui aussi, a vu ce qui n’avait pas été vu, ou, mieux, ce qui n’avait pas été remarqué - la façon dont les couleurs changent en fonction de l’éclairage, même si nos yeux les voient inchangées [le fait que] les ombres peuvent être brunes, vertes, jaunes ou bleues. La camera obscura a aidé Vermeer à prêter attention à des caractéristiques optiques qui n’étaient pas habituellement notées ».
Cette volonté d’appréhender le monde en le regardant objectivement avec une extrême attention, relève-t-elle, est intimement associée au changement intellectuel lié l’essor du rationalisme scientifique et de la technique. Ceci n’est guère douteux, mais il faut bien comprendre qu’on a ici affaire à une influence à double sens, impliquant un jeu de rétroactions positives. Laura Snyder met surtout l’accent sur l’impact du développement technique sur les représentations et les conceptions du monde, avec raison : trop souvent, les effets directs ou induits de la technique sur l’univers des idées, des représentations sociales et des valeurs sont minimisés et sous-estimés. Mais il ne faut pas oublier l’existence d’une influence de sens opposé. La mise au point de dispositifs optiques performants a permis et encouragé l’essor de la vision du monde qui s’est matérialisée dans la révolution scientifique. À lire les analyses de Laure Snyder, on réalise toutefois que l’invention, le perfectionnement et la diffusion de ces dispositifs sont réciproquement, en partie en tout cas, le produit de la généralisation de cette nouvelle vision, une vision que leur développement a certainement facilité, mais dont l’apparition et le succès ont aussi d’autres causes de nature sociale et culturelle.
L’éblouissement de Pierre le Grand
L’analyse de la façon dont Vermeer et Leeuwenhoek ont contribué à forger et façonner un autre regard sur la réalité constitue le fil conducteur de Eye of the Beholder. Mais elle est loin d’épuiser le contenu de l’ouvrage, qui est d’une extraordinaire richesse et dans lequel on trouve bien d’autres choses : une description détaillée et évocatrice de la vie matérielle, sociale, religieuse et culturelle dans la Hollande de l’âge d’or ; la relation d’épisodes historiques spectaculaires, comme la dévastation d’une partie importante de la ville suite à une explosion accidentelle dans un dépôt de munition (preuve de la vitesse à laquelle les bâtiments détruits ont été reconstruits, dans la célèbre Vue de Delft qui enchantait tant Marcel Proust, peinte par Vermeer six ans après la catastrophe, la ville apparaît à nouveau dans tout l’éclat de son opulence et de sa beauté) ; des anecdotes, comme celle de la rencontre de Leeuwenhoek et du tsar Pierre le Grand en visite dans les Provinces-Unies, dont on retiendra l’éblouissement du monarque russe au spectacle de tout ce qu’il était possible d’apercevoir grâce au microscope du savant ; des portraits comme celui de Constantin Huyghens, diplomate et poète, père du physicien Christian Huyghens et une figure-clé de cette histoire, puisqu’il était un ami de Leeuwenhoek, connaissait très vraisemblablement Vermeer, s’intéressait de près à la science était très actif sur le marché de l’art ; et des observations fines, judicieuses et frappantes sur la société du temps, comme cette réflexion au sujet des réactions du peintre et du savant lors de la mort de leurs enfants respectifs (ils en perdirent tous les deux quatre, sur un total de onze pour Vermeer et de cinq pour Leeuwenhoek) : « C’est presque un lieu commun d’affirmer qu’à cette époque les parents étaient si habitués à perdre des enfants qu’ils considéraient leur mort avec insensibilité ou un stoïcisme résigné […] Il s’agit là d’une de ces soi-disant évidences historiques qui s’avèrent en réalité non-fondées. Les parents, les pères comme les mères, pleuraient leurs enfants décédés comme ils le font aujourd’hui. Ils exprimaient leur chagrin en privé dans des lettres, mais aussi publiquement. […] La peur de perdre un enfant était réelle, suspendue au-dessus de la tête des parents tout au long de la période d’éducation ».
Même si son principal intérêt réside ailleurs, Laura Snyder ne peut éviter de prendre position au sujet de la question des éventuels rapports personnels de Vermeer et Leeuwenhoek. Sans s’aventurer à soutenir qu’ils se sont effectivement connus, consciente qu’il n’existe aucun élément de preuve incontestable à l’appui de cette hypothèse, elle tend pourtant à considérer cette possibilité comme assez probable. Un des arguments qu’elle avance en ce sens, systématiquement brandi par ceux qui défendent la thèse que les deux hommes se connaissaient, est le fait que Leeuwenhoek, à la mort de Vermeer, ait assuré la liquidation de sa succession. À côté de ses activités commerciales, Leeuwenhoek était toutefois un fonctionnaire public. Aux yeux des historiens qui contestent l’existence d’un lien personnel entre les deux hommes, c’est simplement à ce titre que cette responsabilité lui a été confiée. Quatre fois seulement dans sa vie, fait cependant valoir Laura Snyder, Leeuwenhoek a été amené à exercer cette charge. Et dans les trois autres affaires, il connaissait le défunt ou avait un lien personnel avec le bien concerné. On peut donc raisonnablement penser que c’était également le cas ici.
Une célébration de la science
Un certain nombre d’historiens de l’art ont été plus loin et défendu l’idée que Leeuwenhoek était le modèle ayant posé pour les deux célèbres tableaux de Vermeer Le Géographe et L’Astronome. Laura Snyder considère cette thèse avec un certain scepticisme. Nous possédons de Leeuwenhoek un portrait, par Johannes Verkolje, que Constantin Huyghens jugeait « très ressemblant ». C’est celui d’un homme assez âgé, au visage plus lourd que celui du personnage des toiles de Vermeer, « pas complètement différent », certes, mais sans que la ressemblance soit pour autant vraiment frappante. On a par ailleurs fait remarquer que Le Géographe, qui représente un homme penché sur une carte un compas à la main, avait été peint l’année même où Leeuwenhoek, qui s’intéressait aussi à l’astronomie et à la navigation, avait accédé au titre d’arpenteur officiel de la ville de Delft. Il n’est pas impossible, concède Laura Snyder, que Leeuwenhoek ait passé commande de ces deux tableaux pour marquer sa nouvelle position d’arpenteur de Delft. Mais il n’y a absolument aucune preuve de cela et il est plus raisonnable de voir dans ces deux toiles le simple reflet de l’intérêt, quasiment de l’obsession, pour la science qui existait à Delft et dans les Provinces-Unies à cette époque : « non une célébration du nouveau statut de Leeuwenhoek, ni même un portrait de lui, mais une représentation du type de personne qu’il était [et] une célébration de la science, en particulier des sciences dans lesquelles la connaissance s’acquiert par l’expérience visuelle ».
Face à une question qui excite inévitablement l’imagination, Laura Snyder, on le voit, ne se départit pas de sa déontologie et de ses réflexes d’historienne, distinguant avec soin entre faits établis, possibilités plus ou moins plausibles et pures conjectures. C’est avec la même circonspection et le même sens critique qu’elle évoque dans un autre passage une possible interaction entre Leeuwenhoek et le philosophe Baruch Spinoza, qui utilisait comme lui un tour pour polir les lentilles. Son récit n’en est pas moins passionnant. On peut imaginer ce que le thème de son livre aurait donné aux mains d’un de ces nombreux romanciers contemporains qui, dans le souci de renforcer la crédibilité et l’attrait des histoires qu’ils racontent, font le choix de baser explicitement et ostensiblement celles-ci sur des faits réels, en mettant en scène des personnes ayant effectivement existé : Leeuwenhoek et Vermeer se seraient rencontrés, ils auraient tenu des propos conformes aux conversations « qu’ils auraient pu avoir », animés de pensées « qui auraient pu être les leurs ». Peut-être même auraient-ils entrepris des projets en commun. La correction historique y aurait perdu beaucoup, sans que l’intérêt de l’histoire y gagne en rien. Un ouvrage comme Eye of the Beholder en témoigne en effet avec éclat : quand, dans le plein respect des faits, sans rien sacrifier de ce qui confère à l’histoire le caractère d’un savoir rigoureux, critique et organisé, ils sont rédigés avec le talent littéraire de Laura Snyder, dans une langue élégante comme la sienne, les livres d’histoire peuvent s’avérer aussi captivants que beaucoup de romans, et leur lecture est aussi prenante que celle de la littérature de fiction.
Michel André