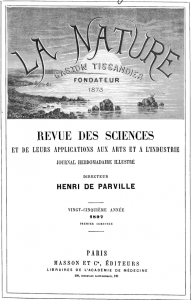Et le rugby apprivoisa la France
Publié le 21 septembre 2015. Par La rédaction de Books.

Frédéric Humbert
En 1897, le rugby (dont la Coupe du monde se déroule jusqu’au 31 octobre) s’appelle encore « foot-ball ». La discipline n’a pas un siècle d’existence, mais le baron Pierre de Coubertin en personne salue la manière dont elle s’est s’imposée dans l’Hexagone. Contre toute attente. Ce sport où « le muscle sert d’écran à l’intelligence » a su vaincre les préjugés, la complexité de ses règles et le manque de terrains. Surtout, il a réussi à faire taire les réticences des mères françaises affolées par sa réputation de brutalité, elles qui craignent « les rhumes et les engelures ».
Il y a dans les mœurs, comme dans l’histoire, des conquêtes imprévues. La marche triomphale du football à travers les habitudes jusqu’alors si sédentaires de notre jeunesse française en est un nouvel exemple. Le foot-ball avait tout contre lui. Son premier défaut était d’être anglais. On nous répète à chaque instant que nous sommes des anglomanes renforcés. Cela n’est pas ; car à part le petit groupe de gommeux parisiens qui affectent de ne porter que du linge blanchi à Londres, il suffit qu’une mode arrive d’outre-Manche, pour qu’elle éveille aussitôt des susceptibilités « patriotiques » dans la presse et dans l’opinion. De plus, le foot-ball faisait son entrée chez nous précédé d’une réputation nettement établie de brutalité : les mères françaises qui craignent les rhumes et les engelures ne pouvaient dès lors lui faire un accueil sympathique. Enfin, c’est un jeu collectif : il exige la formation de deux équipes de onze ou quinze joueurs chacune. Pour se déployer à l’aise, ces équipes ont besoin d’un vaste espace de terrain plat et gazonné. Autant de motifs pour que les maîtres ne fussent pas favorables à une innovation qui allait forcément compliquer la discipline et accroître le poids de leurs responsabilités.
Mais il faut signaler un dernier désavantage auquel nul de ceux qui ont popularisé le foot-ball en France n’avait songé, et dont, pour ma part, j’ai été long à me rendre compte. Il est impossible au spectateur qui n’est pas « au courant » de comprendre quelque chose à ce qui se passe sous ses yeux. Il voit une mêlée, des bras et des jambes enchevêtrés, des poitrines qui se heurtent, des mains qui se crispent, toute une série d’efforts auxquels il s’intéressera s’il est peintre ou sculpteur, qui lui feront horreur s’il est pédagogue ou s’il a simplement l’âme sensible. Comment, en face de ce travail intense des muscles, la pensée lui viendrait-elle que des forces intellectuelles et morales sont, au même moment, mises à contribution et que rien ne sommeille dans l’être qui se débat là devant lui ? Si Paul Bourget, pourtant si bien fait pour comprendre cela, n’a pas su l’apercevoir, qui donc le pourrait ? La description qu’il donne, dans Outre-Mer, d’un match de foot-ball, est une trompeuse photographie : tout ce qui s’y trouve reproduit est exact et réel ; mais elle ne reproduit pas tout. C’est donc que la partie cérébrale du jeu ― de beaucoup la plus importante ― demeure invisible ; c’est donc que le muscle y sert d’écran à l’intelligence.
On maudissait le foot-ball avant de le connaître. La malédiction fut bien plus énergique quand on le connut. Les journalistes, horrifiés, en firent de terribles descriptions, propres à donner la chair de poule aux parents les moins craintifs ; des listes de tués et de blessés, importées d’Angleterre, circulèrent comme pièces à l’appui ; certains proviseurs prirent sur eux de l’interdire aux lycéens. Rien n’y fit : la marée monta avec une parfaite régularité. Les jeunes gens mirent, à vaincre tous les obstacles, une persévérance dont nul ne les aurait crus capables. Les prairies manquaient ; ils jouèrent sur la terre battue, dans le sable, au risque de se rompre les os ; ils auraient, pour un peu, joué sur des tas de cailloux. Je me rappelle des parties épiques au Bois de Boulogne sur la pelouse de Saint-Cloud. L’endroit était fort dangereux ; un arbre était planté tout au milieu ; les joueurs pouvaient à tout instant être précipités sur cet arbre et s’y frapper durement aux tempes. C’était un chêne rabougri et très laid. J’ai bien fait dix démarches pour obtenir qu’on l’enlevât ; mais on sait ce qu’il en coûte pour toucher à un arbre du Bois de Boulogne ! Et l’état civil de ce personnage était si compliqué que je ne réussis jamais à trouver à l’Hôtel de Ville le supérieur hiérarchique qui avait droit de décider de sa vie en dernier ressort ! Deux beaux terrains furent aménagés au Champ-de-Mars, de chaque côté de la Galerie de trente mètres, lorsque les bâtiments de l’Exposition de 1889 eurent eté démolis : M. Alphand nous les avait destinés, mais ils furent réclamés pour les pupilles du Conseil municipal ; les petits bambins des écoles primaires, vêtus de jerseys rayés qu’ils s’obstinaient à porter pardessus leurs chemises et coiffés de « polos » à la dernière mode, s’en vinrent gravement, pendant deux saisons, occuper ces pelouses et y prendre leurs puérils ébats pendant que les lycéens, arrivés à l’âge où les jeux athlétiques sont si nécessaires à l’épanouissement viril, se voyaient relégués dans des préaux trop étroits et exposés à des accidents graves.
En province, la question des terrains n’était pas si difficile à résoudre. Avec de l’ingéniosité et de la persévérance, on trouva des champs inoccupés que les propriétaires consentirent à prêter ou à louer à bas prix ; ou bien l’autorité militaire, la société des courses, la compagnie du chemin de fer concédèrent aux lycéens et aux sociétés athlétiques l’usage des terrains dont elles pouvaient disposer. Mais un autre inconvénient se présenta : l’absence d’émulation. L’émulation est l’essence du foot-ball. Il n’y a pas d’intérêt à y jouer entre camarades qui se connaissent trop bien, qui vivent ensemble depuis longtemps ; à Paris, il y a dix lycées : chaque ville de province n’en a qu’un… On voit, par ce rapide exposé, toutes les chances qu’avait le foot-ball d’expirer, faute de foot-ballers. Or, depuis dix ans, le mouvement athlétique a subi bien des vicissitudes, bien des arrêts ; il y a eu parfois des enthousiasmes exagérés, plus souvent encore des découragements injustifiés. L’aviron n’a pas prospéré comme on s’y attendait : ce sport si parfait au point de vue du travail musculaire, si captivant par « l’ivresse de nature » qu’il procure à ses adeptes, n’a encore séduit qu’une portion relativement infime de notre jeunesse. Quant au jeu de longue-paume, si intéressant et qui a l’avantage supérieur d’être pour la France un exercice traditionnel, un exercice vraiment national, nous avons en vain travaillé à lui rendre son ancienne popularité. Impossible de faire prendre la boxe, même la boxe « française », qui est un art tout parisien… A de certains moment les courses à pied ont fléchi ; les maîtres de manège, les professeurs d’escrime et de gymnastique se plaignent sans cesse de la concurrence que leur fait la bicyclette : leur clientèle diminue… Un seul sport n’a connu ni arrêts ni reculs : le foot-ball. A quoi cela peut-il tenir ― du moment que les circonstances lui ont toujours été adverses ―, sinon à la valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux émotions qu’il procure, à l’intérêt qu’il présente ?
Si les règlements du foot-ball sont assez complexes, on peut toutefois les ramener à quatre ou cinq règles fondamentales qui sont simples. Que cherche le joueur ? Il vise à s’emparer du ballon, à l’amener près de la ligne de but de l’adversaire et à lui faire toucher terre derrière cette ligne et le plus près possible du but que marquent deux grands piquets réunis à mi-hauteur par une barre transversale. S’il y parvient, il marque un essai, lequel se chiffre par un certain nombre de points pour son camp : le ballon est alors placé sur une ligne perpendiculaire à la ligne de but et partant de l’endroit où l’essai a été fait ; on pose le ballon à terre sur un point quelconque de cette ligne et d’un coup de pied savamment donné, un joueur s’efforce de le faire passer entre les deux piquets, et au-dessus de la barre transversale ; l’essai est alors « transformé en but » et de nouveaux points sont comptés : c’est leur total qui tout à l’heure établira la victoire. Le football, en effet, se joue, à la différence de la plupart des jeux, en quatre-vingts minutes ; la partie se divise en deux portions de quarante minutes chacune : pendant l’entracte qui les sépare, les camps changent de côté. A la fin de la partie on additionne les points ; plus les équipes sont fortes, moins élevés seront les totaux : si rien n’a été marqué d’aucun côté, le match est nul.
Tel est le canevas, en apparence très rudimentaire, que viennent compliquer quelques règles additionnelles extrêmement géniales. La manière la plus avantageuse de s’approcher de la ligne du but de l’adversaire, c’est incontestablement d’y porter le ballon en courant et en évitant de se faire « arrêter ». On a le droit, en effet, d’arrêter l’homme qui court avec le ballon, en se saisissant de lui, sauf par le cou ou par les jambes, ce qui pourrait être dangereux. On l’arrête par le milieu du corps. Se voyant sur le point d’être arrêté, que va chercher le joueur ? A se dessaisir du ballon et à le « passer » à un partenaire. Or, il ne peut pas le passer en avant. Il ne peut le jeter à un partenaire que sur la même ligne ou en arrière. Voilà une combinaison qui rappelle certains jeux de dames : pour gagner du terrain, le ballon commence donc par reculer. Mais, d’autre part, le joueur lui-même est hors jeu s’il se trouve en avant du ballon à un moment où ses partenaires se le passent ; il n’est plus qualifié pour le prendre jusqu’à ce qu’il soit de nouveau à sa place, en arrière du ballon… Quelque peine qu’on se donne pour expliquer ceci, il doit forcément en résulter de la confusion dans l’esprit du lecteur. Ce qui peut au contraire lui devenir aisément intelligible, c’est l’ensemble de qualités physiques et morales nécessaires à un bon joueur de foot-ball pour se tirer d’une situation aussi compliquée. Il lui faut de la force sans doute et du poids pour arrêter ses adversaires et résister à leurs arrêts. Mais la souplesse, l’élasticité lui sont bien plus nécessaires encore. Il doit être bon coureur et pouvoir au milieu de sa course en modifier brusquement l’allure ou la direction, se jeter à droite ou à gauche, se couler entre deux ennemis ou bien fondre sur eux pour les dérouter au moment où il vient habilement de se débarrasser du ballon au profit d’un partenaire : autant de décisions à prendre qui exigent du coup d’œil et du sang-froid, de l’abnégation même, car il faut souvent renoncer a accomplir une prouesse individuelle dans l’intérêt de l’équipe, se dessaisir du ballon au moment de tenter soi-même un essai, parce qu’un autre est mieux à même d’y réussir. Enfin, il y a l’esprit de discipline qui s’impose. Chaque équipe ne saurait voir l’ensemble de la bataille, c’est l’affaire du capitaine, qui dirige ses hommes en conséquence, qui sait le fort et le faible de chacun, qui doit prévoir les mouvements et réparer les erreurs. C’est l’opinion des Anglais, qu’un homme inintelligent ou simplement lent dans sa compréhension ne deviendra jamais un bon foot-baller. C’est aussi l’opinion de beaucoup d’officiers distingués de l’armée britannique, qu’il y a dans un capitaine de foot-ball sachant son métier l’étoffe d’un véritable stratège. De pareilles louanges, fréquemment décernées, en disent long sur le mérite du jeu. Mais voici qu’une preuve originale et bien imprévue du caractère véritablement scientifique du foot-ball nous vient d’Amérique.
Un avocat de Boston, nommé Deland, et qui n’avait dans sa jeunesse ni pratiqué, ni même vu pratiquer sous ses yeux le foot-ball ― l’athlétisme n’est pas ancien aux États-Unis : c’est à l’issue de la guerre de Sécession qu’il s’est développé ― assista un jour à un match universitaire. Il en sortit très captivé et voulut s’initier aux règles du jeu ; il les étudia donc consciencieusement et, de plus en plus enthousiaste, suivit assidûment tous les matches de la saison ; cela se passait il y a quelques années seulement. Tout à coup une révélation se fit dans l’esprit de M. Deland ; il se procura l’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers, et se mit à piocher les campagnes de Napoléon. M. Deland cherchait s’il n’y aurait pas dans la tactique impériale quelques préceptes applicables au foot-ball ; ceci suffit à montrer qu’il avait saisi la caractéristique du jeu. Or, Napoléon excellait à détacher soudainement des masses d’hommes pour les jeter à l’improviste là où l’ennemi s’attendait le moins à les rencontrer. Le capitaine de football peut en faire autant s’il a un moyen de transmettre rapidement et mystérieusement à ses hommes des ordres précis. Ce moyen est simple : il leur parlera en langage chiffré. Quand M. Deland publia les résultats de ses méditations, le monde du foot-ball en fut révolutionné ; on discuta passionnément la réforme proposée et en peu de temps elle fut appliquée par les principales équipes universitaires. En 1890, j’ai suivi l’entraînement de l’équipe de Princeton. Les joueurs, enfermés dans un grand bâtiment, sorte de manège énorme, s’y exerçaient à comprendre et à traduire aussitôt en mouvements les chiffres cabalistiques que leur lançait à l’improviste le capitaine ; le secret de ce langage était, bien entendu, jalousement gardé ; ensuite, ils allaient sur le champ de jeu suivre leur entraînement habituel. Il s’agissait du match annuel qui, au mois de novembre, met aux prises à New York les deux universités de Yale et de Princeton. Le grand jour arriva ; il y eut plus de quarante mille spectateurs et l’enthousiasme fut indescriptible. A tout instant, les nombres appelés d’une voix sonore provoquaient des mouvements d’un ensemble parfait et d’une opportunité géniale ; la rapidité avec laquelle ils s’accomplissaient était foudroyante. Si intéressé que je fusse au spectacle que j’avais sous les yeux, il me parut que la tactique Deland était doublement défectueuse. En lançant brusquement plusieurs hommes sur un seul, elle accroissait beaucoup les chances d’accidents ; il n’y en eut pas ce jour-là, mais le danger couru n’en apparaissait pas moins clairement. En second lieu, le rôle de chaque équipier était diminué de tout ce que gagnait le rôle du capitaine ; sur lui reposait la plus grande part de responsabilité. Son initiative devenait trop puissante : les autres étaient réduits à une obéissance trop absolue. Ce qui est admirable dans le foot-ball, c’est le perpétuel mélange d’individualisme et de discipline, la nécessité pour chaque homme de raisonner, de calculer, de se décider pour lui-même et en même temps de subordonner ses raisonnements, ses calculs, ses décisions à ceux du capitaine. Il n’est pas jusqu’au sifflet de l’arbitre l’arrêtant pour une « faute » qu’un camarade a commise et qu’il n’a pas même aperçue, qui n’exerce sa patience et sa force de caractère. Ainsi compris, le foot-ball est, par excellence, l’image de la vie, une leçon de choses vécue, un instrument pédagogique de premier ordre.
Aux Etats-Unis même, on n’a pas tardé à se rendre compte des inconvénients de la méthode Deland et on l’a quelque peu délaissée. Si je l’ai rappelée ici, c’est que rien ne prouve mieux à quel point le foot-ball est un jeu scientifique : le seul fait d’avoir pu lui faire subir une pareille transformation en lui appliquant les principes de la stratégie militaire, établit péremptoirement son caractère « intellectuel ». En tout ceci, je n’ai parlé que du jeu dit de Rugby : le foot-ball se joue aussi sous d’autres règles appelées règles d’Association. L’Association est un sport très élégant, plein de finesse, mais qui ne saurait être comparé au Rugby. Il est interdit de toucher le ballon avec les mains, de le porter… C’est en somme un « ballon au pied » habilement réglementé, mais ne comportant pas les combinaisons et les péripéties du Rugby. Et maintenant ce Rugby, qui porte le nom du célèbre collège d’Angleterre d’où partit, voici cinquante ans, la grandiose réforme pédagogique de Thomas Arnold, ce Rugby n’est-il, comme on l’a prétendu, qu’un dérivé de la soule ? La soule était jadis en grand honneur parmi les paysans de Normandie, et les descriptions qui sont parvenues jusqu’à nous donnent l’impression d’un furieux plaisir auquel prenaient part, d’enthousiasme, des villages entiers. Mais je dois dire que je n’ai aperçu nulle part la trace de ce qui rend les combinaisons du moderne foot-ball si variées et si captivantes, je veux dire une réglementation scientifique.
Si les Français savaient le rôle de l’intelligence et de la volonté, la part de l’esprit et du caractère dans la plupart des sports, ― et dans celui-ci en particulier, ― avec quel entrain ils y pousseraient leurs enfants ! Mais le Français est un grand sceptique : saint Thomas est son patron. Il faut qu’il touche du doigt… On ne peut pourtant pas rendre le foot-ball obligatoire pour tous les hommes valides à partir de 30 ans, afin de leur en faire mieux apprécier les bienfaits ! Alors, il faut attendre que les joueurs d’aujourd’hui deviennent pères à leur tour ! C’est long, mais sûr.