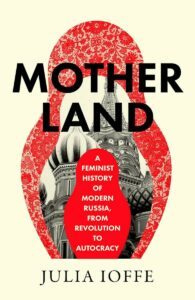L’acte de décès du féminisme russe
Publié en novembre 2025. Par Books.
Pour les femmes russes, 1917 a été l’année de la révolution dans la révolution. Les bolcheviques n’étaient en effet pas féministes à la façon classique : ils considéraient que le genre humain était un, qu’il n’y avait ni de différence ni a fortiori de lutte entre les sexes, juste une lutte des classes. Et les ouvrières – presque aussi nombreuses que les hommes dans les usines mais pas du tout payées comme eux – avaient joué par leur grèves et manifestations un rôle majeur dans la chute du régime tsariste. Lénine, qu’une femme, Fanny Kaplan, avait pourtant presque réussi à assassiner, avait promu l’égalité intersexes et donné de larges responsabilités à certaines de ses proches (parfois très proches comme Nadejda Kroupskaïa ou Inessa Armand). Il avait surtout nommé dans son gouvernement la fameuse Alexandra Kollontaï, première femme ministre de l’Histoire, afin qu’elle mette en œuvre toute une série d’initiatives foncièrement novatrices, depuis la libéralisation du divorce et l’équilibre des droits dans le mariage jusqu’aux congés de maternité – mais sans toutefois jusqu’à la laisser promouvoir l’amour libre dont elle était une grande adepte. Une première génération de femmes bolchéviques s’était alors engouffrée dans la brèche tout juste ouverte, avides d’acquérir des diplômes et de contribuer à l’édification de la société nouvelle. L’historienne Julia Ioffe, qui a passé son enfance en URSS avant que sa famille n’émigre aux États-Unis, évoque quelques-unes de ces pionnières. Trois de ses ancêtres directes étaient du lot, des femmes juives – donc confrontées à un double défi – qui avaient pu toutefois prendre pied dans la science et surtout la médecine (en 1960, 70 % des docteurs soviétiques seront des doctoresses). Les années de guerre mondiale allaient encore conforter le statut des femmes soviétiques, autorisées – ou forcées – à investir tous les territoires masculins, même l’armée. Leurs prouesses comme pilotes ou snipeuses auraient dû faire tomber les dernières préventions, mais hélas il y avait maldonne.
« Même si les femmes avaient reçu des bolcheviques des droits spectaculaires, ce fut pour les voir reculer pendant le reste du siècle, dans la loi mais surtout dans les faits », écrit Charlotte Hobson dans The Spectator. Les mâles soviétiques demeuraient en effet conservateurs dans l’âme, à commencer par le premier d’entre eux, Staline. L’arsenal législatif pro-femmes n’avait pourtant guère été modifié, ni la place des femmes au travail, car l’URSS dévastée d’après-guerre avait besoin des forces féminines dans les usines, les tribunaux, les laboratoires pour remplacer les hommes disparus. Mais le soir à la maison tout le monde reprenait son rôle traditionnel : les maris buvaient et les épouses trimaient avant d’aller au lit corriger le déficit démographique causé par les batailles, les famines et les purges. Or lorsque Julia Ioffe retourne dans son pays natal en 2009 pour y étudier la condition féminine, elle est abasourdie. « Au pays de Poutine, le féminisme est considéré comme quelque chose d’occidental et de vaguement risible, en tout cas de fondamentalement non russe. » Terrible choc pour cette Américaine pur jus et passablement woke : elle qui croyait « être le produit de la plus grande expérience féministe sur terre en tant que descendante de Soviétiques chercheuses, doctoresses, ingénieures – des femmes qui avaient gardé leur nom de jeune fille », elle découvre des jeunes poupées moscovites essentiellement préoccupées, lui semble-t-il, d’attraper un mari financièrement prometteur. Tandis que fleurissent à Moscou les « instituts » où l’on enseigne « l’art du flirt » voire « l’art de la fellation (la “flûte enchantée”) », Poutine uniquement soucieux de son projet ukrainien décriminalise de son côté les violences conjugales (qui affectent 70 % des femmes !) et envoie au goulag les jeunes féministes du groupe Pussy Riot. La société depuis régresse sur beaucoup de fronts tandis que le patriotisme escamote le reste. Épouses et mères, quant à elles, sont censées consentir docilement à l’envoi au front en quantité croissante de chair à canon masculine, grasses compensations financières à l’appui, spécialement en cas de deuil. Mais, comme dans la Grèce antique, il leur est déconseillé d’exprimer trop vigoureusement leur chagrin.