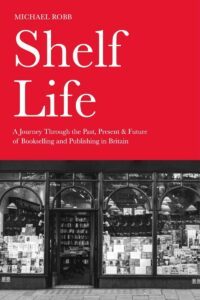Vers une civilisation sans livres ?
Publié en octobre 2025. Par Books.
La fin d’une librairie ou la fin d’un monde ? Amoureux des livres, le père et le fils Robb ouvrent en 1984 un petit commerce de livres à Chelmsford, une ville au nord-est de Londres. Pendant seize ans, « ça a été sans conteste le meilleur job de ma vie – mais aussi le plus dur », raconte Michael, le fils. En 2000, hélas, il doit baisser le rideau. Puis, de ses ruminations sur les causes lointaines et proches de son malheur, il fait un livre. Il incrimine d’abord la concurrence des grandes chaînes comme Waterstones, avec leur offre immense, leurs prix compétitifs et leurs évènements à jet continu – toutes choses auxquelles les inconstants lecteurs cèdent sans trop d’états d’âme. Et voici qu’en 1995 débarque Amazon qui non content de conquérir 50 % du marché américain du livre-papier lance aussi l’e-book Kindle, dont l’objectif revendiqué par Jeff Bezos est de « tuer le job de tous les vendeurs de livres physiques ». Puis c’est l’efflorescence dans le monde anglo-saxon des livres digitaux, ou/et auto-publiés, ou des livres audio (digitaux eux aussi). « L’histoire du business du livre est celle d’une disruption continuelle », philosophe Michael Robb, résigné.
Mais le coupable N° 1 est autre. C’est l’iPhone, qui après l’avènement d’Internet, provoque un désintérêt croissant pour la lecture de livres. James Marriott, journaliste du Times spécialiste des nouvelles technologies, dissèque dans sa newsletter Cultural Capital (sur Substack) les marqueurs, les causes, mais surtout les tristes conséquences de ce qu’il appelle « la plus grande transformation sociale à s’être jamais produite si discrètement ». Résumons : après une formidable expansion de la lecture « extensive » commencée en Europe au XVIIIe siècle (beaucoup plus de livres, mais lus moins « intensivement » qu’auparavant), voici qu’en Amérique au cours des 20 dernières années « la lecture de livres “de plaisir” a chuté de 40 % » ; et qu’en Angleterre, un adulte anglais sur trois déclare carrément l’avoir abandonnée. Du coup, un peu partout dans les deux dernières décennies, les ventes moyennes de livres qui se chiffraient par dizaines ou centaines de milliers sont tombées à 5 000 – pour les plus chanceux. Curieusement, la parade face à cette baisse a été d’augmenter le nombre de publications, notamment en France (cf. le fameux apophtegme de Jérôme Lindon : « L’édition est le seul secteur de l’économie qui répond à une baisse de la demande par une hausse de l’offre »). Aujourd’hui en France, 80 000 à 100 000 nouvelles publications, tous genres confondus, arrivent chaque année sur nos rayons, dont environ 500 romans pour la seule « rentrée littéraire » post-estivale. Mais la « politique de l’offre » chère à Emmanuel Macron dans le domaine économique ne semble pas, dans le domaine littéraire, pouvoir contrer le déclin de l’achat et donc de la lecture de livres. Cela aurait même un effet dissuasif, que le grincheux Kohélet avait déjà identifié au IIIe siècle de notre ère lorsqu’il mettait en garde dans l’Ecclésiaste contre la tentation « de faire trop de livres ».
James Marriott considère cette dégringolade comme « une véritable tragédie intellectuelle ». Alors que, dit-il, « la révolution de la lecture a induit le plus grand transfert de technologie de l’Histoire, la présente révolution des écrans constitue quant à elle le plus grand vol de savoir jamais opéré ». La généralisation à partir de 2010 du smartphone « qui accapare massivement notre vie – à raison de neuf heures par jour pour la génération Z » – a déclenché un mesurable déclin de l’effet Flynn, la progression jusque-là régulière du QI. Partout sur la planète, les performances universitaires régressent (tests PISA). Les étudiants auraient même tendance à devenir « fonctionnellement analphabètes », voire à retourner à un mode de pensée « orale », alors qu’« on ne peut atteindre certains degrés de réflexion complexe et logique sans la lecture et l’écriture », écrivait le jésuite-historien canadien Walter Ong. En effet, précise un autre théoricien des médias, Neil Postman, « se confronter à l’écrit nous contraint à suivre une ligne de pensée – un effort qui requiert d’énormes capacités de classification, de déduction, de raisonnement ». Sans surprise, James Marriott en profite pour rappeler que la lecture si mal-en-point entraîne pourtant nombre de bénéfices bien connus tels que l’amélioration de la mémoire et de la concentration, de la réflexion analytique, des capacités verbales, et une réduction de la chute des capacités cognitives sur le tard de la vie. Il serait donc tragique que le livre, socle de notre civilisation actuelle, dise son dernier mot. Nous devrions alors changer de civilisation.