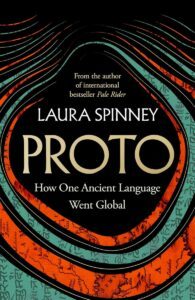Parlez-vous proto ?
Publié en mai 2025. Par Books.
Fut un temps où l’on pouvait (en théorie) traverser toute l’Europe et même une partie de l’Asie en n’utilisant qu’une seule langue. Pas l’anglais d’aujourd’hui, ni le latin d’il y a presque deux millénaires, mais un troisième larron beaucoup plus ancien, le proto-indo-européen, alias PIE. Au néolithique, on estime que la (petite) population humaine parlait au moins 15 000 langues (on en compte 7 000 aujourd’hui, mais cinq parlées par plus de la moitié des gens, et 40 % du reste des idiomes en voie de disparition accélérée). Cette prolifération linguistique s’expliquait par l’isolation des groupements humains – c’est encore vrai aujourd’hui dans les archipels, où l’on trouve fréquemment une langue (mourante) par île, ou dans le Caucase, « cette montagne des langues ».
Mais voici qu’à l’ère suivante, celle du bronze (- 3 000 avant notre ère), les humains se sont mis à circuler et à échanger des biens et des techniques, et leurs langues se sont fédérées pour produire un instrument de communication plus ou moins universel, le fameux PIE. Avec l’intensification des échanges et l’augmentation de la population, celui-ci s’est à son tour tant diversifié qu’on compte aujourd’hui quelque 400 langues issues de ce tronc commun. « L’indo-européen est de loin la plus grande famille de langues de l’humanité tout entière. Une personne sur deux, depuis l’Écosse jusqu’à la Chine, parle une langue indo-européenne », écrit Laura Spinney, l’autrice de cet énorme ouvrage qui se lit comme un polar. Car comment savoir quoi que ce soit d’un langage non écrit vieux de plusieurs millénaires ? Or si aucune science n’apporte à elle seule de réponse définitive, en triangulant les infos émanant de trois d’entre elles – la linguistique, l’archéologie et surtout la génétique –, on peut (« avec une bonne dose d’humilité » ajoute Laura Spinney ) élaborer et sélectionner des hypothèses approchant la vérité au plus près, comme les enquêteurs modernes tentant d’expliquer un crime.
Résumons. La linguistique sait depuis la fin du XVIIIe siècle, grâce à un juge britannique en poste à Calcutta, William Jones, que les langues évoluent à la fois verticalement, avec le temps, et horizontalement, par contact les unes avec les autres (auparavant, on soutenait très bibliquement que toutes étaient nées en même temps, à Babel, avec une source commune ancestrale présumée, l’hébreu). Puis les frères Grimm et d’autres linguistes ont peu à peu édifié un corpus de règles phonétiques et grammaticales permettant de remonter, avec un peu d’imagination et sachant que le larynx humain est limité dans le nombre de sons qu’il peut produire, jusqu’à un plus petit dénominateur commun linguistique entre langues directement voire indirectement apparentées (si l’on sait que le Q latin se transmue en F anglais, on peut réconcilier pater avec father, et remonter la trace…).
On a ainsi identifié 1 000 à 2 000 mots PIE, parfois de façon presqu’irrécusable : les convergences patentes dans l’expression du chiffre trois – Trayas en sanskrit, Treis en grec, Teres en hittite, Trys en lithuanien, etc. – conduisent les linguistes à faire de *Tri l’indiscutable ancêtre PIE (l’astérisque * caractérise ces mots reconstitués). Il est même arrivé (très rarement !) que certaines hypothèses soient factuellement validées – par exemple celle du linguiste suisse Ferdinand de Saussure qui, pour expliquer certains passages entre mots, postulait l’existence d’une « consonne laryngale » dont on a effectivement trouvé la trace sur une tablette hittite. L’archéologie, elle, montre comment les peuples ont circulé : pourquoi (guerre, commerce, changement climatique, ou une combinaison des trois ), sur quels trajets, et surtout à quelles dates ? Quant à la génétique, elle est récemment venue confirmer la simultanéité entre l’arrivée des trop oubliés nomades yamnayas, venus du Caucase pour s’établir au nord-ouest de la mer Noire au troisième millénaire avant notre ère, et la diffusion du PIE dans l’aire européenne (avec ensuite des allers-retours entre l’Europe et l’Ouest de la Chine dans le sillage des nomades). Mais attention, alerte l’autrice, on ne peut pas superposer directement un peuple et une langue (l’anglais est aujourd’hui parlé par des myriades de peuples ethniquement différents ; et les peuples aborigènes australiens, quoiqu’ethniquement apparentés, parlent des myriades de langues différentes). Quoi qu’il en soit, il est établi désormais que, contrairement aux souhaits de certains, l’humanité présente est non seulement le fruit d’un brassage de gènes mais qu’elle s’exprime aussi à travers un brassage de mots issus d’un socle commun. Hélas, même les prodiges de la paléogénétique et de l’informatique quantique ne pourront vraisemblablement explorer notre généalogie linguistique sur plus de cinq (ou peut-être 10) millénaires en amont. Pourtant l’on soupçonne déjà que le PIE lui-même appartenait à une « super-famille » qui comprenait aussi le hittite (frère du PIE, donc, et non pas son descendant comme on le croyait) et sans doute aussi les langues ouraliennes. Mais de là à postuler l’existence – et l’exhumation éventuelle – d’un mythique proto-PIE, ne rêvons pas... Pourtant, nuance Peter Gordon dans la Asian Review of Books, « les connaissances avancent désormais si vite dans ce domaine que chaque détail peut à tout instant être remis en question, et aucune étude ne pourra demeurer valide bien longtemps ».