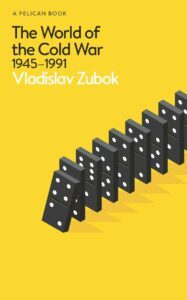La guerre froide, vue de Moscou
Publié en septembre 2025. Par Michel André.
Contrairement à ce que l’on a pu croire en Occident, les dirigeants soviétiques n’avaient pas pour but de répandre le communisme dans le monde. Il s’agissait d’un impérialisme traditionnel, aiguillonné par un fort sentiment d’infériorité à l’égard des États-Unis.

L’expression « guerre froide » est apparue en 1945 sous la plume de George Orwell dans un article sur la bombe atomique. Utilisée pour la première fois dans le sens qui nous est familier en 1947 par le financier et politicien américain Bernard Baruch, elle fut popularisée la même année par le journaliste Walter Lippmann, qui l’employa comme titre d’une série d’éditoriaux puis d’un livre qui les rassemblait. Elle désigne à la fois l’état de tension et de rivalité entre les États-Unis et l’URSS dans les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale et la période de près d’un demi-siècle durant laquelle ces rapports conflictuels ont largement façonné le paysage international. L’abondante littérature sur cet épisode historique est majoritairement en langue anglaise et souvent américaine : en Union soviétique, le concept de « guerre froide » n’était pas utilisé.
Au cours des derniers mois, deux livres sont venus enrichir notre connaissance de cet épisode historique. Leurs auteurs, Sergey Radchenko et Vladislav Zubok, sont l’un et l’autre des historiens russes travaillant dans le monde anglo-saxon. Nourris par l’étude approfondie des archives soviétiques, se distinguant par l’attention particulière dont y fait l’objet le comportement des leaders de l’URSS, leurs ouvrages aident à comprendre le point de vue qu’on avait sur la question de l’autre côté du rideau de fer. Les deux historiens se rejoignent en particulier pour contester que le premier objectif des leaders soviétiques, en soutenant certains régimes et des insurrections armées un peu partout dans le monde, ait été de répandre le communisme sur la planète, comme beaucoup en étaient persuadés aux États-Unis. À leurs yeux, la politique internationale de l’URSS était pour l’essentiel basée sur des considérations impérialistes de la forme la plus traditionnelle, renforcées par un fort sentiment d’infériorité à l’égard des États-Unis. Le livre de Zubok, le plus récent, vise davantage le grand public1. C’est une brillante synthèse qui résume et met en perspective tous les moments-clés de cette longue histoire, du partage de l’Europe lors de la conférence de Yalta à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la chute du mur de Berlin en 1989 et l’éclatement de l’URSS (dans un livre précédent, Zubok attribuait celui-ci moins aux pressions extérieures qu’aux faiblesses structurelles de l’économie soviétique et, surtout, aux erreurs de politique économique de Mikhail Gorbatchev). Le récit très enlevé enchaîne à un rythme soutenu les péripéties les plus marquantes de la guerre froide : le « long télégramme » de George Kennan formulant la politique de « l’endiguement » de l’URSS, le plan Marshall d’aide financière à l’Europe occidentale, le blocus de Berlin en 1948-1949 et le pont aérien mis en place pour le contrer, la création de l’OTAN, l’invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques en 1956, la course aux armements nucléaires dans les années 1960, la crise de Berlin de 1961 et celle des missiles de Cuba en 1962, la répression du printemps de Prague en 1968, l’Ostpolitik allemande et les succès de la politique de la détente durant les années 1970, les premiers accords de limitation des armements et la conférence d’Helsinki de 1975 sur la paix et la sécurité en Europe, le retour des tensions au début des années 1980, la crise des euromissiles et l’initiative américaine de la « guerre des étoiles ». Zubok évoque aussi les nombreuses ramifications de la guerre froide dans le monde et les conflits locaux qui lui furent associés à un titre ou un autre : la guerre de Corée et celle du Vietnam, les guérillas et les renversements de régime en Amérique latine, les guerres de libération nationale en Afrique et les multiples troubles au Moyen-Orient.
Présentée à l’Ouest comme le combat de la démocratie libérale contre le totalitarisme, la guerre froide était décrite par les Soviétiques comme le produit de la lutte entre l’impérialisme capitaliste et le monde socialiste. Une idée qui court tout au long du livre est que l’idéologie ne pesait pas d’un poids égal des deux côtés ; contrairement à ce qui est souvent affirmé, elle jouait un rôle plus important dans les motivations américaines. « La cause de la guerre froide, soutient Zubok, est la décision américaine de bâtir et maintenir un ordre libéral mondial, non un plan de l’Union soviétique pour répandre le communisme en Europe. » L’affirmation contenue dans la première partie de la phrase est assurément exagérée. Mais la seconde partie énonce une vérité trop souvent négligée. À Yalta, Staline défendait moins le communisme que, dans un esprit nationaliste, les ambitions territoriales de la puissance qui avait recueilli l’héritage de l’Empire russe. Dans le même esprit, si les Soviétiques ont voulu être présents au Moyen-Orient, remarque Zubok, c’était « pour y être », d’une manière qui leur assure une présence et une influence comparables à celles des États-Unis. De manière générale, souligne-t-il, on ne comprend rien au comportement de l’URSS tout au long de la guerre froide si l’on fait abstraction de l’énorme besoin de reconnaissance dont il était l’expression : reconnaissance comme ennemi puissant à redouter, mais aussi comme partenaire capable de traiter d’égal à égal avec les États-Unis et de diriger le monde avec eux.
Lecteur de Thucydide, Zubok rappelle qu’à l’origine des guerres, il y a toujours « la peur, l’honneur et l’intérêt » : « Guerres, crises et luttes de gangs ont quelque chose en commun : elles sont le produit de l’intérêt, mais aussi de fortes émotions, de l’arrogance et de la peur. Les deux côtés veulent projeter une impression de dureté, de supériorité, de crédibilité. Les deux côtés craignent de perdre s’ils ne frappent pas les premiers. » Ceci peut se traduire par des comportements infantiles. En décidant de faire exploser en 1961 la « Tsar Bomba » de 50 mégatonnes (la plus puissante bombe nucléaire jamais construite), « c’est comme si Nikita Khrouchtchev s’était engagé avec les Américains dans une querelle de bac à sable entre des enfants : “Tu as davantage de jouets que moi, mais le mien est plus gros” ». Il savait bien, pourtant, qu’aucun missile n’était à même de transporter un tel monstre jusqu’aux États-Unis.
Cette anecdote et plusieurs du même type illustrent deux leçons qui émanent du récit de Zubok. La première est l’importance des facteurs psychologiques, même dans un domaine aussi contraint par les données objectives (géographiques, historiques, économiques) que la géopolitique. Les portraits de Staline, Nikita Khrouchtchev, Leonid Brejnev et Mikhaïl Gorbatchev (dépeint comme un idéaliste maladroit) qu’on trouve dans le livre sont à cet égard très éclairants. La seconde leçon est le rôle inévitablement joué dans l’Histoire par la contingence et le hasard. À plusieurs moments de son récit, Zubok évoque la possibilité que les choses aient pu tourner différemment. Il fait aussi partie de ceux qui considèrent que si la crise de Cuba n’a pas débouché sur un affrontement nucléaire, c’est largement grâce à un coup de chance : ni Kennedy ni Khrouchtchev n’en voulaient, mais ils ne contrôlaient qu’imparfaitement les chaînes de commandement et les probabilités d’une erreur de communication étaient élevées.
Depuis quelques mois, pour une série de raisons évidentes – la guerre en Ukraine, les menaces d’annexion de Taïwan par la Chine et la guerre commerciale féroce entre ce pays et les États-Unis –, il est beaucoup question dans la presse et les médias d’une « nouvelle guerre froide ». Dans les dernières lignes de son livre, Vladislav Zubok se demande dans quelle mesure il n’aurait pas dû intituler celui-ci « La première guerre froide ». « Le temps le dira », conclut-il prudemment. Sans qu’il le fasse remarquer, on peut tenir une chose pour certaine : dans l’hypothèse où une nouvelle période de guerre froide viendrait à s’ouvrir, celle-ci prendra nécessairement une autre forme que celle qui s’est clôturée au début des années 1990. Le monde de la première moitié du XXIe siècle est sensiblement différent de celui de la seconde partie du XXe. Les grands blocs sont en partie les mêmes, mais les rapports de force entre eux ont changé. La Chine s’est hissée au premier rang. Sur les plans économique, financier, technologique et énergétique, ces blocs sont par ailleurs liés par une série d’interdépendances qui ne caractérisaient pas les relations des États-Unis et de l’URSS à l’époque où ils dominaient le monde. De nouveaux acteurs de poids (Inde, Brésil) sont de surcroît apparus sur la scène internationale, dont l’émergence a modifié l’équilibre mondial.Rien ne serait plus vain et dangereux, souligne d’un autre côté Zubok, que de compter sur la capacité des gouvernements à ne pas répéter les erreurs d’autrefois. Parce que l’Histoire n’obéit pas à des règles immuables, mais aussi parce que, voudraient-ils tirer des leçons de ce qu’elle enseigne malgré tout, les dirigeants d’aujourd’hui et de demain ne seraient pas à même de les appliquer : « Les nouvelles élites démocratiques, tout comme les nouveaux autocrates, sont condamnés à avancer sur le même terrain miné, dans une demi-ignorance, victimes de l’incertitude, animés par la peur, l’arrogance, l’égoïsme et une vision myope du passé. Ainsi que le faisait remarquer un diplomate chevronné : “Presque tous les gouvernements opèrent au jour le jour, en naviguant à vue, réagissant sur la base d’informations inadéquates à des événements en dehors de leur contrôle, qui dépendent d’ordres du jour fixés par les autres”. »
Notes
1.Le livre de Radchenko s’intitule To Run the World: The Kremlin’s Cold War Bid for Global Power. Plus volumineux et de facture plus universitaire que celui de Zubok, il a été publié chez Cambridge University Press en 2024.