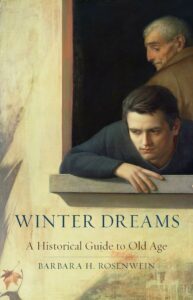Mieux vaut rester un jeune-vieux que devenir un vieux-vieux
Publié en janvier 2026. Par Jean-Louis de Montesquiou.
La vieillesse est certes un phénomène bien étudié, mais les phénomènes n’existent que par la perception qu’on en a, nous disent les philosophes. Barbara H. Rosenwein, qui se veut « historienne des émotions », ne donne donc pas à lire une énième description navrante des modalités physiques, psychologiques ou sociales du vieillissement, mais plutôt de la façon – tout de même moins navrante – dont celui-ci a été ressenti à travers l’histoire et la géographie : « Comment perçoit-on l’âge au cours des âges ? Et comment les vieux eux-mêmes perçoivent-ils la vieillesse ? » La réponse au premier volet de la question n’est pas vraiment encourageante. Certaines peuplades primitives se débarrassent de leurs vieilles bouches inutiles à nourrir avec plus ou moins de cérémonie, parfois en les tuant (éventuellement pour les manger) ou, chez les nomades, en les laissant sur place (abandon létal), à moins que les vieux ne décident d’eux-mêmes de cesser de peser sur la vie du groupe… Mais généralement dans l’Antiquité et aujourd’hui encore dans les sociétés agricoles, les vieux sont plutôt honorés pour le savoir dont ils sont dépositaires, les bons conseils qu’ils peuvent prodiguer, et souvent le succès de leur vie. Après une existence de labeur, la vieillesse est une période de repos où l’on est en droit d’espérer, comme le promet Tirésias dans L’Odyssée, « une mort douce à un âge confortablement avancé, avec une descendance prospère ». En Chine ancienne, Confucius avait institutionnalisé le xiào, la piété filiale, et la vieillesse était un temps béni – où l’on était, de surcroît, enfin débarrassé du souci de ses vieux parents. Sparte était un paradis des vieux, car ils y conservaient prestige mais aussi pouvoir (il fallait avoir au minimum 60 ans pour intégrer le tout puissant Conseil des Anciens). Ailleurs, c’est plus flou. À Rome, par exemple, la pietas envers les anciens était de rigueur, et au Sénat on prisait l’âge (le mot vient de senex, vieux – mais pas de senilis, vieux vraiment trop vieux !). Souvent toutefois les grands anciens étaient brutalement mis à l’écart (cf. Cicéron, Sénèque), et leurs bons conseils ignorés. Quant aux vieilles, elles étaient carrément tournées en dérision par les auteurs comiques.
Ce qui est moins étudié, et que Barbara H. Rosenwein a l’originalité de mettre en lumière à partir des textes disponibles, c’est la perception de la vieillesse. Laquelle est tantôt très négative, tantôt (modérément) positive, mais le plus souvent fluctuante dans un entre-deux turbide traversé de puissants remous. Socrate, par exemple, considérait à 70 ans que le « grand âge » – à venir ! – était une horreur à laquelle il se félicitait d’échapper grâce à sa condamnation à mort ! Et Shakespeare évoque dans Comme il vous plaira ces vieillards « sans dents, sans yeux, sans goût, sans quoi que ce soit », qui sont bien à plaindre. Mais moins que ceux qui, comme le Roi Lear ou encore le Père Goriot de Balzac, croient raisonnable de faire confiance à leurs descendant(e)s pour leur conserver pouvoir, prestige et confort. Et quand la tragédie ne s’apitoie pas sur le sort des vieux, c’est la comédie qui prend le relais pour ridiculiser les vieillards qui s’accrochent et pourrissent la vie des jeunes – un thème récurrent, de Plaute à Molière et même après (Rousseau s’en indigne d’ailleurs au point de vouloir faire interdire la comédie à Genève !). D’autres auteurs en revanche s’emploient dans leur grand âge à convaincre (ou se convaincre ?) des mérites et des satisfactions qu’on peut y trouver. Ça sonne parfois juste, comme chez Pétrarque, qui affirme savourer à la fois la tranquillité de l’âme et sa confiance dans la survie posthume de ses œuvres. Ça sonne un peu moins juste dans le De Senectute de Cicéron, plaidoyer un peu laborieux. Mais tous les auteurs de cette « littérature de consolation » s’accordent sur la même analyse : « Les vieillards ne recherchent pas le bonheur mais le contentement », résume Joseph Epstein dans le Wall Street Journal ; et la condition d’une vieillesse « contente », c’est qu’elle ait été précédée d’une vie saine, du point de vue du corps mais aussi des mœurs. Galien, le père de la médecine, met même particulièrement en garde contre l’excès de sexe, qui épuise l’organisme des jeunes et rend la désaccoutumance encore plus pénible pour les vieux. On s’accorde aussi à reconnaître que pour réussir sa vieillesse, il faut agir plus sur son mental que sur son corps. La vieillesse « étant essentiellement une construction personnelle et culturelle », dit Barbara H. Rosenwein, il faut l’affronter positivement, c’est-à-dire s’efforcer de rester un « jeune-vieux » le plus longtemps possible en se maintenant en état d’alerte intellectuelle, en restant engagé dans la société (ou au minimum dans la vie sociale), et surtout en travaillant. Dans les sociétés du Nord de l’Europe, moins patriarcales que celles du Sud, des mécanismes de support financier ou médical ont été mis en place dès la toute fin du Moyen Âge, avec les guildes et les sociétés de bienfaisance, relayées en Angleterre au début du XVIIe siècle par l’État lui-même (le « Relief Act ») pour protéger les vieillards pauvres ne pouvant vraiment plus travailler. À partir du XXe siècle, cette protection sans contrepartie s’est généralisée, suscitant « la fragile illusion que les vieux pourraient tous vivre dans la dignité et l’appréciation », ironise l’autrice. Mais la modernité fera apparaître un nouveau douloureux corollaire du vieillissement, peu évoqué précédemment : la solitude. Une nouvelle raison de ne pas rendre les armes en se résignant à devenir trop tôt un « vieux-vieux ». Ce qui implique de ne pas se concevoir comme tel.