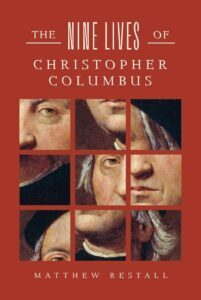Christophe Colomb, à hue et à dia
Publié en novembre 2025. Par Books.
Christophe Colomb était-il un navigateur de génie ou un truqueur, un saint ou un pervers polymorphe, un idéaliste ou un génocidaire ? Son image a tant été tirée à hue et à dia par la postérité, qui plus est entre des extrêmes particulièrement extrêmes… En effet, « tout ce qui concerne sa biographie ou sa réputation posthume a donné lieu pendant 500 ans à un foisonnement d’interprétations, de spéculations, d’affabulations » écrit Andrés Reséndez dans le New York Times. Autant de « vies » post mortem, de constructions étonnantes que l’historien Matthew Restall déconstruit méticuleusement, révélant au passage les arrière-pensées derrière tant de « mystères inventés afin de mieux les résoudre à coup de prétendues solutions, la plupart formidablement imaginatives et étonnamment déconnectées de la réalité historique ». Le premier de ces mystères, c’est le foisonnement des mystères eux-mêmes, car contrairement à la légende, la vie de Christophe Colomb est – hormis pour sa jeunesse – très bien documentée.
Au grand dam de bien d’autres lieux, c’est ainsi à Gênes que le futur navigateur est indubitablement né, en 1451, d’un père d’abord fromager puis tisserand. Mais sans doute pour occulter la modestie de ses origines, Christophe lui-même les a revêtues d’un brouillard qui favorisera les élucubrations ultérieures et dont plusieurs pays, depuis la Suisse ou la Norvège jusqu’à la Grèce, profiteront pour le revendiquer. Ensuite il a tôt navigué, c’est sûr – mais ni en tant que prince pirate grec au service des Turcs, ni jusqu’en Islande. Son visage même est un mystère – le fameux portrait par Piombo au Metropolitan Museum est en fait celui d’un ecclésiastique. Ce mystère-là permet toutefois de lui assigner au choix un nez aquilin (qui conforte les origines grecques !) ou bien juif (au bénéfice d’une autre légende, infondée). Ce n’est qu’en 1474 qu’on retrouve la trace certaine de Colomb, à Lisbonne. Pendant dix ans, il y a appris à naviguer et aussi à lire. Il s’est marié là (avantageusement) et y a entamé sa grande carrière d’explorateur de l’Atlantique en présentant au roi du Portugal João II un projet pour atteindre les Indes par l’ouest – mais le roi portugais a préféré miser sur le prometteur contournement de l’Afrique.
Alors Colomb, devenu veuf, est parti tenter sa chance en Espagne, où il a conçu un fils (hors mariage ou non, selon que l’on souhaite ou non voir en lui un bon catholique), et a soumis au couple royal espagnol un projet aussitôt déféré à un comité d’ecclésiastiques et d’experts réunis à Salamanque. Selon Matthew Restall, tout le monde dans ce comité savait bien que la Terre était ronde, même si les ecclésiastiques étaient contraints de soutenir le contraire. La contribution nouvelle de Colomb fut de démontrer, chiffres fallacieux à l’appui, que la planète sphérique était beaucoup plus petite qu’on ne le croyait depuis Ptolémée, et donc que le succès d’un voyage par l’ouest était plus assuré. Les experts resteront sceptiques, et les rois catholiques hésiteront pendant dix ans avant que, par crainte que les Portugais ne leur dament le pion, ils donnent enfin leur feu vert.
Mais la postérité va encore se diviser sur le traitement de cet épisode majeur. Les Espagnols, soucieux de légitimer leurs prétentions sur l’Amérique du Sud, vont faire le maximum pour s’attribuer rétrospectivement 100 % du succès de Colomb. Le très hispanique Don Cristóbal Colón sera fait amiral et célébré pour une découverte due à son talent mais aussi à son équipage 100 % espagnol – et bien sûr au soutien financier des souverains, de la souveraine Isabelle surtout, embobinée (sinon séduite) au point d’avoir mis ses bijoux au clou pour financer l’expédition ! Les nombreux rivaux de l’Espagne présenteront quant à eux Colomb tantôt comme un génie malmené à Salamanque par des obscurantistes, tantôt comme un tricheur se prévalant du savoir d’autrui et qui aurait même été accompagné dans son premier voyage par « un pilote mystère ». Puis, au quatrième voyage, en 1498, les choses vont se gâter – d’abord pour Colomb lui-même, accusé d’exactions et rapatrié de force, mais plus encore pour son image posthume. Les amis de l’Espagne (et de l’amiral) comme Las Casas vont bien chercher à faire de lui un champion du catholicisme, un croisé venu sauver les âmes des sauvages, qu’on tentera même au XIXe de faire canoniser !
L’effort est d’autant plus louable que dans l’autre camp on noircit Colomb tant qu’on peut : il n’était qu’un soudard avide de s’enrichir et surtout l’instigateur d’épouvantables massacres, pillages et viols ; pire encore, c’est lui qui aurait en personne apporté aux Antilles ou rapportée en Espagne la syphilis. On ira même jusqu’à lui prêter une sexualité bestiale aux confins de la zoophilie avec une prédilection pour les lamantins, ces pseudo-sirènes !
Ce qui n’empêchera pourtant pas une autre récupération, très surprenante : au XIXe les États-Unis feront du navigateur le véritable découvreur de l’Amérique du Nord (où il n’a jamais mis les pieds). Colomb, qui est en effet blanc, chrétien, esclavagiste et capitaliste, et surtout européen mais heureusement pas anglais, sera promu « non pas père de la nation (c’est Washington) mais grand-père ». D’où l’efflorescence du culte colombien aux États-Unis avec statues, ronds-points, célébrations diverses, et ces fresques grandioses qui couvrent les murs du Capitole. Hélas, cette vision-là est aujourd’hui battue en brèche par les dénonciateurs du « suprématisme blanc », et les étudiants détruisent ou décapitent les statues de l’ex-héros à qui mieux mieux.Mais l’image du navigateur, dispersée entre gloire et opprobre comme ses restes mortels le sont entre Saint-Domingue et l’Espagne, connaîtra sans doute encore d’autres mutations. Positives ou négatives ? Ce n’est pas la matière qui manque, et le passé est imprévisible…