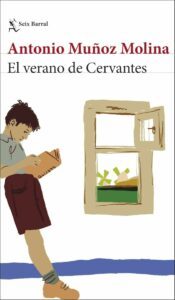En lisant Don Quichotte
Publié en octobre 2025. Par Michel André.
Le romancier Antonio Muñoz Molina relit Don Quichotte chaque été depuis son adolescence. Cousin spirituel de Montaigne, Cervantes a connu une vie aventureuse et romanesque qui inspire son réalisme. Le premier vrai roman de la littérature occidentale.
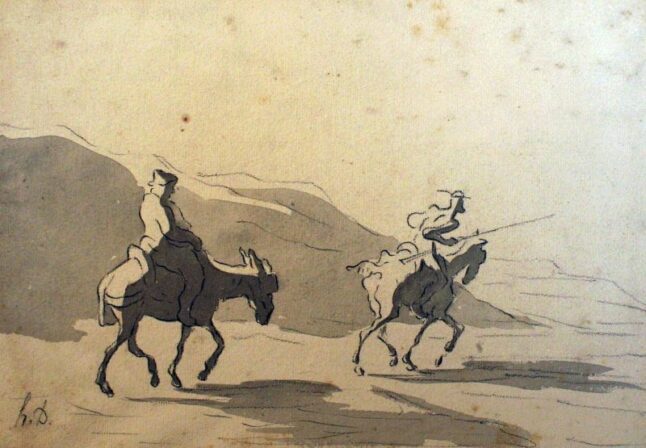
Cervantes joue dans la littérature espagnole un rôle encore plus important que Shakespeare dans la littérature anglaise, Dante dans l’italienne ou Goethe dans les lettres allemandes. Pour les écrivains espagnols, particulièrement depuis Benito Pérez Galdós à la fin du XIXe siècle, l’auteur de Don Quichotte n’est pas seulement une gloire nationale et une référence en matière d’art littéraire. Il est à la fois une source d’inspiration, un modèle auquel ils éprouvent le besoin de se confronter et le créateur d’une œuvre essentielle au sujet de laquelle ils ressentent l’obligation de s’exprimer. Rares sont ceux d’entre eux qui ne lui ont pas consacré de nombreuses pages, voire des livres entiers, projetant souvent sur lui leurs propres préoccupations. Les écrivains du début du XXe siècle comme Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno et José Ortega y Gasset lisaient ainsi Don Quichotte à la lumière de la question nationale, qui agitait les esprits à ce moment. À leurs yeux, ce roman détenait la clé du caractère espagnol, donc de l’histoire et du destin du pays, à propos duquel leurs vues ne coïncidaient d’ailleurs pas.
Don Quichotte occupe une place également centrale dans le cœur de plusieurs auteurs espagnols contemporains, qui abordent cette œuvre dans une perspective plus personnelle. Avant de proposer au public une version du roman en castillan moderne, Andrés Trapiello avait fait paraître en 1993 un essai biographique sur Cervantes qu’il présentait comme le livre qu’il avait écrit avec le plus d’amour et de soin. Au terme de dix années d’un travail fréquemment interrompu par d’autres projets et obligations, Antonio Muñoz Molina vient de publier un ouvrage encore plus intime, mélange de souvenirs de lecture de Don Quichotte et de réflexions sur le contenu du livre et son influence.
Si le livre s’intitule « L’été de Cervantes », explique Muñoz Molina, c’est que l’été est la saison de Don Quichotte (dans le roman, il ne pleut presque jamais) et la plus appropriée pour lire et relire cette longue œuvre de fiction : « Le temps intérieur du roman et le temps extérieur à lui, mais également intime, de l’acte de lire confluent en une forme particulière de souvenir [...] dans lequel se superposent la lecture actuelle et chacune des lectures qu’on a effectuées tout au long de sa vie, au cours d’étés successifs qui se présentent comme un unique été. » Ses premiers étés de lecture de Don Quichotte, à la fin de son enfance et au cours de sa prime adolescence, il les a vécus dans une région rurale d’Andalousie qui n’était pas très différente à l’époque où il y a grandi de ce qu’était au XVIe siècle la Manche où Cervantes situe les aventures de son héros : une terre extrêmement pauvre et aride, où les champs étaient cultivés à la force des bras, avec l’aide de quelques animaux, et où les maisons, dépourvues de confort, n’avaient pas l’eau courante.
Le livre est organisé en quelque 150 courtes sections permettant à Muñoz Molina de passer d’un sujet à l’autre « par sauts et gambades » à la manière de Montaigne, écrivain qu’il rapproche constamment de son contemporain Cervantes en raison des traits qu’ils partagent à ses yeux : un aimable scepticisme, un profond humanisme, un réalisme foncier. Les Essais sont d’ailleurs avec À la recherche du temps perdu de Marcel Proust un des deux livres qu’à côté de Don Quichotte, il relit le plus souvent. Le réalisme de Cervantes, souligne-t-il, qui tranche avec la préciosité et le formalisme des auteurs qui l’ont précédé, est le produit de la richesse et de la variété de son expérience de la vie. Contrairement aux autres grandes figures du Siècle d’or, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Calderón, Cervantes est mort sans nous avoir laissé un portrait de lui qu’on puisse considérer comme authentique. Mais on en sait suffisamment sur sa vie pour mesurer à quel point elle a été aventureuse et romanesque : une jeunesse vagabonde faite d’errances et de déménagements en compagnie de son père harcelé par les créanciers, l’entrée sur la scène littéraire madrilène qu’il abandonne précipitamment pour partir en Italie, sans doute pour échapper à une condamnation après avoir blessé un homme en duel, l’engagement sous les ordres de don Juan d’Autriche et la perte de sa main gauche lors de la bataille navale de Lépante contre la flotte ottomane, sa capture par des corsaires barbaresques suivie de cinq ans de captivité à Alger, son retour en Espagne marqué par de nouveaux succès au théâtre, mais aussi plusieurs séjours en prison pour des délits et des crimes dont il était innocent ; la publication, enfin, à dix ans d’intervalle et au milieu de difficultés financières, des deux parties de Don Quichotte, la seconde, encore meilleure que la première, écrite pour faire pièce à la parution d’une suite à la première publiée sous pseudonyme par un contrefacteur demeuré inconnu, qui exploitait le grand succès populaire du livre.
« Cervantes, observe Muñoz Molina, identifie les langages particuliers des métiers et des classes sociales, le jargon des délinquants, des juristes et des gardiens de l’ordre, des soldats, des bergers, des prêtres, de la pègre, des prisonniers. Son acuité de perception et son sens de l’observation sont aussi exceptionnels que l’ampleur de ses lectures et la profondeur de son expérience du monde. Il a la culture littéraire de celui qui a passé toute sa vie au milieu des livres et la fraîcheur de perception de quelqu’un qui n’a jamais cessé de se trouver engagé dans la vie réelle, par choix délibéré ou par hasard, y compris par malchance. »
L’imagination de Cervantes, souligne-t-il, est fondamentalement narrative et s’exprime avant tout dans les conversations. On a de fait souvent relevé la pauvreté relative de ses descriptions, largement compensée par le brio et le caractère extraordinairement vivant des échanges entre Don Quichotte et Sancho Panza. Ils portent tout le roman et laissent percevoir un vrai sage derrière le vieux fou qui se prend pour un chevalier et veut redresser tous les torts du monde, et, sous les apparences du grossier paysan qui lui sert d’écuyer, un homme plein d’authentique bon sens. Muñoz Molina salue la force des personnages féminins du roman, auxquels il rend hommage dans la dédicace de son livre, notamment la bergère Marcelle, qui, dans une tirade fameuse, se refuse à endosser la responsabilité du suicide du jeune homme qui s’est tué par amour pour elle : « Je suis née libre, et c’est pour garder ma liberté que j’ai choisi la solitude des champs. […] J’ai le goût de la liberté et ne veux pas être asservie. » Il relève la grande violence qui traverse le roman, reflet de celle qui prévalait à l’époque, sur laquelle Nietzsche a attiré l’attention et qui révulsait Vladimir Nabokov, l’extrême cruauté qui s’abat régulièrement sur les deux protagonistes, battus, frappés, humiliés, trompés, en des scènes dont seul le caractère excessif et parodique désamorce la gêne qu’on éprouve à les lire.
Avec justesse, il compare l’apparition de Cervantes dans son roman à celle de Vélasquez dans son tableau Les Ménines. Comme on sait, la structure narrative de Don Quichotte est d’une grande complexité, le récit étant successivement attribué à différents auteurs : Cervantes lui-même dans les deux prologues, mais aussi un personnage non identifié parlant à la première personne, un historien arabe fictif, un traducteur morisque. Dans la deuxième partie, Don Quichotte et Sancho Panza rencontrent des personnages qui ont lu leurs aventures dans la première et connaissent donc leur histoire. Don Quichotte reproche même à l’auteur de cette première partie d’avoir trop digressé en multipliant les épisodes qui ne le concernent pas, enchâssés dans le récit principal (un peu à la manière du Décaméron de Boccace ou des Contes de Canterbury de Chaucer).
Ce procédé de construction sophistiqué impliquant des appels réguliers au lecteur et la reconnaissance explicite du caractère fabriqué, artificiel et imaginaire de l’histoire racontée sera repris par Diderot, Laurence Sterne et Henry Fielding. Parmi les autres écrivains qui mirent Cervantes et Don Quichotte au plus haut ou subirent son influence figurent Samuel Johnson, Goethe, Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, Mark Twain, Herman Melville, Thomas Mann et James Joyce. Antonio Muñoz Molina consacre quelques lignes à plusieurs d’entre eux, ainsi qu’à Sigmund Freud : comme il l’a affirmé en toutes lettres, le fondateur de la psychanalyse était convaincu que les grands romanciers en savent davantage sur l’âme humaine que les médecins et les neurologues.
On s’est souvent interrogé sur le message que Cervantes voulait transmettre par l’intermédiaire de sa tragi-comédie, toujours très enlevée, souvent bouffonne, profonde et émouvante à plus d’un endroit, surtout dans la deuxième partie. « [Don Quichotte], suggère Antonio Muñoz Molina, est l’expression de la conscience […] que rien n’est solide, ni entièrement noble, ni durable, ni totalement nuisible ou bénéfique, que chaque personne est un monde, et même plusieurs mondes […]. Le roman irrite et déconcerte, parce qu’il ne se marie à aucune préconception, n’offre aucune des certitudes qu’exigent les théories de la littérature ou du bonheur social. [Il] peut paraître progressiste, parce qu’il ne respecte aucune hiérarchie et illustre la bassesse de tous les privilèges et la fausseté et le ridicule de toutes les rhétoriques ; mais aussi réactionnaire, parce qu’il peut se montrer aussi acide et irrespectueux avec les opprimés qu’avec les puissants, aussi proche de l’âme des canailles que de celle des justes. » Si Don Quichotte peut revendiquer le titre de premier vrai roman de la littérature occidentale, autant que pour avoir inauguré une nouvelle forme de récit, c’est en effet pour cette ouverture à un large spectre d’interprétations, qui le rend aussi riche, mouvant et ambigu que la vie elle-même.