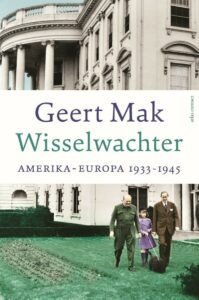Le sherpa de F. D. Roosevelt
Publié en mai 2025. Par Michel André.
Le New Deal n’a nullement été conçu comme une application des idées de Keynes. Il est issu du cerveau de l’étonnant Harry Hopkins. Devenu le principal conseiller de Roosevelt, ce fils d’un commis voyageur a joué un rôle central à ses côtés, jusqu’au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dont il fut un acteur influent.

Les personnes de pouvoir sont entourées de collaborateurs et de conseillers dont l’influence est toujours importante, parfois déterminante. Un des cas les plus célèbres est celui de Harry Hopkins, bras droit du président américain Franklin D. Roosevelt durant ses trois mandats successifs, au cœur des politiques pour lesquelles celui-ci est passé dans l’Histoire : principal architecte du New Deal, il fut aussi l’homme-clé de l’alliance entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS durant la Seconde Guerre mondiale.
Outre-Atlantique, il est un personnage connu. Une demi-douzaine de livres lui ont été consacrés, dont quatre biographies complètes. En Europe, il est une figure moins familière. S’appuyant sur les livres qui racontent sa vie, ainsi que sur l’étude de ses archives et des document de la Bibliothèque présidentielle Franklin D. Roosevelt, Geert Mak vient de publier sa première biographie dans une autre langue que l’anglais : le néerlandais. Journaliste et écrivain hollandais, Mak est l’auteur de plusieurs livres sur Amsterdam, les Pays-Bas et l’histoire récente de l’Europe. Son intérêt pour les États-Unis s’était déjà manifesté dans un récit de voyage sur les traces de John Steinbeck.
Contrairement à Franklin D. Roosevelt, issu d’une grande famille patricienne de la côte Est, Harry Hopkins est né dans un milieu modeste, dans l’Iowa. De son père, qui était commis voyageur, il hérita un tempérament aventureux, le goût du risque et un penchant pour les plaisanteries irrévérencieuses aux dépens des prétentieux ; de sa mère, méthodiste fervente, la conviction que rien ne donne plus de sens à l’existence que le service aux autres. Tout au long de ses études, il se distingua par son ambition féroce, son infatigable énergie et son caractère combatif. Son diplôme en main, en 1912, il entama une carrière dans le domaine de l’aide sociale. Après avoir occupé des postes de responsabilité de plus en plus élevés dans différentes associations à New York, La Nouvelle-Orléans et Atlanta, en 1931, il fut nommé directeur général du programme d’aide sociale de l’État de New York, qui combinait assistance en matière alimentaire, de santé et de logement et programmes de création d’emplois.
Le gouverneur de l’État, qui ne tarda pas à le remarquer, était alors Franklin D. Roosevelt. Frappé par la poliomyélite cinq ans plus tôt – il resta paralysé en dessous de la taille le restant de ses jours –, il avait été convaincu de reprendre sa carrière politique par sa femme Eleanor, son conseiller Louis Howe et celle qui fut sa très dévouée secrétaire privée durant 21 ans, Missy LeHand, si proche de lui qu’on pouvait la considérer comme sa seconde femme. En 1932, Roosevelt se présenta à l’élection présidentielle, qu’il emporta face au président sortant Herbert Hoover. Quelques jours après son investiture, au début de 1933, Hopkins (qui n’avait pas été impliqué dans sa campagne) et un autre responsable des programmes sociaux de New York présentaient à Frances Perkins, secrétaire au Travail, un projet de programme d’aide sociale pour le pays entier. L’idée séduisit Roosevelt. Le programme fut mis en œuvre, d’abord en fournissant les moyens financiers nécessaires aux États, puis directement au niveau fédéral. Le New Deal était lancé.
En quelques années, le financement de centaines de milliers de projets d’infrastructure par plusieurs agences fédérales permit de remettre au travail plusieurs millions de chômeurs que la dépression consécutive au krach boursier de 1929 avait privés de leur emploi. L’âme de ce dispositif était Hopkins : fumeur à la chaîne, s’abreuvant de café noir, bourreau de travail, insoucieux de son apparence, souvent négligée, cultivant un style de gestion informel mais terriblement efficace, il était partout.
Au mois de mai 1934, Roosevelt eut l’occasion de rencontrer John Maynard Keynes, avec lequel il eut un entretien d’une heure. Quelques mois auparavant, l’économiste avait publié dans le New York Times une lettre ouverte au président dans laquelle il soulignait l’intérêt de l’expérience dans laquelle s’engageaient les États-Unis pour les pays qui se trouvaient dans la même situation qu’eux. Contrairement à ce que l’on dit parfois en oubliant la chronologie (la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ne parut qu’en 1936), le New Deal n’a nullement été conçu comme une application du keynésianisme. « Le New Deal, relève Mak, n’est pas sorti d’une vision philosophique. Ainsi que l’historien Richard Hofstadter l’a écrit, il est “le produit d’un tempérament”. Et si quelqu’un incarnait ce tempérament, c’était Harry Hopkins. » Keynes et Roosevelt se félicitèrent de leur entrevue, mais le second avait trouvé le premier un esprit très abstrait et jamais il ne reparla de sa visite.
En 1913, Hopkins avait épousé Ethel Gross, une jeune juive d’origine hongroise. Ils eurent quatre enfants, dont une fille qui mourut en bas âge et trois garçons : David, Robert et Stephen. Au bout de quelques années, le mariage se mit à battre de l’aile en raison du peu de disponibilité de Hopkins, complètement absorbé par son travail, de sa tendance à vivre au-dessus de ses moyens et à s’endetter, de sa passion pour le jeu et des soupçons d’infidélité de sa femme à son égard. En 1926, il entama une liaison avec une secrétaire, Barbara Duncan, qui devint sa seconde femme après qu’il eut divorcé d’Ethel. Ils eurent une fille, Diana. Hopkins développa aussi une amitié avec Eleanor Roosevelt, éloignée de son mari sur le plan affectif (sentimentalement elle était surtout liée à son amie la journaliste Lorena Hickok), mais dont les idées en matière sociale l’influençaient. Cette amitié dura quelques années et s’étiola plus tard, lorsqu’Eleanor eut l’impression qu’il se sentait plus proche du président que d’elle et qu’il abandonnait les principes idéalistes qui l’avaient guidé dans sa jeunesse.
N’entretenant au départ que des relations professionnelles ordinaires, les deux hommes s’étaient en effet progressivement rapprochés. Au bout de quelques années, Hopkins était devenu le conseiller le plus écouté du président. Plus que n’importe quel autre de ses collaborateurs, remarque un témoin, il était en effet capable de « comprendre, sentir, imaginer, deviner – et généralement deviner juste – ce qu’il y avait dans la tête de Franklin Roosevelt ». Il était de surcroît un fin observateur et un brillant analyste, y compris en matière de politique étrangère. En 1934, Roosevelt l’envoya en mission en Europe, officiellement pour enquêter sur les systèmes d’aide sociale mis en place dans différents pays, en réalité pour lui faire un rapport confidentiel sur la situation politique sur le vieux continent, qui le préoccupait. En 1937, Barbara mourut d’un cancer du sein et Hopkins (qui était à ce moment-là secrétaire au Commerce) resta seul avec sa fille Diana. La même année, il se découvrit atteint d’un cancer à l’estomac, dont on lui ôta les trois quarts. Son organisme ne parvenant plus à assimiler les nutriments, son état se détériora. Au début de 1939, il s’aggrava encore mais Hopkins s’en sortit grâce à un traitement combinant transfusions sanguines, alimentation par intraveineuse et injections de fer et de vitamines. Le 11 mai 1940, le lendemain du début de l’invasion de la Belgique et des Pays-Bas par les troupes de l’Allemagne nazie, Roosevelt le convoquait à la Maison-Blanche, où il devait théoriquement passer la nuit. Il y resta trois ans et demi, avec Diana.
Hopkins joua un rôle clef auprès de Roosevelt durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que n’étant nullement familier au départ des questions stratégiques et militaires, il fut durant le conflit, de près ou de loin, et plus souvent de près que de loin, impliqué dans toutes les initiatives importantes prises par les États-Unis et, de manière générale, par les Alliés. Roosevelt, qui avait totalement confiance en lui, l’utilisa à de multiples reprises comme son agent de liaison personnel avec Churchill et, après la rupture du pacte germano-soviétique, avec Staline. Parce qu’ils se rendaient compte qu’il parlait vraiment au nom de Roosevelt, impressionnés aussi par son style direct et sa façon concrète de réfléchir, les deux hommes apprirent rapidement à l’apprécier. Comme les précédents biographes, Geert Mak raconte en détail les divers entretiens qu’Hopkins eut avec l’un et l’autre, notamment celui au cours duquel Staline, une fois acquis le principe que l’URSS pouvait bénéficier de l’aide accordée par les États-Unis à leurs alliés, dressa pour lui la liste des matériaux, équipements et armements dont son pays avait besoin pour continuer la guerre.
Hopkins fut aussi au cœur des quatre conférences interalliées auxquelles participa Roosevelt, celles de Téhéran et Yalta avec Churchill et Staline, et, avant cela, Casablanca et Le Caire, sans Staline mais avec, dans le premier cas les deux dirigeants français rivaux, les généraux de Gaulle et Giraud (il les aida à conclure un accord), dans le second le leader chinois Tchang Kaï-chek. À Yalta, Hopkins, très affaibli, ne quitta guère le lit de sa chambre d’hôtel. Celle-ci devint vite un point de rencontre pour les membres des différentes délégations. Durant les réunions, il pouvait conserver longtemps le silence. Mais lorsqu’il intervenait, c’était pour aller directement au cœur du problème, ce qui le fit surnommer par Churchill « Lord Root of the Matter » (« Seigneur du Fond de la Question »).
Après sa mort, on a reproché à Hopkins de s’être montré trop complaisant envers Staline. Il a été accusé d’avoir livré aux soviétiques des informations stratégiques et même des secrets nucléaires. Dans ses contacts avec les autorités soviétiques, il s’était montré ouvert au sujet des plans américains. Mais rien de ce qu’il a dit à Staline n’était couvert par le secret militaire. Bien conscient du caractère implacable du leader soviétique et comme Roosevelt dépourvu de toute sympathie pour le communisme, il était déterminé à aider les troupes russes à combattre et résolu à tout faire pour que les soviétiques ne concluent pas de paix séparée avec l’Allemagne – l’important était la défaite complète du régime nazi. Mais Hopkins s’était fait de nombreux ennemis, surtout au sein du Parti républicain. Cinq ans après la mort de sa seconde femme, il avait épousé Louise Macy, ex-rédactrice en chef de Harper’s Bazaar et personnalité en vue. Après ce mariage, on fustigea son grand train de vie apparent. Parce qu’il avait acquis beaucoup de pouvoir, on l’avait aussi souvent accusé d’être mû par des ambitions personnelles.
Au début de 1944, Hopkins perdit son fils Stephen, tué sur le front du Pacifique. Au mois d’avril 1945, Roosevelt mourut. Un mois plus tard, à la demande de son successeur Harry Truman, Hopkins fit une dernière visite à Staline à l’occasion de laquelle celui-ci l’assura que si les accords de Yalta au sujet de l’Extrême-Orient étaient respectés, l’URSS déclarerait comme promis la guerre au Japon. Le 29 janvier 1946, il mourut épuisé. Ces derniers mots furent : « On ne peut pas vaincre le destin ».
Louise Macy, qui ne pouvait parler de Roosevelt sans amertume (« Il a tué ton père », disait-elle à sa belle-fille Diana), se remaria. Six mois après le décès de son mari, elle se suicida. Ethel Gross se remaria aussi, en 1949. Elle se consacra à la peinture et s’établit à Los Angeles pour être proche de ses petits-enfants et de son fils David. Lorsque celui-ci émigra en Australie, elle le suivit et c’est là qu’elle mourut, à l’âge de 90 ans. Tout en admirant son père, David souffrit toute sa vie de n’être considéré que comme le fils de Harry Hopkins. Il fit une brillante carrière dans la publicité. Son frère Robert travailla pour la CIA en Europe et en Amérique latine, puis pour une association d’aide aux victimes. Leur enfance fut parfois un peu triste, observe June Hopkins, la fille de Diana : leurs parents étaient séparés et leur père, qui ne quittait pas la Maison-Blanche, accaparé par les affaires du monde, ne fut pas présent aux moments importants de leur vie, anniversaires ou remises de diplôme. Proche d’Eleanor, Diana resta liée à l’univers des Roosevelt. Elle se maria à deux reprises, la deuxième fois avec James Halsted, veuf d’Anna Roosevelt, la fille du président. Les deux mariages se terminèrent par un divorce. Durant trente ans, Diana travailla pour la CIA comme analyste des questions de sécurité. Sa fille évoque son enfance solitaire à la Maison-Blanche avec pour principale compagnie Fala, le terrier écossais de Roosevelt. Sur plusieurs photos on la voit à côté de son père et de Churchill, tenant le chien en laisse.