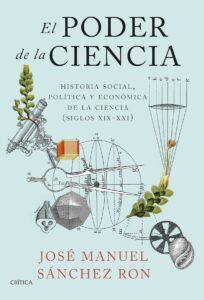Le pouvoir politique et la science
Publié en mai 2025. Par Michel André.
D’autres facteurs que la curiosité et la volonté de connaître guident, modèlent et déterminent le développement scientifique : les intérêts économiques et industriels, les forces du marché, les attentes de la société et, surtout depuis la Première Guerre mondiale, le pouvoir politique. Un historien espagnol démêle les fils de cette intrication.

C’est en 1840 que le terme « scientifique » apparaît pour la première fois, sous la plume de l’esprit universel William Whewell. À partir du milieu du XIXe siècle, dans le prolongement de l’âge des Lumières et en liaison avec la révolution industrielle, l’histoire de la science devient aussi celle de son institutionnalisation et de sa professionnalisation. Ce double processus est directement lié au développement de l’économie capitaliste et à l’essor des États-nations. Il va de pair avec une implication de plus en plus active des gouvernements et de l’industrie dans la recherche scientifique, avec des résultats variables et changeants selon les pays. À la fin du XIXe siècle, c’est l’Allemagne qui domine la scène européenne, du fait du dynamisme de son industrie (chimique, métallurgique, optique, électrique) et du rôle de personnalités comme Justus von Liebig, un des fondateurs de la chimie organique. Dans son livre El poder de la ciencia, José Manuel Sánchez Ron attribue le retard relatif de l’Angleterre à cette époque, en dépit de la qualité de ses savants (James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Lord Kelvin) et de son statut de première puissance industrielle du monde, au poids et aux contraintes de l’administration de l’Empire et au conservatisme des institutions d’enseignement. Il explique la perte d’influence de la France après l’âge d’or qu’a été de ce point de vue la période napoléonienne (avec Laplace, Monge, Arago, Berthollet, Chaptal, Joseph Fourier) par la centralisation excessive du système universitaire. À ce moment de l’Histoire, les États-Unis commencent seulement à exister sur la scène scientifique. Dans ce pays, « la période qui va de la création de la National Academy of Sciences [1863] au début de la Première Guerre mondiale en 1914, peut être décrite comme une période de croissance modérée [...] sans appui important de fonds publics et sans aucun type de planification fédérale ». L’évolution du système de production des connaissances a démarré avec les sciences physico-chimiques. Mais les décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale virent aussi la création de la médecine scientifique et expérimentale, avec Claude Bernard, puis l’essor de la théorie microbienne de Louis Pasteur et Robert Koch, avec pour conséquence la mise en œuvre des premières politiques de santé et d’hygiène.
Comme toutes les formes de connaissance, la science est source de pouvoir ; elle peut aussi être mise au service du pouvoir politique, militaire ou économique. Le pouvoir, d’un autre côté, peut encourager, soutenir et organiser le progrès scientifique, chercher à l’orienter, tenter de le contraindre ou de l’empêcher. L’histoire des sciences et celle du pouvoir sous ses formes variées sont inextricablement imbriquées.
Cette imbrication est au cœur de El poder de la ciencia, dont une troisième édition augmentée est récemment parue. Tel qu’il est évoqué dans le sous-titre (« Histoire sociale, politique et économique de la science »), l’objectif est de mettre en lumière à la fois la manière dont la science et la technologie ont façonné la société contemporaine et le jeu complexe d’interactions entre le pouvoir de la science et les autres formes de pouvoir. Pour cette raison, l’auteur avoue qu’au lieu de El poder de la ciencia, réflexion faite, il aurait mieux fait de donner à son livre le titre Poder y ciencia (« Le pouvoir et la science »), qui reflète plus fidèlement son contenu. Long de près de 1200 pages, contenant des centaines de noms, de dates et de références, l’ouvrage est organisé selon un ordre à la fois chronologique et thématique. Il traite de nombreux sujets, mais les rapports du pouvoir politique et de la science, plus particulièrement sous la forme de ses utilisations militaires, y occupent une place centrale.
On dit souvent de la Première Guerre mondiale qu’elle fut la première guerre de l’ère industrielle. Elle est aussi la première dans laquelle la science a été mise à contribution à grande échelle. Dès son éclatement, tous les belligérants mobilisèrent leurs capacités dans ce domaine au service de la victoire. Le résultat le plus connu de ces efforts est la mise au point de la première génération de gaz de combat : dichlore, phosgène, gaz moutarde. Ils furent produits en grande quantité et, sans qu’on puisse leur attribuer un rôle décisif, régulièrement utilisés sur le front par toutes les armées en présence, l’armée allemande avec une efficacité particulière. Il faut aussi mentionner les travaux menés par les savants français, anglais et américains pour développer des systèmes de détection acoustique des sous-marins.
Mais le conflit ralentit l’internationalisation de la science qui s’était amorcée à la fin du XIXe siècle. Les liens qui avaient été établis furent circonscrits aux pays victorieux et à leurs alliés, à la contrariété des scientifiques allemands, blessés dans leur orgueil. C’est ce que montre cette déclaration de Fritz Haber, inventeur du procédé de synthèse de l’ammoniac, utilisé pour la fabrication d’engrais azotés, mais aussi d’explosifs, et artisan de la guerre chimique : « Nous savons parfaitement que nous avons perdu la guerre et que nous ne pouvons prétendre à la direction du monde en termes politiques et économiques. Mais, sur le plan scientifique, nous figurons parmi les [...] principales nations. »
En dépit de l’inflation galopante et de la montée de courants de pensée irrationalistes, grâce au soutien de l’industrie du pays et d’institutions comme la fondation Rockefeller américaine, la science allemande se maintint sous la République de Weimar. Mais l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et la mise en œuvre des politiques de déjudaïsation lui portèrent un coup fatal. De 1933 à 1945, dix lauréats ou futurs lauréats du prix Nobel de physique (dont Albert Einstein, Max Born et Hans Bethe), quatre de celui de chimie (dont Fritz Haber) et six de celui de physiologie ou médecine quittèrent le pays. La plupart d’entre eux, tout comme de nombreux savants juifs autrichiens ou hongrois (John von Neumann, Edward Teller, Leo Szilard, Eugene Wigner) s’établirent aux États-Unis, où beaucoup s’étaient déjà rendus. Tous ces réfugiés y trouvèrent des postes, certains non sans difficultés, compte tenu notamment de l’antisémitisme fréquent dans le milieu universitaire américain.
Plus encore que la Première, la Seconde Guerre mondiale donna une impulsion décisive à la militarisation de la science. Sánchez Ron raconte en détail la gestation de l’idée d’une bombe extraordinairement puissante basée sur la réaction de fission, dont le principe avait été découvert par Lise Meitner et Otto Hahn, puis sa réalisation dans le cadre du projet Manhattan auquel contribuèrent, sous la direction de Robert Oppenheimer, à côté de Szilard, Teller et von Neumann, les physiciens Niels Bohr, Richard Feynman, Enrico Fermi, Emilio Segrè, Isidore Rabi, Ernest Lawrence et bien d’autres. Il explique aussi pour quelle raison, en dépit des efforts de Werner Heisenberg, l’Allemagne ne parvint pas à se doter en temps utile de l’arme atomique : le manque de cyclotrons, nécessaires pour la production de l’uranium enrichi et du plutonium composant le matériau explosif des bombes atomiques, le faible nombre de scientifiques mobilisés et le peu d’intérêt d’Hitler pour ce type de recherche. Dans ses Mémoires, son ministre de l’Armement Albert Speer rapporte n’avoir parlé qu’une seule fois de ce sujet avec lui.
Il passe également en revue les multiples autres retombées scientifiques de l’effort de guerre : la mise au point du radar (« si la bombe atomique a terminé la guerre, dit-on parfois, c’est le radar qui l’a gagnée ») ; les premiers développements de l’ordinateur, sur la base des travaux d’Alan Turing et de von Neumann, pour le décryptage des codes secrets, le calcul des trajectoires de projectiles d’artillerie (« solutions de tir ») et la modélisation des explosions nucléaires ; et les technologies de propulsion spatiale, dans le prolongement des moteurs-fusées mis au point au centre de recherche dePeenemünde par Wernher von Braun, récupéré par les Américains : « Von Braun accomplit son travail aux États-Unis avec le même enthousiasme qu’en Allemagne, splendide exemple de la souplesse politique des scientifiques – malléabilité ou un terme équivalent serait peut-être plus approprié dans ce cas. »
Durant la guerre froide, l’intérêt des autorités politiques et militaires américaines pour la recherche scientifique continua à se manifester dans de nombreux autres domaines : l’aéronautique, sous l’impulsion de l’expert en dynamique des fluides et aérodynamique Theodore von Kármán, la physique de l’état solide, avec les transistors puis les microprocesseurs, la physique des hautes énergies et des particules.
Dans la dernière partie du livre, d’autres formes de pouvoir apparaissent au premier plan parmi les facteurs qui, à côté de la curiosité et de la volonté de connaître, guident, modèlent et déterminent le développement scientifique : les intérêts économiques et industriels, les puissantes forces du marché, les attentes et les pressions de la société. Ce sont eux qui sont largement à l’œuvre derrière les progrès spectaculaires, au cours de la dernière partie du XXe siècle, des technologies de l’information et de la communication, jusqu’aux récentes réalisations en matière d’intelligence artificielle. Derrière, aussi, l’essor des technologies médicales (par exemple d’imagerie), ainsi que les multiples applications de la génétique et de la biologie moléculaire en médecine et en agronomie, sur la base de la découverte, en 1953, par James Watson et Francis Crick, du code génétique, dans le prolongement des idées du physicien Erwin Schrödinger et des travaux de Max Delbrück et Max Perutz. La période la plus récente voit par ailleurs surgir de nouveaux acteurs : le livre se termine par l’évocation d’une expérience sur le phénomène d’intrication quantique menée par une équipe internationale à l’aide de satellites chinois. Si une quatrième édition paraît un jour, la politique scientifique et technologique de la Chine y occupera obligatoirement une place très importante.
La science et la politique et leurs rapports ont leur logique propre mais sont aussi affaires d’hommes. On ne peut qu’être frappé par le rôle particulier joué, dans l’histoire des relations de la science et du pouvoir, par des scientifiques un peu atypiques, familiers de plusieurs disciplines et passant de l’une à l’autre, liés souvent de surcroît au monde politique : des personnalités comme von Neumann, Szilard, Oppenheimer, Vannevar Bush (créateur de la National Science Foundation), J. D. Bernal (pionnier de la cristallographie en biologie moléculaire et théoricien de la science), Norbert Wiener (fondateur de la cybernétique), Claude Shannon (père de la théorie de l’information) et de nombreux autres.
On notera qu’il n’est pas question, dans El poder de la ciencia, de la statistique, dont la naissance et le développement sont pourtant inséparables de l’histoire politique, économique et sociale. Résolu à s’en tenir aux disciplines qu’il connaît le mieux, Sánchez Ron laisse aussi de côté l’économie, la démographie, la psychologie et la sociologie, dont les liens avec les réalités politiques et les formes de pouvoir qui leur sont associées ne sont pas moindres.L’ouvrage ne s’appuie par ailleurs sur aucune théorie particulière, philosophique, politique ou sociologique de la science et du pouvoir. Il laisse largement au lecteur le soin de forger sa vision de leurs relations sur la base des faits et des développements qu’il rapporte, avec un luxe de détails et une précision qui font de ce livre une riche source d’information. Sánchez Ron aborde son sujet en historien aimant se plonger dans les archives. En faisant entendre la voix des scientifiques eux-mêmes, les nombreux extraits de correspondance, d’écrits autobiographiques, de notes personnelles, d’articles de presse et de textes de conférences pour le grand public qu’il cite aident à rendre vivant ce gros livre touffu.