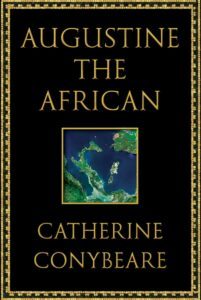Saint Augustin le Maghrébin
Publié en octobre 2025. Par Books.
Arrière-grand-père de l’humanisme européen, saint Augustin était africain (du Nord). Ce n’est pas vraiment un scoop : on sait bien qu’il est né en 354 d’un père citoyen romain et d’une mère berbère, et qu’il a passé toute sa longue vie entre Thagaste (Souk Ahras), Carthage (Tunis) et Hippone (Annaba) dont il fut trente ans l’évêque, après juste cinq ans passés en Italie. Mais la nouvelle biographe augustinienne, Catherine Conybeare, va plus loin. Selon elle, celui qui fut « un des plus importants auteurs-penseurs de l’histoire de l’humanité […], qui a façonné le christianisme et la philosophie occidentale […], qui a joué un rôle pionnier dans pratiquement chaque domaine de l’humanisme » était en réalité profondément marqué par l’Afrique. « À partir du moment où l’on envisage pleinement la vie d’Augustin dans la perspective africaine, le point de vue sur ses combats, ses alliances, ses positions philosophiques et politiques se décale… » La biographie de la philologue britannique a pour propos de « capturer le décalage » au cœur d’une personnalité volontiers divisée contre elle-même – d’où l’intérêt passionné d’Augustin pour sa propre subjectivité et la question de l’ego humain. Conybeare sonde les textes augustiniens (on en a conservé plus de 5 millions de mots) pour y dénicher les contradictions d’un homme tenaillé, par exemple, entre l’ambition d’être reconnu pour sa supériorité intellectuelle ou la perfection de son éloquence latine, et un tenace sentiment d’infériorité et de non-appartenance que ravivent ses étudiants lorsqu’ils se moquent de son accent africain. Elle souligne aussi l’ambivalence du Maghrébin face au colonisateur romain : Augustin vénère l’Énéide de Virgile, socle de sa culture latine, et semble éprouver une émotion quasi amoureuse envers Didon, la reine de Carthage, qui s’est suicidée après avoir été abandonnée par Énée. Mais s’il admire intensément Rome, il ne cesse d’évoquer (entre les lignes) la fragilité impériale, comme celle de toutes les institutions humaines au regard de « La Cité de Dieu ». Orfèvre du latin, Augustin a aussi une deuxième langue, le phénicien (le punique de Carthage), laquelle informe sa lecture et son interprétation de la Bible et ses réflexions de proto-linguistique. Même son christianisme est puissamment ancré dans les traditions orientales et africaines que pourtant il combattra avec acharnement : le dualisme manichéen, dont il a été longtemps l’adepte ; et surtout le donatisme, un schisme qui « opposait les puritains numides de “l’église d’Afrique” à “l’église en Afrique” », c’est-à-dire au catholicisme romain. Il défendra ce dernier par écrit avant de rechercher carrément l’appui de l’État.
Pour Catherine Conybeare, ce sont les copistes du Moyen Âge qui ont innocemment dépouillé Augustin de son africanisme et l’ont européanisé, simplifiant au passage une pensée d’une complexité infinie. « Quand on a préservé ses écrits en Europe, on a gommé la distinctive composante africaine de sa vie. En reprenant en compte ce contexte, on redécouvre sa pensée », écrit Jonathan Egid dans The Times Literary Supplement. On comprend alors combien les conflits qui tiraillaient le philosophe-théologien propulsaient sa réflexion comme un moteur deux temps fonctionnant par alternance dialectique : d’abord entre le patriotisme enfiévré du citoyen romain et le particularisme de l’homme à la périphérie de l’empire, mais aussi entre le Bien et le Mal, entre la liberté de l’homme et sa condition pécheresse, entre la raison et la foi, pour ne citer que les dichotomies les plus fameuses. Mais ce tumulte qui galvanise la métaphysique d’Augustin procure un bénéfice supplémentaire : d’un futur saint, il a fait un homme bien terrestre qui avouait prier Dieu « de le rendre chaste, mais pas tout de suite » !