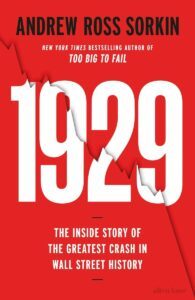Les coulisses d’un krach historique
Publié en décembre 2025. Par Michel André.
Alors que se crée sous nos yeux la bulle financière de l’intelligence artificielle, il n’est pas sans intérêt de revenir sur les facteurs qui ont conduit au krach de 1929, origine de la plus grande dépression économique de l’histoire du capitalisme.

Près d’un siècle après qu’il s’est produit, le krach de Wall Street de 1929 continue de fasciner. Loin d’en effacer le souvenir, la crise financière de 2008, d’une ampleur comparable, n’a fait que renforcer l’intérêt pour cet événement dramatique. L’effondrement spectaculaire de la bourse de New York les 24, 28 et 29 octobre 1929, passés dans l’histoire économique sous le nom de « jeudi noir », « lundi noir » et « mardi noir », n’était pas le premier épisode de ce type. Lors de la panique de 1907, les cours avaient chuté jusqu’à la moitié de leur niveau de l’année précédente, contraignant les banques rassemblées à l’initiative du puissant J. P. Morgan à sacrifier quelques-unes d’entre elles pour sauver celles qui pouvaient l’être. Ce ne fut pas non plus le dernier krach du XXe siècle : en 1987, après une dégringolade des cours du même ordre de grandeur, le désastre fut évité grâce à l’injection massive de liquidités dans le système bancaire par la Réserve fédérale des États-Unis (FED). En 2008, elle répéta d’ailleurs l’opération à l’échelle mondiale. Mais en 1929, la FED encore peu aguerrie (elle avait été créée en 1913) n’intervint que trop tard et de manière insuffisante, jouant avec réticence le rôle de prêteur en dernier ressort. La crise boursière se transforma rapidement en une crise bancaire, puis celle-ci en une crise économique de longue durée.
La relation exacte entre le krach de 1929 et la Grande Dépression des années 1930 est un sujet de controverse parmi les économistes. Mais il a incontestablement donné le signal de son déclenchement. L’épisode a fait l’objet d’innombrables analyses. Au milieu des années 1950, John Kenneth Galbraith lui a consacré un livre qui demeure un classique. Trouvant dommage que cette suite d’événements ait exclusivement bénéficié de l’attention des économistes et des historiens, le journaliste Andrew Ross Sorkin raconte son histoire dans sa dimension de drame humain. Sur le modèle de Too Big to Fail, son ouvrage sur la crise financière de 2008, son récit se concentre sur les agissements et les sentiments d’une série de personnages-clés. Parce qu’il est spécialisé dans le journalisme économique et financier, qu’il a lu tout ce qui a été écrit sur le sujet et effectué huit ans de recherches sur des archives en partie inédites, ce récit est solide et bien informé. Le livre prend la forme d’un thriller avec suspense et rebondissements, et on peut légitimement s’attendre à ce qu’il soit un jour adapté au cinéma ou donne lieu à une série télévisée, comme son ouvrage précédent.
Au moment où le krach de Wall Street s’est produit, l’état de santé de l’économie américaine n’était pas éclatant. Dans un environnement international instable marqué par des tensions importantes sur le marché des produits agricoles, des matières premières et des produits industriels, après une période d’expansion et de croissance, la production avait commencé à baisser. Surtout, depuis plusieurs mois, un phénomène « d’orgie spéculative » faisait rage. Longtemps, dans l’Amérique puritaine, le crédit et l’emprunt étaient restés frappés d’opprobre. Mais avec le développement du marché de l’automobile, la formule de l’achat à tempérament avait fait son apparition, pour s’étendre bientôt à l’achat d’appareils domestiques. Dans les milieux bancaires germa l’idée de l’appliquer au domaine des actions, en offrant aux acheteurs des conditions extrêmement tentantes : grâce à la technique de l’achat « à la marge », ils pouvaient acquérir une action en ne payant que 10 % de son prix, empruntant les 90 % restants à l’agent de change, qui se les procurait auprès d’une banque. Les actions ainsi achetées ne l’étaient pas dans le but d’en toucher les dividendes, mais dans un but spéculatif : si les cours continuaient à monter, leur revente rapide engendrait un bénéfice que l’acheteur et le courtier se partageaient. Des millions d’Américains de toutes classes sociales se mirent ainsi à spéculer. Des agences de courtage s’ouvrirent à tous les coins de rue. Les cours ne cessaient de monter, sous l’impulsion de la conviction générale qu’ils allaient continuer à grimper. Ils le faisaient d’ailleurs d’autant plus facilement qu’ils étaient manipulés par des groupes d’investisseurs qui, en toute légalité (les activités boursières et bancaires étaient alors peu réglementées), et parfois en plein jour, les faisaient monter artificiellement.
Des voix s’élevèrent pour mettre le public en garde. L’économiste Roger Babson, par exemple, prévint à plusieurs reprises : « Tôt ou tard, un krach va se produire, qui affectera les valeurs de premier ordre et entraînera une chute de 60 à 80 points de l’indice Dow Jones ». Mais son prestigieux confrère Irving Fisher se montrait, lui, résolument optimiste. « Les prix des actions, déclarait-il le 15 octobre, ont atteint ce qui semble être un haut plateau permanent. […] Je m’attends à voir le marché des actions à un niveau sensiblement plus élevé d’ici quelques mois. » Deux semaines plus tard, les cours s’effondraient, ruinant une grande quantité de spéculateurs. Andrew Ross Sorkin démonte à cet égard le mythe voulant que le krach engendra une vague de suicides. Il y en eut, certes, mais pas dans les proportions parfois évoquées.
Parmi les personnages pris dans la tourmente du krach dont les histoires servent de fil conducteur au récit, deux figures se détachent. La première est celle de Charles Mitchell, président de la National City Bank. Promoteur enthousiaste de la technique de l’achat « à la marge », il est étroitement associé aux initiatives financières risquées qui conduisirent à la débâcle. Pour cette raison, il a été un peu vite tenu pour un des principaux responsables de celle-ci, particulièrement par le sénateur Carter Glass, qui le poursuivit longtemps de son hostilité. En 1933, il eut à répondre des pratiques de la National City Bank avant et durant la crise devant une commission du Sénat. Il perdit lui-même beaucoup d’argent. Lorsque les cours commencèrent à s’écrouler, apprenant, au retour d’une réunion du bureau de la Réserve fédérale de New York, dont il faisait partie, que la National City Bank, pour éviter que ses actions ne tombent trop bas, en avait racheté une très grande quantité, sachant que la banque n’avait pas de liquidités en suffisance, il n’hésita pas à emprunter personnellement 6 millions de dollars à la banque J. P. Morgan pour acquérir secrètement ces actions lui-même, les ajoutant au stock qu’il détenait. Durant les semaines qui suivirent la panique, il en vendit un certain nombre. Accusé d’évasion fiscale pour en avoir vendu d’autres par la suite, à sa femme, afin de pouvoir déclarer des pertes l’exemptant d’impôt, il fut acquitté au pénal mais condamné au civil.
Une autre personnalité au centre des événements est Thomas Lamont, directeur général de facto de la banque J. P. Morgan. À la mort de J. P. Morgan, son fils lui succéda à la tête de la banque. Assez lucide et honnête pour se savoir moins compétent que son illustre père, il laissa Thomas Lamont gérer l’établissement. Infatigable promoteur des intérêts de la banque aux quatre coins du monde, une des premières personnalités de la finance à figurer en couverture des magazines, Lamont fut pris par surprise par l’effondrement de la bourse. Comme J. P. Morgan l’avait fait en 1907, il réunit les directeurs des grandes banques du pays pour réaliser en secret un achat massif de valeurs sûres. Mais, cette fois, cela ne fut pas suffisant pour enrayer la chute. Il avait d’ailleurs prévenu les membres de la commission de la bourse : « Aucun individu, ou groupe d’individus, n’est en position d’acheter toutes les actions que le public américain peut vendre. »
Une des figures les plus flamboyantes du récit de Sorkin est le légendaire trader Jesse Livermore. Objet de « fascination, d’envie et de suspicion », observé avec une attention passionnée par tous ceux qui voulaient percer le secret de ses succès, c’était un spécialiste de la spéculation à la baisse, la vente à découvert. La hausse continue des cours, au cours des premiers mois de 1929, ne lui permit pas de déployer ses talents en la matière, mais le krach de 1929 le laissa plus riche que jamais. À la suite d’un de ces coups audacieux dont il était coutumier, il perdit par la suite presque tout. « Comme tous les parieurs, remarque Sorkin, il vivait plus pour l’excitation du risque que pour les profits. » Après de nouveaux déboires, il se suicida en 1940, laissant à sa troisième et dernière femme une lettre dans laquelle il déclarait être « fatigué de lutter ».
Toute la seconde moitié du livre d’Andrew Ross Sorkin est consacrée aux suites du krach. Le récit court en effet jusqu’en 1933, après l’élection de F. D. Roosevelt à la présidence des États-Unis. Il est courant de tenir son prédécesseur Herbert Hoover pour largement responsable de la crise de 1929 et de considérer Roosevelt comme celui qui a permis aux États-Unis de commencer à en sortir. Sorkin réhabilite Hoover. Certes, celui-ci a longtemps cru que le gouvernement devait surtout se garder d’intervenir dans la vie économique, mais face à la catastrophe il revint sur cette position de principe. Lorsqu’il se décida à agir, il se heurta toutefois à la résistance du Congrès, où dominaient les partisans d’une non-intervention, et à l’opposition féroce de son secrétaire au Trésor Andrew Mellon, convaincu que la crise était un développement naturel dans le cycle des affaires et allait très heureusement « liquider la main-d’œuvre, liquider les actions, liquider les agriculteurs, liquider l’immobilier. Purger le système de toute corruption. » Hoover parvint malgré tout à mettre en place une agence fédérale de prêt qui permit de sauver un certain nombre d’entreprises de la faillite, sans parvenir pour autant à relancer l’activité économique. Durant les derniers mois de son mandat, il déploya discrètement des efforts considérables pour convaincre Roosevelt, qui avait été élu mais n’avait pas encore pris ses fonctions, d’appuyer l’idée d’une suspension temporaire des transactions bancaires. Soucieux, pour des raisons politiques, de ne s’associer à aucune initiative de son prédécesseur et de donner l’impression d’un tout nouveau départ, Roosevelt attendit son investiture pour adopter lui-même cette mesure.
On a reproché à Sorkin de se montrer trop indulgent à l’égard de certains des hommes dont il raconte l’histoire. Il ne condamne en effet que ceux qui se sont livrés à des actes clairement illégaux, sans mettre en cause le comportement tout de même contestable de plusieurs autres, au motif que « le marché n’est pas un concours de vertu ou d’honneur ». À l’inverse, certains l’ont accusé de trop suivre l’interprétation de Galbraith, qui attribue fondamentalement le krach à la spéculation et l’absence de réglementation et explique qu’il ait conduit à une crise par la combinaison de faiblesses structurelles du monde des entreprises et des banques et d’une mauvaise appréhension des lois de l’économie par les autorités. Aux yeux de ces commentateurs, le krach n’était en effet jamais qu’une saine correction du fonctionnement du marché et la Grande Dépression fut la conséquence des politiques d’esprit keynésien mises en œuvre après 1929. Pour le monétariste Milton Friedman, pourtant généralement hostile à l’intervention de l’État dans l’économie, c’est la réticence du gouvernement et de la FED à contrer la contraction de la masse monétaire en prêtant massivement aux banques qui transforma une récession ordinaire en profonde dépression.
Sorkin, qui a foi dans le marché et le capitalisme et considère même qu’un peu de spéculation est utile à l’innovation et la croissance, voit surtout dans l’histoire du krach de 1929 une invitation à la modestie. La nature humaine étant ce qu’elle est, « l’antidote à l’exubérance irrationnelle […] est l’humilité ». Conçu comme un thriller, 1929 se veut aussi un avertissement. Le livre ne contient aucune comparaison explicite avec la crise financière de 2008, ni avec la situation boursière actuelle. Mais on voit bien les points communs. L’engouement extraordinaire dont fait aujourd’hui l’objet l’intelligence artificielle, en propulsant les actifs des sociétés du secteur très au-delà de la valeur économique réelle de leur activité, engendre la formation d’une bulle financière. La question n’est pas de savoir si elle va éclater (toutes finissent par le faire), mais quand et, surtout, compte tenu de l’environnement économique dangereux (dettes publiques et privées énormes, endettement caché dans le système bancaire parallèle, forte interconnexion du système bancaire et des économies à l’échelle mondiale), avec quelles conséquences : sérieuses mais limitées, comme la « bulle Internet » de l’an 2000, ou considérables, comme en 1929 et 2008.