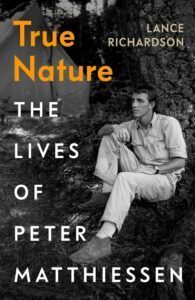Toutes les vies de Peter Matthiessen
Publié en février 2026. Par Michel André.
Pionnier de la défense de l’environnement et du combat pour les droits des populations indiennes, aventurier intrépide, l’auteur du Léopard des neiges fut aussi brièvement pêcheur sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, responsable d’une revue littéraire à Paris et éphémère agent de la CIA.

« Les gens me demandent toujours de les introduire auprès de Peter Matthiessen, déclara un jour l’écrivain James Salter, mais il est difficile de savoir quel Matthiessen ils voudraient rencontrer. » Bien que se définissant d’abord comme un auteur de fiction, l’homme est surtout connu pour ses récits de voyage et ses écrits sur la nature. Pionnier de la défense de l’environnement et du combat pour les droits des populations indiennes, aventurier intrépide, il fut aussi brièvement pêcheur sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, responsable d’une revue littéraire à Paris et éphémère agent de la CIA. Au terme de huit ans de recherches dans des archives inédites et de quelque 200 entretiens, Lance Richardson brosse le portrait d’un homme à la fois charismatique et égocentrique, brillant et naïvement idéaliste, épris de justice sociale et peu compatissant avec ses proches.
Peter Matthiessen est né en 1927 à New York dans une famille aisée. L’atmosphère y était froide. Ses rapports avec son père ne furent jamais bons. Il avait le sentiment de ne pas être le préféré de sa mère, ce que celle-ci lui confirma plus tard. Lorsqu’il avait 10 ans, ses parents, fatigués de la vie mondaine, déménagèrent dans une région rurale du Connecticut. Son goût pour l’observation de la nature, en particulier les oiseaux, qui s’était formé dans la propriété de vacances de la famille à Fishers Island, s’y épanouit. Enfant, il aimait les histoires de James Fenimore Cooper et de Rudyard Kipling et les récits animaliers de A. A. Milne et Kenneth Grahame. Il ne brilla particulièrement ni à St Bernard, ni à Hotchkiss, les deux écoles d’élite qu’il fréquenta. Mais ses goûts littéraires s’élargirent progressivement et il commença à écrire. Enfant peu discipliné, il fut un adolescent rebelle. En révolte contre son milieu, il demanda à ses parents de rayer son nom du « Social Register », une sorte de Who’s Who des élites américaines, ce qu’ils ne firent pas.
Inscrit à l’université de Yale après un passage dans la marine de guerre, il n’y suivit guère les cours. Approché, comme d’autres étudiants, par un de ses professeurs qui recrutait pour la CIA, il accepta d’entrer au service de l’organisation, principalement parce qu’on lui offrait de retourner à Paris. Lors d’un séjour dans cette ville dans le cadre d’un programme d’envoi d’étudiants américains en France, il y avait fait la connaissance de Patsy Southgate, qu’il avait entre-temps épousée. Son travail pour la CIA consistait à fournir des informations sur des personnes vivant à Paris, communistes ou soupçonnées de sympathie pour le parti. Il est possible qu’il ait rédigé des rapports sur les écrivains Richard Wright et Tristan Tzara et le dramaturge Irwin Shaw. En partie pour disposer d’une couverture crédible, il fonda avec George Plimpton et Harold L. Humes la Paris Review. Peu intéressé par le métier d’éditeur, tout en restant membre du comité de rédaction, il cessa de s’en occuper lorsqu’il quitta la CIA parce qu’on lui demandait d’infiltrer les milieux qu’il surveillait. Matthiessen évoquera par la suite rarement cet épisode de sa vie, dont il dira lors d’un entretien avec le journaliste Charlie Rose que de toutes ses aventures c’était la seule qu’il regrettait.
De retour aux États-Unis en 1953, il s’installa avec sa famille à Long Island, où il passa plusieurs années au milieu d’une population de pêcheurs très pauvres à qui il cachait ses activités d’écrivain. Sa carrière littéraire avait en effet démarré. Une de ses nouvelles avait été publiée par The Atlantic Monthly. D’autres avaient été refusées, tout comme un projet de roman, sèchement renvoyé dans des termes dont il se souvint toute sa vie. Entre 1954 et 1961, il rédigea trois romans autobiographiques qui furent publiés sans susciter d’écho particulier et qu’il renia par la suite comme des œuvres de jeunesse. Le succès vint en 1965 avec En liberté dans les champs du Seigneur, récit d’aventures dont l’action se passe en Amazonie. À la manière des histoires de Joseph Conrad, il met en scène des personnages tourmentés dans un décor exotique. Suivra, dix ans plus tard, Far Tortuga, qui raconte un épisode de la vie de pêcheurs de tortues dans les îles Caïmans sous une forme poétique et expérimentale ainsi décrite par Richardson : « Tout l’attirail de la prose a disparu : transitions, liens, paragraphes conventionnels. Il ne reste qu’un assemblage d’images, décrites avec un minimum d’embellissements, à la façon des indications dépouillées d’un scénario. » Ce livre étrange était, de tous les siens, celui que Matthiessen préférait. En 1990 parut le premier volume d’une trilogie sur la vie d’un planteur de canne à sucre du Sud de la Floride à la réputation féroce, massacré de 33 balles dans le corps par la population locale. Tant l’intrigue que le procédé consistant à faire raconter l’histoire par de multiples voix évoquent les romans de William Faulkner. Une version très remaniée en un seul livre fut publiée neuf ans après le dernier volume, sous le titre Shadow Country. L’ouvrage fut salué par la critique.
Quelques années après son retour aux États-Unis, Matthiessen avait fait paraître Wildlife in America, une étude de la faune et de la flore des États-Unis qui était surtout un cri d’alarme face à l’extinction des espèces et, trois ans avant le Printemps silencieux de Rachel Carson, un plaidoyer pour la préservation de l’environnement. Refusant d’être rangé parmi les écrivains naturalistes et préférant l’étiquette d’écrivain et d’activiste de l’environnement, il publia par la suite une série d’ouvrages et de reportages (notamment dans le New Yorker) à la fois personnels, savants et d’une grande qualité stylistique, tirés de ses voyages en Amérique du Sud, en Afrique, en Indonésie, en Nouvelle-Guinée, au Népal, en Corée, en Mongolie, en Sibérie et dans l’Antarctique. Il consacra aussi un livre au syndicaliste d’origine mexicaine César Chávez, qui luttait pour l’amélioration des conditions de travail des ouvriers agricoles, et en publia deux autres en défense des droits des populations indiennes d’Amérique du Nord. L’un d’entre eux, In the Spirit of Crazy Horse, dans lequel il soutenait l’innocence d’un leader indien nommé Leonard Peltier accusé d’avoir tué deux agents du FBI, lui valut, ainsi qu’à son éditeur, deux plaintes pour diffamation. Au terme d’une longue bataille juridique, elles furent rejetées et l’ouvrage, longtemps interdit, fut autorisé à la vente. Matthiessen témoigna dans cette affaire d’une incontestable naïveté en ajoutant foi aux propos tenus par un homme qui se prétendait le véritable tueur et se révélèrent le produit d’une supercherie. De manière générale, ainsi que le souligne Richardson, sa vision de la nature et des cultures traditionnelles, en dépit de la connaissance qu’il en avait, était très romantique.
L’ouvrage pour lequel il est le plus connu est Le Léopard des neiges, récit d’un voyage au Népal qui fut en même temps une quête spirituelle. Il l’effectua en compagnie du naturaliste George Schaller, parti dans l’Himalaya pour étudier une race locale de petits ruminants. L’objectif de Matthiessen était d’apercevoir le légendaire félin qui donne son titre au livre – il ne le vit jamais. Mais le livre est aussi une méditation sur la vie et la mort, la mémoire et le sens de l’existence après le décès précoce, peu avant son départ, de Deborah Love, devenue sa deuxième femme (lassée de ne le voir qu’entre deux voyages, la première avait demandé le divorce). Son souvenir est fréquemment évoqué dans le récit. Il y avoue aussi ses remords d’avoir négligé ses enfants. Pour l’occasion, il avait abandonné son très jeune garçon devenu orphelin de mère.
Dans Le Léopard des neiges, il est constamment question de la sagesse bouddhiste et du zen, auquel Deborah l’avait initié. En Amazonie, Matthiessen avait expérimenté l’ayahuasca, une décoction hallucinogène utilisée par les shamans de certaines tribus. Aux États-Unis, pour atteindre des états de conscience modifiés, lui et Deborah avaient fait usage du LSD. Le zen finit par lui sembler le meilleur moyen d’accéder à la connaissance de lui-même. Il ne cessa d’occuper une place centrale dans sa vie. S’astreignant à la discipline et aux exercices quotidiens qu’implique sa pratique, il devint un maître zen sous le nom de Muryo Roshi. Dans la maison en bois au milieu des arbres sur la côte de Long Island où il habita durant plus de cinq décennies, les quarante dernières années de sa vie en compagnie de sa troisième femme, Maria Koenig, une pièce importante était l’ancienne étable convertie en zendo où il méditait et enseignait. Une autre était l’espèce de chalet dans lequel il s’enfermait pour écrire durant de longues heures. Parmi les papiers inédits que Richardson a trouvés dans ses archives figure un épais dossier sur Bigfoot, la mystérieuse créature bipède velue censée hanter certaines forêts américaines, qui l’obséda toute sa vie.
Doté d’un physique avantageux d’acteur de cinéma et nimbé d’une aura d’aventures, Matthiessen attirait les femmes. Il ne fit aucun effort pour ne pas en profiter. Tout au long de ses trois mariages, il entretint en permanence de multiples liaisons, souvent plusieurs simultanément. Les six enfants avec lesquels il vécut (trois de lui, un de sa deuxième femme et les deux filles de la troisième) affirment ne l’avoir vu qu’assez peu. Sociable, souvent drôle, chaleureux avec ses amis parmi lesquels les écrivains William Styron, Jim Harrison et Kurt Vonnegut, il pouvait se montrer très dur avec ses éditeurs et mordant avec les critiques.
Un de ses traits de caractère les plus frappants était son incapacité à rester en place : un irrépressible besoin d’être toujours en mouvement. Donnant l’impression de fuir en permanence, perpétuellement insatisfait, il était, de son propre aveu, à la recherche d’un objet insaisissable, sa « vraie nature », pour reprendre la formule bouddhiste qui sert de titre au livre de Lance Richardson. Une quête inséparable, dans son esprit, du contact intime avec la nature sauvage, de « la nostalgie primordiale d’un paradis perdu », de la volonté de retrouver « le sens de l’origine, de l’innocence et du mystère, comme une merveilleuse capacité d’enfance restaurée ».
Lorsqu’il est mort de leucémie, à l’âge de 86 ans, avait-il atteint la sérénité ? Sur le chemin qu’il a suivi pour y arriver, il nous a en tout cas laissé de nombreuses pages où se déploient d’extraordinaires capacités d’observation et de description de la nature, comme dans ce passage sur la faune africaine : « Les vautours courent comme des voleurs boiteux, en galopant par petits sauts, à demi tournés, l’air recroquevillé, comme s’ils serraient contre leur poitrine aux plumes raides et fanées quelque chose de honteux. Le marabout, avec son crâne décharné et ses pattes pâles […], s’élève dans les airs dans un battement d’ailes creux, tel un linceul qui s’envole, dans un horrible claquement sourd de son bec puissant capable de percer les peaux les plus dures et d’ouvrir les carcasses qui résistent aux becs crochus des vautours bossus. Les vautours volent avec un rythme plus martelé, et la cacophonie des deux espèces, s’éloignant des charognes, est un son ancestral de l’Afrique, un rappel poignant de la mortalité. »