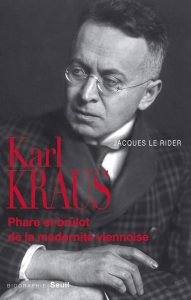Au ciel de la littérature satirique, polémique et pamphlétaire scintille le nom de Karl Kraus, « l’une des étoiles les plus brillantes […] de la modernité viennoise », pour utiliser la belle formule de Jacques Le Rider. De 1899 à 1936, Kraus, qui affirmait détester Vienne mais était incapable de vivre ailleurs, publia la revue
Die Fackel (« la torche » ou « le flambeau »), dont il fut le seul rédacteur à partir de 1911. Franz Kafka, Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Elias Canetti étaient ses lecteurs enthousiastes, comme le seront Bertolt Brecht, Theodor Adorno et Max Horkheimer.
Die Fackel, dont la collection complète représente plus de 20 000 pages, paraissait sans contrainte de périodicité ou de longueur. Sous des formes littéraires variées (l’aphorisme, la parodie, la longue diatribe), Kraus s’y livrait sans relâche à une critique féroce de tout ce qui le révulsait dans la société viennoise de son temps : la corruption économique, l’hypocrisie de la morale bourgeoise, la détérioration de la langue, l’idéologie naïve du progrès. Non dans l’espoir de changer quoi que ce soit, mais parce qu’il s’y sentait contraint : « Il n’y a pas moyen d’amender les scélérats, observait-il en des termes évoquant ceux d’un autre grand satiriste, Jonathan Swift, mais c’est une obligation morale de les embêter. »
La cible principale des sarcasmes véhéments de Kraus, c’était la presse, à ses yeux la source de tous les maux. Inlassablement, il dénonçait sa soumission au pouvoir politique, son inféodation aux puissances de l’argent, la logique mercantile de son fonctionnement. Il s’insurgeait contre la confusion qu’elle installe dans les esprits par le mélange des faits et des commentaires, qu’il voyait à l’œuvre dans le genre du « feuilleton », mauvais hybride de journalisme et de littérature. En des termes anticipant de manière frappante la critique contemporaine des médias, il stigmatisait la propension des journaux à fabriquer une fausse réalité, mensongère et artificielle.
Pionnier de la défense de la nature à une époque où le grand rêve industriel triomphait, il s’interrogeait sardoniquement sur le temps nécessaire pour transformer quelques arbres « sur les branches desquels [...] les oiseaux gazouillaient » en un journal imprimé.
Dans un premier temps, la cible privilégiée de ses commentaires enflammés fut le grand quotidien libéral bourgeois
Neue Freie Presse, de Moriz Benedikt. Lorsque Imre Békessy lança
Die Stunde, journal progressiste et populaire pratiquant le sensationnalisme, son combat devint encore plus âpre. Békessy extorquait à des personnalités du monde industriel des sommes importantes en échange de la publication d’articles favorables ou de la non-publication d’informations de nature à leur nuire. Scandalisé par ces pratiques de chantage, Kraus, sous la devise « Cette crapule doit être chassée de Vienne », mena contre lui une campagne difficile, qui lui coûta, dira-t-il, quelque six mille sept cents heures de travail avant de pouvoir crier victoire : poursuivi pour fraude et extorsion, Békessy se réfugia à Paris.
Le paradoxe, relève Jacques Le Rider, est que Kraus, qui exécrait la presse, consacrait une bonne partie de ses journées à la lire (il écrivait la nuit) : « Lui qui clamait sa haine de la presse ne pouvait se passer de journaux. » La presse était la fenêtre à travers laquelle il regardait le monde – il affirmait y apercevoir « le visage grimaçant de l’époque ». Elle lui fournissait aussi la matière première de ses écrits. Pour une part importante, ceux-ci consistent en effet en d’astucieux collages de citations commentées, mais dont le simple énoncé, ou le rapprochement, suffisaient à produire des effets dévastateurs. Il avait un œil d’aigle pour repérer les titres ridicules et les expressions absurdes.
Pour lutter contre ce qu’il appelait « la phraséologie », Kraus entendait « drainer le vaste marais des slogans et des clichés ». Horkheimer a dit de lui avec admiration qu’il a construit « une sociologie de la langue, non à partir des sciences sociales mais de la langue elle-même ». Ses observations sur le langage de l’idéologie nationale-socialiste, par exemple, anticipent la célèbre analyse de Victor Klemperer,
LTI, la langue du IIIe Reich. Comme George Orwell, il était convaincu que la
corruption du langage et celle de la pensée étaient inséparables. Mais, dans ce domaine, il était nettement plus radical que lui, ainsi que le fait remarquer Jacques Bouveresse après Edward Timms, son biographe britannique. Pour Orwell, la causalité s’exerçait dans les deux sens. Pour Kraus, elle n’était pas loin d’être unilatérale : dans son esprit, la dégradation de la langue était une cause bien plus qu’un effet. Il était notoirement obsédé par l’emploi correct des virgules. Sa propre langue est extrêmement difficile à traduire. D’une grande complexité, elle tire toute sa puissance comique et évocatrice d’un usage sophistiqué des jeux de mots, des assonances, des néologismes et des paradoxes, ainsi lorsqu’il parle de l’Autriche-Hongrie comme d’un « empire sur lequel le soleil ne se lève jamais » ou évoque « tous les livres qu’il a le temps de ne pas lire ».
L'aversion de Kraus à l’égard de la presse s’enracine dans son expérience de la Première Guerre mondiale et son exposition à la propagande nationaliste et belliciste à laquelle se sont livrés les journaux à cette occasion, ce qu’on appelait à l’époque le « bourrage de crâne ». « Les diplomates disent des mensonges aux journalistes, observait-il, puis ils les croient quand ils les voient imprimés. » Le radicalisme de sa vision le conduisait à attribuer à la presse la responsabilité première, quasiment totale et exclusive, du conflit. Avec la tragédie satirique
Les Derniers Jours de l’humanité, il livrera en 1919 un des textes littéraires les plus forts suscités par la guerre de 14-18, qu’il considérait comme marquant la fin de la civilisation. Il était convaincu que la Grande Guerre avait ouvert le chemin à une autre, qui allait être plus terrible encore.
Une légende fondée sur une interprétation au premier degré de la célèbre phrase parue en 1934 dans
Die Fackel («
Mir fällt zu Hitler nichts ein », « Hitler ne m’inspire rien ») veut qu’il ait été aveugle aux conséquences prévisibles de l’accession d’Hitler au pouvoir. Rien n’est plus faux. Le sens de la phrase est évidemment que, face à un phénomène aussi monstrueux au sens littéral du mot, l’esprit le mieux armé reste sans voix et la satire est impuissante. Ainsi que le montre
Troisième nuit de Walpurgis, un texte qu’il n’a jamais publié en entier, dès 1933, Kraus avait parfaitement saisi tout ce qui dans la nature du régime nazi, son mélange inédit d’archaïsme et de culte de la technique, le rendait particulièrement dangereux. Des camps de concentration à l’action de propagande de Goebbels, des tortures aux exécutions sommaires en passant par la complaisance de penseurs comme Heidegger, qui « proposent dans les universités et les revues de faire de la philosophie une école préparatoire aux idées d’Hitler », tout était annoncé. Et, une fois encore, c’est vers la presse qu’il pointait le doigt : « Le national-socialisme n’a pas anéanti la presse, mais la presse a produit le national-socialisme. »
Son analyse des phénomènes politiques était morale et culturelle ; elle exprimait une vision prophétique et apocalyptique de l’histoire. Jamais il n’eut d’affiliation politique claire et stable. Conservateur sous bien des aspects, antilibéral en économie, proche à certains égards de la social-démocratie, critique des excès du capitalisme plutôt que de son principe, sympathisant, à une certaine époque, de la gauche révolutionnaire de Rosa Luxemburg et du parti communiste, ennemi déclaré de l’ex-chancelier Schober après que celui-ci, en tant que préfet de police, eut réprimé dans le sang une manifestation ouvrière, il s’est rallié, à la fin de sa vie, au régime autoritaire de Dollfuss, en qui il voyait le meilleur rempart contre l’Anschluss, le rattachement de l’Autriche au IIIe Reich.
Il n’a cessé de se battre contre la morale bourgeoise. Grand admirateur d’Oscar Wilde, il militait pour la décriminalisation de l’homosexualité et de l’avortement. Il s’est aussi constamment présenté en défenseur des prostituées, mais pour des raisons assez singulières. Sous l’influence, notamment, des idées d’Otto Weininger et de Frank Wedekind, il avait élaboré toute une mythologie des femmes en tant qu’êtres fondamentalement voués au plaisir. Il voyait dans la prostituée une expression de la vraie nature de la femme, érotique et rebelle. Pour reprendre les mots d’Edward Timms, cela l’entraînait « à s’éloigner de tous les mouvements de l’époque considérant la prostitution comme une question sociale » 1.
Beaucoup de commentateurs, à commencer par l’antipsychiatre Thomas Szasz, l’ont présenté comme un ennemi juré de la psychanalyse. S’il n’a effectivement pas manqué d’exercer son esprit critique et sa verve caustique aux dépens de celle-ci (« La psychanalyse est la maladie mentale dont elle se prétend la thérapie »), il a toujours conservé une grande estime envers Freud, qui le lui rendait bien. Son acrimonie, qui s’est développée avec le temps, était dirigée contre ses épigones, plus particulièrement Fritz Wittels, qui avait eu le mauvais goût de le caricaturer dans un roman à clé.
Kraus était aussi un homme de spectacle. Tout au long de sa carrière, il a donné un total de 700 lectures publiques, devant des salles de plusieurs centaines de spectateurs où se pressait le tout-Vienne. Seul sur l’estrade, sa silhouette déformée par la scoliose, il lisait des poèmes de Goethe, des pièces d’Ibsen, de Strindberg ou de Shakespeare, auteur qu’il mettait par-dessus tous les autres, des extraits d’opérettes d’Offenbach et ses propres textes. Tous les témoignages s’accordent à souligner l’effet magnétique qu’exerçait sur son auditoire subjugué sa « voix de cristal » de « magicien courroucé », pour reprendre l’expression du poète George Trakl. Dans des textes qu’il a ultérieurement fait disparaître, Canetti a comparé son éloquence à celle de Goebbels et d’Hitler. De fait, lorsqu’on écoute les enregistrements qui ont été conservés de ces lectures, en entendant ces roulements de
r dramatiques et sinistrement familiers, venus de la tradition du
Burgtheater, on se dit qu’il y a peut-être un fond de vérité dans cette affirmation de George Steiner : « Sans conteste, l’oreille de Kraus pour les forces démoniaques de la rhétorique politique, pour le venin de la propagande du nazisme, répondait à une impulsion oratoire et hallucinatoire présente en lui. »
Issu d’une famille de commerçants juifs de Bohême installée à Vienne, Kraus a souvent tenu des propos qui l’ont fait taxer d’antisémitisme. Dans ses philippiques contre la presse viennoise, il n’hésitait pas à employer les pires clichés antisémites. « On sait que ma haine de la presse juive, disait-il étrangement, n’est dépassée que par ma haine de la presse antisémite, tandis qu’à son tour ma haine de la presse antisémite n’est dépassée que par ma haine de la presse juive. » Certains ont voulu expliquer son attitude à l’aide du concept peu convaincant de « haine de soi juive ». Le fait est que Kraus voyait dans les industriels et financiers juifs (comme le père de Ludwig Wittgenstein) le fer de lance du capitalisme conquérant qu’il abhorrait. Il était par ailleurs un fervent partisan de l’assimilation des juifs dans la culture autrichienne et plus largement, germanophone et européenne. Lors de l’affaire Dreyfus, il s’est ainsi rangé dans le camp des antidreyfusards, le mouvement de solidarité autour du capitaine français lui semblant mettre en danger l’assimilation des juifs en Europe. Pour la même raison, il était radicalement opposé au sionisme de Theodor Herzl et s’appliquait à traquer les traces de « jargon » chez les écrivains germanophones d’origine juive. Mais il est clair qu’il a terriblement sous-estimé le danger qu’il y avait à jouer avec les préjugés antisémites. Avec la montée du nazisme en Allemagne, il en prendra conscience. Significativement, ses attaques contre Békessy font beaucoup moins référence à la judéité de ce dernier que celles qu’il avait menées contre Benedikt (également juif) quelques années auparavant.
Kraus était rentier et n’a jamais eu à travailler pour vivre. Il ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfants. Réputé pour sa capacité à se faire des ennemis, il avait le don de s’assurer la loyauté des femmes. Ses amies et amantes étaient des actrices ou des aristocrates, fait peu étonnant compte tenu de sa passion pour le théâtre et de sa fascination pour la haute société. Parmi les premières, on retiendra les noms d’Annie Kalmar, son grand amour de jeunesse, dont la mort de tuberculose à l’âge de 23 ans le laissera dévasté, et de la très jeune Irma Karczewska, dont il se lassa vite et qu’il poussa dans les bras de Fritz Wittels. Sa liaison la plus durable fut celle qu’il entretint avec la baronne Sidonie Nádherná von Borutín, une femme cultivée, cosmopolite et polyglotte. Elle se maria deux fois et avait d’autres amants. Leur liaison s’interrompit et reprit à plusieurs reprises, avant de se transformer en relation d’amitié. Elle était pour Kraus une interlocutrice de choix, comme l’atteste leur abondante correspondance.
Il avait « le génie de l’indignation », dit de lui Canetti. Sa passion pour la justice, son dégoût de la médiocrité morale et intellectuelle, sa haine de la tartuferie s’accompagnaient d’un goût certain pour l’invective et le style imprécatoire. Animé par la fureur et une conception biblique de la justice, il se voulait un procureur implacable. L’opiniâtreté et le courage dont il a fait preuve dans ses multiples combats témoignent de sa grande force d’âme. Mais les jugements cruels et à l’emporte-pièce qu’il a portés sur des auteurs morts (le poète allemand Heinrich Heine) ou des écrivains vivants (Max Brod, Franz Werfel) sont outranciers et immérités. On comprend le malaise qu’éprouvaient devant sa personnalité des esprits épris de modération comme Stefan Zweig ou de froids rationalistes comme Robert Musil, qui le rangeait au nombre des « dictateurs de l’esprit ». Monument de l’esprit critique, les écrits de Karl Kraus témoignent aussi de la manière dont celui-ci, lorsqu’il se manifeste sous des formes exacerbées, peut conduire à l’intolérance.
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié
Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).
— Ce texte a été écrit pour
Books.
Notes
1. Karl Kraus, Apocalyptic Satirist, vol. 1 et 2 (Yale University Press, 1986 et 2005).
Pour aller plus loin
♦ Schmock ou le Triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus, de Jacques Bouveresse (Seuil, 2001).
♦ « Les guerres de Karl Kraus », sous la direction de Gerald Stieg, Agone, no 35/36, 2006.
♦ Les Derniers Jours de l’humanité, de Karl Kraus, traduit de l’allemand par Jean-Louis Besson et Henri Christophe (Agone, 2003).
♦ Troisième nuit de Walpurgis, de Karl Kraus, traduit de l’allemand par Pierre Deshusses (Agone, 2005).
♦ Il ne suffit pas de lire. Aphorismes, de Karl Kraus, présenté et traduit de l’allemand par Alfred Eibel (Klincksieck, 2019).