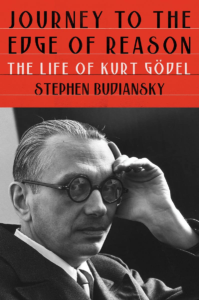L’âme tourmentée de Kurt Gödel
Publié dans le magazine Books n° 118, mars-avril. Par Michel André.
C’est un paradoxe : les mathématiques, la science pure par excellence, ne reposent pas sur des fondements mathématisables. La démonstration en fut donnée par Kurt Gödel. Logicien implacable, l’Autrichien était aussi de santé mentale fragile. Gravement hypocondriaque, il croyait aux esprits, aux démons, aux fantômes et à la vie après la mort.

À l’Institute for Advanced Study de Princeton, Albert Einstein avait pour meilleur ami Kurt Gödel. À ses yeux, il était « le plus grand logicien depuis Aristote ». Pour le prolifique mathématicien John von Neumann, il était « une classe à lui seul », quelqu’un d’« absolument irremplaçable ». Sa réputation de génie tient à deux théorèmes de logique qu’il a démontrés en 1931 et qui sont de toute première importance en philosophie des mathématiques. Mais Kurt Gödel était aussi connu pour les bizarreries de son caractère, son comportement parfois déroutant et les sérieux problèmes de santé mentale dont il souffrait. On sait désormais qu’il avait toutes sortes d’idées étranges. Hypocondriaque, introverti et discret, voire secret, il n’a publié qu’une petite partie de ses travaux. Des milliers de pages de notes personnelles qu’il a laissées à sa mort sont rédigées dans une écriture sténographique que peu savent lire. Avec le temps, on a appris à mieux le connaître. Aux témoignages de ceux qui l’ont côtoyé à Vienne ou aux États-Unis sont venus s’ajouter deux recueils de souvenirs du logicien et philosophe Hao Wang, qui a eu de nombreuses conversations avec lui durant les dernières années de sa vie 1. Les travaux et les lettres de Gödel ont été édités, une grande partie de ses notes ont été déchiffrées. En 1997 paraissait une première biographie, substantielle, par John W. Dawson 2, bientôt suivie par plusieurs essais biographiques 3. Publiée l’an dernier, la nouvelle biographie de Stephen Budiansky est facile d’accès, bien documentée, correcte sur le plan scientifique et fait une large place à sa vie privée et à sa psychologie.
Kurt Gödel est né en 1906 à Brünn (aujourd’hui Brno), en Moravie, une région de la République tchèque qui faisait alors partie de l’Empire austro-hongrois. Comme beaucoup d’habitants de la ville, ses parents étaient germanophones. Son père, un homme énergique et doté d’un esprit pratique, était un industriel du textile. De tempérament plus intellectuel, sa mère était une personne lettrée et cultivée. Il lui était très attaché et resta proche d’elle toute sa vie, entretenant avec elle une abondante correspondance. C’était un enfant vif et curieux, studieux et de santé fragile. À 8 ans, il souffrit d’une grave crise de rhumatisme articulaire que son frère aîné Rudolf, devenu médecin, considéra à l’origine de son hypocondrie. Adolescent intellectuellement précoce, il s’intéressait surtout aux mathématiques et à la philosophie. Entré à l’Université de Vienne, il commença par étudier la physique. Au bout d’un certain temps, trouvant que cette discipline manquait de précision, il se tourna vers les mathématiques et la logique. Depuis ses années d’école à Brünn, bien que n’étant pas juif lui-même, il avait surtout des juifs pour amis. En marge de l’université, où étudiants et professeurs juifs se heurtaient à l’antisémitisme, existaient à Vienne de nombreux cercles de discussion philosophique. Sur l’invitation de son directeur de thèse, Hans Hahn, qui en faisait partie, Gödel rejoignit le plus prestigieux d’entre eux, le Cercle de Vienne. Il réunissait principalement des philosophes des sciences, comme Moritz Schlick, son fondateur, ou encore Otto Neurath et Rudolf Carnap. La philosophie du Cercle était l’empirisme (ou positivisme) logique. Pour ses tenants, la connaissance, lorsqu’elle ne se réduit pas à la simple application des lois de la logique, ne saurait provenir que de l’observation et de l’expérience. Une conception très différente de celle de Gödel, pour qui, dans l’esprit de la philosophie de Platon, les concepts et les objets mathématiques sont dotés d’une réalité objective, directement accessible à l’intelligence. Pour la même raison, il ne partageait pas la fascination de ses collègues pour la pensée de Ludwig Wittgenstein, selon laquelle les mathématiques, à l’instar du langage, ne sont qu’un outil, un ensemble de règles fondées sur des conventions. Socialiste comme la plupart des membres du Cercle, il n’appréciait guère les efforts d’Otto Neurath, le plus radical d’entre eux, pour politiser son activité. Même si Gödel n’intervenait pas souvent, les discussions du Cercle de Vienne ont nourri sa réflexion.
En 1928, il se lia avec une Viennoise un peu plus âgée que lui et séparée de son mari, Adele Nimbursky. Ancienne danseuse de cabaret, elle gagnait sa vie en travaillant comme masseuse et esthéticienne. Ses amis et sa famille furent choqués, la trouvant peu éduquée et bavarde. Peu à peu, ils apprirent à apprécier ses qualités domestiques, mais aussi sa vivacité d’esprit. Le divorce n’étant pas autorisé dans la très catholique Autriche, Gödel ne l’épousa qu’en 1938, lorsqu’avec l’annexion du pays par l’Allemagne nazie de nouvelles lois sur le mariage et le divorce entrèrent en vigueur. L’économiste Oskar Morgenstern, qui allait devenir l’un de ses meilleurs amis à Princeton, affirma un jour qu’Adele avait « sauvé la vie » de Gödel. Il avait à l’esprit la dévotion qu’elle lui témoigna lors du dernier et plus grave des trois épisodes de troubles psychiatriques qu’il traversa durant les années qui suivirent leur rencontre. Les deux premiers avaient pris la forme d’accès d’anxiété et d’indécision, de dépression et d’hypocondrie. En 1936, Gödel fut la proie d’une vraie crise de paranoïa. Persuadé que ses médecins le droguaient secrètement et voulaient l’empoisonner, il refusa de s’alimenter. Adele parvint à le convaincre d’absorber un peu de nourriture en goûtant chaque cuillerée devant lui.
Entre-temps, Gödel avait accédé à la célébrité en apportant une contribution décisive à la réflexion sur les fondements des mathématiques qui agitait le monde savant à cette époque. Au tournant du XXe siècle, des paradoxes avaient été découverts dans la théorie des ensembles de Georg Cantor – le plus connu étant : l’ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient-il lui-même ? Cela incita philosophes et mathématiciens à chercher le moyen d’asseoir le savoir mathématique sur des bases solides. Comme Euclide l’avait fait pour la géométrie dans l’Antiquité, il s’agissait d’établir l’arithmétique, considérée comme la pierre angulaire de tout l’édifice mathématique, sur un socle d’axiomes, de définitions et de règles.
Dans le prolongement des travaux pionniers des mathématiciens Giuseppe Peano, Gottlob Frege et Ernst Zermelo, Bertrand Russell et Alfred North Whitehead proposèrent des solutions qui permettaient de résoudre certains problèmes mais en laissaient subsister d’autres – quand ils n’en créaient pas de nouveaux. Dans le but d’éliminer tout doute au sujet de la solidité des mathématiques, l’Allemand David Hilbert suggéra une nouvelle approche, dont la mise en œuvre est connue sous le nom de « programme de Hilbert ». Elle consistait à considérer les propositions mathématiques en fonction non de leur contenu mais de leur structure, et à vérifier par des moyens eux-mêmes de type mathématique que leur articulation formait un ensemble cohérent. Un système d’axiomes est cohérent (ou consistant) s’il n’est pas contradictoire : on ne peut pas y démontrer à la fois une proposition et son contraire. Il est complet s’il ne contient aucune proposition « indécidable » (on ne peut ni la démontrer ni la réfuter).
Gödel, dans sa thèse de doctorat, prouva la complétude d’un système formel assez simple appelé « logique du premier ordre ». Dans la foulée, il découvrit que le programme de Hilbert n’était pas réalisable. Après s’en être ouvert en privé à Carnap, il rendit cette conclusion publique en 1930, lors d’un congrès de plusieurs sociétés savantes allemandes à Königsberg. L’année suivante, il en publiait la démonstration sous la forme d’un « premier théorème d’incomplétude », qui peut s’énoncer de la manière suivante : « Tout système cohérent d’axiomes assez puissant pour qu’on puisse y formaliser l’arithmétique (par exemple les Principia Mathematica de Russell et Whitehead) contient nécessairement au moins une proposition indécidable. » Pour l’établir, Gödel avait très ingénieusement converti en nombres tous les symboles logiques et transformé une proposition énonçant sa propre indémontrabilité en une formule mathématique dont on pouvait montrer qu’elle était à la fois vraie et indémontrable dans le système considéré.
Le premier à comprendre les implications de ce théorème fut John von Neumann. Peu après la conférence de Königsberg, il écrivit à Gödel pour lui annoncer qu’il avait découvert et prouvé une conséquence importante de sa démonstration : aucun système cohérent ne peut démontrer sa propre cohérence, la proposition qui l’énonce étant, précisément, une des propositions indécidables dans le système. Un système d’axiomes suffisamment puissant ne peut donc être à la fois cohérent et complet. À sa grande déception, Gödel lui répondit qu’il était lui-même déjà arrivé à cette conclusion et était sur le point d’en publier la preuve. Elle deviendra son « second théorème d’incomplétude ». Von Neumann n’avait pas l’habitude d’être pris de vitesse. Mais ses regrets furent atténués par la grande estime dans laquelle il tenait Gödel, dont il resta un ami fidèle. Les deux théorèmes ruinaient le programme de Hilbert, sans que cela ait été leur objectif. Ils n’empêchèrent pas les connaissances mathématiques, dont la plus grande partie est indépendante de la question de leurs fondements, de continuer à progresser. Ni Zermelo, ni Russell, ni Wittgenstein ne semblent avoir compris la signification et la portée des théorèmes de Gödel. « Plus de choses inexactes ont probablement été dites à leur sujet [...] que de n’importe quel autre théorème mathématique dans l’Histoire », relève Budiansky. On a ainsi soutenu qu’ils établissent l’existence de vérités inconnaissables ou indémontrables, ou qu’on ne peut rien connaître avec certitude. Gödel les présentait en termes bien plus modestes : « Mes théorèmes montrent uniquement que la mécanisation des mathématiques […] est impossible. […] Je n’ai pas démontré qu’il existe des questions mathématiques indécidables pour l’esprit humain, mais seulement qu’il n’y a pas de machine (ou de formalisme aveugle) qui puisse décider de toutes les questions de théorie des nombres. » Des philosophes et des scientifiques ont voulu étendre la portée de ces théorèmes au-delà du champ des systèmes formels. Stephen Hawking et Freeman Dyson (qui reconnut son erreur) les ont indûment invoqués pour contester la possibilité d’une « théorie du tout » en physique. Les idées de Gödel ont été appliquées par analogie et de manière métaphorique à des questions politiques, sociales ou théologiques, avec une légèreté qu’ont dénoncée Alan Sokal et Jean Bricmont et, à leur suite, Jacques Bouveresse 4.
En 1937, dans un article sur « les nombres calculables et le problème de la décision », Alan Turing fournissait une démonstration à la fois plus générale et plus précise des théorèmes de Gödel. Pour arriver à ce résultat, il avait imaginé une machine théorique (dite aujourd’hui « machine de Turing universelle ») capable de simuler son propre fonctionnement et constituant un équivalent mécanique du dispositif logique de Gödel. Découle-t-il de sa démonstration que l’esprit humain peut avoir accès à des vérités indémontrables par une machine ? Certains l’ont soutenu (le mathématicien Roger Penrose, par exemple), sans en fournir de preuve convaincante. Tout indique que Gödel le pensait lui-même, mais il ne l’a jamais affirmé publiquement. Dans une conférence donnée en 1951, il laissait la question ouverte sous la forme d’une alternative : soit l’esprit surpasse la machine, soit il existe des problèmes théoriques concernant les nombres qui sont insolubles.
Tout au long des années 1930, le climat politique en Autriche ne cessa de se dégrader. En 1936, Moritz Schlick était abattu par un de ses anciens étudiants. La condamnation de son assassin donna lieu à une vague de dénonciations des scientifiques « athées » du Cercle de Vienne et, par association, des juifs. La montée en puissance du parti nazi autrichien facilita le rattachement du pays à l’Allemagne. Mis en danger par ses liens avec les intellectuels juifs et menacé d’être enrôlé dans l’armée allemande, Gödel, qui avait effectué trois séjours à Princeton au cours des années précédentes, se décida à suivre l’exemple de ses amis et à quitter le pays. Après de nombreuses péripéties administratives, grâce aux efforts et à l’habileté de John von Neumann, qui était sur place, il obtint un visa pour les États-Unis. N’étant pas autorisé à traverser l’Atlantique, il dut prendre le Transsibérien jusqu’au Japon avant d’embarquer sur un bateau pour San Francisco. Lors de son premier voyage aux États-Unis, il avait fait la connaissance d’Einstein. Rapidement, ils devinrent très proches. On ne pouvait imaginer deux hommes plus différents : Gödel vêtu en permanence avec le plus grand soin, Einstein pieds nus dans ses chaussures et affublé de pantalons informes tenus par des bretelles. « Einstein sociable, joyeux et plein de bon sens, note son assistant Ernst Straus, […] Gödel extrêmement solennel, très sérieux, assez solitaire, méfiant à l’égard du sens commun […]. » Mais tous les deux, ajoute-t-il, allaient directement aux questions fondamentales. Moitié en plaisantant, Einstein dit un jour à Morgenstern que, s’il se rendait tous les jours au bureau, son travail ne le stimulant plus guère, c’était « pour pouvoir [...] rentrer chez lui en marchant avec Gödel ». Selon ce dernier, si Einstein prenait tant de plaisir à converser avec lui, c’était entre autres parce que ses opinions étaient souvent en désaccord avec les siennes et qu’il ne s’en cachait pas.
Au cours de leurs promenades, ils parlaient de physique, de philosophie et de politique. Gödel admirait Franklin Roosevelt et, comme Einstein, détestait Harry Truman. Mais il révérait aussi Dwight Eisenhower, pour qui il vota en 1952, ce qui surprit beaucoup Einstein. Pour obtenir la nationalité américaine, il avait soigneusement préparé le test d’aptitude. Interrogé par le juge sur la possibilité que les États-Unis deviennent une dictature, le logicien, qui pensait avoir trouvé une faille dans la Constitution, répondit : « Oh oui, je peux le prouver. » Le juge, Einstein et Morgenstern le firent immédiatement taire.
En guise de contribution à un ouvrage d’hommage à Einstein, Gödel rédigea un article proposant, sur la base de solutions inédites aux équations de la relativité générale, un modèle cosmologique d’univers stationnaire en rotation dans lequel les voyages dans le passé sont possibles. Il se débarrassait des paradoxes liés à la violation des règles de la causalité à l’aide de l’argument, très faible, que de tels voyages, théoriquement envisageables, étaient en pratique irréalisables. Tout en reconnaissant la valeur de cette contribution à la réflexion cosmologique, Einstein était d’avis qu’il fallait vérifier s’il ne convenait pas d’écarter ce modèle d’univers « sur la base de considérations physiques ». Cette position est celle de la plupart des physiciens. « Le modèle cosmologique de Gödel, résume l’épistémologue espagnol Jesús Mosterín, est compatible avec la relativité générale mais incompatible avec le monde réel 5. »
À Princeton, Gödel frappait par son comportement curieux et ses idées singulières. Persuadé que son frigo et les radiateurs produisaient des émanations toxiques, il fit changer le premier à plusieurs reprises, déménagea souvent et, dans un des appartements qu’il occupa, se débarrassa carrément des radiateurs. La manière dont il interprétait l’Histoire et l’actualité était souvent déconcertante. Des coïncidences dans les dates de décès de personnalités connues lui semblaient grosses de significations ; il mettait en doute les versions officielles de certains événements. Il étonnait aussi par ses goûts simples, très éloignés de ceux, plus sophistiqués, de ses collègues. Il aimait les dessins animés, plus particulièrement Blanche-Neige, les contes pour enfants, les valses viennoises, la musique populaire, les histoires sentimentales illustrées. Il contemplait avec fierté, dans son jardin, le flamant rose en ciment d’un kitsch achevé que lui avait offert Adele. Il lisait des romans classiques mais ne découvrit Kafka que sur le tard.
Dans la dernière partie de sa vie, il consacra beaucoup de temps à la philosophie. Il étudia les œuvres d’Edmund Husserl, pensant trouver chez lui des idées étayant ses positions platoniciennes, ainsi que la philosophie de Leibniz, qui l’inspirait par son rationalisme extrême et dont il s’employa à adapter la preuve ontologique de l’existence de Dieu. Il développa à son propos des idées conspirationnistes, prétendant que des pans entiers de son œuvre avaient été délibérément occultés. Jamais il ne fit ouvertement état de ses vues en philosophie. « Gödel, remarque le philosophe des mathématiques Solomon Feferman, était extrêmement réticent à l’idée de rendre publiques ses convictions philosophiques lorsqu’il ne parvenait pas à produire des arguments inattaquables en leur faveur 6. » En lisant ses carnets de notes et sa correspondance, on a découvert qu’il croyait aux esprits, aux démons, aux fantômes, au diable, aux médiums et à la vie après la mort 7.
Ses dernières années furent pénibles. La mort d’Einstein, qui le dévasta, fut bientôt suivie par celle de von Neumann. Lorsque celui-ci était à l’agonie, Gödel l’interrogea dans une lettre au sujet de ce que l’on appelle aujourd’hui le « problème P vs NP » : la solution d’un problème dont on peut rapidement vérifier l’exactitude peut-elle être trouvée rapidement ? Von Neumann était bien trop malade pour répondre. La santé de Gödel se détériora, en grande partie par sa faute. Atteint d’une hypertrophie de la prostate, il refusa de se faire opérer, s’administrant lui-même des antibiotiques pour combattre les risques d’infection. Plus hypocondriaque que jamais, se méfiant des médecins, il prenait sa température plusieurs fois par jour et absorbait de grandes quantités de laxatifs et d’autres médicaments. Convaincu que l’institut de Princeton voulait le supprimer, imaginant qu’on lui faisait des injections dans son sommeil comme, pensait-il, autrefois dans les hôpitaux psychiatriques de Vienne, craignant à nouveau d’être empoisonné, il mangeait de moins en moins. Une première hospitalisation d’Adele, malade elle aussi, le laissa désemparé. Une seconde puis la mort de Morgenstern précipitèrent sa fin. Au début de l’année 1978, il mourut de malnutrition et d’inanition.
On peut être déconcerté par la coexistence, chez lui, d’idées scientifiques de grande valeur, d’opinions philosophiques et religieuses discutables, de croyances superstitieuses et de troubles pathologiques. Mais tout cela est lié. Gödel était persuadé que rien ne pouvait se produire sans raison et par accident. Une telle conviction, observe Budiansky, est à la fois l’expression d’un rationalisme extrême et un terreau fertile pour la paranoïa. Elle pourrait aussi expliquer, paradoxalement, son attrait pour le surnaturel et l’occulte. Son perfectionnisme et son obsession maniaque de l’ordre et de la précision pouvaient être paralysants et l’ont souvent conduit à une prudence excessive. D’un autre côté, c’est cette tournure d’esprit qui lui a permis de résoudre des problèmes qui étaient dans l’air mais que personne n’avait jamais réussi à formuler avec autant de justesse que lui. Et ces qualités étaient appréciées. Gödel, souligne Budiansky, étudiait et commentait les travaux des autres avec la méticulosité dont il témoignait dans les siens, « un souci d’exactitude et une conscience professionnelle élevée que beaucoup de ses amis reconnaissaient comme un de ses traits de caractère les plus admirables ».
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008). — Cet article a été écrit pour Books.
Notes
1. Reflections on Kurt Gödel (MIT Press, 1987) ; A Logical Journey: From Gödel to Philosophy (MIT Press, 1997).
2. Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel (A K Peters/CRC Press, 1997).
3. Einstein/Gödel. Quand deux génies refont le monde, de Palle Yourgrau (traduit de l’anglais par Christian Jeanmougin, Dunod, 2005) ; Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt Gödel, de Rebecca Goldstein (W. W. Norton, 2005).
4. Impostures intellectuelles (Odile Jacob, 2018) ; Prodiges et vertiges de l’analogie (Raisons d’agir, 1999).
5. « Gödel y el Tiempo », Revista de libros, 1er avril 2009.
6. « Provenly Unprovable », London Review of Books, 9 février 2006.
7. Les Démons de Gödel. Logique et folie, de Pierre Cassou-Noguès (Points, 2015).