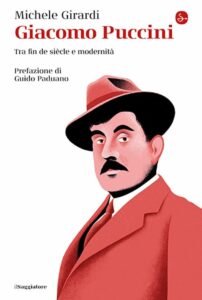Le génie méconnu de Puccini
Publié en décembre 2025. Par Michel André.
Les mélomanes ordinaires ont tendance à juger ses opéras faciles, vulgaires et empreints de sentimentalisme. C’est une forme de snobisme. Orchestrateur de génie, auteur de mélodies inoubliables, il fut aussi le plus cinématographique des compositeurs. Avec la splendeur barbare de Turandot, œuvre inachevée, il atteint l’apothéose de son art.

Un jour que Maurice Ravel était en train de parler de Puccini en termes enthousiastes à l’un de ses étudiants, celui-ci, avec l’impertinence de la jeunesse, se mit à ricaner. Éclatant de rage, Ravel s’assit au piano et joua de mémoire l’intégralité de Tosca, s’interrompant une cinquantaine de fois pour faire remarquer la qualité d’un passage. Puis il prit la partition pour souligner la perfection de l’orchestration. Ravel n’est pas le seul compositeur du XXe siècle à avoir fait l’éloge de Giacomo Puccini. Stravinsky, Schoenberg et Webern exprimèrent également leur admiration pour son talent. Selon le critique américain Jay Nordlinger, deux catégories de personnes aiment Puccini : d’un côté le grand public, de l’autre côté les vrais musiciens, dont font partie les compositeurs. Influencés par une partie de la critique et du monde musical, qui le considère avec dédain, les mélomanes ordinaires ont tendance à juger ses opéras faciles, vulgaires et empreints de sentimentalisme. Lorsqu’ils sont touchés malgré tout par sa musique, ils répugnent à l’avouer.
La réputation de Puccini ne cesse cependant de s’améliorer. Ses œuvres moins connues sont redécouvertes. Son génie dramatique et musical, mieux appréhendé, est analysé en profondeur. On s’intéresse à sa vie, en cherchant à y repérer des liens avec les sujets et l’atmosphère émotionnelle de ses opéras. Au cours des dernières années, de gros livres en italien lui ont été consacrés par, respectivement, Virgilio Bernardoni et Michele Girardi, deux spécialistes de son œuvre. Le second, le plus récent, est une version considérablement revue et enrichie d’un ouvrage plus ancien du même auteur, décédé il y a quelques mois.
Né en 1858, Giacomo Puccini est issu d’une dynastie de musiciens établie dans la ville de Lucques, en Toscane. Son père, compositeur de musique sacrée, mourut lorsqu’il avait 5 ans. Toute sa vie, il resta très attaché à sa famille. La mort de sa mère, quand il avait 25 ans, l’affecta profondément. Il commença à étudier la musique au conservatoire de sa ville natale avant de s’inscrire à celui de Milan, où il ne suivit que les cours qui l’intéressaient. Une légende veut qu’il ait découvert sa passion pour l’art lyrique lors d’une représentation d’Aïda de Verdi. Son premier opéra, Le Villi, attira l’attention du tout puissant éditeur de musique Giulio Ricordi. Les éditeurs, à l’époque, ne se contentaient pas d’établir et publier les partitions des œuvres. Ils jouaient aussi le rôle d’imprésarios. Ayant repéré le talent de Puccini, Ricordi prit celui-ci sous son aile. Il lança sa carrière, qu’il continua à soutenir durant près de trente ans. Lorsqu’il mourut, en 1912, son fils Tito prit le relais. Bien que leurs relations fussent cordiales, Puccini n’eut jamais pour Tito l’affection intense, quasiment filiale, qu’il avait pour son père.
Deux autres personnes indissociables de la vie artistique de Puccini sont les librettistes que Ricordi lui assigna, Luigi Illica et Giuseppe Giacosa. Ils travaillaient en tandem : le premier était chargé d’élaborer les scénarios, le second de transformer le texte en vers élégants. Calme et d’un naturel conciliant, Giacosa aida à fluidifier les relations entre Puccini et Illica, qui étaient souvent tendues. Il faut aussi mentionner le chef d’orchestre Arturo Toscanini avec lequel, en dépit de quelques brouilles passagères, il resta lié toute son existence. Parce que Ricordi n’appréciait pas son style de direction sans complaisance et rigoureusement fidèle à la partition, Toscanini n’eut l’occasion de créer que trois opéras de son ami. Mais il s’en fit le champion en dirigeant ses œuvres dans le monde entier.
Le succès vint pour Puccini avec Manon Lescaut, en 1894. Suivirent, en quelques années, trois de ses œuvres les plus célèbres : La Bohème (1896), Tosca (1900) et Madame Butterfly (1904). Puis le rythme se ralentit. Explorant des voies nouvelles, il produisit en 1908 La Fille du Far West, ensuite un « triptyque » de trois courtes œuvres avant de revenir au grand opéra avec Turandot, qu’il ne parvint pas à achever avant sa mort, en 1924 (d’un cancer de la gorge). Un final fut composé par Franco Alfano, que l’on joue aujourd’hui généralement raccourci. L’Histoire a toutefois retenu que, lors de la première, Toscanini, qui dirigeait, abaissa sa baguette après la dernière partie que Puccini avait composée lui-même. Se tournant vers le public, dans des termes variant selon les témoignages, il déclara qu’à cet endroit le maître s’était arrêté, avant de laisser le rideau s’abaisser.
Comme Verdi, Puccini resta toujours attaché à sa région d’origine. Il ne cessa de voyager à travers le monde pour superviser les premières de ses opéras à Paris, Londres, New York, Budapest, Madrid ou Buenos Aires, se faisant dans ces villes de nombreuses relations dans les milieux littéraires et artistiques. Mais lorsque ses premiers succès lui apportèrent l’aisance financière, il fit construire, pour s’y installer, une villa à Torre del Lago, un petit bourg situé à quelques dizaines de kilomètres de sa ville natale. Il aimait y chasser le canard, un de ses passe-temps favoris avec l’automobile, dont il fut un des premiers adeptes en Italie. Cette deuxième passion lui valut d’être victime d’un accident de la route qui l’obligea à rester immobilisé de nombreux mois. Il en garda des séquelles sous la forme d’une boiterie permanente. À Torre del Lago, il passait de longues soirées au café avec des amis. Sociable, appréciant les plaisirs simples, mais aussi un certain luxe, il ne recherchait pas la gloire et détestait les mondanités. Contrairement à Verdi, la politique le laissait indifférent. Le sort des plus démunis le touchait, mais jamais il ne songea à mettre son art au service d’une cause, en particulier la cause nationale. S’il accepta d’être nommé sénateur par le régime fasciste à la fin de sa vie, c’est avec beaucoup de détachement et parce que son confrère Pietro Mascagni l’était.
En 1886, il entama une liaison avec une jeune femme à qui il donnait des leçons de musique, Elvira Gemignani. Mariée, mère de deux enfants, elle en attendit bientôt un troisième de lui. Très amoureuse, elle quitta son mari, emmenant avec elle sa fille et lui laissant leur fils. Ce n’est qu’à la mort de son époux, vingt ans plus tard, qu’elle et Puccini purent enfin se marier. Leur union ne fut pas de tout repos. Il lui était attaché et elle ne cessa jamais de le soutenir. Mais elle était dévorée de jalousie, non sans raisons. Homme sensuel et enclin à tomber amoureux, il eut de nombreuses aventures. Parfois, il ne s’agissait que d’engouements, qui s’exprimaient surtout sous forme épistolaire. Dans le cas de Sybil Seligman, épouse d’un banquier londonien, ce fut essentiellement une amitié profonde, très enrichissante pour l’un comme pour l’autre ainsi qu’en atteste leur correspondance. Mais son comportement dans ce domaine et le soupçon permanent qu’il alimentait eurent des conséquences tragiques. Injustement accusée par Elvira d’être la maîtresse de Puccini, une de leurs jeunes servantes se suicida. À la suite de cet épisode, le musicien sombra dans la dépression et ses relations avec sa femme se détériorèrent pour un temps.
On s’est souvent interrogé sur ce qui se reflète de la personnalité de Puccini dans ses opéras. Hédoniste, il était aussi incontestablement porté à la mélancolie. Une vision sombre et pessimiste de la vie se dégage de ses œuvres. La passion amoureuse y joue un rôle central, mais elle n’y trouve jamais d’issue heureuse. Bien sûr, il s’agit là d’une règle dans l’opéra romantique, notamment italien : les femmes n’y survivent pas au dernier acte. Mimi, la jeune compagne des artistes parisiens de La Bohème, est ainsi emportée par la maladie, et Manon Lescaut, envoyée en exil, meurt d’épuisement dans les bras du chevalier des Grieux. Mais la cantatrice Tosca, avidement convoitée par le chef de la police le baron Scarpia, Cio-Cio San (Madame Butterfly), abandonnée par l’officier américain Pinkerton qu’elle a épousée, et Liù, la jeune esclave torturée sur ordre de la glaciale princesse Turandot, se suicident toutes les trois. La première par désespoir d’avoir perdu l’homme qu’elle aimait, fusillé sur instruction de Scarpia pour le meurtre duquel elle va de surcroît être arrêtée ; la seconde parce qu’elle est déshonorée et que Pinkerton est revenu pour lui prendre leur fils ; la troisième pour sauver le prince Calaf, qu’elle aime mais qui aime Turandot, en ne révélant pas son nom qu’il a mis la princesse au défi de découvrir au prix de sa vie. Turandot, de son côté, avant de tomber dans les bras de Calaf par un coup de théâtre invraisemblable, se montre d’une cruauté inhumaine. Quand les femmes ne souffrent pas, elles font souffrir. Les drames de Puccini sont d’une terrible dureté. Le chef d’orchestre Lorin Maazel avouait ne pas pouvoir regarder la dernière scène de Madame Butterfly, tant la mort de celle-ci après avoir dit adieu à son petit garçon est poignante. Une telle mise en exergue de la détresse et du malheur relève-t-elle simplement des conventions du genre ? C’est loin d’être sûr.
Comme Julian Budden dans un excellent ouvrage de 2002, Michele Girardi analyse longuement la technique musicale de Puccini à l’aide d’extraits de partitions et de portées commentées. Au moment où le compositeur entama sa carrière, l’opéra italien était dominé par les grandes ombres de Verdi et Wagner. Le premier avait porté à son sommet le grand opéra romantique, tout en introduisant dans le genre, avec Othello, une série d’innovations qu’il développa davantage encore avec Falstaff. Wagner, de son côté, avait inauguré une toute nouvelle conception de l’opéra comme drame total, intégrant le chant et la musique en un flux continu. Pour les compositeurs de la Giovane Scuola (Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Catalani), l’enjeu était de poursuivre la tradition de l’opéra italien tout en la renouvelant, sans imiter ces deux géants. C’est Puccini qui y parvint le mieux.
De la tradition du bel canto, il avait hérité l’art de composer des mélodies inoubliables, conçues pour faire éclater le public en applaudissements. Il l’exploita avec brio. « Sola, perduta, abbandonata » (Manon Lescaut), « Che gelida manina » (La Bohème), « E lucevan le stelle » et « Vissi d’arte » (Tosca), « Un bel dì vedremo » (Madame Butterfly), « O mio babbino caro » (Gianni Schicchi), « Non piangere, Liù » et « Nessun dorma » (Turandot), sont des morceaux de bravoure que sopranos et ténors inscrivent systématiquement au programme de leurs récitals. Ces arias, que Puccini apprit progressivement à insérer de manière de plus en plus naturelle dans le récit, ne sont pas seulement très prenants. Ils sont aussi d’une remarquable subtilité. Des sentiments et des émotions parfois contradictoires s’y expriment, ce qui les rend difficiles à interpréter.
Contrairement à ce qui se passe chez Verdi, où le chant entraîne l’orchestre, chez Puccini, c’est l’orchestre qui porte le chant. Mélodiste de talent exceptionnel, il était surtout un orchestrateur de génie, et c’est dans ce domaine qu’il a le plus profondément renouvelé le genre. D’une richesse peu commune, sa palette orchestrale fait entendre des sonorités nouvelles en empruntant avec intelligence aux traditions musicales étrangères, qu’il avait étudiées avec soin : japonaise (Madame Butterfly), américaine (La Fille du Far West), chinoise (Turandot). Les chœurs sont mis à contribution d’une façon inédite, inventive et variée. C’est dans le domaine de l’harmonie qu’il se montre le plus audacieux, avec un recours intense au chromatisme, l’utilisation d’accords de tons entiers et des dissonances proches de l’atonalité. L’intégration étroite de la musique et de l’action, l’utilisation qu’il fait des leitmotivs, plus souple que celle de Wagner, et l’emploi régulier des ostinatos en font par ailleurs le plus cinématographique des compositeurs. Tous ces procédés se trouvent combinés de la manière la plus accomplie dans Turandot, qui représente l’apothéose de son art. Cette œuvre d’une splendeur barbare marque la fin d’une époque. Avec elle, le grand opéra romantique italien jetait somptueusement ses derniers feux.