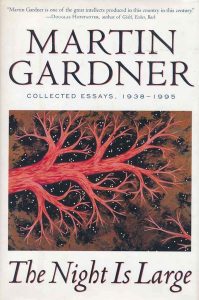Dans son roman
Ada ou l’Ardeur, Vladimir Nabokov, estropiant quelque peu le nom de l’intéressé, parle de Martin Gardner comme d’un « philosophe inventé » : un clin d’œil à celui qui, dans la première édition de
L’Univers ambidextre,, son livre sur la symétrie en physique, chimie et biologie, présentait le poète fictif John Shade, héros de
Feu pâle, comme ayant réellement existé
1. Loin d’être un personnage imaginaire, Gardner est une figure importante de l’histoire des idées au XX
e siècle. « [Sa] contribution à la culture intellectuelle contemporaine, disait le linguiste Noam Chomsky, est unique par son étendue, la perspicacité de ses vues et sa compréhension des questions les plus profondes. » Pour le paléontologue et historien des sciences Stephen Jay Gould, il a été durant plusieurs décennies « le phare le plus lumineux en défense de la rationalité et de la véritable science ». Auteur de 70 à 100 livres selon le critère de calcul utilisé, Gardner, qui se présentait comme un journaliste, a livré sur un large éventail de sujets des réflexions originales et éclairantes témoignant d’une extraordinaire érudition, d’un sens critique aiguisé et d’une grande indépendance d’esprit.
Né en 1914 à Tulsa, dans l’Oklahoma, d’un père géologue spécialisé dans la prospection pétrolière et d’une mère éducatrice et artiste, après des études de premier cycle en philosophie et quatre ans de service dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale, il commença à écrire pour des magazines. Il le fit jusqu’à sa mort, à l’âge de 95 ans, avec un plaisir jamais émoussé. « Je m’amuse tout le temps, disait-il, et j’ai la chance d’être payé pour cela. » Durant vingt-cinq ans, il tint la rubrique « Jeux mathématiques » du magazine
Scientific American. Au départ, il y traitait de problèmes de mathématiques récréatives : énigmes, casse-têtes, puzzles, devinettes. À mesure qu’il gagnait en assurance, il aborda des questions de plus en plus complexes concernant la géométrie, la théorie des nombres, la logique, le calcul combinatoire, la calculabilité ou la théorie des graphes ou des nœuds.
Le secret de la réussite de ces chroniques, faisait-il remarquer, était sa formation limitée en mathématiques, qui le forçait à bien comprendre ce dont il s’agissait avant de l’expliquer aux autres : « Pas de meilleur moyen d’apprendre les mathématiques que d’écrire à leur sujet. » Il résidait aussi dans son exceptionnelle capacité d’expliquer les réalités les plus compliquées dans une langue simple, claire, comparable à celle de son héros Bertrand Russell ou de George Orwell, qu’illustre bien cette définition tirée d’un texte sur le ruban de Möbius : « La topologie analyse les propriétés d’un objet qui ne changent pas même lorsqu’on le plie, l’étire ou le tord. Elle examine par exemple combien de faces il a ou combien de trous il comporte. »
Gardner présentera à ses lecteurs les travaux de mathématiciens contemporains : le jeu de la vie (automate cellulaire) de John Conway, la théorie des fractales de Benoît Mandelbrot, le pavage quasi périodique de Roger Penrose, l’algorithme de chiffrage à clé publique de Ronald Rivest en cryptographie. Non sans exprimer parfois certaines réserves. À propos, par exemple, de la floraison d’applications suscitées en sciences sociales par la théorie des catastrophes de René Thom, sollicitée pour expliquer les crashs boursiers, les grèves, les comportements de panique des foules ou les révolutions, il soulignait : « Aucun mathématicien […] ne conteste l’élégance des modèles de Thom ou ne nie leur valeur comme métaphores descriptives. Mais une chose est de décrire la nature d’une façon nouvelle, une autre d’appliquer des modèles d’une manière conduisant à des explications et des prédictions substantielles. »
Mais c’est peut-être à l’égard des pseudosciences que le regard critique de Gardner s’est le plus notoirement exercé. Fondateur, avec quelques autres, du magazine
Skeptical Inquirer et du CSICOP
2, il s’est employé dans des centaines d’articles à dénoncer toutes les variétés possibles de fausses sciences, théories farfelues et inventions de charlatans du passé ou d’aujourd’hui, de l’astrologie et la radiesthésie aux récits d’observations de
soucoupes volantes et d’enlèvement par les extraterrestres en passant par le spiritisme, la numérologie et l’
archéologie fantastique 3.
Considérant comme « une perte de temps » d’essayer de convaincre par des arguments rationnels les adeptes des croyances les plus aberrantes, il se sentait néanmoins moralement obligé de sensibiliser le public à tout ce qui sépare la science sérieuse des affabulations pseudoscientifiques, en mettant en garde contre les plus pernicieuses d’entre elles dans les domaines de la médecine ou de l’anthropologie. L’iridologie, l’homéopathie, la réflexologie, la thérapie par l’urine, la chirurgie à mains nues des guérisseurs philippins peuvent mettre en danger la santé et la vie de ceux qui y recourent, directement par les pratiques qu’elles impliquent ou indirectement en les détournant de traitements efficaces. Pour cette raison, il conclut un article sur le docteur William Horatio Bates, ennemi acharné des lunettes et promoteur d’une méthode naturelle de correction des défauts de la vision et de guérison des maladies de l’œil, par le sage conseil suivant : « Pour un charlatan qui s’avère avoir été un génie, il y a dix mille charlatans qui se révèlent avoir été seulement des charlatans. [...] Pour le profane en médecine, se fier au consensus de la communauté médicale informée est l’attitude la plus raisonnable et la plus saine. »
Parmi les cibles favorites de Gardner figurait le « psychokinésiste » Uri Geller, célèbre pour ses démonstrations de pliage de petites cuillères par la seule force mentale. Avec l’aide de son ami l’illusionniste James Randi, il mit en évidence ses impostures. Un de ses leitmotivs était que les démonstrations de phénomènes paranormaux doivent être effectuées en présence, non de physiciens, mais de prestidigitateurs : « N’importe quel magicien vous dira que les scientifiques sont les personnes les plus faciles à leurrer […] La plupart des gens pensent qu’un brillant esprit est qualifié pour détecter les fraudes. C’est inexact. S’il n’a pas été formé à l’art de l’illusion et ne connaît pas ses méthodes, il est plus aisément trompé qu’un enfant. » Gardner parlait en connaissance de cause : il maîtrisait en professionnel les techniques de la magie de proximité, auxquelles il a consacré deux traités.
À côté de leur exploitation au music-hall, les prétendues facultés de télékinésie, de clairvoyance, de précognition et de perception extrasensorielle – c’est une de leurs singularités – ont été étudiées expérimentalement en laboratoire. Qu’est-ce qui a conduit certains chercheurs, demande Gardner, à des conclusions positives inexactes au sujet de leur existence ? « Dans la plupart des cas, les résultats obtenus sont le produit de biais involontaires dans la conception des expériences et l’analyse des données. Dans tous les types de recherche qui dépendent fortement des statistiques, les expérimentateurs sont enclins à trouver ce qu’ils désirent passionnément trouver […] Une autre explication […] est simplement la tricherie plus ou moins habile des sujets étudiés […] Enfin, il y a les rares cas où c’est le chercheur en parapsychologie lui-même qui triche. »
Martin Gardner s’est également amusé à tourner en ridicule la théosophie d’Helena Blavatsky, l’anthroposophie de Rudolf Steiner, la dianétique de Ron Hubbard et de l’Église de scientologie, la thérapie primale d’Arthur Janov, les idées du psychanalyste dissident Wilhelm Reich sur l’orgone, la sémantique générale d’Alfred Korzybski, la théorie de la collision des mondes d’Immanuel Velikovsky, la résonance morphique de Rupert Sheldrake, le créationnisme et l’idéologie messianique des télévangélistes, ainsi que les idées de l’ancien champion de base-ball Alfred William Lawson, auteur d’une théorie physique nouvelle fondée sur les concepts de « pénétrabilité », « succion et pression » et « zig-zag et tourbillons ».
Face à des théories aussi saugrenues et dépourvues de fondement, affirmait-il, l’attitude la plus sensée est de s’en tenir au précepte du sarcastique journaliste de Baltimore H. L. Mencken : « Un rire tonitruant vaut dix mille syllogismes. » Il s’est tout de même appliqué à dresser le portrait-robot de l’auteur de ce genre de fumisterie. Souvent porté à la paranoïa, « il se considère comme un génie […] regarde ses collègues sans exception comme des imbéciles ignares […] se croit injustement persécuté et objet de discrimination […] éprouve une forte compulsion à concentrer ses attaques sur les plus grands savants et les théories les mieux établies [et] a souvent tendance à écrire dans un jargon complexe et à employer des mots ou des expressions qu’il a lui-même inventés. »
Gardner n’a par ailleurs pas hésité à relever les égarements de personnalités considérées (au moins par certains) comme des savants de valeur : Margaret Mead, pour ses vues au sujet du paranormal, Bruno Bettelheim et sa thèse de la fabrication de l’autisme par les « mères réfrigérateurs », Carlos Castaneda et son anthropologie New Age, ou même Freud pour son concept du rêve et son indulgence envers les idées délirantes de son ami Wilhelm Fliess sur la « névrose nasale réflexe ».
Un des arguments avancés par les défenseurs des pseudosciences est que des théories qui font aujourd’hui partie intégrante de la science sont nées en marge du savoir établi : lorsqu’elles ont été proposées, la théorie microbienne de Pasteur, les règles d’asepsie de Semmelweis, la thèse de l’existence des météorites ont fait scandale. Mais le fait est, souligne Gardner, qu’elles ont été confirmées. Et s’il exact qu’on peut passer de façon continue des idées les plus fantaisistes aux moins contestables, et que la frontière entre les premières et les secondes est floue et mouvante, la distinction entre les unes et les autres conserve tout son sens : « Des théories non orthodoxes, essentielles à une science saine et aux progrès du savoir, sont qualitativement différentes de théories si contraires à la science acceptée, si peu soutenues par des preuves convenables, que leur probabilité d’être vraies est quasiment nulle. »
Gardner était à cet égard sévère envers des physiciens comme Olivier Costa de Beauregard ou David Bohm (ce dernier sous l’influence de Krishnamurti) qui exploitaient les paradoxes de la mécanique quantique pour justifier l’existence des phénomènes parapsychologiques. Et, face à des théories et des idées plus sérieuses mais d’un caractère purement spéculatif, comme la théorie des mondes multiples dans ses diverses variantes ou le principe anthropique sous ses différentes formes, il demeurait extrêmement sceptique.
Sa robuste vision de la science comme composée « de faits, de lois et de théories » était très classique. Durant sa jeunesse, il avait aidé Rudolf Carnap à réaliser un livre à partir de notes prises à ses cours. Toute sa vie, il restera fidèle au positivisme de Carnap, supérieur à ses yeux à l’épistémologie de la réfutabilité de Popper. Ce que ce dernier présentait comme son idée révolutionnaire – les théories scientifiques ne peuvent être qu’infirmées et jamais confirmées – repose, disait-il un peu trop rapidement, sur un jeu de mots, l’infirmation n’étant qu’une confirmation sous forme négative. Il avait moins de patience encore à l’égard de l’épistémologie anarchiste de Paul Feyerabend (pour qui, en sciences, « tout est bon »), du relativisme et du dédain affiché par plusieurs philosophes envers l’idée de vérité ou de la façon dont certains d’entre eux emploient, sans en comprendre le sens, les termes du langage scientifique, mise en lumière par la fameuse « affaire Sokal ».
D’un autre côté, Gardner revendiquait son appartenance, aux côtés des philosophes Colin McGinn, Thomas Nagel et John Searle, à cette école de pensée appelée le « mystérianisme », qui considère qu’un phénomène comme celui de la conscience est destiné à échapper à la connaissance scientifique, parce qu’il dépasse les capacités de compréhension du cerveau humain. Il se rangeait à cet égard parmi les plus radicaux : « L’affirmation que la science peut en principe tout découvrir n’est défendable que réduite à la tautologie triviale que la science peut découvrir tout ce que la science est capable de découvrir. » Il considérait comme insoluble la question du libre arbitre, impossible moyen terme entre le déterminisme strict des actes et leur caractère totalement aléatoire.
Rationaliste, Gardner n’en croyait pas moins à l’existence d’un Dieu personnel, à l’efficacité de la prière et à la vie après la mort. Ce qu’il appelait son « théisme », étranger à toute religion établie et certains dogmes du christianisme (par exemple la divinité de Jésus-Christ), relevait strictement, soulignait-il, du registre émotionnel et du sentiment. Niant la validité de toute preuve (« ontologique ou « physico-théologique ») de l’existence de Dieu, il était d’accord avec Carnap que « les propositions de la religion sont dépourvues de signification cognitive et [ne sont pas] soutenues par la logique ou la science ». « Toute l’expérience suggère qu’après la mort notre corps pourrit, écrit-il, et rien ne survit de notre cerveau. » En un mot, il reconnaissait que « les athées ont les meilleurs arguments », mais, à la suite de penseurs comme le psychologue Williams James ou l’écrivain Miguel de Unamuno, il n’en défendait pas moins sa foi, comme « un postulat du cœur, non de la tête ». Il croyait, « parce que cela le rendait plus heureux », pour utiliser la formule de son ami l’astronome Carl Sagan ou, comme il le disait lui-même – citant Shakespeare sans le nommer – pour « soulager l’angoisse d’un Univers qui ne serait rien qu’une histoire racontée par un idiot [...] pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien ».
Il ne lui semblait donc pas impossible de « combiner la foi de G. K. Chesterton en un Dieu personnel et l’admiration de H. G. Wells pour la science ». Ces deux écrivains de l’Angleterre edwardienne étaient ses auteurs favoris. En matière littéraire, sa tournure d’esprit le portait de manière générale vers des auteurs partageant son amour des charades, des jeux de mots et de l’insolite comme Jorge Luis Borges, Georges Perec et, surtout, Lewis Caroll. On lui doit une édition annotée d’
Alice au pays des merveilles considérée comme la Bible par tous les spécialistes. À propos des scènes de violence (par exemple de décapitation) qu’on y trouve, censées traumatiser les très jeunes lecteurs, il faisait ironiquement remarquer : « Mon impression est que des enfants ordinaires trouvent tout cela très amusant, mais qu’il ne faut pas faire circuler sans discernement des livres comme
Alice au pays des merveilles et
Le Magicien d’Oz auprès d’adultes en psychanalyse. » Il n’avait de fait que des sarcasmes pour les interprétations psychanalytiques de la littérature pour enfants.
Il s’intéressa aussi aux énigmes cachées dans l’
Ulysse de James Joyce (dont le
Finnegans Wake était pour lui une « monstrueuse curiosité de peu de valeur ») et cherchait l’inspiration chez des auteurs de science-fiction comme Philip José Farmer ou son ami Isaac Asimov, dont il appréciait l’imagination exempte de crédulité : « Les grands auteurs de science-fiction qui utilisent des dispositifs comme le voyage dans le temps, les mondes parallèles, les torsions de l’espace, la propulsion inertielle, la disparition et la réapparition dans des trous noirs et des trous blancs, la lévitation, l’antigravitation, la téléportation, les véhicules spatiaux d’origine extraterrestre, […] la réincarnation et les pouvoirs psychiques confondent rarement ces merveilles avec la science sérieuse. »
En politique et en économie, Gardner avait la même aversion pour les dogmes et l’idéologie qu’en matière scientifique. Hostile au marxisme comme au libertarisme d’Ayn Rand et de Robert Nozick, favorable à l’économie de marché mais conscient des limites du libéralisme, prônant une intervention de l’État dans l’économie dans un esprit keynésien, attaché aux libertés civiles et à l’égalité des droits, il se décrivait comme un social-démocrate à l’ancienne dans la tradition de Gunnar Myrdal et d’Irving Howe. Dans un article satirique sur la « courbe de Laffer », il tournait en dérision les prétentions de l’économie de l’offre, à la mode durant les années 1980.
Martin Gardner, soutient David Auerbach, a été « un des écrivains plus influents du XX
e siècle ». Ses articles dans
Scientific American ont suscité d’innombrables vocations de mathématicien. Des vulgarisateurs comme Douglas Hofstadter, Ian Stewart et bien d’autres lui doivent énormément, tout comme Michael Shermer et le mouvement sceptique. Il écrivait avec une incroyable facilité, souvent debout, sans contrainte d’horaire ou de calendrier, quand il en avait envie. Jamais il n’a connu le « syndrome de la feuille blanche », à l’exception de la période de dépression qui a suivi le décès de sa femme. Au plan personnel, il était un homme casanier de tempérament aimable, modeste et timide, fuyant les honneurs, évitant les conférences, renâclant à donner des interviews, toujours soucieux de payer ses dettes intellectuelles et prêt à dialoguer avec ses contradicteurs.
C’était aussi un esprit facétieux. Au mois de décembre 1983,
The New York Review of Books publiait une recension sévère de
The Whys of a Philosophical Scrivener, le livre dans lequel il expose le plus systématiquement sa vision du monde. L’auteur, George Groth, y fustigeait les contradictions des vues de Gardner en matière politique et philosophique, l’arbitraire de ses préférences esthétiques et l’incongruité des idées religieuses d’un homme se présentant comme un paladin de la raison scientifique. À quel point, se demandait-il, peut-on prendre un tel ouvrage au sérieux ? Après tout, Gardner est connu pour ses supercheries. Après avoir donné quelques exemples de canulars dont il s’était rendu coupable, il concluait, vendant la mèche au dernier moment : « Au fait, George Groth est un des pseudonymes de Gardner. »
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié
Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).
— Ce texte a été écrit pour
Books.
Notes
1. Le Seuil, 1994.
2. Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, devenu le Committee of Skeptical Inquiry.
3. Beaucoup de ses articles ont été réunis en volumes, notamment Fads and Fallacies in the Name of Science ; Science : Good, Bad and Bogus ; et The New Age : Notes
of a Fringe Watcher.