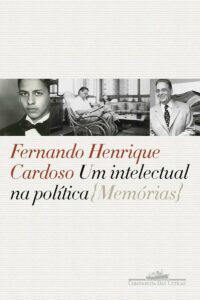Un intellectuel reconnu peut-il être un chef d’État ?
Publié en septembre 2025. Par Michel André.
Le cas de Fernando Henrique Cardoso, l’ancien président brésilien, illustre la complexité d’une question déjà posée par Max Weber.

Dans le discours qu’il prononça en 1999 à l’université d’Oxford à l’occasion de la remise de son diplôme de docteur honoris causa, l’écrivain et ancien président de la République tchèque Václav Havel énonçait en ces termes ce que devait être à son avis le double rôle des intellectuels en politique : offrir aux gouvernants un miroir critique ; exercer des responsabilités publiques pour aider à réaliser ce qu’ils estiment nécessaire dans l’intérêt général. Cité par Havel, l’historien et journaliste Timothy Garton Ash éprouva le besoin de le reprendre sur un point. Václav Havel, souligna-t-il, s’est engagé avec succès en politique. C’était aussi le cas de l’homme qui lui a remis son diplôme, le chancelier d’Oxford Roy Jenkins (historien et biographe, il fut plusieurs fois ministre et le seul président britannique de la Commission européenne). Mais ce sont là des exceptions. Les intellectuels et les responsables politiques exercent des métiers différents, qui gagnent à rester distincts. Dans ses deux célèbres conférences rassemblées sous le titre Le Savant et le Politique, Max Weber souligne lui aussi à quel point les vocations de penseur et de politicien réclament des dispositions d’esprit qui ne coïncident pas. Comme le montre l’exemple de Havel ou de Jenkins, ainsi que, plus loin de nous, celui d’Edmund Burke ou de François Guizot, les talents nécessaires pour réussir dans les deux domaines peuvent malgré tout se trouver réunis chez une même personne. Ils ne s’exercent toutefois pas toujours en même temps.
Président de la République du Brésil de 1995 à 2003, Fernando Henrique Cardoso était et demeure également connu comme un intellectuel. À côté de livres de réflexion politique et de recueils de discours, il a publié plusieurs ouvrages de sociologie et d’économie du développement. Paru lorsqu’il avait 90 ans, Um intelectual na política s’inscrit dans le prolongement d’un premier livre de souvenirs, La Somme et le Reste, publié à l’occasion de son 80e anniversaire. C’est une autobiographie intellectuelle. Les activités de Cardoso à la tête du Brésil, dont il a rendu compte au jour le jour dans les quatre volumes de ses Journaux de la présidence, sont à peine évoquées, et les débuts de sa carrière politique guère davantage. L’ouvrage contient dans ses pages finales des réflexions sur l’état du monde et quelques considérations philosophiques et personnelles. Mais l’essentiel de son contenu est le récit de son parcours de sociologue.
Fernando Henrique Cardoso est né dans une famille de militaires très impliqués dans la vie politique du Brésil. Son arrière-grand-père, son grand-père et son père furent tous les trois généraux. Animé par des idéaux nationalistes et progressistes, son père fut aussi avocat et député du Parti travailliste après la chute du dictateur populiste Getúlio Vargas, en 1954. Né à Rio de Janeiro, Cardoso fit ses études secondaires à São Paulo. Il s’inscrivit ensuite à l’université de cette ville, fondée en 1934 dans le but de redonner à la capitale régionale le prestige et l’influence que les liens de Vargas avec les États du nord-ouest lui avaient fait perdre. Le choix de la sociologie n’avait rien d’incongru dans un pays dont les fondateurs de la république s’étaient inspirés des idées d’Auguste Comte et où cette discipline était perçue comme ayant partie liée avec le destin national.
Dans l’esprit libéral et cosmopolite qui caractérisait les élites de la ville, l’université de São Paulo faisait largement appel à des professeurs étrangers. En sciences sociales et humaines, il s’agissait essentiellement de Français comme Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss ou Roger Bastide. Tout en défendant une pratique de la sociologie basée sur des fondements empiriques et sur la recherche de terrain, celui qui allait devenir le maître de Cardoso, Florestan Fernandes, accordait dans son enseignement une grande place aux auteurs canoniques européens : Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Ils demeurèrent une référence essentielle pour son brillant étudiant. Lorsque Roger Bastide, dont il était un assistant, retourna en France et fut remplacé par Fernandes, Cardoso devint l’assistant de ce dernier. Ses premiers travaux portèrent sur l’héritage des relations entre maîtres et esclaves dans le capitalisme du sud du Brésil. À l’instar de Roger Bastide, il défendait une vision des relations entre les races différente de celle du grand anthropologue et père de la sociologie brésilienne Gilberto Freyre dans son célèbre ouvrage Maîtres et esclaves. Les sociologues de São Paulo jugeaient cette vision trop idyllique et trouvaient qu’elle reflétait la situation dans le nord-est du pays plutôt que dans l’ensemble du Brésil. Cardoso conserva néanmoins toujours un grand respect pour Freyre, dont il admirait le sens du concret et des détails de la vie quotidienne ainsi que les grandes qualités d’écrivain. Freyre figure en bonne place dans la série de portraits réunis dans son livre Ces penseurs qui ont inventé le Brésil, aux côtés du théoricien de l’abolitionisme Joaquim Nabuco et de plusieurs autres écrivains et théoriciens qui se sont intéressés à la formation du Brésil et à l’histoire sociale du pays : l’écrivain Euclides da Cunha, les historiens et sociologues Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Prado et Raymundo Faoro, l’économiste Celso Furtado.
En rupture avec l’approche très ouverte de Florestan Fernandes, les jeunes chercheurs de l’université de São Paulo faisaient du marxisme leur principal cadre de référence. Au cours des années 1950, un groupe d’entre eux comprenant notamment Cardoso et sa femme Ruth, anthropologue, consacra un séminaire fameux à la lecture du Capital. En 1962, Cardoso prenait la direction du Centre de sociologie industrielle et du travail créé à l’initiative d’Alain Touraine, arrivé à l’université de São Paulo dans les pas de George Friedman. À cette époque, sans être engagé dans la vie politique active, Cardoso était proche du Parti communiste, avec lequel il coupa les liens à la suite de la répression de l’insurrection de Budapest par les troupes soviétiques.
En 1964, les militaires ayant pris le pouvoir au Brésil, il s’exila au Chili. C’est là qu’en collaboration avec le Chilien Enzo Faletto il rédigea son livre le plus connu, Dépendance et développement en Amérique latine. Avec ceux de Celso Furtado, il est considéré comme un des ouvrages fondamentaux de la théorie de la dépendance, qui postule l’existence d’un lien structurel entre la prospérité des pays situés au centre de l’économie capitaliste et le retard de développement des contrées de la périphérie. Cardoso s’est toujours défendu d’avoir voulu formuler une théorie critique appelant à la révolution. Il souligne l’accent mis sur les conditions de la croissance et du développement plutôt que sur les mécanismes de la dépendance. De fait, l’ouvrage analyse la manière dont ce que l’on n’appelait pas encore la mondialisation peut affecter négativement, mais aussi positivement, les pays du Sud, en fonction des politiques économiques menées par leurs dirigeants.
De retour au Brésil à la suite de l’adoucissement du régime militaire, Cardoso prit la tête d’un centre de recherche financé par la fondation Ford. Il effectua durant cette période plusieurs séjours à l’étranger, notamment à Princeton, Paris et Cambridge, qui contribuèrent à renforcer sa réputation internationale. En même temps, ses liens avec le monde politique se fortifièrent. En 1970, il entrait résolument en politique en rédigeant le programme du parti d’Ulysses Guimarães, opposé au régime militaire. Peu avant le rétablissement de la démocratie au Brésil, en 1985, il était élu sénateur du Parti social-démocrate. Leader de ce parti au Sénat sous le gouvernement du président José Sarney, après la destitution de Fernando Collor il fut nommé ministre des Affaires étrangères, puis de l’Économie, par son successeur Itamar Franco. Son grand succès dans le deuxième poste fut le lancement du plan Real, qui à l’aide de la création d’une nouvelle monnaie (la quatrième en quelques années) et d’une série de mesures d’accompagnement permit de juguler une inflation galopante et de réduire le taux de pauvreté. Il lui servit de tremplin pour la présidence, à laquelle il fut élu à une large majorité en 1994 face au candidat du parti des travailleurs Luiz Inácio Lula da Silva.
En 1998, ayant fait modifier la Constitution pour pouvoir se représenter, il était réélu. Le bilan de son double mandat est mitigé. On met généralement à son crédit d’avoir stabilisé le pays, consolidé la démocratie, modernisé l’État et amélioré la situation du Brésil dans les domaines de l’éducation et de la santé. Mais la politique de dérégulation et de privatisation massive qu’il mena, mise en œuvre sans précaution dans une conjoncture internationale peu propice, n’eut pas les effets positifs escomptés. À l’issue de ses huit années de présidence, la monnaie du pays s’était fortement dépréciée, la croissance stagnait, les salaires avaient baissé, la dette publique et le chômage augmenté dans des proportions spectaculaires.
En quittant le pouvoir, Fernando Henrique Cardoso n’abandonna pas la scène politique, sur laquelle il est longtemps resté actif. Apprécié de la presse et des médias pour son brio et sa forte personnalité, jouant volontiers le rôle de « vieux sage » de la politique nationale, il continua à intervenir dans le débat public, critiquant sévèrement les politiques menées par Lula, qui lui succéda pour deux mandats, puis par Dilma Rousseff, et stigmatisant la corruption endémique dans le pays. En 2022, il soutint toutefois Lula contre Jair Bolsonaro, qui se représentait pour un second mandat.
Dans Um intelectual na política comme dans les entretiens qu’il a accordés au cours des dernières années, Cardoso insiste sur la double cohérence de son parcours : cohérence de son travail de sociologue et de son action politique ; cohérence de sa vision du monde, de la politique et de la société tout au long de sa longue carrière. Ses détracteurs soulignent le contraste entre ses travaux sociologiques et les propos plus généraux et convenus qu’il a tenus oralement et par écrit sur la scène publique depuis qu’il est pleinement entré dans la vie politique. Ils relèvent aussi la contradiction entre les analyses marxistes de sa jeunesse et sa maturité et la politique économique d’inspiration néo-libérale qu’il mena une fois arrivé au sommet du pouvoir.
Pour expliquer ce que certains dénoncent comme une trahison de ses anciens idéaux, Cardoso invoque les changements intervenus dans l’économie mondiale et la politique internationale au cours des dernières décennies. Il rappelle aussi la profonde différence entre la situation de l’intellectuel, libre de suivre ses idées jusqu’où elles le mènent, et celle du responsable politique, qui pour mener à bien ses projets doit nécessairement conclure des alliances, composer avec ses adversaires, accepter des compromis, convaincre les parlementaires, les représentants des forces économiques, les syndicats et l’opinion. Ces contraintes, déplore-t-il, l’ont condamné à ne réaliser qu’une partie de ce qu’il ambitionnait.
Le métier de politicien suppose un savoir-faire particulier. Fernando Henrique Cardoso n’aurait pas eu la carrière politique qu’il a eue s’il n’avait pas possédé les talents indispensables : une suffisante aisance en société, le don de persuasion, un minimum de psychologie, un grand sens tactique et de réelles capacités manœuvrières. Il lui fallait aussi une forte motivation : de son propre aveu, notamment parce qu’il y baignait en raison de son environnement familial, la politique l’a toujours passionné. Sociologue influent, il a aussi été un brillant homme d’État. Mais le lien entre ces deux volets de ses activités est plus ténu et moins direct qu’on ne le dit volontiers. L’agilité mentale et les capacités d’analyse qui s’expriment dans ses travaux scientifiques se manifestaient également dans ses interventions publiques et l’ont indiscutablement servi dans sa carrière. Celle-ci a par ailleurs bénéficié de son prestige d’intellectuel et des contacts qu’il a eu l’occasion de faire grâce à ses travaux universitaires. Au bout du compte, il aura tout de même exercé deux métiers différents, en succession plutôt que simultanément.