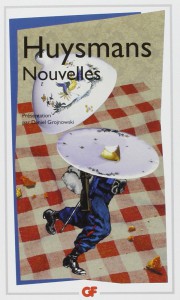Jamais sans mon bureau
Publié le 28 août 2015. Par La rédaction de Books.
Pire que les vacances, la retraite ! Des années à profiter de son temps libre, l’horreur pour monsieur Bougran. Ce fonctionnaire dévoué mis à la retraite d’office à 50 ans, héros d’une nouvelle de J. K. Huysmans, trouve donc une solution pour lutter contre son insupportable désœuvrement. Il suffisait d’y penser…
Ils avaient guetté la rentrée et les condoléances variaient avec les têtes. Le commis d’ordre, un grand secot, à tête de marabout, peluchée de quelques poils incolores sur l’occiput, lui secoua vivement les mains, sans dire mot ; il se comportait envers lui comme envers la famille d’un défunt, à la sortie de l’église, devant le corps, après l’absoute. Les expéditionnaires hochaient la tête, témoignaient de leur douleur officielle, en s’inclinant.
Les rédacteurs, ses collègues, plus intimes avec lui, esquissèrent quelques propos de réconfort.
— Voyons, il faut se faire une raison — et puis, mon cher, songez qu’en somme, vous n’avez ni femme, ni enfants, que vous pourriez être mis à la retraite dans des conditions infiniment plus dures, en ayant, comme moi, par exemple, une fille à marier. Estimez-vous donc aussi heureux qu’on peut être en pareil cas.
— Il convient aussi d’envisager dans toute affaire le côté agréable qu’elle peut présenter, fit un autre. Vous allez être libre de vous promener, vous pourrez manger au soleil vos petites rentes.
— Et aller vivre à la campagne où vous serez comme un coq en pâte, ajouta un troisième.
Bougran fit doucement observer qu’il était originaire de Paris, qu’il ne connaissait personne en province, qu’il ne se sentait pas le courage de s’exiler, sous prétexte d’économies à réaliser, dans un trou ; tous n’en persistèrent pas moins à lui démontrer qu’en fin de compte, il n’était pas bien à plaindre.
Et comme aucun d’eux n’était menacé par son âge d’un semblable sort, ils exhibaient une résignation de bon aloi, s’indignaient presque de la tristesse de M. Bougran.
L’exemple de la réelle sympathie et du véridique regret, ce fut Baptiste, le garçon de bureau, qui le servit ; l’air onctueux et consterné, il s’offrit à porter lui-même chez M. Bougran les petites affaires, telles que vieux paletot, plumes, crayons, etc., que celui-ci possédait à son bureau, laissa entendre que ce serait ainsi la dernière occasion que M. Bougran aurait de lui donner un bon pourboire.
— Allons, Messieurs, fit le Chef qui entra dans la pièce. Le Directeur demande le portefeuille pour 5 heures.
Tous se dispersèrent ; et, hennissant comme un vieux cheval, M. Bougran se mit au travail, ne connaissant plus que la consigne, se dépêchant à rattraper le temps qu’il avait, dans ses douloureuses rêveries sur un banc, perdu.
*
Les premiers jours furent lamentables. Réveillé, à la même heure que jadis, il se disait à quoi bon se lever, traînait contrairement à ses habitudes dans son lit, prenait froid, bâillait, finissait par s’habiller. Mais à quoi s’occuper, Seigneur ! Après de mûres délibérations, il se décidait à aller se promener, à errer dans le jardin du Luxembourg qui n’était pas éloigné de la rue de Vaugirard où il habitait.
Mais ces pelouses soigneusement peignées, sans tache de terre ni d’eau, comme repeintes et vernies, chaque matin, dès l’aube ; ces fleurs remontées comme à neuf sur les fils de fer de leurs tiges ; ces arbres gros comme des cannes, toute cette fausse campagne, plantée de statues imbéciles, ne l’égayait guère. Il allait se réfugier au fond du jardin, dans l’ancienne pépinière sur laquelle maintenant tombaient les solennelles ombres des constructions de l’Ecole de Pharmacie et du Lycée Louis-le-Grand. La verdure n’y était ni moins apprêtée, ni moins étique. Les gazons y étalaient leurs cheveux coupés ras et verts, les petits arbres y balançaient les plumeaux ennuyés de leurs têtes, mais la torture infligée, dans certaines plates-bandes, aux arbres fruitiers l’arrêtait. Ces arbres n’avaient plus forme d’arbres. On les écartelait le long de tringles, on les faisait ramper le long de fils de fer sur le sol ; on leur déviait les membres dès leur naissance et l’on obtenait ainsi des végétations acrobates et des troncs désarticulés, comme en caoutchouc. Ils couraient, serpentaient ainsi que des couleuvres, s’évasaient en forme de corbeilles, simulaient des ruches d’abeilles, des pyramides, des éventails, des vases à fleurs, des toupets de clown. C’était une vraie cave des tortures végétales que ce jardin où, à l’aide de chevalets, de brodequins d’osier ou de fonte, d’appareils en paille, de corsets orthopédiques, des jardiniers herniaires tentaient, non de redresser des tailles déviées comme chez les bandagistes de la race humaine, mais au contraire de les contourner et de les disloquer et de les tordre, suivant un probable idéal japonais de monstres !
Mais quand il avait bien admiré cette façon d’assassiner les arbres, sous le prétexte de leur extirper de meilleurs fruits, il traînait, désœuvré, sans même s’être aperçu que cette chirurgie potagère présentait le plus parfait symbole avec l’administration telle qu’il l’avait pratiquée pendant des ans. Dans les bureaux, comme dans le jardin du Luxembourg, l’on s’ingéniait à démantibuler des choses simples ; l’on prenait un texte de droit administratif dont le sens était limpide, net, et aussitôt, à l’aide de circulaires troubles, à l’aide de précédents sans analogie, et de jurisprudences remontant au temps des Messidors et des Ventôses, l’on faisait de ce texte un embrouillamini, une littérature de Magot, aux phrases grimaçantes, rendant les arrêts les plus opposés à ceux que l’on pouvait prévoir.
Puis, il remontait, allait sur la terrasse du Luxembourg où les arbres semblent moins jeunes, moins fraîchement époussetés, plus vrais. Et il passait entre les chaises, regardant les gamins faire des pâtés avec du sable et de petits seaux, tandis que leurs mères causaient, coude à coude, échangeant d’actives réflexions sur la façon d’apprêter le veau et d’accommoder, pour le déjeuner du matin, les restes.
Et il rentrait, harassé, chez lui, remontait, bâillait, se faisait rabrouer par sa servante Eulalie, qui se plaignait qu’il devînt « bassin », qu’il se crût le droit de venir « trôler » dans sa cuisine.
Bientôt l’insomnie s’en mêla ; arraché à ses habitudes, transporté dans une atmosphère d’oisiveté lourde, le corps fonctionnait mal ; l’appétit était perdu ; les nuits jadis si bonnes sous les couvertures s’agitèrent et s’assombrirent, alors que, dans le silence noir, tombaient, au loin, les heures.
Il s’avisa de lire, dans la journée, quand il plut, et alors, fatigué de ses insomnies, il s’endormit ; et la nuit qui suivait ces somnolences devenait plus longue, plus éveillée, encore. Il dut, quand le temps se gâta, se promener quand même, pour se lasser les membres et il échoua dans les musées, — mais aucun tableau ne l’intéressait ; il ne connaissait aucune toile, aucun maître, ambulait lentement, les mains derrière le dos, devant les cadres, s’occupant des gardiens, assoupis sur les banquettes, supputant la retraite qu’eux aussi, en leur qualité d’employés de l’État, ils auraient un jour.
Il se promena, las de couleurs et de statues blanches, dans les passages de Paris, mais il en fut rapidement chassé ; on l’observait ; les mots de mouchard, de roussin, de vieux poivrot, s’entendirent. Honteux il fuyait sous l’averse et retournait se cantonner dans son chez lui.
Et plus poignant que jamais, le souvenir de son bureau l’obséda. Vu de loin, le Ministère lui apparaissait tel qu’un lieu de délices. Il ne se rappelait plus les iniquités subies, son sous-chèfat dérobé par un inconnu entré à la suite d’un Ministre, l’ennui d’un travail mécanique, forcé ; tout l’envers de cette existence de cul-de-jatte s’était évanoui ; la vision demeurait, seule, d’une vie bien assise, douillette, tiède, égayée par des propos de Collègues, par de pauvres plaisanteries, par de minables farces.
Décidément, il faut aviser, se dit mélancoliquement M.Bougran. Il songea, pendant quelques heures, à chercher une nouvelle place qui l’occuperait et lui ferait même gagner un peu d’argent ; mais, même en admettant qu’on consentît à prendre dans un magasin un homme de son âge, alors il devrait trimer, du matin au soir et il n’aurait que des appointements ridicules puisqu’il était incapable de rendre de sérieux services, dans un métier dont il ignorait les secrets et les ressources.
Et puis ce serait déchoir ! — Comme beaucoup d’employés du Gouvernement, M. Bougran se croyait, en effet, d’une caste supérieure et méprisait les employés des commerces et des banques. II admettait même des hiérarchies parmi ses congénères, jugeait l’employé d’un Ministère supérieur à l’employé d’une Préfecture, de même que celui-ci était, à ses yeux, d’un rang plus élevé que le commis employé dans une Mairie.
Alors, que devenir ? Que faire ? Et cette éternelle interrogation restait sans réponse.
De guerre lasse, il retourna à son bureau, sous le prétexte de revoir ses Collègues, mais il fut reçu par eux comme sont reçus les gens qui ne font plus partie d’un groupe — froidement. L’on s’inquiéta d’une façon indifférente de sa santé ; d’aucuns feignirent de l’envier, vantèrent la liberté dont il jouissait, les promenades qu’il devait aimer à faire.
Bougran souriait, le cœur gros. Un dernier coup lui fut inconsciemment porté. Il eut la faiblesse de se laisser entraîner dans son ancienne pièce ; il vit l’employé qui le remplaçait, un tout jeune homme ! Une colère le prit contre ce successeur parce qu’il avait changé l’aspect de cette pièce qu’il aimait, déplacé le bureau, poussé les chaises dans un autre coin, mis les cartons dans d’autres cases ; l’encrier était à gauche maintenant et le plumier à droite !
Il s’en fut navré. — En route, soudain, une idée germa qui grandit en lui. — Ah! fit-il, je suis sauvé peut-être, et sa joie fut telle qu’il mangea, en rentrant, de bon appétit, ce soir-là, dormit comme une taupe, se réveilla, guilleret, dès l’aube.
*
Ce projet qui l’avait ragaillardi était facile à réaliser. D’abord M. Bougran courut chez les marchands de papiers de tentures, acquit quelques rouleaux d’un infâme papier couleur de chicorée au lait qu’il fit apposer sur les murs de la plus petite de ses pièces ; puis, il acheta un bureau en sapin peint en noir, surmonté de casiers, une petite table sur laquelle il posa une cuvette ébréchée et un savon la guimauve dans un vieux verre, un fauteuil canné, en hémicycle, deux chaises. Il fit mettre contre les murailles des casiers de bois blanc qu’il remplit de cartons verts à poignées de cuivre, piqua avec une épingle un calendrier le long de la cheminée dont il fit enlever la glace et sur la tablette de laquelle il entassa des boîtes à fiches, jeta un paillasson, une corbeille sous son bureau et, se reculant un peu, s’écria ravi: « M’y voilà, j’y suis ! »
Sur son bureau, il rangea, dans un ordre méthodique, toute la série de ses porte-plume et de ses crayons, porte-plume en forme de massue, en liège, porte-plume à cuirasses de cuivre emmanchés dans un bâton de palissandre, sentant bon quand on le mâche, crayons noirs, bleus, rouges, pour les annotations et les renvois. Puis il disposa, comme jadis, un encrier en porcelaine, cerclé d’éponges, à la droite de son sous-main, une sébille remplie de sciure de bois à sa gauche ; en face, une grimace contenant sous son couvercle de velours vert, hérissé d’épingles, des pains à cacheter et de la ficelle rose. Des dossiers de papier jaunâtre un peu partout ; au-dessus des casiers, les livres nécessaires : Le Dictionnaire d’Administration de Bloch, Le Code et les Lois usuelles, le Béquet, le Blanche ; il se trouvait, sans avoir bougé de place, revenu devant son ancien bureau, dans son ancienne pièce.
Il s’assit, radieux, et dès lors revécut les jours d’antan. Il sortait, le matin, comme jadis, et d’un pas actif, ainsi qu’un homme qui veut arriver à l’heure, il filait le long du boulevard Saint-Germain, s’arrêtait à moitié chemin de son ancien bureau, revenait sur ses pas, rentrait chez lui, tirant dans l’escalier sa montre pour vérifier l’heure, et il enlevait la rondelle de carton qui couvrait son encrier, retirait ses manchettes, y substituait des manchettes en gros papier bulle, le papier qui sert à couvrir les dossiers, changeait son habit propre contre la vieille redingote qu’il portait au Ministère, et au travail !
Il s’inventait des questions à traiter, s’adressait des pétitions, répondait, faisait ce qu’on appelle « l’enregistrement », en écrivant sur un gros livre la date des arrivées et des départs. Et, la séance de bureau close, il flânait comme autrefois une heure dans les rues avant que de rentrer pour dîner.
Il eut la chance, les premiers temps, de s’inventer une question analogue à celles qu’il aimait à traiter jadis, mais plus embrouillée, plus chimérique, plus follement niaise. Il peina durement, chercha dans les arrêts du Conseil d’État et de la Cour de Cassation ces arrêts qu’on y trouve, au choix, pour défendre ou soutenir telle ou telle cause. Heureux de patauger dans les chinoiseries juridiques, de tenter d’assortir à sa thèse les ridicules jurisprudences qu’on manie dans tous les sens, il suait sur son papier, recommençant plusieurs fois ses minutes ou ses brouillons, les corrigeant dans la marge laissée blanche sur le papier, comme le faisait son Chef, jadis, n’arrivant pas, malgré tout, à se satisfaire, mâchant son porte-plume, se tapant sur le front, étouffant, ouvrant la croisée pour humer de l’air.