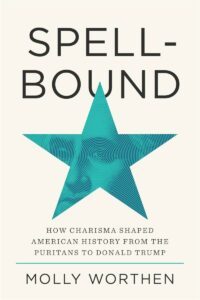La transcendance de Donald Trump
Publié en novembre 2025. Par Books.
Trump n’est pas particulièrement bel homme. Sa rhétorique est hésitante et volontiers répétitive. Ses théories rudimentaires oscillent entre l’incohérence et l’inquiétant. Sa morale… Alors, quel est son secret ? Le charisme, explique Molly Worthen, qui est… historienne des religions. Ce qui lui permet d’expliciter (ou tenter de) « cette qualité propre à un individu qui le met à part du reste » et sur laquelle le sociologue Max Weber s’est penché avant elle. Le leader charismatique, proposait Weber, exerce une emprise fondée ni sur la raison ni sur la tradition mais sur l’émotion. Sa personnalité le situe en dehors du monde et lui permet, à certains moments clés de l’Histoire, de susciter chez ses admirateurs la croyance en « un futur radicalement nouveau », quitte à pulvériser les habitudes et les normes en vigueur. Molly Worthen quant à elle approche la question sous l’angle résolument religieux. Le charisme, qui dans la Grèce antique comme pour saint Paul est un don de Dieu, une grâce, permet à un être d’exception de répondre à « une urgence métaphysique » en proposant à ses concitoyens un « narratif », « une sorte de récit transcendantal qui invite les adeptes à découvrir le sens de leur vie ». Évidemment, voir Donald Trump figurer aux côtés de prophètes et de gourous révérés dans la taxonomie charismatique que propose Molly Worthen peut surprendre. Mais il arrive au « milliardaire du peuple » (comme en 2016 lors d’un meeting en Caroline du Nord) de tenir des propos quasi messianiques du genre : « Ce “big beautiful” projet, c’est tout ce que nous allons faire ensemble. Et vous allez être si fiers. Et vous allez être si heureux. Et vous allez gagner. » Voyez aussi comme Trump sacralise sa propre richesse (une bénédiction divine) ou encore l’échec de l’attentat contre lui (c’est le Tout-Puissant qui a fait dévier la balle mortelle vers son oreille, au grand bénéfice de l’Amérique). Le charisme – « à la fois un phénomène et un concept » – n’a rien pourtant de spécifiquement américain, « mais son histoire aux États-Unis est particulièrement intéressante… Le pays est un véritable champ d’expérience pour les entrepreneurs métaphysiques », résume Molly Worthen qui étaye sa théorie en évoquant une série d’exemples, depuis la prophétesse puritaine du XVIIe siècle Anne Hutchinson jusqu’aux télévangélistes d’aujourd’hui, en passant par le père des mormons, Joseph Smith, ou des prescripteurs culturels comme Oprah Winfrey. Tous ces gens ont en commun de refléter « la dialectique entre personnalité et contexte du moment ». (À vrai dire, pour que le message reçoive le meilleur accueil en nos jours de déclin religieux, il faut en parallèle maîtriser les « moyens de distribution » technologiques, TV ou réseaux sociaux.)
Cette idée que le charisme politique « repose fondamentalement sur une expérience religieuse » ne convainc pas forcément tout le monde. John G. Turner fait valoir dans la Los Angeles Review of Books que « des leaders comme Eisenhower ou Reagan débordaient de charisme sans qu’ils aient pour autant cherché à transmettre le moindre message transcendantal ». Les liens entre politique et religion demeurent mystérieux, même s’il faut se souvenir que dans « culte de la personnalité » il y a « culte » – et qu’en Corée du Nord, par exemple, la naissance des leaders vénérés est accompagnée de prodiges, qu’eux-mêmes font des miracles, qu’ils sont immortels, etc. Et puis Max Weber n’a-t-il pas postulé que lorsqu’une société se sécularise et se bureaucratise, les élans spirituels sont nécessairement redirigés vers d’autres domaines, notamment la politique ? Mais Molly Worthen n’en démord pas. Tout en reconnaissant « qu’il faut tolérer une certaine flexibilité dans la définition du charisme », elle affirme qu’en dépit du recul du religieux aux États-Unis, « les instincts spirituels des Américains d’aujourd’hui continuent à les orienter vers des leaders qui ont le don de proposer un projet transcendant ». Des leaders qui – sauf Kennedy et Reagan bien sûr – « sont par ailleurs dépourvus en général de charme physique et du moindre talent oratoire ». Ils sont hélas souvent dénués aussi de sens moral – moralité et transcendance ne marchant pas toujours de pair (voir le sulfureux gourou Maharaj Ji, fraudeur fiscal et prédateur sexuel). Cette regrettable déconnexion explique que le divin don du charisme amène au pouvoir aussi bien des libérateurs que de futurs tyrans. Voilà donc les Américains prévenus…