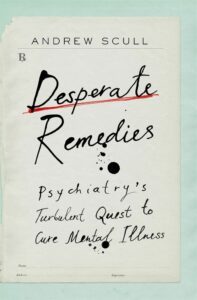Déprimante psychiatrie
Publié en mars 2024. Par Mikkel Borch-Jacobsen.
L’histoire de la psychiatrie est un cimetière de conceptions fantaisistes, aux conséquences souvent dévastatrices. En Europe et aujourd’hui plus encore aux États-Unis.
Desperate Remedies, sous-titré « Psychiatry’s Turbulent Quest to Cure Mental Illness », est un livre déprimant. Son auteur, Andrew Scull, est un éminent sociologue et historien de la psychiatrie et plus largement de la folie. Dans l’un de ses précédents livres, Madness in Civilization, il brossait une très ambitieuse histoire culturelle de la folie qui concurrençait par son ampleur l’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault. Dans un autre, Hysteria, il suivait les métamorphoses de cette étrange « maladie » à travers les âges et les « thérapies » le plus souvent aberrantes mises en œuvre pour la contrôler. Dans un autre encore, Madhouse, il racontait l’histoire édifiante du Dr Henry Cotton, un influent psychiatre américain du début du XXe siècle qui s’était convaincu que la folie était causée par des infections focales et pratiquait à la chaîne des ablations d’organes qui mutilaient les patients sans pour autant les guérir.
Deux cents ans d’histoire et aucun progrès ?
Desperate Remedies prolonge cette dernière dénonciation de l’hubris psychiatrique, en l’étendant cette fois-ci à la psychiatrie américaine dans son ensemble et même, faut-il comprendre, à la psychiatrie en général depuis ses débuts européens. Scull nous en avertit dès les premières lignes de sa préface : « Dans ce livre, j’ai tenté de fournir une évaluation sceptique de l’entreprise psychiatrique – de son impact sur ceux qu’elle traite et sur la société dans son ensemble. [...] Je me suis concentré sur la thérapie des maladies mentales et sur les professionnels qui l'ont développée. » La psychiatrie, discipline médicale qui a émergé au début du XIXe siècle avec la prétention d’étudier et de traiter ce qu’elle présentait comme des maladies mentales, n’a en fait jamais réussi, dit Scull, à en percer les causes et encore moins à les guérir : « Deux siècles après la naissance de la profession psychiatrique, les racines des formes les plus graves de troubles mentaux restent toujours aussi énigmatiques. »
Deux cents ans d’histoire et aucun progrès ? Toujours dans sa préface, Scull raconte comment « un producteur hollywoodien qui avait un temps envisagé de faire un film basé sur l’un de mes livres m’a expliqué que celui-ci fournissait une très bonne matière pour un premier et un second acte. “Mais où est donc le troisième acte ?”, m’a-t-il demandé. Il voulait dire par là : “Où est le happy end ?” » Hollywood étant Hollywood, on soupçonne qu’en fait ce producteur demandait plutôt à Scull : « Où est l’histoire ? » Où est, autrement dit, la bonne vieille intrigue aristotélicienne avec un début, un milieu et une fin, heureuse ou non ?
De fait, l’histoire que raconte Scull dans Desperate Remedies a bien trois actes, ou plutôt trois parties, mais on n’y trouve aucune unité d’action ni aucun arc narratif bien défini. Non seulement les parties se chevauchent chronologiquement, à la façon d’un collage cubiste entremêlant les temporalités, mais toutes racontent en fin de compte la même histoire : comment une nouvelle théorie ou un nouveau traitement avait suscité chez ses promoteurs l’espoir d’avoir enfin trouvé le moyen de guérir la maladie mentale, pour les exposer en fin de compte à une cruelle déception après qu’ils eurent volontairement ignoré le mal infligé aux patients.
Rien de tout cela ne fait une bonne histoire, évidemment, mais cela fait de la bonne histoire, et qui donne à réfléchir. Trop souvent en effet l’histoire de la psychiatrie a été écrite à partir d’un happy end supposé, comme si la vérité définitive sur la maladie mentale avait été découverte en 1895 par Sigmund Freud, ou au début des années 1950 avec l’avènement de la « révolution psychopharmacologique ». Rien de tel avec Scull. Méthodiquement sceptique à l’égard des prétentions théoriques et thérapeutiques des psychiatres, il raconte non pas « ce qui pourrait arriver », mais « ce qui est arrivé » (c’est la différence entre l’histoire et la poésie selon Aristote), sans chercher à donner un sens prédéterminé aux événements qu’il narre. Le résultat est un récit désordonné, brouillon et, oui, tout à fait déprimant.
La folie est-elle une maladie ?
Acte 1. – En tant que profession, la psychiatrie est née au début du XIXe siècle de l’idée que la folie est une maladie et que celle-ci peut être soignée. Inspirés par le « traitement moral » de William Tuke et Philippe Pinel, les réformateurs sociaux de l’époque promouvaient la création d’asiles publics où les aliénés seraient traités avec humanité et ramenés à la raison, au lieu d’être jetés en prison ou condamnés à l’itinérance. Très vite, cependant, il devint évident que la psychiatrie ne pouvait pas tenir ses promesses et l’optimisme des débuts céda progressivement la place au nihilisme thérapeutique. Dans les dernières décennies du siècle, les asiles psychiatriques devinrent de vastes lieux d’internement où croupissaient une multitude de patients dont le seul point commun était qu’on ne savait pas quoi faire d’eux : les séniles et les déments, les alcooliques, les pervers, les faibles d’esprit, les schizophrènes, les personnes souffrant de mélancolie, d’hystérie ou de syphilis tertiaire (la redoutable paralysie générale des aliénés, ou PG). La plupart de ceux qui n’étaient pas libérés au bout d’un an en raison d’une rémission spontanée étaient laissés à l’abandon.
Cette impuissance thérapeutique était opportunément théorisée sous la forme d’une fatalité biologique qui était en même temps sociale : tous ces pauvres gens souffraient, disait-on, d’une hérédité chargée et payaient le prix de l’intempérance, de l’immoralité ou du manque d’hygiène de leurs parents et grands-parents (c’est ce que le neurologue Jean-Martin Charcot, le maître de Sigmund Freud, appelait la « famille névropathique »). Selon une variante de cette théorie de la dégénérescence, réservée à ceux qui pouvaient se le permettre, les « nerfs » fragiles dont souffraient les neurasthéniques et les hystériques de la bonne société provenaient au contraire du raffinement de leurs ancêtres. Ceux-là étaient orientés vers des cliniques privées et des sanatoriums où ils étaient pris en charge par des neurologues ou « médecins des nerfs » attentionnés, sans que pour autant on espérât les guérir de leur hérédité.
Les autres, ceux qui ne pouvaient pas payer, représentaient un poids financier et même un danger pour la société. Certains psychiatres rêvaient tout haut d’euthanasier les « unfits » (inaptes à la vie) afin de désengorger les asiles. D’autres préconisaient à tout le moins leur stérilisation afin de stopper la transmission du plasma germinatif défectueux. La Californie, suivie par d’autres États, passa en 1909 une loi autorisant la stérilisation forcée des handicapés et malades mentaux. La pratique, bientôt émulée par la plupart des pays nordiques et l’Allemagne nazie, se poursuivit aux États-Unis jusque dans les années 1970, après quelque 60 000 stérilisations forcées à travers le pays.
De curieux prix Nobel de médecine
Toutefois, tout le monde dans la communauté psychiatrique ne partageait pas ce très littéral nihilisme thérapeutique. L’histoire que raconte Scull est aussi celle des enthousiasmes thérapeutiques qui se sont succédé tout au long du XXesiècle, basés le plus souvent sur des théories aventureuses et sans fondement. Voici par exemple le Dr Henry Cotton et sa théorie bactérienne de la psychose, dont Scull retrace ici l’histoire. La découverte en 1905 de la bactérie responsable de la syphilis (Treponema pallidum), suivie par celle en 1909 de l’efficacité du Salvarsan sur le stade primaire de la maladie, avait ouvert la possibilité que la psychose, tout comme la PG, soit une maladie infectieuse, comme telle susceptible de céder à une stratégie antibactérienne. Cotton en était persuadé et avait essayé par exemple d’injecter du Salvarsan directement dans le cerveau de ses patients pour voir si cela pouvait avoir un effet. En l’absence de succès, il s’était rabattu sur les divers foyers infectieux susceptibles, spéculait-il, d’affecter à distance le cerveau. Il suffisait donc de procéder à l’ablation des foyers potentiels – dents, amygdales, estomac, colon, thyroïde, ovaires, col de l’utérus, etc. – pour couper le mal à sa racine. Une absence de résultat signifiait, non pas que la théorie était à revoir, mais qu’un autre foyer était vraisemblablement responsable et devait être à son tour enlevé. Rien n’arrêtait Cotton dans son zèle mutilateur et notamment la mort du patient. Un rapport indépendant établit en 1933 que le taux de mortalité des colectomies pratiquées par lui s’élevait à 44 %. D’après la psychiatre et psychanalyste Phyllis Greenacre, le taux de résultats positifs obtenus par les milliers de détoxications effectuées par Cotton s’élevait quant à lui à zéro.
D’autres traitements étaient tout aussi cruels et inefficaces. Le psychiatre autrichien Julius Wagner-Jauregg, qui avait observé que la fièvre provoquait des rémissions temporaires chez certains psychotiques, décida de la provoquer artificiellement chez ses patients atteints de PG en leur injectant du sang prélevé sur un prisonnier de guerre souffrant de malaria. Le traitement, quand il n’était pas mortel, provoquait des fièvres abominables mais aussi, affirmait Wagner-Jauregg, des améliorations sensibles des symptômes de la PG. On sait maintenant que cet optimisme était très fortement exagéré, mais cela n’empêcha pas Wagner-Jauregg d’obtenir le prix Nobel de médecine pour le développement de la malariathérapie.
Son collègue suisse Jakob Klaesi prétendait quant à lui guérir la schizophrénie en induisant un sommeil prolongé à l’aide de barbituriques. Mieux encore, le médecin polonais Manfred Sakel provoquait un coma profond chez ses patients en leur injectant de l’insuline (lui aussi obtint un prix Nobel). Ladislas Meduna, persuadé que les convulsions épileptiques amenaient une réduction des symptômes de la schizophrénie, les causait artificiellement en injectant des doses élevées de metrazol, un stimulant circulatoire et respiratoire. Ugo Cerletti obtint le même résultat en soumettant ses patients à des électrochocs : l’électroconvulsivothérapie (ECT) était née, bête noire de l’antipsychiatrie des années 1960. Puis vint la lobotomisation, introduite par le neurologue portugais Edgar Moniz. Partant de l’idée que des modifications dans la région du lobe frontal pouvaient entraîner des modifications de la personnalité, Moniz, bientôt suivi par Walter Freeman et d’innombrables psychiatres américains, perçait la boîte crânienne des patients au niveau des orbites de l’œil pour réarranger, disait-il, les connections neuronales bloquées (Freeman utilisait pour ce faire un instrument spécial inspiré d’un pic à glace trouvé dans sa cuisine).
Basées sur des considérations théoriques purement spéculatives et promues à chaque fois comme des cures miraculeuses, aucune de ces téméraires expérimentations n’obtint jamais des résultats probants (sauf peut-être l’ECT dans certains cas de dépression majeure), tout en infligeant des dégâts irréparables aux fonctions cérébrales de ceux qui en faisaient les frais. L’ECT, en particulier, provoquait des pertes de mémoire massives qui furent exploitées par le psychiatre Ewen Cameron pour des expériences de lavage de cerveau financées secrètement par la CIA.
Le charme peu discret de la psychanalyse
Acte II. – Ces pratiques, qui continuèrent jusque dans les années 1960, perdirent toutefois de leur prestige à mesure que la psychiatrie américaine tomba sous le charme de la psychanalyse à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les histoires freudo-centrées de la psychiatrie datent d’ordinaire l’introduction des idées psychanalytiques en Amérique du Nord de la visite de Freud aux États-Unis en 1909, mais Scull montre très bien que la vaste majorité des psychiatres y est restée imperméable et même franchement hostile durant l’entre-deux guerres. Tout comme d’ailleurs en Europe, la psychanalyse a d’abord recruté ses patients et ses adeptes parmi une élite qui pouvait se permettre des analyses longues et coûteuses sur des divans privés (Freud s’inscrivait, ne l’oublions pas, dans la tradition de ces « médecins des nerfs » qui s’adressaient à une clientèle aisée, contrairement aux psychiatres asilaires).
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la psychiatrie américaine s’est ouverte aux idées psychanalytiques, en raison notamment du problème posé par les « névroses de guerre » qui avaient affecté un très grand nombre de soldats envoyés sur le front. Non seulement ces névroses traumatiques prouvaient que des troubles psychiatriques pouvaient être causés par des facteurs non biologiques ou héréditaires, mais des psychiatres militaires comme Herbert Spiegel avaient pu montrer que l’application de diagnostics psychiatriques aux patients était contre-productive, contrairement à des interventions brèves de type « psychodynamique ». Armé de cette version simplifiée de la psychanalyse, le psychiatre William Menninger en profita après la guerre pour vendre aux politiciens et au public américains l’idée que la psychothérapie (entendez : la psychanalyse) était une méthode révolutionnaire pour traiter les troubles mentaux, y compris les plus graves.
Ces promesses étaient largement exagérées, une fois de plus, mais le G.I. Bill comportait une généreuse enveloppe financière pour la formation psychanalytique des psychiatres retournant du front, dispensée à la toute nouvelle Menninger School of Psychiatry. De leur côté, les quelque deux cents psychanalystes qui avaient fui l’Europe fasciste grâce au « Special Research Aid Fund for Deposed Scholars » de la Fondation Rockefeller ne demandaient pas mieux que de participer au grand effort de transformation de la psychiatrie américaine. En 1948, Menninger fut nommé président de l’Association Américaine de Psychiatrie. Dix ans plus tard, la plupart des directeurs de départements de psychiatrie étaient d’obédience psychanalytique et un tiers des psychiatres américains étaient d’orientation « psychodynamique ». En 1973, ils étaient la majorité. Grâce à la guerre, Freud avait finalement « conquis la psychiatrie », ainsi qu’il l’avait promis à Eugen Bleuler en 1906.
Scull, bizarrement, ne s’appesantit pas sur l’inefficacité manifeste de la psychanalyse en matière de traitement des formes sévères de maladie mentale, sans doute parce qu’elle va pour lui de soi et qu’il la juge bénigne comparée à la cruauté des méthodes somatiques. Dans sa description, la psychanalyse était essentiellement une idéologie qui permettait aux psychiatres de briller dans les congrès professionnels et les revues spécialisées tout en cachant leur impuissance à guérir les patients dont ils avaient la charge. Très souvent, d’ailleurs, ils continuaient à pratiquer des ECT et des lobotomies afin de stabiliser les patients et permettre l’établissement du « transfert ».
En réalité, c’est surtout en dehors de l’asile que l’impact de la psychanalyse s’est fait sentir aux États-Unis. Conformément à l’approche dimensionnelle et psychosomatique de la psychanalyse, la psychiatrie s’est soudain étendue à toute une série de problèmes qui jusque-là ne relevaient pas de sa compétence : asthme, ulcères gastroduodénaux, anxiété, troubles de la personnalité et du comportement, traumatismes psychiques, problèmes sexuels, conflits familiaux, éducation des enfants, difficultés professionnelles, manque d'estime de soi, etc. Impuissants à guérir leurs patients psychotiques, les psychiatres américains ont émigré en masse en dehors des murs de l’asile, en « psychopathologisant » la vie quotidienne pour mieux la traiter en pratique privée à l’aide du transfert et de la talk therapy. La figure du « shrink »(réducteur de têtes) était née, bientôt suivie – et finalement éclipsée – par celle du psychologue clinicien utilisant des stratégies cognitivo-comportementales validées scientifiquement et remboursées par des tiers-payants. Un énorme marché avait été créé qui allait à terme être inondé par les pilules de l’industrie pharmaceutique.
Pour le plaisir de l’industrie pharmaceutique
Acte III. – Ce troisième acte commence en fait à peu près au même moment que le précédent, au début des années 1950. En 1949, un médecin australien, John Cade, avait noté de façon plus ou moins fortuite que le sel de lithium calmait de façon spectaculaire les patients en phase maniaque, une découverte qui passa presque inaperçue à l’époque. Trois ans plus tard, une équipe de chercheurs français découvrit que la chlorpromazine, une molécule produite par la société pharmaceutique française Rhône-Poulenc, avait un effet calmant quasi immédiat sur les patients présentant une agitation violente. « Ils ont l’air d’être changés en pierre », remarquait le psychiatre Pierre Deniker : on avait enfin une formidable alternative aux sédatifs, électrochocs et autres lobotomies (on parla très vite de « camisole chimique »). Dans la foulée, d’autres molécules se révélèrent avoir des effets similaires sur la dépression majeure (imipramine) et l’anxiété (benzodiazépines).
Au début, ces médicaments psychotropes étaient considérés comme de simples « tranquillisants », nullement comme des agents thérapeutiques. En ce sens, c’est une illusion rétrospective que de croire que leur découverte sonna immédiatement le glas de la psychanalyse en psychiatrie. Au contraire, les psychiatres d’obédience psychanalytique y virent longtemps un commode adjuvant leur permettant de préparer le terrain pour une exploration profonde de l’inconscient des patients, au point qu’on peut se demander si la psychanalyse aurait jamais pu cannibaliser la psychiatrie américaine sans l’aide des psychotropes. Ce n’est que progressivement que ces derniers furent théorisés comme des médicaments « antipsychotiques » ou « antidépresseurs », c’est-à-dire comme des traitements spécifiques agissant sur la maladie elle-même plutôt que sur son expression. Raisonnement profondément erroné car ce n’est pas parce qu’une substance X produit un effet sur la pathologie Y que l’on peut en conclure qu’elle agit sur la cause de la maladie. Il ne viendrait à l’idée de personne, par exemple, de qualifier l’aspirine de médicament « antigrippe » sous prétexte qu’elle soulage les symptômes de la grippe.
Il n’empêche que ce sophisme élémentaire finit par convaincre tout le monde que les troubles mentaux, y compris les plus légers, étaient d’ordre biologique plutôt que le résultat de conflits psychiques ou de facteurs environnementaux, et qu’on pouvait raisonner à partir des effets produits sur eux par des agents chimiques pour établir leur cause. Si, par exemple, telle molécule augmentant le taux d’un neurotransmetteur appelé sérotonine dans le cerveau avait un effet sur la dépression, on pouvait en conclure que celle-ci était due à un manque de sérotonine.
De son côté, l’industrie pharmaceutique n’était que trop heureuse de produire à tour de bras des molécules produisant un effet, serait-il minime, sur tel ou tel symptôme listé par le DSM, le fameux Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders édité par l’Association Américaine de Psychiatrie. Ce manuel, fondé depuis sa troisième édition (1980) sur l’idée que les troubles mentaux sont des maladies spécifiques dont on peut décrire et lister les symptômes de façon neutre et athéorique, fournissait une feuille de route idéale pour le marketing des laboratoires. En effet, il permettait de segmenter le marché des maladies mentales et de présenter chaque nouvelle molécule comme le médicament validé scientifiquement pour tel ou tel diagnostic, qu’il s’agisse du trouble bipolaire I, II, III ou IV, des attaques de panique, du trouble déficit de l’attention avec hyperactivité ou encore de la timidité, rebaptisée pour l’occasion « trouble d’anxiété sociale ». À la psychiatrisation de la vie quotidienne à laquelle avait présidé la psychanalyse a succédé une psycho-biologisation sans rivages : une pilule pour chaque maladie, remboursée par les tiers payants ! Quant aux psychanalystes, incapables d’abandonner leur modèle dimensionnel et de soumettre leurs résultats aux essais randomisés en double insu utilisés pour tester les médicaments, ils ont été tout simplement balayés de la scène psychiatrique nord-américaine.
Mais la révolution psychopharmacologique a-t-elle réellement amélioré la condition des malades ? Personne ne nie, et Scull non plus, que la découverte des psychotropes a apporté un soulagement considérable à de nombreux patients, sans parler de leurs familles et de leurs psychiatres. Cependant ces médicaments n’ont jamais permis de guérir la maladie mentale et ils s’accompagnent d’effets secondaires extrêmement débilitants qui contrebalancent nettement leurs effets positifs. Les premiers antipsychotiques, comme on s’en est vite aperçu, provoquaient de la dyskinésie tardive, un trouble invalidant et irréversible qui se traduit par des mouvements involontaires de la bouche, des lèvres et de la langue. Les antipsychotiques « atypiques » de seconde génération, réputés un temps moins toxiques que leurs prédécesseurs de première génération, sont aujourd’hui connus pour provoquer une prise de poids importante, du diabète, des pancréatites et des accidents cardio-vasculaires. Les benzodiazépines créent une forte dépendance, tout comme les antidépresseurs de troisième génération tels que le Prozac et le Zoloft, qui provoquent de plus de l’anhédonie, une diminution ou perte complète de libido et dans certains cas de l’akathisie, une agitation interne extrême accompagnée de pensées suicidaires parfois suivies d’un passage à l’acte. Quant aux anticonvulsivants utilisés pour traiter les troubles de l’humeur, ils sont susceptibles de provoquer des défaillances rénales, de l’obésité, du diabète, le syndrome des ovaires polykystiques et ils figurent parmi les médicaments les plus tératogènes.
Une population de clochards et de prisonniers
En réalité, la révolution psychopharmacologique a représenté aux États-Unis un véritable désastre pour les patients car son effet le plus immédiat a été la fermeture progressive de la plupart des hôpitaux psychiatriques au cours des années 1960 et 1970 au profit de cliniques ambulatoires et d’alternatives communautaires. Pourquoi enfermer les patients, disait-on, puisqu’on pouvait maintenant les stabiliser à l’aide de médicaments et les rendre à une vie plus ou moins normale ? L’argument était parfaitement raisonnable, mais aux États-Unis, comme le montre Scull, il servit de justification aux divers États pour se décharger des tâches et des coûts associés aux hôpitaux psychiatriques sur un système de protection sociale (welfare system) fédéral qui n’était nullement préparé pour cette tâche, notamment après les brutales coupes budgétaires de l’administration Reagan. Concrètement, cela veut dire que les patients ont été tout simplement livrés à eux-mêmes, sans aucun filet de sécurité, dérivant de maisons de transition en hôtels « sociaux » pour aboutir très vite dans la rue. En l’absence de suivi thérapeutique, les malades se sont empressés de jeter leurs médicaments à la poubelle et sont repartis de plus belle dans leur délire ou leur dépression. Le plus souvent, ils ont fini en prison pour avoir volé de quoi manger dans un supermarché ou avoir menacé quelqu’un dans la rue. La révolution psychopharmacologique, qui était censée libérer les malades et les rendre à une existence à peu près normale, a abouti, par un paradoxe pervers, à créer une population de clochards, de mendiants et de prisonniers, tout comme à l’époque d’avant la création de la psychiatrie.
Épilogue
On sent que Scull a eu du mal à écrire la conclusion de son implacable description de l’entreprise psychiatrique. « La psychiatrie a-t-elle un avenir ? » se demande-t-il, mais la réponse ne vient pas. De fait, que pouvons-nous encore espérer après tant d'échecs dans la compréhension et le traitement des maladies mentales ? Peut-être ce projet était-il erroné dès le départ. Peut-être la folie n’est-elle pas une maladie à guérir, mais plutôt un état (condition) dont il faut prendre soin. Scull joue de façon inconfortable avec l’idée de dépasser le clivage esprit/cerveau qui a si longtemps défini la psychiatrie, et il aboutit finalement au social : « Je suis convaincu, écrit-il, que la folie ne peut pas être séparée avec succès de la matrice culturelle, sociale et psychologique dans laquelle les êtres humains existent. »
Une déclaration finalement assez prévisible de la part d’un sociologue, mais qui permet au moins à Scull de conclure son exposé sur une note politique. Si la situation des malades mentaux est si désespérée aux États-Unis aujourd’hui, dit-il, la faute n’en incombe pas en fin de compte à la psychiatrie, malgré toutes ses défaillances, mais à l’Amérique et à son arrangement social : « L’idée que nous avons une responsabilité morale collective de subvenir aux besoins des malheureux – mieux, que l’une des marques d’une société civilisée est sa détermination à garantir un niveau de vie minimum à tous ses citoyens –, cette idée n’a jamais bénéficié d’un large soutien aux États-Unis. […] Si notre objectif est de faire renaître une psychiatrie qui prenne en compte les dimensions psychologiques, physiques et sociales des troubles mentaux, il faut reconnaître à quel point une telle transformation est susceptible de s’avérer difficile. »
Voilà qui est déprimant.
– Cet article est paru dans la Los Angeles Review of Books le 6 juin 2022, sous le titre « Psychiatrtic Hubris ». Il a été traduit par l’auteur pour la Booksletter. Pour aller plus loin, lire l’article d’Andrew Scull sur Michel Foucault publié par Books en septembre 2019.