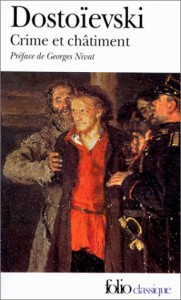Djokhar Tsarnaev, nouveau Raskolnikov
Publié le 21 avril 2015. Par La rédaction de Books.
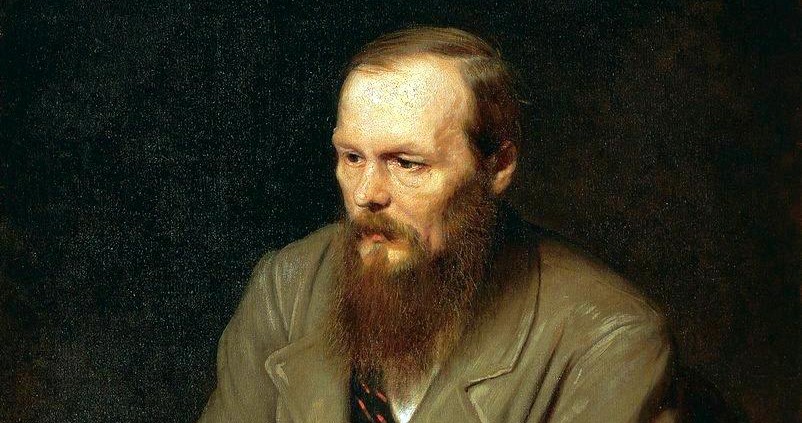
Un étudiant autrefois prometteur, éloigné de ses parents, seul dans une grande ville, sans moyens. Il est en colère, se rapproche d’une idéologie extrême et enfin passe à l’acte. Avant et après le jour fatidique, ses proches ne remarquent rien.
Ce portrait de Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski est mis en parallèle avec le profil de Djokhar Tasarnaev par la chercheuse Elizabeth Stoker dans la Los Angeles Review of Books. Le procès des attentats du marathon de Boston entre aujourd’hui dans sa deuxième phase, celle qui décidera de la peine du jeune homme. Peine de mort ou prison ? Les juges américains sont face au même choix que ceux du roman. Ces derniers se prononcent dans l’épilogue que voici.
La Sibérie. Sur la rive d’un fleuve large et désert se trouve une ville, l’un des centres administratifs de la Russie ; dans la ville il y a une forteresse où se trouve une prison. Dans la prison est détenu depuis neuf mois déjà le forçat-déporté de deuxième catégorie, Rodion Raskolnikov. Près d’un an et demi s’est écoulé depuis le jour de son crime.
Son procès s’était déroulé sans heurts. Le criminel soutint sa déposition avec fermeté, clarté et précision ; il n’embrouilla par les circonstances, ne tenta pas de les atténuer en sa faveur, n’oublia pas le moindre détail. Il raconta, jusqu’au dernier trait, tout le processus de l’assassinat, il résolut le mystère du gage (les planchettes de bois avec la languette de fer), qui était resté dans la main de la vieille ; il raconta comment il lui avait pris les clés, les décrivit, décrivit le coffret et son contenu ; il nomma même certains des objets qui s’y trouvaient ; il donna une réponse au problème de la mort de Lisaveta ; il rapporta comment arriva Koch, comment il frappa à la porte, comment il fut rejoint par l’étudiant et tout ce qui fut dit entre eux ; comment lui, le criminel, descendit en courant l’escalier et entendit les hurlements de Mikolka et de Mitka ; comment il se cacha dans l’appartement vide et comment il rentra chez lui ; pour terminer, il indiqua la pierre près de la porte de la cour, perspective Vosniessensky, où les bijoux et la bourse furent effectivement retrouvés.
En un mot, l’affaire était claire. Les magistrats chargés de l’enquête et le juge s’étaient beaucoup étonnés, entre autres, de ce qu’il avait caché la bourse et les bijoux sous une pierre, sans rien prendre et, surtout, de ce que non seulement il ne se souvenait pas de tous les objets qu’il avait volés, mais qu’il ne connaissait pas leur nombre. Le fait qu’il n’avait pas ouvert la bourse et qu’il ne savait même pas combien d’argent s’y trouvait, constituait une particularité qui parut invraisemblable (la bourse se trouva contenir trois cent dix-sept roubles argent et trois pièces de vingt kopecks ; d’avoir séjourné si longtemps sous la pierre, les billets du dessus – les plus gros – s’étaient fort détériorés).
On chercha longtemps à savoir pourquoi l’accusé mentait sur ce seul point, tandis qu’il avait avoué tout le reste volontairement et correctement. Enfin certains (surtout les psychologues) finirent par admettre la possibilité de ce qu’en effet, il pouvait n’avoir pas regardé dans la bourse et que c’était pour cette raison qu’il ne savait pas ce qu’elle contenait ; il l’avait donc portée tout droit sous la pierre. Cependant, ils en conclurent immédiatement que le crime n’avait pu être commis autrement qu’en état de folie passagère et, pour ainsi dire, en proie à la monomanie morbide du meurtre et du vol, sans but subséquent et sans compter sur un profit. Ici vint bien à point la nouvelle théorie à la mode de la folie passagère que l’on essaye si souvent d’appliquer de nos jours à certains criminels. En outre, l’état hypocondriaque dans lequel se trouvait depuis longtemps Raskolnikov fut attesté avec précision par beaucoup de témoins : le docteur Zossimov, ses anciens camarades, la logeuse, la servante. Tout cela contribua beaucoup à former l’opinion que Raskolnikov ne ressemblait pas tout à fait à un assassin, à un brigand, à un pillard ordinaire et qu’il y avait dans tout cela quelque chose d’autre.
Au grand dépit des partisans de cette opinion, le criminel lui-même n’essaya presque pas de se défendre ; aux questions qu’on lui posa afin de savoir ce qui l’avait poussé au meurtre et au vol, il répondit fort clairement, avec la précision la plus brutale, que la cause de son acte était sa situation pénible, sa misère et le désir de raffermir les premiers pas de sa carrière à l’aide des trois mille roubles qu’il avait compté trouver chez sa victime. Il s’était décidé à assassiner celle-ci, étant donné son caractère vil et futile et, en outre, il était exaspéré par les privations et les échecs. À la question de savoir ce qui l’avait incité à se dénoncer, il répondit franchement qu’il s’était sincèrement repenti. Tout cela était presque grossier…
Le verdict fut pourtant plus clément que l’on ne pouvait s’y attendre, étant donné le crime commis et cela précisément peut-être parce que le criminel n’avait pas voulu se justifier, mais qu’au contraire, il parut manifester le désir de se charger davantage. Toutes les circonstances bizarres furent prises en considération. L’état maladif et l’indigence du criminel avant le crime étaient établis avec une certitude absolue. Le fait qu’il ne profita pas du produit de son vol fut attribué en partie à l’effet d’un réveil de sa conscience, en partie à ce que ses facultés mentales n’étaient pas parfaitement normales à l’époque du crime.
Les circonstances du meurtre fortuit de Lisaveta servirent même d’exemple à l’appui de cette dernière hypothèse : un homme commet deux meurtres et oublie que la porte est restée ouverte ! Enfin, le fait qu’il vint se dénoncer au moment où l’affaire s’était extraordinairement embrouillée à la suite de la fausse déposition d’un fanatique effrayé (Nikolaï) et lorsque non seulement il n’y avait pas de preuves contre le vrai criminel, mais qu’il n’y avait presque pas de soupçons à son égard (Porfiri Pètrovitch avait tenu parole), tout cela contribua grandement à adoucir le sort de l’accusé.
D’autre part, des circonstances tout à fait inattendues vinrent au jour qui lui furent très favorables. L’ancien étudiant Rasoumikhine fit connaître certains renseignements qu’il avait recueillis et présenta les preuves de ce que le criminel Raskolnikov avait aidé de son dernier argent un camarade d’université, pauvre et tuberculeux, et qu’il subvint pratiquement aux besoins de son existence pendant une demi-année. Lorsque celui-ci mourut, il soigna le père de son camarade, un vieillard impotent, dont l’entretien avait été assuré par le travail de son fils, et cela depuis que ce dernier atteignit l’âge de treize ans. Le criminel Raskolnikov avait enfin fait admettre ce vieillard dans un hôpital et lorsque celui-ci mourut aussi, il le fit enterrer à ses frais.
Tous ces renseignements eurent une influence favorable sur le sort de Raskolnikov. Son ancienne logeuse elle-même, la mère de sa défunte fiancée, la veuve Zarnitzina, témoigna aussi que, lorsqu’ils habitaient une autre maison, près de Piat-Ouglov, lors d’un incendie, Raskolnikov réussit à sauver deux petits enfants d’un appartement déjà en proie aux flammes et qu’en faisant cela, il fut couvert de brûlures. Ce fait donna lieu à une enquête approfondie et il fut confirmé par le témoignage de nombreuses personnes. En un mot, l’affaire aboutit à une condamnation aux travaux forcés de deuxième catégorie pour une durée de huit ans seulement, en prenant en considération sa dénonciation volontaire et certaines circonstances atténuantes.