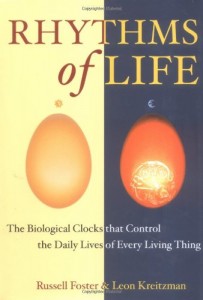Oubliez votre montre, fiez-vous à vos gènes
Publié le 30 mars 2015. Par la rédaction de Books.

Crédit: NASA
Un an sans jour, ni nuit. Deux spationautes, un Américain et un Russe, vont séjourner une année à bord de la Station spatiale internationale pour étudier l’effet de l’espace sur le vieillissement. Leur seul moyen de se repérer dans le temps sera leur montre. Mais en auront-ils tant besoin ? Peut-être pas. Comme le rappelle cet article de The New Republic traduit dans Books en mai 2009, les horloges sont en nous. Ou, plus précisément, dans nos gènes.
L’homme a inventé d’innombrables manières de mesurer le temps, des cadrans solaires aux clepsydres et autres sabliers, de la pendule à la montre, jusqu’à l’horloge atomique moderne. Inventée en 1950, celle-ci se fonde sur une seconde équivalant à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation de l’atome de césium. Cette « seconde atomique » est égale à 1/86 000 du jour solaire moyen et possède une exactitude d’une seconde pour trois millions d’années. Pas mal, si vous êtes soucieux de ponctualité. Que le temps existe réellement ou non (comme les philosophes continuent de se le demander), qu’il « passe » réellement ou pas, toutes les horloges ont ceci de commun qu’elles mesurent un changement physique bien défini, régulier et uniforme.
Dans leur merveilleux ouvrage, Russell F. Foster et Leon Kreitzman nous rappellent que, si notre capacité à mesurer le temps n’a cessé de s’améliorer, nous avons pourtant « perdu progressivement la bataille contre le temps. Au lieu de contrôler nos horloges modernes, ce sont elles qui nous contrôlent ». Que l’on y songe : lorsque nous voulons savoir s’il est le moment de manger, d’aller se coucher ou d’organiser les vacances, nous commençons par regarder nos montres, nos pendules et autres calendriers. Ces outils nous tyrannisent chaque jour davantage. Mais regardez un instant la nature : sans la moindre Rolex, ni même la moindre Swatch, le papillon monarque migre d’Amérique du Nord vers l’Amérique centrale exactement au même moment chaque année. Sans calendrier ni réveil, la cigale sort de terre après exactement treize ou dix-sept ans pour quelques fugitives semaines d’accouplement frénétique, et l’écureuil sait quand et où revenir vers chacune de ses cachettes pleines de nourriture périssable très précisément avant qu’elles ne perdent toute valeur. Les ours hibernent, l’hirondelle se lève tôt pour attraper le ver matinal et même les plantes semblent compter silencieusement les heures. Le fait est d’ailleurs connu depuis quelque temps déjà : en 1751, Linné proposa de planter en cercle deux espèces de pâquerettes, le liondent et la crépide, dont les fleurs s’ouvrent et se ferment exactement à une demi-heure d’intervalle, formant ainsi les aiguilles d’une horloge florale.
Le monde du « 24 heures sur 24 », « 7 jours sur 7 »
Tous les organismes possèdent-ils donc des horloges et des calendriers cachés ? L’avancée de la civilisation a-t-elle privé l’humanité de l’intime connaissance qu’elle avait aussi autrefois de la nature ? Un premier élément de réponse nous est donné lorsque nous voyageons et nous retrouvons désespérément en train de regarder un film de série B sur le téléviseur d’une chambre d’hôtel à 4 heures du matin : les troubles provoqués par le décalage horaire – ou par le travail de nuit – sont aussi les fruits de la civilisation. Ces nuisances appartiennent en propre au genre humain. Il n’en est que plus difficile de répondre de manière un tant soit peu convaincante aux questions posées précédemment. Nous vivons dans le monde du « 24 heures sur 24 », du « 7 jours sur 7 » ; nous avons inventé avec intelligence une multitude de moyens – électricité, réveils, chauffage, médicaments – nous permettant de triompher de nos anciens rythmes naturels. Affranchis des cadences de la nature, nous ne sommes plus contraints de grelotter en hiver et de nous lever tôt en été – c’est du moins ce dont nous sommes pour la plupart persuadés.
À tort. Comme tous les êtres vivants qui nous entourent, nous sommes viscéralement définis par nos rythmes internes, et quelques milliers d’années de civilisation ne sauraient suffire à passer outre plusieurs milliards d’années d’évolution. Comme l’expliquent Foster et Kreitzman, les crises cardiaques et les naissances se produisent le plus souvent entre 4 heures et 6 heures du matin, les rages de dents sont moins douloureuses après le déjeuner et les risques de réaction allergique sont plus élevés à 23 heures. La température du corps, le rythme cardiaque et la pression artérielle sont plus faibles la nuit et plus élevés le jour, et oscillent avec régularité tout au long de la journée. Il en va de même de nos capacités cognitives : selon toute vraisemblance, vous n’obtiendrez pas le même résultat à un examen selon qu’il a lieu le matin ou l’après-midi. La nature connaît des rythmes liés aux marées, lunaires, annuels et circadiens (environ une journée), ainsi que, moins connus, des rythmes infradiens (supérieurs à une journée) et ultradiens (inférieurs à une journée).
Le petit déjeuner des abeilles
À l’évidence, ces rythmes se sont inscrits dans les êtres vivants au cours de l’évolution. Car, si la semaine, l’heure et la minute ont été inventées par l’homme, la Terre continuera d’accomplir une rotation sur son axe à peu près toutes les 24 heures pendant encore au moins cinq milliards d’années, de même que la Lune continuera de croître et de décroître tous les 29 jours et demi, et la marée de monter et descendre deux fois par jour. Chez l’homme, ce sont les rythmes circadiens qui influencent le plus les comportements. Que la fermeté de votre poignée de main varie selon les heures peut paraître un détail insignifiant. Mais si l’on vous dit qu’il existe des moments plus ou moins propices aux ébats amoureux, voilà qui vous fera peut-être tendre l’oreille à la chronobiologie. Il existe en somme une étroite relation entre nos horloges internes et le monde extérieur ; comprendre comment elle fonctionne reste l’une des aventures les plus passionnantes de la biologie moderne.
Depuis le début du XIXe siècle, de nombreux héros ont participé à la légende de la chronobiologie. Mais son histoire n’a vraiment débuté qu’avec le XXe siècle, lorsque les indices les plus divers ont commencé à s’accumuler. Tout commença avec August Forel, médecin et naturaliste suisse qui remarqua en 1910 qu’un groupe d’abeilles venait se nourrir tous les jours des restes de son petit-déjeuner. Les abeilles apparaissaient systématiquement à la même heure, y compris quand il les piégeait en débarrassant la table de toute nourriture. Puis ce fut le scientifique germano-américain Curtis Richter ; il découvrit au début des années 1920 à l’université Johns Hopkins que, lorsqu’il obscurcissait et isolait du bruit les fenêtres du labo pour le rendre étanche à tout stimulus extérieur, les rats semblaient néanmoins suivre des rythmes précis, mangeant, nourrissant leurs petits et jouant à heures fixes. Cette découverte fut le point de départ des recherches sur la source du rythme. L’hypothèse d’une sorte d’horloge interne s’imposait de plus en plus.
Quelques années plus tard, en 1930, en Allemagne, Erwin Bunning montra que l’oscillation des feuilles du Phaseolus, le haricot commun, se produisait dans le noir complet au cours d’un cycle de 24,4 heures. Il appela cette période le rythme de « libre cours » de la plante, et il devint vite évident que ce qui était vrai pour le haricot l’était aussi pour l’anémone de mer, le kangourou, l’araignée et la belette : les êtres vivants de la planète, humains compris, ont un rythme de libre cours proche d’un cycle de 24 heures. Et il devint également évident que, si des signaux extérieurs contribuaient à faire concorder ce rythme avec la journée de 24 heures, ils n’en étaient pas la cause ; le rythme de libre cours relevait davantage du tic-tac d’une sorte d’horloge interne.
La quête du « donneur de temps »
Une fois encore, la notion d’horloge interne trouva un soutien auprès des abeilles. Karl von Frisch avait étudié leur manière de localiser les sources de nourriture et, surtout, d’en informer leurs camarades une fois de retour à la ruche. La découverte que le mouvement et l’angle de leur ballet aérien indiquaient une direction et une distance lui a d’ailleurs valu le prix Nobel, aux côtés des deux autres grands éthologues du XXe siècle, Konrad Lorenz et Niko Tinbergen. Mais il observa aussi que l’abeille, en cas de vent contraire, indiquait une distance supérieure, laissant clairement entendre qu’elle devait avoir un certain sens interne du temps – le vent contraire impliquant une vitesse réduite.
Mais si les abeilles, les haricots et les hommes ont tous des horloges internes, quelles peuvent en être les caractéristiques communes ? Au cœur de l’horloge se trouverait un oscillateur autonome, quelque chose qui compterait les pulsations à intervalle régulier en l’absence de tout signal temporel extérieur. Il fallait donc supposer l’existence d’un mécanisme de réglage ou « donneur de temps » (Zeitgeber) reliant l’oscillation interne au monde extérieur – le mouvement prévisible du soleil et des constellations, peut-être même la température, le magnétisme ou la nourriture. Et il devait y avoir un moyen de rendre le résultat biologiquement utile – quelque chose d’observable comme un comportement adaptatif, régulier, rythmique. Mais comment un ensemble de réactions biochimiques pourrait-il produire des rythmes ayant une périodicité d’environ 24 heures ? Le problème, c’est que les molécules biologiques sont extrêmement sensibles à la chaleur : la vitesse à laquelle agit une enzyme dépend énormément de la température de son environnement. Les mammifères et les oiseaux utilisent l’homéostasie pour créer un environnement interne stable. Mais qu’en est-il des algues et des coraux, ou des insectes, des lézards et des plantes, ces organismes dont la température corporelle fluctue en fonction du soleil et des saisons et dont, pourtant, les rythmes biologiques ne changent pas ?
Révolution moléculaire
Lorsqu’un petit groupe d’experts se réunit en 1960 à Cold Spring Harbor, près de New York, la plupart s’accordent à dire que, malgré ce sérieux problème, il existe nécessairement des horloges internes indépendantes des signaux extérieurs ; même si personne ne savait encore comment elles pouvaient fonctionner. Colin Pittendrigh, qui étudiait les mouches drosophiles, se montra alors étonnamment prophétique : « Le chercheur qui s’intéresse aux rythmes se plaint de ne pas disposer d’un mécanisme commun donnant à son domaine l’unité qu’il voudrait. Et pourtant, il y a des mécanismes communs – constitués par différents éléments matériels – partout dans les systèmes circadiens et les effets photopériodiques [liés à l’alternance de lumière et d’obscurité]. » Pittendrigh ne pouvait savoir à quel point il avait raison. La révolution moléculaire ne faisait que commencer ; il se trouvait même encore deux ou trois scientifiques importants pour douter de la portée de la découverte récente de la structure de l’ADN. Et comment de tels « mécanismes communs » fonctionnaient-ils ? On pouvait évidemment supposer que des milliards d’années d’évolution avaient rattaché la vie à la planète : autrement, les oiseaux migreraient vers le sud et non vers le nord, les yeux des poissons ne passeraient pas en mode nocturne au bon moment et l’homme de Cro-Magnon aurait gaspillé toutes ses matinées dans un profond sommeil. Mais quelle sorte d’oscillateur interne couplé à un mécanisme de réglage externe pouvait être commun à l’algue et à la méduse, à l’alose, au plongeon catmarin et à l’être humain ?
Pour répondre à cette question, la recherche emprunta deux voies distinctes. Certains suivirent la piste de Richter, qui avait démontré que des lésions de la partie frontale de l’hypothalamus chez les rats détruisaient le rythme circadien de leur comportement. En 1970, des chercheurs ont localisé l’endroit précis de l’hypothalamus qui jouait le rôle principal – un petit groupe de vingt mille cellules, le noyau suprachiasmatique (NSC). Lorsqu’on découvrit des structures analogues au NSC chez les oiseaux et les reptiles, les esprits commencèrent à s’échauffer. Mais ce fut l’extase lorsqu’une équipe, dont Russell Foster faisait partie, transplanta le NSC d’un hamster mutant, dont l’horloge interne était réglée sur 22 heures, dans le cerveau d’un hamster normal énucléé, qui se mit à suivre lui aussi ce rythme de 22 heures. Bientôt, on donna à ce point minuscule, dont le volume est d’un tiers de millimètre cube, le nom suggestif d’« horloge du cerveau ».
La seconde voie consistait à suivre la trace de l’un des grands héros de la révolution moléculaire. Fils d’immigrants juifs polonais, Seymour Benzer reçut son premier microscope comme cadeau de bar-mitsva en 1934. À 15 ans, il était déjà boursier au Brooklyn College, bien que personne dans sa famille n’ait fait d’études supérieures. Considéré comme le mouton à cinq pattes de sa famille, Benzer avait à la fois, selon son biographe Jonathan Weiner, « une sensibilité pour la physique et une sensibilité pour l’étude de la vie ». C’est cette combinaison rare qui l’amena à définir son objet de recherche : découvrir les caractéristiques physiques des gènes afin de comprendre comment ils expliquent le comportement.
À l’université Purdue, Benzer réussit à démontrer que les gènes n’étaient pas indivisibles, comme on le croyait jusque- là, mais pouvaient être scindés. Il était déjà difficile à l’époque de le croire. Mais faire en outre l’hypothèse hérétique que certains comportements – et pas seulement des caractéristiques physiques ou des maladies – pouvaient être altérés par un seul gène défectueux était plus scabreux encore. Lorsqu’un étudiant en thèse du nom de Ronald Konopka arriva dans son laboratoire de Cal Tech au milieu des années 1960, Benzer, célèbre couche-tard, l’orienta vers la génétique des rythmes circadiens. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir une mouche mutante qui n’avait pas la notion du temps.
L’empire de la lumière
En croisant ladite mouche avec des mouches sauvages, on découvrit que le gène responsable se trouvait sur le chromosome X. Il fut platement surnommé « per », pour « période ». Peu de temps après que Benzer et Konopka eurent envoyé l’article « Clock Mutant of Drosophila melanogaster » (« L’horloge mutante de Drosophilia melanogaster ») à la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, le maître de la biologie moléculaire, Max Delbrück, s’avança vers Benzer au cours d’une soirée et lui dit avec son fort accent allemand, un verre à la main : « Je n’y crois pas » – « Mais Max, répondit Benzer avec son léger accent de Brooklyn, nous avons trouvé le gène ! » Plantant ses fameux yeux bleus dans ceux de Benzer, Delbrück répondit : « Je n’en crois pas un mot. » C’était vrai. Et, bien qu’on ne sût pas encore très bien si d’autres gènes étaient impliqués, ni comment ils codaient pour un « minuteur », Benzer et Konopka avaient découvert le tout premier gène horloger d’un organisme, corrélant fermement – et pour certains, fâcheusement – le comportement et la génétique.
Dans les décennies qui suivirent, de nombreux détails s’éclaircirent. Et, si nous ne connaissons pas encore précisément la mécanique des systèmes de tous les organismes, le principe de base est simple : une horloge peut être constituée d’un gène qui code pour une protéine qui inhibe sa propre production et une seconde protéine qui retarde cette auto-inhibition pendant un temps donné. Pour le minuscule champignon Neurospora par exemple, le gène frequency (frq) code pour la protéine FREQUENCY (FRQ), qui est régulée par une autre protéine, WC-1, produite huit heures après FREQUENCY, qui a elle-même besoin de seize heures pour retrouver son niveau optimum. L’ensemble constitue une horloge circadienne. C’est aussi simple et aussi beau que cela.
Mais comment l’horloge interne se synchronise-t-elle avec l’environnement ? Comment le « rythme de libre cours » d’un organisme s’adapte-t-il aux exigences du monde extérieur ? Voici un exemple. Chez les mouches drosophiles, les équivalents des protéines FRQ et WC-1 s’appellent PER et TIM. Lorsque la lumière atteint TIM à travers le nerf optique de la mouche, elle la dégrade d’une manière prévisible et régulière. Ainsi, avec l’aide de quelques autres protéines, la boucle de rétroaction PER/TIM s’ajuste sur le cycle jour/nuit, assurant le lien crucial entre les mondes extérieur et intérieur. Ce processus s’appelle l’« entraînement », et si des signaux comme la température, la nourriture disponible ou l’humidité peuvent faire office de déclic, la lumière est le plus grand de tous les agents d’entraînement.
Du point de vue de l’évolution, c’est parfaitement logique. La lumière est le plus stable des signaux, et il peut être utilisé non seulement pour indiquer l’aube et le crépuscule mais aussi, puisque la luminosité varie en fonction de la latitude et de la saison, le moment de l’année. C’est ainsi que le saumon, le plongeon et le monarque savent quand migrer, le chevreuil, le wallaby et la cigale quand s’accoupler, l’écureuil quand déterrer ses réserves de nourriture et le plant de tabac ou l’onagre, quand libérer les odeurs qui attireront les insectes pollinisateurs nocturnes. Et c’est ainsi que le message interne de l’organisme se transforme en poème de la nature.
Parfois, le poème peut être assujetti à d’autres objectifs. Les fermiers espagnols l’ont compris il y a plus de deux cents ans, qui utilisaient l’éclairage artificiel pour stimuler la production de leurs poules. Même la Nasa est très attentive à la question : le fait qu’il n’y ait pas de lumière régulière dans l’espace a d’importantes conséquences sur les performances et la fatigue des astronautes. La lumière est un agent d’entraînement si important que l’évolution a même « inventé » chez les mammifères un nouveau type de photorécepteurs, différents des bâtonnets et des cônes utilisés pour la vision, pour la transmettre en toute sécurité au NSC dans le cerveau. L’existence surprenante de ces récepteurs, découverte dans le laboratoire de Russell Foster en 2002, a démontré que même des yeux atrophiés devaient être gardés intacts pour leur permettre de remplir leurs fonctions circadiennes. Les aveugles, dont les bâtonnets et les cônes ne fonctionnent plus, ont toujours besoin de leurs yeux pour réguler l’éveil et le sommeil.
Le « tic » de l’ADN, le « tac » de la protéine
Aussi impressionnantes soient-elles, ces belles histoires de triomphe scientifique ne sont que des versions simplifiées de l’aventure. Comment les oiseaux migrent, quand les animaux décident-ils de s’accoupler, et même quelles protéines précises composent l’horloge interne de Neurospora ? Toutes ces questions sont particulièrement complexes. Et nous ignorons encore bien des choses. Mais la découverte du fonctionnement de base du « tic » de l’ADN et du « tac » de la protéine, et des signaux externes qui les activent, est l’une des aventures les plus extraordinaires de l’histoire récente de la science. Quelle réussite que d’avoir montré ce fait : dans la mesure où de nombreux gènes et protéines qui indiquent le temps sont similaires chez les souris et chez les mouches, il a dû exister une horloge ancestrale pour les insectes et les mammifères il y a 700 millions d’années – et une bien plus ancienne encore pour les bactéries. Cela signifie que, depuis le début, nous avons évolué de façon à réguler nos mondes intérieurs, mais aussi à rester en phase avec notre planète.
Et les philosophes peuvent bien continuer à débattre de la réalité du temps ; les malheureux qui souffrent du rarissime syndrome de l’insomnie fatale familiale, ou même simplement tous ceux d’entre nous qui font l’expérience banale de ce bon vieux décalage horaire, ne perçoivent guère la nécessité d’approfondir outre mesure le débat philosophique; la réponse va de soi. Comme le montrent Foster et Kreitzman dans les derniers chapitres de leur livre, l’enjeu de la chronobiologie n’est pas seulement de comprendre comment les cigales savent quand elles doivent sortir de terre et les monarques quand migrer, mais aussi quel est le meilleur moment pour administrer tel ou tel médicament et la meilleure manière de soigner les maladies, notamment les cancers.
Prenons l’exemple du syndrome d’avance de phase du sommeil, qui se caractérise par un cycle veille/sommeil décalé : les malades se couchent vers 19 h 30 et se réveillent bien avant le coq, à 3 h 30 du matin. Louis Ptacek, de l’université d’Utah, a découvert qu’il s’agit d’un trouble héréditaire, provoqué chez certains patients par la modification d’un seul acide aminé de la protéine encodée par le gène « per ». À ce jour, c’est le premier exemple d’un gène codant pour un comportement complexe chez des humains ; l’équivalent, pour Homo sapiens, de la découverte faite par Benzer et Konopka sur les mouches drosophiles.
L’affaire est sérieuse. Environ 3 % de la population anglaise souffre de dépression saisonnière (ou SAD, Seasonal Affective Disorder) pendant l’automne et l’hiver. Et le mal est bien plus répandu encore en Norvège, où 27 % des habitants sont touchés chaque année par ce trouble, qui se caractérise par un état de somnolence, une prise de poids et, parfois, une perte d’intérêt pour la vie tout court. Les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, de l’arthrose, de l’asthme et même des troubles cardio-vasculaires se caractérisent tous par des rythmes circadiens très marqués. Dans ce dernier cas, cela tient au fait que la pression artérielle et le rythme cardiaque sont au plus haut très tôt le matin, raison pour laquelle la plupart des crises se produisent à l’aube, vers 6 heures. Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer souffrent également de troubles du rythme circadien qui peuvent parfois les empêcher de dormir. Certains médecins testent aujourd’hui un traitement combinant luminothérapie et prise de mélatonine pour tenter de soulager les symptômes les plus généraux de cette terrible maladie.
La chronobiologie contre le cancer
Mais la chronothérapie est dévoreuse d’argent et de travail, et il lui reste encore à devenir une préoccupation majeure du milieu médical. De nombreux médicaments anticancéreux, par exemple, attaquent les cellules en croissance rapide à un moment précis de leur division. Mais – et c’est le problème de la chimiothérapie – ces médicaments attaquent aussi d’autres cellules à division rapide comme celles de la moelle osseuse et des cheveux, entraînant douleur et calvitie. Mais les rythmes circadiens des cellules saines ne sont généralement pas les mêmes que ceux des cellules cancéreuses ; si le traitement quotidien est concentré aux moments de la journée où le cycle cellulaire de la réplication de l’ADN des cellules normales est le moins élevé, les médicaments anticancéreux peuvent être administrés à de plus fortes doses. À l’évidence, les patients auraient donc tout intérêt à être soignés en tenant compte de l’horloge biologique. Pourtant, on continue à les soigner aux heures qui conviennent le mieux au personnel hospitalier et non aux moments les plus appropriés à la lutte contre la maladie.
Mais l’enjeu majeur de la chronobiologie est ailleurs encore : nous serons de plus en plus à même de comprendre et de manipuler nos rythmes. Si vous pensez que la nécessité est la mère de l’invention et que l’argent compte en ce monde, alors la note de 40 milliards de dollars par an que représentent les effets des troubles du sommeil pour les seuls États-Unis (pertes de productivité, accidents et dépenses pharmaceutiques) rend plus probable l’apparition de nouveaux médicaments ciblés et, le cas échéant, l’intervention génétique. Voudrons-nous tous avaler une pilule ou permuter un gène pour nous libérer totalement du sommeil, ou nous contenterons-nous de réserver cet usage aux médecins, aux grands patrons, aux super women et aux pilotes de chasse ? (L’armée américaine consacre déjà 100 millions de dollars à la recherche sur le modafinil, médicament qui réduit le besoin de sommeil, utilisé aujourd’hui en Irak et en Afghanistan.)
Nous vivons dans un monde frénétique, où la télévision et la radio remettent à jour chacune de nos minutes et où les horaires de travail et les voyages sont de plus en plus indifférents aux rythmes naturels. L’évolution et la chronobiologie nous enseignent que nos mondes internes et externes sont profondément connectés. Mais notre manière de voir le temps est intimement liée à nos rêves et à nos aspirations – à la manière dont nous voudrions voir s’écrire le poème de nos vies, et de notre monde. Souhaiterons-nous continuer à nous détacher de plus en plus des cycles du Soleil, de la Lune, des marées et des planètes ? Ou la nature finira-t-elle par nous rappeler puissamment, voire rudement, à son ordre ? Finalement, il se pourrait que la décision nous appartienne.