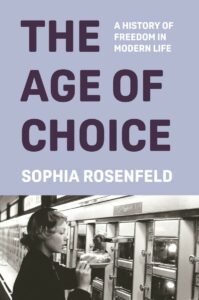Pour une histoire du choix
Publié en septembre 2025. Par Michel André.
Avec l’essor du capitalisme, l’éventail des choix qui s’offrent à nous pour organiser notre vie s’est tellement élargi que notre rapport même à la notion de choix s’est transformé. Nos ancêtres vivaient contraints. Serions-nous devenus trop libres ?

Qu’est-ce qu’être libre ? Benjamin Constant opposait la liberté des Anciens, conçue comme la possibilité de participer à la vie publique, et la liberté des Modernes, définie comme celle de mener sa vie privée comme on l’entend. Dans le même esprit (les deux distinctions se recoupent sans coïncider), Isaiah Berlin différenciait la liberté positive, comme capacité de réaliser ses objectifs de manière autonome, et la liberté négative, celle d’agir sans entraves extérieures. Dans les sociétés contemporaines du monde occidental, suggère l’historienne Sophia Rosenfeld, la liberté n’est pas seulement conçue comme l’absence de dépendance, de contrainte ou d’interférence. Fondamentalement, elle est identifiée à la possibilité de faire des choix, dans tous les domaines. Cette conception n’a pas toujours prévalu et ne s’est pas non plus imposée d’un coup. Elle s’est installée progressivement, en liaison avec le développement de l’économie de marché, du capitalisme et de la démocratie, ainsi qu’avec la valorisation de plus en plus importante de l’individu et de ses satisfactions. Ce processus, soutient-elle, est largement demeuré inaperçu en dépit de sa portée déterminante. Dans The Age of Choice, elle entend faire l’« l’histoire inédite d’une idée et d’un mode de vie fondamentaux pour définir le monde moderne ». Bien que les noms de plusieurs grands théoriciens de la liberté (John Locke, Emmanuel Kant, John Stuart Mill) y apparaissent, et que les deux sujets ne soient pas sans liens, le livre n’est pas une histoire du libéralisme. Il relève d’ailleurs moins de l’histoire des idées que de celle des pratiques, des mentalités et des institutions.
Longtemps, les choix auxquels les êtres humains se sont trouvés confrontés ont eu un caractère ponctuel. Ils prenaient essentiellement la forme d’alternatives simples ou de dilemmes moraux comme celui, entre le vice et la vertu, auquel Hercule doit faire face dans une allégorie célèbre. Dans la société moderne, les choix sont multiples et omniprésents, ouverts à un vaste éventail de possibilités et censés définir ceux qui les font en fonction de leurs goûts, leurs préférences et leurs opinions. Sophia Rosenfeld retrace l’émergence du paradigme du choix dans quatre grands domaines : le commerce, les idées et les convictions religieuses, la vie sentimentale et matrimoniale, la politique. Elle conclut son enquête par un aperçu des « sciences du choix » qui sont nées au début du XXe siècle et se sont épanouies tout au long de celui-ci.
Au début, il y a le négoce, plus particulièrement celui des biens de luxe ou de demi-luxe, des nourritures et des étoffes exotiques. Autour de 1700 apparaissent les premiers catalogues et guides pour les acheteurs et les premiers menus de restaurant. On commence à se rendre dans les boutiques, non simplement pour y faire des achats, mais pour contempler ce qui est à vendre. Le shopping est né, et avec lui les rudiments de la publicité. Parallèlement se développe un autre marché, celui des croyances et des idées. Parce que le protestantisme met l’accent sur la liberté de conscience, et parce qu’il se fractionne rapidement en une multitude d’églises, la Réforme établit, popularise et diffuse l’idée que chacun est libre de choisir sa religion. En matière littéraire et intellectuelle, avec le relâchement de la censure, la production écrite explose. Des idées nouvelles sont mises en circulation par l’intermédiaire de livres, de lettres et de pamphlets. Pour aider les lecteurs à choisir entre elles, les premières revues sont créées. Une mode se répand : les compilations personnelles de maximes, proverbes, pensées, adages, aphorismes, citations, extraits de livres d’écrivains et de penseurs. Elles fournissent à chacun le moyen de se définir par ses choix et ses préférences dans ce domaine.
Au début du XIXe siècle, l’émergence du mariage d’amour ouvre considérablement le champ des possibilités matrimoniales. Avec cet élargissement apparaît le risque de faire de mauvais choix. Un instrument utilisé dans la bonne société pour le limiter et mettre de l’ordre dans le processus aléatoire des rencontres est le carnet de bal, auquel Rosenfeld, sur les pas de Jane Austen, consacre plusieurs pages. Le chapitre sur le choix politique porte, non sur la substitution du suffrage universel au vote censitaire, mais sur le vote des femmes et sur l’introduction du scrutin secret. Sophia Rosenfeld attache une importance particulière à ce dernier développement, qui transforme ce qui était jusque-là un acte public en l’expression de préférences privées. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle John Stuart Mill y était opposé. Protégé par le secret, affirmait-il, le votant risque « d’utiliser une fonction publique dans son intérêt personnel, pour son propre plaisir et en fonction de ses caprices ».
Peu à peu, l’idée et la pratique du choix ont pris une importance suffisante pour susciter l’envie et le besoin d’en construire une science permettant de mieux comprendre les choix, d’en mesurer les effets et, le cas échéant, de les manipuler. Elle a pris plusieurs formes. Le marketing, les études de marché et les enquêtes sur les préférences de vote font appel à la psychologie, pour identifier, expliquer et hiérarchiser les préférences des consommateurs et des votants qui sont à l’origine de leurs choix. À l’opposé, s’abstenant délibérément de toute considération psychologique, les économistes ont développé des théories du choix abstraites, basées sur des hypothèses au sujet du comportement d’un homo economicus rationnel désincarné choisissant entre des moyens alternatifs pour maximiser son intérêt. Ce modèle a été étendu au domaine de la politique avec la théorie du « choix social ». Il a été fortement critiqué au motif que les individus sont loin de se comporter de façon rationnelle et que les choix qu’ils font s’expliquent en grande partie par le poids de biais cognitifs et de facteurs émotionnels. Pour tenir compte de ceci, de nouvelles techniques visant à influencer les choix ont été développées dans le champ de la communication commerciale et politique.
Tout au long de son récit, Sophia Rosenfeld accorde une attention particulière à la place des femmes dans l’histoire du choix. Leurs possibilités de choisir, souligne-t-elle, furent toujours plus réduites que celles de hommes. Le vote des femmes, par exemple, fut plus difficile à obtenir que le scrutin secret, parce qu’elles étaient jugées capricieuses, assujetties à leurs émotions et influençables. D’un autre côté, le shopping fut perçu dès le début comme une activité féminine par excellence, avec ce que cela peut connoter de frivolité. On trouvera aussi dans le livre une réflexion sur l’histoire de la décision des féministes de placer la lutte pour l’avortement sous le signe unique du choix, décision qu’elle trouve inopportune, notamment parce qu’il présuppose que toutes les femmes se trouvent dans les mêmes conditions matérielles et sociales face à la maternité.
Sophia Rosenfeld montre de quelle manière chaque extension du domaine du choix s’est heurtée à des résistances et à la volonté de limiter la possibilité de choisir à certaines catégories de la population ou certaines options : partisan de la liberté de croyance, par exemple, Locke ne l’étendait pas jusqu’au catholicisme ou à l’athéisme. Elle évoque les effets délétères, sur le plan psychologique et social, de la combinaison de l’injonction à choisir avec l’extraordinaire abondance de possibilités auxquelles chacun se trouve aujourd’hui confronté – de sa vie quotidienne aux décisions les plus fondamentales au sujet de son avenir – abondance dont les rayons des supermarchés, les catalogues des entreprises de vente en ligne et les pages des sites de rencontre constituent l’illustration emblématique. Avec une grande prescience, Kant, dans les Conjectures sur le commencement de l’histoire humaine, mettait en garde dès le XVIIIe siècle contre l’anxiété que ne pouvait manquer d’engendrer, en même temps qu’elle donnait un avant-goût de la liberté, la disponibilité d’une grande quantité d’objets. La plupart des choix qui nous sont offerts sont par ailleurs des choix forcés. Ils l’ont toujours été jusqu’à un certain point, mais cette caractéristique ne fait que s’accentuer dans un monde commandé par les algorithmes. Et sous les apparences de l’originalité et de la volonté de se singulariser, ceux que font beaucoup d’entre nous sont souvent marqués par un grand conformisme.
Dans les sociétés du passé caractérisées par la rareté, l’immutabilité de statuts sociaux rigides et la prépondérance du groupe sur les individus, les possibilités de choisir (ses biens, ses opinions, sa profession, son lieu de vie, son partenaire, ses dirigeants) étaient limitées. Mais ces contraintes fournissaient des repères et créaient un cadre de référence qui rendaient la vie à certains égards plus facile. Personne, aujourd’hui, ne voudrait se retrouver dans un univers aussi limité et astreignant. On peut toutefois s’interroger avec Sophia Rosenfeld sur la place et la forme qu’a prise l’idée de choix dans le fonctionnement des sociétés capitalistes et d’individualisme de masse, et sur les conditions matérielles et idéologiques dans lesquelles la possibilité de choisir s’y exerce. Ceci tout en cherchant à mieux comprendre – l’histoire peut nous y aider autant que la philosophie – la relation exacte entre la possibilité de choisir et la liberté.