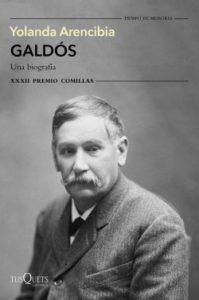Benito Pérez Galdós, le génie méconnu
Publié dans le magazine Books n° 111, octobre 2020. Par Michel André.
On connaît les films Viridiana et Tristana de Buñuel, moins l’écrivain qui les a inspirés. Et pourtant, ce contemporain de Zola est considéré comme le plus grand romancier espagnol après Cervantes. Le centenaire de sa mort est l’occasion de (re)découvrir sa vie et son œuvre immense.

Benito Pérez Galdós (ici à Las Palmas de Gran Canaria, sa ville natale, en 1890) était un homme affable et affectueux qui aimait la nature et les animaux, plus particulièrement les chiens.
Aux yeux de ses compatriotes, il est l’égal de Balzac et de Dickens, deux géants de la littérature qu’il admirait et qui l’ont fortement influencé. Benito Pérez Galdós, dont on commémore cette année le centième anniversaire de la mort, est le plus grand écrivain espagnol du XIXe siècle : le plus grand depuis Cervantes, affirmait au siècle dernier l’essayiste Salvador de Madariaga ; un génie comparable à l’auteur de Don Quichotte, enchérit aujourd’hui le critique et romancier Andrés Trapiello.
Il y a quelques mois, deux autres écrivains, Antonio Muñoz Molina et Javier Cercas, engageaient une polémique au sujet de Galdós dans les colonnes du quotidien El País. Dans un article cinglant, Cercas reprochait à Galdós d’avoir pratiqué une littérature paternaliste et de parti pris, en violation de la règle de neutralité du point de vue qui est l’un des piliers du roman moderne. Muñoz Molina récusait cette accusation et s’employait à montrer que Galdós, tout en défendant passionnément la liberté et la justice, s’efforçait toujours de montrer dans ses romans la complexité des situations et des personnages.
S’il refusait d’élever Galdós à la hauteur de Tolstoï ou de Flaubert, Cercas concédait toutefois un point : Fortunata et Jacinta, un livre à peine moins long que Guerre et Paix, « est sans doute avec La Régente [de Leopoldo Alas, dit Clarín], le meilleur roman espagnol du XIXe siècle. » Clarín, qui est mort jeune, n’a toutefois publié que deux romans. En près de soixante ans de carrière, son ami Pérez Galdós en a produit une bonne trentaine, auxquels s’ajoutent les 46 romans historiques de la série des « Épisodes nationaux », 23 pièces de théâtre et l’équivalent de 20 volumes d’essais, d’articles de presse, de nouvelles et de récits de voyage.
Parce que son œuvre dominait la vie littéraire espagnole de son temps, Galdós était un personnage célèbre et une figure publique. Beaucoup d’aspects de sa vie personnelle restaient cependant dans l’ombre. De tempérament réservé, il ne s’ouvrait que peu, même à ses proches. Et les Mémoires qu’il a dictés à la fin de sa vie ne sont qu’une collection de souvenirs de voyage. Une des premières biographies qui lui ont été consacrées, après celle de Clarín, publiée de son vivant, est due à un hispaniste lituanien émigré aux États-Unis, H. Chonon Berkowitz 1. D’autres ont suivi, dont une, par Pedro Ortiz-Armengol 2, a fait autorité durant vingt ans. À l’occasion du centenaire de sa mort, trois nouvelles biographies ont paru : celle de Yolanda Arencibia, la plus volumineuse et détaillée, est appelée à devenir la biographie de référence ; celle de l’historien Francisco Cánovas 3 situe la vie et l’œuvre de Galdós dans le contexte littéraire, historique et politique de l’époque ; celle d’Eduardo Valero 4 est un ouvrage pédagogique organisé en chapitres thématiques.
Contemporain de Zola, Benito Pérez Galdós naquit en 1843 à Las Palmas de Gran Canaria, aux Canaries. Son père était colonel et sa mère une femme au très fort caractère, dure et exigeante, dont la personnalité allait le marquer durablement. Il était leur dixième enfant. Toute sa vie, il resta très lié à ses frères et sœurs, plus particulièrement à ces dernières, au point d’habiter à Madrid avec deux d’entre elles et leur mari. Parce qu’il s’était épris d’une de ses cousines, sa mère, pour mettre fin à une relation qu’elle n’approuvait pas, l’envoya faire son droit à Madrid. S’il profita de la liberté que procure la vie d’étudiant, Galdós n’était guère intéressé par la carrière juridique. Rapidement, il se tourna vers l’écriture.
Son entrée en littérature se fit par l’intermédiaire du journalisme. C’est dans ses multiples articles pour La Nación, El Debate, Revista de España et d’autres publications qu’il forgea ses moyens d’expression. Et c’est par leur truchement qu’il pénétra dans ce monde foisonnant de faits, de situations et de sentiments qui allait constituer la matière de son œuvre : les affaires judiciaires et les litiges commerciaux, les drames familiaux, les ambitions bourgeoises et la lutte pour l’existence des petits boutiquiers, la vie intense et animée des cafés et les rivalités politiques. « Les personnages de Galdós, commente Francisco Cánovas, composent une photographie de la société [...] madrilène de la seconde moitié du XIXe siècle : commerçants, fonctionnaires, rentiers, militaires, artisans, professeurs. » Et, avec eux, tous les anonymes qui n’ont ni travail ni patrimoine, les sin oficio ni beneficio, comme on dit en espagnol, « les mendiants, les indigents, les marginaux ». Il est le peintre de l’entrée de l’Espagne dans la modernité et, au centre de son attention, figurent les classes moyennes.
On distingue généralement trois cycles dans l’œuvre romanesque de Galdós : les romans à thèse de sa jeunesse, les romans de la maturité et les romans tardifs, dans lesquels les conflits sociaux et psychologiques acquièrent une dimension spirituelle. Dans tous, Galdós a recours à un ensemble de procédés souvent inédits, tels ceux que décrit Yolanda Arencibia à propos de La desheredada, le premier des romans de la maturité : « le soliloque, le monologue intérieur, la narration dramatisée […], la différentiation des plans de narration […], le dialogue dramatique ». Ils lui permettent de raconter l’histoire de l’extérieur et de l’intérieur, en entrant et sortant de la tête des personnages et en confrontant leurs agissements et leurs sentiments.
Les deux sommets de l’œuvre de fiction de Galdós sont Fortunata et Jacinta, drame social et sentimental complexe à multiples rebondissements fondé sur le triangle classique mari-épouse-maîtresse qui est en même temps un tableau cruel de la bonne société madrilène ; et Miséricorde, drame de la misère et de la compassion dont l’action se déroule dans le Madrid des bourgeois déclassés et des bas-fonds et que la philosophe Maria Zambrano considérait comme le cœur même de son œuvre 5.
Les Épisodes nationaux sont composés de cinq séries de romans historiques, consacrée chacune à un moment particulier de l’histoire de l’Espagne au xixe siècle : la guerre d’indépendance contre la France de Napoléon Ier, la lutte entre absolutistes et libéraux, la première guerre carliste, la révolution de 1848 et le règne d’Isabelle II, la Ire République et la restauration des Bourbons. Galdós, qui avait entamé ce projet un peu par hasard, le poursuivit dans l’intention d’instruire les Espagnols qui, disait-il, n’ignorent rien autant que l’histoire de leur pays. Pour composer ces romans, qui mêlent figures historiques et de fiction, il utilisa le procédé du personnage récurrent hérité de Balzac. Avant de les rédiger, il étudiait soigneusement la documentation disponible, visitait les lieux évoqués dans le récit et interrogeait tous ceux qui pouvaient lui fournir des informations intéressantes sur les faits racontés. Très appréciés des lecteurs, les Épisodes nationaux firent beaucoup pour la popularité de Galdós et la vente de ces ouvrages lui assura des rentrées importantes.
C’est au théâtre qu’il débuta et acheva sa carrière littéraire. Il écrivait des pièces en vue d’atteindre un public très large, mais aussi parce qu’il éprouvait le besoin de moderniser le théâtre espagnol, qu’il estimait paralysé par une tradition poussiéreuse et des conventions rigides. On lui reconnaît le mérite d’avoir introduit sur la scène madrilène une série d’innovations dans la conception et les thèmes de l’art dramatique. Ses pièces, souvent tirées de ses romans, bénéficièrent d’un accueil chaleureux, voire enthousiaste. L’une d’entre elles, Electra, dans laquelle il affirmait avoir condensé tout son combat contre la superstition et le fanatisme, remporta un grand succès mais fut férocement critiquée par les milieux cléricaux, qui la jugèrent antireligieuse.
Galdós était choqué par les abus de pouvoir du clergé espagnol et ses positions autoritaires en matière de morale et de mœurs. Il se définissait pourtant comme un homme « pratique dans la vie, et religieux dans [sa] conscience ». Influencé dans sa jeunesse par les idéaux du philosophe et théoricien de l’éducation Francisco Giner de los Ríos, il était un libéral et un humaniste attaché à la liberté, au rationalisme, à la tolérance et à la justice. Proche au départ des républicains réformistes mais déçu par leurs querelles intestines, leur comportement souvent intéressé et leur absence d’idéaux, il s’éloigna progressivement d’eux. Avec le temps, ses idées se radicalisèrent jusqu’à lui faire éprouver de la sympathie pour le socialisme de Pablo Iglesias, fondateur du Parti socialiste ouvrier espagnol. Mais jamais il ne fut un révolutionnaire, ni même, bien qu’ayant été élu député à plusieurs reprises, un politicien. « Je ne suis pas et ne serai jamais un homme politique, écrivait-il. J’ai été à la Chambre des députés parce qu’on me l’a demandé, et je n’ai pas résisté parce que [...] je désirais vivement connaître de près la vie politique. [...] Il est impossible de comprendre la vie nationale sans être passé par là. »
Sa vie sentimentale est longtemps restée entourée de mystère. Grâce notamment à l’étude de sa correspondance, on en sait aujourd’hui un peu plus. Il ne s’est jamais marié. Dans une déclaration souvent citée, le médecin et essayiste Gregorio Marañón, qui l’a connu dans sa jeunesse, attribue cela à l’influence de sa mère sur sa vie affective. Dans son étude consacrée à l’écrivain suisse Amiel, Marañon décrit Galdós comme un homme « extrêmement viril et coureur de jupons, mais timide avec les femmes ». Le souvenir de sa mère et son lien affectif avec ses sœurs l’ont-ils dissuadé de se marier ? Lui-même affirme n’en avoir jamais éprouvé le besoin, mais on peut imaginer d’autres explications : une déception amoureuse, le fait, suggère Yolanda Arencibia, qu’il n’ait jamais rencontré la personne adéquate, l’incompatibilité, à ses yeux, entre la vie conjugale et le travail d’écrivain.
Les femmes ne furent pas pour autant absentes de sa vie, il y en eut même beaucoup. À côté de multiples aventures, on lui connaît plusieurs grandes passions. Une des femmes importantes dans son existence fut Lorenza Cobián, qui posait comme modèle et dont il s’employa à parfaire l’éducation. Il eut avec elle une fille qu’il reconnut mais ne vit régulièrement qu’à la fin de sa vie. Il y eut aussi la romancière Emilia Pardo Bazán, avec qui la relation était largement fondée sur une admiration littéraire réciproque et se transforma progressivement en amitié ; l’actrice Concha Morell et, enfin, la dernière grande passion de sa vie, l’institutrice Teodosia Gandarias : après avoir été « l’image idéalisée de l’amour suprême », écrit Yolanda Arencibia, elle fut « une lueur d’espoir pour l’écrivain aveugle et désabusé qui voyait ses forces diminuer de jour en jour ».
Ses multiples liaisons lui coûtèrent beaucoup. Ainsi que le résume brutalement Pedro Ortiz-Armengol, « il gagna beaucoup d’argent et dépensa tout avec les femmes ». À plusieurs d’entre elles (pas Emilia Pardo Bazán, qui n’en avait pas besoin) il acheta un appartement. Mais les femmes de sa vie furent pour lui une puissante source d’inspiration. On en retrouve les traits dans les personnages féminins de ses romans, des femmes fortes, attachantes et inoubliables. « Sans les femmes, il n’y a pas d’art, disait-il. Elles sont l’enchantement de la vie, le moteur des ambitions grandes et petites ; elles sont l’origine et la source d’où émanent toutes les vertus. » Son progressisme le poussait à défendre leurs droits, notamment en matière d’instruction.
Tous ceux qui l’ont connu le décrivent comme un homme timide et taciturne, capable de se montrer brillant lorsqu’il prenait la parole mais peu porté à s’exprimer en public, préférant écouter que parler. S’il lui est arrivé de fréquenter les tertulias, les cercles d’écrivains et d’intellectuels, il n’en était pas un participant assidu. C’était un homme affable et affectueux qui adorait les enfants, aimait la nature et les animaux, plus particulièrement les chiens, et détestait la corrida. Frugal dans ses habitudes alimentaires, il ne buvait guère de vin et d’alcool mais était un grand fumeur. Ses intérêts et ses talents artistiques ne se limitaient pas à la littérature. Mélomane averti, il jouait passablement du piano et de l’harmonium. Dessinateur doué, il peignait volontiers, notamment des marines.
Dans l’ensemble, sa vie était centrée sur son travail et il était un homme d’habitudes. Dans les différents appartements qu’il occupa à Madrid et dans la propriété qu’il possédait à Santander, sur la côte nord, il se levait tôt, écrivait toute la matinée, produisant en moyenne dix pages par jour. Lorsqu’il était à Madrid, il passait ses après-midis à arpenter les rues, et à se perdre dans les différents quartiers. À Paris, Londres et Rome, il visita avec passion les grands musées. De France, d’Angleterre, d’Italie, du Portugal, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse, du Danemark il ramena des observations utiles et des impressions de voyage.
On l’a souvent présenté comme quelqu’un de modeste, ce qu’il n’était que jusqu’à un certain point. Parfaitement conscient de son génie, il ne doutait pas de sa supériorité comme romancier. Mais il n’était pas avide de reconnaissance et ne commença à quêter les marques de celle-ci qu’à la fin de sa vie, lorsque le grand âge, une santé déclinante et l’état précaire de ses finances l’eurent rendu moins sûr de lui et enclin à rechercher des satisfactions d’amour-propre.
Ses dernières années furent pénibles, marquées par les avanies de la vieillesse et les affres de la maladie. Sa vision se détériora progressivement et il dut être opéré de la cataracte à l’œil gauche, puis au droit. En vain, puisqu’au bout d’un certain temps il perdit complètement la vue et se trouva réduit à dicter ses livres et son courrier. Souffrant de divers maux physiques, il ne se déplaça bientôt plus qu’avec peine.
Il lui devint par ailleurs difficile de soutenir le train de vie dispendieux auquel il était habitué. C’est une des raisons pour lesquelles plusieurs de ses amis menèrent campagne pour lui faire obtenir le prix Nobel de littérature. Leurs efforts furent entravés par les manœuvres des milieux catholiques. Une souscription publique en sa faveur avait été ouverte, qui ne rapporta qu’une partie de la somme attendue ; mais il bénéficia d’une aide allouée par l’État. Ces diverses vicissitudes et son impression que ses forces créatives s’épuisaient altérèrent son caractère, qui s’aigrit, et son humeur, qui s’assombrit. Un an avant sa mort, il eut toutefois la joie d’assister à l’inauguration d’une statue à son effigie dans le parc du Retiro, à Madrid.
Lors de son décès, en 1920, la ferveur populaire fut intense. Trente mille personnes assistèrent à ses obsèques. Les hommages officiels furent nombreux, comme ceux du milieu littéraire. Galdós était admiré par ses pairs. Certains des membres de la génération de 1898 – le philosophe Miguel de Unamuno, l’essayiste Azorín, les écrivains Ramón María del Valle-Inclán et Pío Baroja émirent parfois des jugements sévères à son sujet. Mais leurs désaccords étaient de nature artistique et n’impliquaient aucune mise en cause de son talent. Le poète Antonio Machado plaçait son œuvre très haut, tout comme les membres de la « génération de 1914 » José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón et Ramón Pérez de Ayala.
Sous le régime franquiste, Galdós, jugé trop républicain, fut peu mis en valeur dans l’enseignement et la vie publique. Certaines de ses œuvres se heurtèrent à la censure en raison de leur caractère prétendument immoral et anticlérical. Depuis les années 1980, l’Espagne, qui ne l’avait en vérité jamais complètement oublié, le redécouvre et salue en lui l’observateur sagace et irremplaçable la société espagnole du XIXe siècle. « [Il] a recréé avec sa plume un siècle et un pays », disait le romancier et poète canarien Juan Pedro Castañeda.
Peu traduit, Galdós est essentiellement connu à l’étranger grâce aux films de Luis Buñuel Nazarín, Viridiana et Tristana, adaptations de trois de ses romans de la dernière période. En Espagne, il est aujourd’hui révéré comme un créateur puissant, le témoin privilégié d’une époque et l’auteur d’une fresque historique passionnante. Comme le fait remarquer Javier Cercas, « les débats à son sujet prouvent que Galdós est toujours vivant. Et c’est ce qui peut arriver de mieux à un auteur classique ».
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).
— Cet article a été écrit pour Books.
Notes
1. Pérez Galdós: Spanish Liberal Crusader (University of Wisconsin Press, 1948).
2. Vida de Galdós (Crítica, 1996).
3. Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso (Alianza Editorial, 2019).
4. Benito Pérez Galdós. La figura del realismo español (Sargantana, 2019).
5. La España de Galdós (Alianza Editorial, 2011).
Pour aller plus loin
L’œuvre de Benito Pérez Galdós demeure pour l’essentiel méconnue du public francophone. Seuls quelques-uns de ses romans ont été traduits, et encore, ils n’ont pas été réédités depuis des décennies.
- Fortunata et Jacinta, traduit par Robert Marrast (Les Éditeurs français réunis, 1980).
- Miséricorde, traduit par Pierre Guenoun (Les Éditeurs français réunis, 1964).
- La Passion Torquemada, 3 volumes, traduit par Caroline Pascal et Liliane Hasson (Desjonquères, 1998).
- Tristana, traduit par Suzanne Raphaël (Flammarion, « GF », 1993).