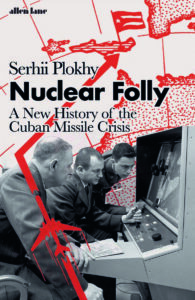Crise des missiles : une leçon à méditer
Publié dans le magazine Books n° 119, mai-juin 2022. Par Michel André.
La crise de Cuba en 1962 est un cas d’école. On sait aujourd’hui de manière précise qu’à cette occasion une guerre nucléaire a été évitée de justesse. En cause, l’esprit va-t-en-guerre de certains militaires de haut rang et le risque d’erreur d’interprétation de la part des officiers à la manœuvre. Cette affaire illustre clairement la possibilité d’une escalade accidentelle.

«Ces galonnés ont un grand avantage. Si nous les écoutons et faisons ce qu’ils nous disent de faire, aucun d’entre nous ne sera en vie pour leur montrer qu’ils avaient tort ». Cette remarque sarcastique de John Fitzgerald Kennedy à propos des hauts responsables militaires lui conseillant en 1962, au plus fort de la crise des missiles de Cuba, de bombarder les sites de lancement ou d’envahir l’île, en dit long sur son état d’esprit durant ces journées. Baptisé en Russie « crise des Caraïbes » et à Cuba « crise d’octobre », cet épisode marqua le moment le plus dangereux de la guerre froide. Davantage encore qu’à l’occasion de la crise du canal de Suez de 1956, le monde est alors passé très près d’un conflit nucléaire. Réduite à ses étapes clés, cette séquence d’événements peut être décrite comme un drame en trois actes : la découverte, le 14 octobre, par un avion de reconnaissance américain U-2, de plateformes de lancement et de missiles balistiques russes de moyenne portée au sud-ouest de La Havane ; l’établissement, le 22 octobre, par les États-Unis, d’un blocus naval autour de Cuba empêchant les navires soviétiques d’atteindre l’île ; le dénouement, le 28 octobre, avec la conclusion d’un accord prévoyant le retrait des missiles en échange d’un engagement des États-Unis de ne pas envahir Cuba, ainsi que du démantèlement des missiles qu’ils avaient eux-mêmes installés un an auparavant en Turquie – une clause destinée à demeurer secrète à la demande des Américains.
Des centaines de rapports, de livres et d’articles ont été consacrées à cet épisode. Avec le temps, il est devenu de plus en plus évident que la version des faits présentée en 1969 dans le livre 13 Jours 1, de Robert Kennedy, frère et bras droit de John Kennedy, et propagée par les biographes du président, Ted Sorensen et Arthur M. Schlesinger Jr., exigeait d’être corrigée. La déclassification progressive des enregistrements des réunions du groupe de conseillers rassemblé par Kennedy (l’Executive Committee, surnommé Excomm), effectués à la demande du président et à l’insu des participants, a jeté une lumière nouvelle sur les décisions prises à Washington. Le groupe comprenait notamment Robert Kennedy, le vice-président Lyndon B. Johnson, le secrétaire à la Défense Robert McNamara, le secrétaire d’État Dean Rusk, le conseiller à la Sécurité nationale McGeorge Bundy, le directeur de la CIA John McCone et le général Maxwell D. Taylor, chef d’état-major des armées. Ces hauts responsables étaient loin d’être toujours d’accord entre eux. Certaines des informations sur lesquelles ils s’appuyaient étaient fausses. Beaucoup d’entre eux ont changé d’avis à plusieurs reprises, et les positions qu’ils défendaient n’étaient pas nécessairement celles qu’ils ont rétrospectivement prétendu avoir été les leurs. Contrairement à ce qu’il a laissé entendre, Robert Kennedy, par exemple, fut un de ceux qui préconisaient l’attitude la plus dure. On découvre aussi à quel point John Kennedy s’est souvent trouvé seul à prôner la modération, contre ses conseillers et les militaires.
L’ouverture des archives soviétiques après l’effondrement de l’URSS a permis de mieux comprendre les motivations ayant conduit Khrouchtchev à se lancer dans une entreprise aussi risquée que l’installation de missiles nucléaires à 170 kilomètres de la côte de la Floride, ainsi que la manière dont la crise était perçue et vécue du côté russe. Dans le prolongement des travaux pionniers de deux historiens, l’un russe, l’autre américain, et de l’ouvrage très équilibré de Michael Dobbs sur le sujet 2, Serhii Plokhy, en s’appuyant notamment sur l’étude d’archives du KGB hébergées en Ukraine, où furent fabriqués les missiles, propose un récit de la crise de Cuba faisant une large place à ce qui se passait au Kremlin, sur les bateaux convoyant les armes et du côté de Fidel Castro. Si la crise a pour point de départ la décision de Khrouchtchev, le gouvernement de John Kennedy porte une part de responsabilité dans son déclenchement. En 1959, Fidel Castro, à la tête de ses guérilleros, renversait le dictateur cubain Fulgencio Batista et prenait le contrôle de l’île. Rapidement, les Américains essayèrent de le chasser du pouvoir. Peu après son élection, Kennedy donnait le feu vert au lancement d’une opération conçue et préparée par la CIA à la demande de son prédécesseur Dwight Eisenhower. La tentative de débarquement, en avril 1961, de quelque 1 500 contre-révolutionnaires dans la baie des Cochons, sur les côtes cubaines, se solda par une débâcle. Après cet échec, la CIA élabora un programme à long terme, l’opération Mongoose, comprenant différentes actions visant à renverser ou à assassiner Castro. On sait aussi aujourd’hui que l’armée américaine avait des plans d’invasion de Cuba. Se sentant menacé, Castro se tourna vers l’Union soviétique. Le révolutionnaire nationaliste se transforma en leader communiste.
L’idée de placer des missiles nucléaires à Cuba vint à Khrouchtchev à l’occasion d’un voyage en Bulgarie. Dans son esprit, cette manœuvre audacieuse lui permettrait de faire d’une pierre plusieurs coups : assurer la présence du communisme dans une partie du monde où il était absent ; atténuer le risque de voir Castro se tourner vers la Chine ; compenser l’énorme déséquilibre stratégique existant en faveur des États-Unis (Kennedy avait prétendu l’inverse), lesquels possédaient bien davantage de missiles intercontinentaux, dont les plus récents, à combustible solide, étaient opérationnels en quelques minutes ; enfin, faire comprendre aux Américains, qui avaient installé de 1959 à 1961 des missiles nucléaires Jupiter en Italie et en Turquie, « ce que l’on ressent quand on a des missiles ennemis pointés sur soi » et ainsi leur « rendre la monnaie de leur pièce ». Le scénario qu’il envisageait consistait à transporter secrètement ces armements à Cuba, puis à placer les États-Unis devant le fait accompli. D’abord réticent, Castro se laissa convaincre. Andreï Gromyko, ministre des Affaires étrangères, et Anastase Mikoïan, vice-président du Conseil des ministres, doutaient qu’il soit possible d’acheminer les missiles à l’insu des Américains. Mais, dans le régime soviétique, les collaborateurs du premier secrétaire du Parti ne disposaient pas d’une grande marge de manœuvre. Comme l’écrit Plokhy, « ils étaient supposés approuver et entériner les décisions de Khrouchtchev – et se taire ». L’opération fut donc lancée. Pour semer le doute sur sa finalité en cas de fuite d’information, elle fut baptisée « opération Anadyr », du nom d’un fleuve sibérien qui se jette dans la mer de Béring.
Le plan était d’une ampleur impressionnante. Il prévoyait l’installation de 42 missiles à moyenne portée (R-12) et de 24 missiles à portée intermédiaire (R-14) accompagnés de batteries de missiles sol-air pour les défendre, d’avions de chasse MiG-21 et MiG-15, de 6 bombardiers Iliouchine II-28 capables de larguer des bombes nucléaires et d’une armée de 51 000 hommes équipée d’armes nucléaires tactiques. Une partie des missiles R-12, la totalité des R-14 et les 8 000 hommes qui les accompagnaient n’arrivèrent jamais à Cuba en raison du blocus imposé par les Américains après la découverte de l’opération. Mais, le 20 octobre, 8 missiles de moyenne portée étaient pleinement opérationnels. Et, au total, 164 têtes nucléaires étaient présentes à Cuba au moment de la crise. À La Havane, trente ans plus tard, en écoutant un exposé du général Anatoly Gribkov – l’un des architectes de l’opération Anadyr –, Robert McNamara et les experts américains découvrirent avec stupéfaction à quel point leurs services de renseignement avaient sous-évalué l’importance des forces russes présentes à Cuba. Ils avaient estimé leur nombre à quelque 10 000 soldats et officiers, non 43 000. Surtout, les armes nucléaires tactiques leur avaient complètement échappé. En cas d’invasion, il ne fait guère de doute qu’elles auraient été utilisées, entraînant une riposte de même nature qui aurait déclenché une guerre nucléaire. Comment les Soviétiques ont-ils réussi à transférer aussi discrètement tous ces hommes et ce matériel militaire ? Plokhy fournit sur ce point des indications éclairantes. Surveillés par des agents du KGB lors du passage des détroits de la mer Noire pour éviter que l’un d’eux ne passe à l’Ouest, les soldats russes étaient confinés dans les navires avec interdiction de monter sur le pont. Ils effectuèrent donc la traversée dans des conditions particulièrement éprouvantes (une fois à Cuba, ils durent affronter un climat auquel ils n’étaient pas habitués et s’accommoder d’une nourriture souvent avariée).
La découverte de la présence des missiles fut annoncée à Kennedy le 16 octobre. Oubliant qu’il avait lui-même souvent menti à Khrouchtchev, il s’indigna : « Il ne peut pas me faire ça. » Ainsi que Robert McNamara le fit observer, vu que l’URSS possédait des missiles intercontinentaux, la présence à Cuba de missiles à portée limitée ne bouleversait pas l’équilibre stratégique. C’est surtout sur le plan politique qu’ils posaient problème. Durant sa campagne électorale, Kennedy avait férocement critiqué Eisenhower et son rival Richard Nixon pour leur manque de fermeté à l’égard de Castro. L’opinion américaine attendait de lui une réponse énergique. Plusieurs scénarios étaient sur la table : bombarder les sites de lancement des missiles, détruire leurs systèmes de défense, envahir l’île, établir un blocus, recourir à la voie diplomatique. Après avoir penché plusieurs jours pour l’utilisation de la force, solution que lui recommandaient tous ses conseillers, à l’exception de Dean Rusk, ainsi que les militaires, notamment l’impitoyable général Curtis LeMay, Kennedy opta pour le blocus et la diplomatie. L’idée du blocus lui avait été suggérée par McNamara. Dans un autre excellent ouvrage sur la crise récemment publié3, Martin Sherwin défend de façon convaincante la thèse qu’une rencontre fortuite entre Kennedy et le démocrate Adlai Stevenson, ancien rival d’Eisenhower, joua un rôle important dans le choix d’une solution diplomatique comprenant un échange avec les missiles de Turquie. Kennedy n’avait pas de sympathie pour Stevenson, qui ne l’avait pas soutenu pour l’investiture du Parti démocrate, mais il garda sa suggestion en tête. Ce qui ne l’empêcha pas, par la suite, d’encourager la presse à présenter Stevenson comme un défaitiste animé par une mentalité « munichoise ». L’homme d’État était redevenu politicien.
Kennedy avait déjà montré sa préférence pour le règlement pacifique des différends internationaux. Dans une lettre envoyée à Khrouchtchev en octobre 1961, lorsque les chars russes et américains s’étaient retrouvés face à face à Berlin, il écrivait : « En lisant l’histoire des guerres du passé et de la manière dont elles ont commencé, on ne peut s’empêcher d’être impressionné par la fréquence avec laquelle la mauvaise communication, les malentendus et l’irritation mutuelle ont joué un rôle important dans les événements conduisant à des décisions fatales. » C’était une allusion claire au livre de Barbara Tuchman, Août 14 4, sur l’engrenage ayant mené à la Première Guerre mondiale. Un livre qu’il avait recommandé à tous ses conseillers et fait distribuer dans les bases américaines à travers le monde.
Destiné à stopper la livraison des missiles, le blocus fut baptisé « mise en quarantaine », pour éviter d’employer un mot pouvant être interprété comme une déclaration de guerre. Khrouchtchev, connu pour son tempérament émotif et colérique, réagit violemment. Plokhy rapporte le témoignage du leader roumain Gheorghe Gheorghiu-Dej, en visite au Kremlin le jour où le blocus lui fut annoncé : « Khrouchtchev entra en rage, criant, jurant, lançant une avalanche d’ordres contradictoires », maudissant l’Amérique et menaçant « d’atomiser la Maison-Blanche ». La tension continua à monter, pour atteindre un point culminant le 27 octobre. Au cours de cette journée, surnommée le « samedi noir », une série d’incidents se succédèrent, dont chacun aurait pu donner le signal d’une conflagration nucléaire. Un avion de reconnaissance U-2 en mission de routine – il était chargé de prélever des échantillons atmosphériques pour détecter les traces d’un éventuel test nucléaire russe – survola le territoire de l’URSS. Un autre avion du même type fut abattu par la défense anti-aérienne cubaine. Le capitaine d’un sous-marin soviétique obligé de faire surface pour recharger ses batteries, interprétant mal le lancement de fusées éclairantes par un destroyer américain, fut sur le point de lui expédier une torpille équipée d’une tête nucléaire. L’ordre ne fut pas exécuté grâce à l’intervention d’un autre officier, Vassili Arkhipov. Ayant compris que leur sous-marin n’était pas attaqué, il fit arrêter la préparation du tir et gagna ainsi la réputation d’être « l’homme qui sauva le monde ». Le capitaine avait été induit en erreur parce qu’un message américain informant les Russes de l’usage non offensif qui serait fait des fusées éclairantes ne lui avait pas été communiqué. Comme d’autres incidents l’ont montré, le risque de quiproquo n’était pas moindre du côté américain. « Il y a toujours un enfoiré qui ne transmet pas les ordres », commenta Kennedy lorsqu’on lui annonça qu’un U-2 avait été intercepté au-dessus de l’Union soviétique.
Entre-temps, une solution diplomatique était conçue en secret. Bien avant la crise, Kennedy et Khrouchtchev avaient établi entre eux deux canaux de communication privilégiés : l’un, officiel, par l’intermédiaire de rencontres régulières de Robert Kennedy avec l’ambassadeur soviétique Anatoli Dobrynine ; l’autre, secret, par le truchement d’un agent du GRU (le service de renseignement russe à l’étranger), Georgi Bolshakov, basé à Washington. Tel qu’il fut finalement conclu, l’accord reposait sur deux lettres successivement envoyées par Khrouchtchev à Kennedy : la première, confidentielle, le soir du 26 octobre ; la seconde, publique, le matin du 27. Dans la première, il se disait prêt à retirer les missiles en échange d’un engagement des États-Unis à ne pas envahir Cuba ; dans la seconde, il ajoutait comme condition le démantèlement des missiles de Turquie.
Un des mythes démontés par l’historien Sheldon M. Stern 5 veut que Robert Kennedy ait suggéré à son frère d’accepter les termes du premier message en ignorant le second. Il n’en fut rien. L’idée d’utiliser les missiles de Turquie comme monnaie d’échange circulait depuis un certain temps déjà, tant elle semblait naturelle. Kennedy avait d’autant moins de raisons d’hésiter à les sacrifier que ces missiles étaient obsolètes. Lors d’un de ses entretiens avec Dobrynine, Robert Kennedy informa celui-ci que son frère était prêt à donner l’ordre de démanteler les missiles Jupiter pour peu que ce volet de l’accord demeure secret. La proposition fut transmise à Khrouchtchev, qui l’accepta. Aucun des membres de l’Executive Committee (pas même Lyndon B. Johnson) ne fut mis au courant de cette disposition secrète, dont Kennedy cacha également l’existence à ses prédécesseurs (Hoover, Truman et Eisenhower), avec qui il était en contact. Quelques mois plus tard, les missiles turcs étaient retirés, tout comme ceux qui étaient installés en Italie. Restait à convaincre Fidel Castro, remonté au point d’avoir invité les Soviétiques, au cœur de la crise, à lancer une frappe nucléaire sur les États-Unis. Appel dut être fait aux talents diplomatiques de Mikoïan. Le sort à la fois des armes nucléaires tactiques, ignorées des Américains et que Castro voulait garder, et des avions Iliouchine ne fut pas tout de suite décidé. Et l’inspection des navires en route pour l’URSS pour vérifier que les missiles étaient bien à bord n’alla pas sans difficultés.
Kennedy put se présenter comme celui qui avait sauvé les États-Unis d’un terrible péril grâce à sa détermination, et Khrouchtchev se prévaloir d’avoir obtenu que Cuba ne serait jamais attaquée. Un an après, le président américain était assassiné, peut-être pour des raisons liées à sa politique à l’égard de Cuba. En 1964, Khrouchtchev fut limogé par ses collègues du présidium du Soviet suprême, essentiellement pour des motifs ayant trait à sa politique intérieure, mais aussi parce qu’ils lui reprochaient d’avoir lancé le pays dans une aventure téméraire sans parvenir à la conclure à son avantage. « Jamais la Russie ou l’armée soviétique n’ont souffert une telle humiliation », se plaignit à cette occasion le maréchal Rodion Malinovski, maître d’œuvre de l’opération Anadyr. Le véritable gagnant à long terme fut, paradoxalement, Fidel Castro, pourtant persuadé (et furieux) d’avoir tout perdu. Contraint de se passer de missiles pour la défense de Cuba, il se sentait humilié : Kennedy et Khrouchtchev avaient passé un accord dans son dos. Mais, un demi-siècle plus tard, il était toujours le leader d’un des derniers pays communistes du monde.
La crise marqua un tournant important dans la guerre froide. D’un côté, le caractère secret de la clause sur les missiles de Turquie contribua à renforcer, au sein de la classe politique américaine, la conviction qu’il était possible et souhaitable de se montrer offensif à l’égard du bloc communiste – ce sentiment contribua à l’escalade dans la guerre du Viêt Nam. De l’autre, la prise de conscience qu’une communication de qualité entre Washington et Moscou était indispensable conduisit à la création, en 1963, d’une ligne directe (incorrectement baptisée « téléphone rouge ») entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Surtout, l’idée, prévalant dans les milieux militaires, qu’une guerre nucléaire pouvait être gagnée si l’on frappait en premier perdit de sa crédibilité. « Les armements nucléaires créent les dangers qu’ils sont censés prévenir », soutient Martin Sherwin. Sans aller jusqu’à l’affirmer, Américains et Russes engagèrent alors de premiers efforts pour freiner la course aux armements. En 1963, un traité d’interdiction partielle des essais nucléaires était signé à Moscou, qui bannissait notamment les tests dans l’atmosphère. « Verbal, secret, informel, spontané », ainsi que le définit l’auteur d’un livre entièrement consacré au sujet 6, l’accord sur les missiles de Turquie, premier dans l’Histoire à prévoir un démantèlement réciproque, ouvrit la voie à la série de traités visant au contrôle des armements qui furent signés lors des deux décennies suivantes.
Comment le pire a-t-il été évité ? Une réponse traditionnelle, surtout aux États-Unis, consiste à invoquer les qualités de chef d’État de Kennedy, la combinaison de fermeté et de savoir-faire diplomatique dont il a su faire preuve. Mais ces qualités auraient été inopérantes en l’absence d’un interlocuteur de bonne volonté du côté adverse. En dépit de leurs personnalités profondément différentes, de leurs origines sociales opposées et de tout ce qui les séparait sur le plan idéologique, Kennedy et Khrouchtchev avaient quelque chose en commun : ils redoutaient l’un et l’autre une apocalypse nucléaire. Ils « réussirent à éviter la guerre nucléaire, observe Plokhy, après avoir commis toutes les erreurs concevables et accompli tout ce qu’il était possible d’imaginer pour la déclencher. [...] Ils ne tombèrent pas dans le piège qu’ils s’étaient si magistralement tendu à eux-mêmes, parce qu’ils ne croyaient pas pouvoir gagner une guerre nucléaire ». Dans un livre récent, Theodore Voorhees Jr. 7 n’hésite pas à avancer que l’entente des deux leaders sur ce point était si grande que le risque de basculer dans la guerre nucléaire n’a en réalité jamais existé. Mais cette thèse fait fi d’un élément crucial. Ni le président américain, ni son homologue russe ne contrôlaient parfaitement la chaîne de commandement. Des initiatives dangereuses pouvaient être prises à tout moment, à différents niveaux. Si la guerre nucléaire n’a pas éclaté, affirmera donc plus tard Dean Acheson, c’est par « un simple coup de chance », un jugement repris à son compte par Robert McNamara.
C’est notamment ce rôle joué par la chance qui incite l’historien Mark J. White à conclure son livre 8 sur le sujet de la manière suivante : « La principale leçon à tirer de la crise des missiles de Cuba ne concerne pas la gestion de crise – les techniques à employer pour désamorcer de futures tensions [...]. Ce que ces événements démontrent, c’est surtout la nécessité d’éviter à tout prix que de telles crises éclatent. Les leaders des grandes puissances doivent toujours prendre en considération les conséquences des politiques qu’ils mènent, en particulier la façon dont elles influencent celles des autres chefs d’État. Si Kennedy et Khrouchtchev avaient fait cela en 1961 et 1962, il n’y aurait pas d’histoire de la crise des missiles cubains à raconter. »
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008). — Cet article a été écrit pour Books.
Notes
1. Traduit de l’anglais par Madeleine Chapsal (Pluriel, 2018).
2. « One Hell of a Gamble », d’Aleksandr Fursenko et Timothy Naftali, W. W. Norton & Company, 1997 ; One Minute to Midnight, de Michael Dobbs, Vintage, 2009.
3. Gambling with Armageddon: Nuclear Roulette from Hiroshima to the Cuban Missile Crisis (Knopf, 2020).
4. Traduit de l’anglais par René Jouan (Presses de la cité, 1962).
5. The Cuban Missile Crisis in American Memory: Myths Versus Reality (Stanford University Press, 2012).
6. The Other Missiles of October, de Philip Nash (The University of North Carolina Press, 1997).
7. The Silent Guns of Two Octobers: Kennedy and Khrushchev Play the Double Game (The University of Michigan Press, 2020).
8. Missiles in Cuba: Kennedy, Khrushchev, Castro and the 1962 Crisis (Ivan R. Dee, 1997).