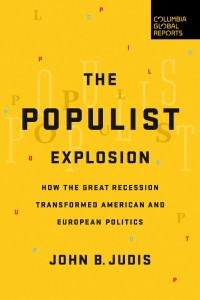Une crise, deux populismes
Publié dans le magazine Books n° 85, septembre / octobre 2017. Par Manuela Latchoumaya.
La grande récession de 2008 a vu l’émergence de mouvements populistes à droite comme à gauche. Ils ont en commun la prétention à incarner le peuple et l’hostilité à l’égard des élites. Mais vient s’ajouter à droite la stigmatisation des étrangers.

Donald Trump en meeting électoral dans le Michigan. La crise de 2008, la stagnation des revenus et une forte progression des inégalités expliquent en grande partie sa victoire.
Le pouvoir d'attraction du populisme
John B. Judis ne cherche pas à révolutionner les études théoriques sur le populisme. Il affiche un objectif plus modeste, mais non moins essentiel : retracer le développement historique du populisme occidental afin de mieux comprendre son pouvoir d’attraction actuel. Reprenant une thèse classique mais non unanimement partagée, l’auteur considère les États-Unis comme le berceau du populisme : « Le populisme est une création américaine, qui s’est ensuite propagée en Amérique latine et en Europe. » (1) Il voit la première manifestation du phénomène dans la création du Parti populiste dans les années 1890. Issu d’un mouvement de révolte de paysans, ce dernier entendait corriger les failles du système capitaliste de « laisser-faire » et formulait des demandes aux antipodes de la politique traditionnelle incarnée par le Parti démocrate et le Parti républicain. Mais, contrairement au multipartisme fréquent en Europe, le système américain a favorisé le bipartisme, ce qui diminuait les chances des nouveaux partis. Les deux partis dominants ont penché inéluctablement vers le centre, favorisant un consensus sur le rôle de l’État dans l’économie. Ce sont les moments de récession économique ou de guerre qui introduisent des phases de réalignement. De nouvelles idées politiques émergent alors dans le débat public et le populisme trouve à s’exprimer. Témoin la campagne de réélection de Franklin D. Roosevelt en 1936. Soumis à la pression de Huey Long, le gouverneur de la Louisiane, dont les idées progressistes étaient saluées par une classe moyenne redoutant de se voir déclassée, Roosevelt dut revoir son discours. Il s’ingénia tout au long de sa campagne à défendre les intérêts de « l’homme moyen » (the average man) contre les « royalistes économiques ». Judis montre que la rhétorique populiste de George Wallace, gouverneur de l’Alabama dans les années 1960, a jeté les bases de ce qui constituerait par la suite la remise en cause par Donald Trump de « l’orthodoxie libérale ». Wallace n’a pas uniquement lutté de façon véhémente contre le mouvement des droits civiques, il a brandi ses prises de position racistes comme une forme de défense de l’Américain moyen contre la « tyrannie des bureaucrates de Washington ». En 1967, le sociologue Donald Warren introduisait le concept de « middle American radicals » et présentait une typologie des sympathisants de Wallace : ce groupe politique n’était identifiable ni par le clivage droite-gauche, ni par la distinction entre libéraux et conservateurs, mais plutôt par un profond sentiment d’être négligé par une classe politique favorisant à la fois les plus aisés et les plus pauvres. Cinquante ans plus tard, les États-Unis allaient connaître la campagne présidentielle la plus marquée de références au populisme de leur histoire. Le terme « populiste » a été utilisé de manière récurrente par les médias à partir de 2014, pour désigner les deux candidats remettant en cause le consensus néolibéral, l’un à droite et l’autre à gauche : Donald Trump et Bernie Sanders. En juillet 2015, la rédaction du Huffington Post à Washington communiquait sa décision de traiter la campagne de Donald Trump dans la rubrique divertissement. Des mois plus tard, ce dernier remportait primaire après primaire. Comment en est-on arrivé là ? Selon Judis, le mécontentement croissant d’une partie de la population dans le sillage de la « Grande Récession », laquelle s’est ajoutée à quarante ans de stagnation des revenus et à une forte progression des inégalités, explique en grande partie ce succès inattendu. La prospérité d’après-guerre avait créé un terreau propice au triomphe du néolibéralisme. La dérégulation financière, l’adoption de politiques budgétaires régressives, la délocalisation d’un grand nombre d’usines et l’augmentation rapide de l’immigration illégale ont alimenté une frustration populaire que Donald Trump a exploitée. Dans son manifeste de 2011, Time to Get Tough, il accusait notamment les grandes entreprises de tirer profit des différents accords commerciaux pour délocaliser leur production et se disait fermement opposé à l’Alena (Accord de libre-échange nord-américain), jugé responsable la suppression de nombreux emplois aux États-Unis. Avant l’avènement du phénomène Trump, l’« explosion populiste » s’était déjà manifestée avec l’apparition de mouvements moins institutionnalisés, comme le Tea Party, constitué en réaction aux dépenses publiques effectuées par l’administration Obama. Fédérant des groupes locaux, le Tea Party rejetait tant les mesures visant à sauver le secteur bancaire après la crise financière que celles qui avaient pour objectif d’instaurer un système national d’assurance-maladie. Ce qui conduit Judis à s’interroger sur le rôle de la présidence de Barack Obama dans la montée des mouvements populistes et le « virage à droite de l’électorat ». Mais la montée d’une forme de populisme à gauche en découlerait également. Le mouvement Occupy Wall Street fut régulièrement qualifié de populiste, car opposant les citoyens ordinaires au « 1 % », à savoir l’élite des Américains les plus riches. « Nous sommes les 99 % », criaient les manifestants. Ils dénonçaient notamment le manque de fermeté d’Obama face aux abus du capitalisme financier et protestaient, comme le Tea Party, contre ses plans de sauvetage des banques. L’auteur soutient que le radicalisme d’Occupy Wall Street est par la suite réapparu sous une forme plus organisée avec la candidature de Bernie Sanders aux primaires démocrates.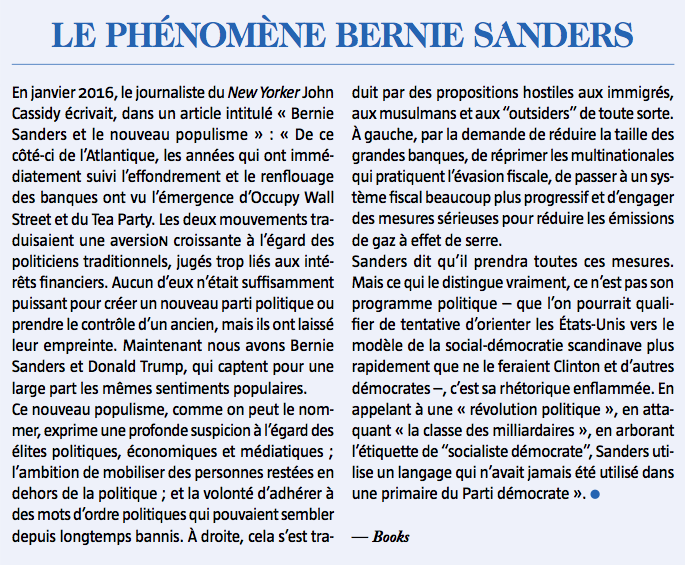
Les populistes peuvent-ils gouverner de façon effective, une fois le pouvoir conquis ?
Concernant l’Europe, Judis engage une analyse fouillée des conséquences du revirement économique qui a suivi les Trente Glorieuses, période de croissance économique durant laquelle tous les grands partis étaient favorables à l’immigration. Marquées par la stagflation, les années 1970 voient la montée du populisme européen, qui s’accompagne d’une remise en cause à la fois de l’État-providence et de l’immigration. C’est le début d’une nouvelle ère. Les restrictions salariales introduites par le Premier ministre travailliste James Callaghan en septembre 1978 au Royaume-Uni et le « tournant de la rigueur » de François Mitterrand en mars 1983 sonnent le glas du consensus keynésien. C’est à cette époque que les partis populistes prennent leur essor, souvent issus de mouvements plus anciens mais hostiles notamment à l’impôt sur le revenu, comme le Parti du progrès au Danemark, créé en 1972. L’influence de ces partis est restée limitée jusqu’au début des années 1990 puis a été dopée par la progression des taux d’immigration, le ralentissement durable de l’économie, le déclin des partis communistes (accéléré par l’effondrement du bloc soviétique), l’élargissement de l’Europe et l’extension de ses pouvoirs bureaucratiques. Après quoi, à la fin des années 2000, la conjonction des attaques terroristes, de la récession et de la crise financière a porté le mouvement à son paroxysme. Le Danemark, l’Autriche, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni, pour ne citer que les pays abordés de façon exhaustive par l’auteur, ont vu leur paysage politique se transformer avec la percée de partis populistes se présentant comme la solution face à la supposée déferlante de l’immigration. Tous se mobilisent contre l’élite dirigeante : aucune de ses composantes n’est ménagée, des partis traditionnels domestiques à la technocratie bruxelloise. Certains, à l’instar du UKIP au Royaume-Uni (fondé en 1993), ont en outre tiré parti de facteurs domestiques : les tensions au sein du Parti conservateur entre une minorité profondément eurosceptique et le Premier ministre David Cameron ont conduit ce dernier à convoquer un référendum sur le maintien du pays au sein de l’Union européenne. Les pays directement touchés par la crise de la dette souveraine ont pour leur part connu un essor du populisme de gauche. Les plans d’aide aux pays en difficulté mis en place par la Troïka en échange de l’adoption de mesures d’austérité ont eu pour conséquence politique l’irruption de partis populistes contestant la légitimité de ces accords et condamnant le manque de fermeté des élites en place. La rhétorique populiste de ces partis a instauré une dichotomie morale entre leurs peuples respectifs et l’Union européenne. En Grèce, le parti Syriza, fondé en 2004 sous la forme d’une coalition, bascule clairement dans le populisme en 2012. Lors de son fameux discours électoral de juin, son dirigeant, Alexis Tsipras, ne mentionne pas moins de 51 fois « le peuple ». En Espagne, le professeur de sciences politiques Pablo Iglesias annonce la création d’un nouveau parti en janvier 2014. S’inspirant de la « vague rose » en Amérique latine, notamment de l’expérience Chávez (2), mais aussi de la pensée postmarxiste d’Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe (3), Podemos se présente comme une force politique capable de capturer l’énergie des Indignés, qui avaient manifesté trois ans auparavant contre les mesures d’austérité de José Luis Rodríguez Zapatero. Dans ces deux pays, la crise de la dette souveraine a pointé des disparités trop souvent ignorées par les États les plus puissants de la zone euro. Longtemps considérée par les dirigeants grecs et espagnols comme une « bénédiction absolue », la participation à la zone euro se trouva soudain mise en cause en profondeur, ce qui généra une véritable crise existentielle, questionnant la viabilité du projet européen. Comme d’autres analystes, Judis invite à réfléchir sur la nature du populisme. Employé sans précaution dans le langage courant, le terme résiste aux tentatives de définition. Il ne désigne pas une catégorie aux caractéristiques claires. Présent à gauche et à droite de l’échiquier politique, le populisme relève plus d’une logique politique que d’une idéologie. Pour tenter de mettre de l’ordre dans cette complexité, l’auteur marque une distinction de nature théorique entre le populisme de gauche et le populisme de droite. Le premier est « dyadique », en ce sens qu’il n’oppose pour l’essentiel que deux catégories, le peuple et l’élite. Le second est « triadique » en ce que l’élite, l’establishment, est de surcroît accusée de défendre un groupe tiers (communément les étrangers, qui ne sont pas « le peuple »). L’auteur aborde trop brièvement la question du populisme au pouvoir. Les populistes n’étant autorisés à exister politiquement que par leur contestation du pouvoir en place, peuvent-ils gouverner de façon effective, une fois le pouvoir conquis ? L’attrait des populistes semble s’évaporer une fois que leur parti cesse d’être un parti de protestation. Lorsqu’en juillet 2015 Alexis Tsipras se résignait à accepter les conditions de la Troïka, il pouvait sembler réduire Syriza à un parti ordinaire ayant approuvé un plan de sauvetage qualifié par l’économiste Paul Krugman de « folie », répétant les actions de ses prédécesseurs du parti conservateur Nouvelle Démocratie puis du parti socialiste Pasok. Quand, le 23 juin 2016, les Britanniques décident de pousser la porte de sortie de l’Union européenne, la raison d’être du Ukip se dissipe : sans une sérieuse redéfinition de ses principes directeurs, le parti de Nigel Farage risquait d’être relégué à un rôle marginal. Mais, dans ses chapitres consacrés à l’Europe, Judis passe sous silence l’expérience populiste en Hongrie. Or, comme l’a fait valoir l’universitaire allemand Jan Werner-Müller dans un essai remarquable, l’installation de Viktor Orbán au pouvoir en 2010 a démontré que les populistes peuvent, non seulement atteindre le pouvoir, mais le conserver – et donc surmonter leur crise d’identité (4). À la fin de son livre, le journaliste américain interroge les liens entre populisme et fascisme. Mais ne vous y trompez pas : si le populisme est parfois considéré comme un danger pour la démocratie, il n’est pas pour autant synonyme de fascisme. En dépit de certaines similitudes – le rôle d’un leader charismatique, la désignation de boucs émissaires -, le populisme opère la plupart du temps dans le cadre de la démocratie représentative, et, contrairement au fascisme, exprime plutôt un repli sur soi qu’une ambition hégémonique. Le populisme a une vertu, soutient Judis : il tire la sonnette d’alarme en mettant l’accent sur des problèmes minimisés par les partis traditionnels. Ses prédictions pour l’avenir sont pessimistes : « Les pressions engendrées par les partis populistes de gauche et de droite vont augmenter et pourraient atteindre le point où différents pays, à l’instar du Royaume-Uni, décideraient de se ruer vers la sortie de l’Union européenne. » En même temps, à mesure que s’éloignent le souvenir de la « Grande Récession » et celui des réfugiés arrivant en masse en Europe, les pressions propices à l’expansion du populisme pourraient s’atténuer. — Manuela Latchoumaya est étudiante à l’Institut d’études politiques de Paris. Cet article lui a valu de recevoir le prix Books/Sciences Po de l’essai critique 2017.Notes
1. Les historiens font souvent remonter le populisme aux narodniki russes du début du XIXe siècle.
2. La « vague rose » en Amérique latine désigne aussi l’accession au pouvoir d’Evo Morales en Bolivie (à partir de 2006) et de Rafael Correa en Équateur (de 2007 à 2017).
3. Chantal Mouffe se réclame d’un populisme « postmarxiste », dans lequel le clivage traditionnel entre droite et gauche est jugé obsolète.
4. Qu’est-ce que le populisme ? (Premier Parallèle, 2016).