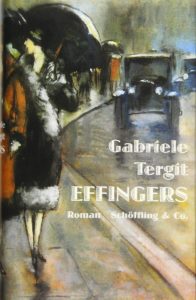C’est l’histoire d’une réédition qui est presque une première parution, tant, en 1951, Effingers s’était heurté à l’indifférence, sinon à la sourde hostilité du public allemand.
Il faut dire que ce roman de près de 900 pages racontait une histoire qu’on n’avait guère envie d’entendre dans l’immédiat après-guerre : il y était question de cette bourgeoisie juive qui avait aimé son pays, l’Allemagne, cru à l’assimilation et fini en exil ou à Auschwitz.
Aujourd’hui,
Effingers est considéré comme une œuvre importante : « Ce grand roman du XXe siècle est extraordinaire à bien des titres. Brillamment documenté mais jamais didactique, il propose un panorama de l’histoire de Berlin entre la fondation du Reich et la destruction de la ville. Ses banquiers et ses chefs d’entreprise, chose rare dans la littérature allemande, ne sont pas des caricatures, mais plutôt des hommes d’affaires honnêtes, qui peuvent se tromper et sont plus ou moins intelligents », résume le journaliste et écrivain Jens Bisky dans le quotidien
...