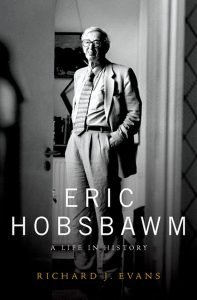Au moment de son décès, en 2012, à l’âge de 95 ans, Eric Hobsbawm travaillait à un nouveau recueil d’articles. Il était alors l’historien le plus célèbre du monde et l’est sans doute resté. Traduites dans plusieurs dizaines de langues, sa trilogie sur l’histoire du XIX
e siècle et son histoire du XX
e siècle sont des classiques
1. Dans l’hommage posthume qu’il lui a rendu, l’historien britannique Niall Ferguson, pourtant d’un tout autre bord politique, présente ces quatre ouvrages comme « la meilleure introduction à l’histoire du monde moderne en langue anglaise ». Des expressions qu’il a forgées ou contribué à populariser, telles que « la crise générale du XVII
e siècle », « la double révolution du XIX
e siècle » (politique en France, industrielle en Angleterre), « le long XIX
e siècle » et « le court XX
e siècle », ou « l’invention de la tradition », sont entrées dans le langage des historiens.
D’un autre côté, Hobsbawm était et demeure une des figures intellectuelles contemporaines les plus controversées. Comme plusieurs autres grands historiens britanniques de sa génération, notamment Christopher Hill et E. P. Thompson, il était membre du Parti communiste de Grande-Bretagne. Mais, contrairement à eux, il n’a jamais renié son engagement. Après la répression de l’insurrection de Budapest par les troupes soviétiques en 1956, il s’éloigna du Parti, mais il ne cessa d’y appartenir qu’à sa dissolution, en 1991. Et jamais il ne renonça explicitement à ses convictions. Lors de deux entretiens radiophoniques accordés à la BBC après l’effondrement du bloc soviétique, il alla jusqu’à déclarer que, dans l’hypothèse où l’utopie communiste d’un monde meilleur se serait réalisée, le sacrifice de millions de vies commis en son nom serait rétrospectivement justifié.
À de nombreuses reprises, Hobsbawm a été interrogé sur les raisons de son obstination à défendre le rêve communiste. Invariablement, avec une lassitude non dissimulée, il donnait les mêmes réponses : refus de renier les idéaux de sa jeunesse, fidélité envers le souvenir de ses amis et camarades, horreur à la perspective d’être assimilé au groupe des communistes repentis. Il lui est arrivé d’avancer une explication supplémentaire : la volonté de prouver qu’il pouvait rencontrer le succès tout en étant notoirement communiste. Cet aveu est notamment formulé dans ses Mémoires, que le critique Stefan Collini décrivait dans le quotidien
The Independent comme « un curieux hybride, une autobiographie impersonnelle »
2.
Personnel, l’ouvrage ne l’est en effet véritablement que dans les cent premières pages. En termes émouvants, il y raconte son enfance à Vienne, où ses parents, tous deux juifs – lui britannique, elle autrichienne – s’étaient installés après avoir quitté Alexandrie, où son père avait un emploi et où lui-même est né. Puis son adolescence. À Berlin, tout d’abord, chez la tante et l’oncle qui l’avaient recueilli avec sa sœur après la mort, en l’espace de deux ans, de leur père et de leur mère – à laquelle il était fortement attaché. C’est là qu’il découvrit et embrassa immédiatement le communisme. Ensuite à Londres, où sa famille d’adoption déménagea en 1933, tant en raison de mésaventures financières que pour fuir le nazisme.
Avec son entrée à l’université de Cambridge, le récit change de teneur et de ton. À la première personne du singulier se substitue souvent celle du pluriel. Les aspects les plus intimes sont évacués en quelques phrases générales (« Je ne peux pas dire que la première partie des années 1950 fut une période heureuse sur le plan personnel »). Et tout le reste de l’ouvrage consiste en réflexions – brillantes comme tout ce qui sort de sa plume mais d’une tonalité assez détachée – sur sa trajectoire politique, ses travaux, ses voyages et les personnalités qu’il a rencontrées.
Pour qui cherchait à comprendre le lien entre la vie d’Eric Hobsbawm, ses idées, son œuvre et sa personnalité, il y avait là une difficulté. On peut aujourd’hui la surmonter grâce à l’épaisse biographie que vient de lui consacrer Richard Evans. Pour la rédiger, il a pu s’appuyer sur les riches archives personnelles de l’historien, notamment sa correspondance et le journal qu’il a tenu (en allemand) dans sa jeunesse, ainsi que sur les dossiers établis à son sujet par le service de renseignement intérieur britannique, le MI5 – transcriptions d’écoutes téléphoniques et rapports de surveillance. Contrairement aux célèbres
Cinq de Cambridge, Hobsbawm ne s’est jamais livré à des actes d’espionnage au profit de l’Union soviétique, raison pour laquelle le choix fait par
John le Carré de donner son nom à un personnage de son roman
Un pur espion l’a fortement contrarié
3. Mais, parce qu’il était communiste, et peut-être aussi du fait qu’il avait vécu en Autriche et en Allemagne, le MI5 le considérait comme une personne suspecte à garder à l’œil.
Paradoxalement, ces documents montrent à quel point Hobsbawm était peu intégré au parti communiste : l’appareil n’avait guère confiance en lui, et à plusieurs reprises, il s’est opposé aux thèses officielles. Comme le relève Evans, « d’un côté, il était très profondément attaché à l’idée d’appartenir au mouvement communiste, mais, de l’autre, il refusait absolument de se soumettre à la discipline qu’exigeait le Parti. » Un des aspects de sa personnalité qui ressortent le plus clairement du livre est, de fait, son irrésistible propension à demeurer en lisière des groupes dont il faisait partie.
Toute sa vie, peut-être en raison du décès prématuré de ses parents, il a éprouvé un puissant besoin d’appartenance. Dans son adolescence, le scoutisme l’a aidé à l’assouvir. Mais sa féroce indépendance d’esprit, sa réticence à abdiquer son sens critique et son caractère individualiste lui interdisaient de s’abandonner à la fusion dans une collectivité et l’incitaient à toujours garder ses distances. Cette remarque s’applique à d’autres groupes auxquels il s’était joint, comme, lorsqu’il était à Cambridge, le petit club des Apôtres, cercle de discussion qui rassemblait les esprits les plus brillants de l’université (Keynes en avait fait partie), ou le monde intellectuel, littéraire et politique britannique, dont, après son second mariage, il invitait régulièrement des représentants à dîner chez lui. Il n’était de même qu’à moitié intégré à la communauté des amateurs de jazz, un genre musical qu’il affectionnait et sur lequel il a beaucoup écrit, dans un premier temps sous le pseudonyme de Francis Newton : des pages perspicaces au sujet de Duke Ellington, par exemple, ou un beau texte d’hommage à Billie Holiday dans lequel il célébrait « sa voix granuleuse, envoûtante ».
À juste titre, Eric Hobsbawm a été décrit comme « un homme d’institutions » attaché à l’ordre et sensible à la reconnaissance et aux honneurs. Il a toujours regretté de n’avoir pu obtenir une chaire à Oxford ou à Cambridge, vraisemblablement en raison de ses opinions politiques affichées. Jusqu’à sa retraite, il a enseigné au Birkbeck College de l’université de Londres, un établissement ne prodiguant que des cours du soir, ce qui lui laissait la journée entièrement libre pour lire et écrire. En même temps, il avait le tempérament d’un outsider. Ses deux livres les plus originaux sont ceux qu’il a consacrés aux rebelles paysans et aux bandits révolutionnaires, un sujet qui lui permettait de s’intéresser à des héros marginaux et oubliés tout en créant une nouvelle branche de la recherche historique, ce dont il tirait une grande fierté
4.
Bien qu’historien lui-même, Evans n’évoque qu’en passant le contenu des livres d’Hobsbawm, pour s’intéresser essentiellement à leur réception et aux conditions matérielles de leur publication : les contrats avec les éditeurs, les tirages, les droits d’auteur, les traductions et éditions étrangères – il a vendu des centaines de milliers d’exemplaires au Brésil et en Inde (de fait, Hobsbawm vivait en partie de sa plume). Il rappelle à ce sujet les difficultés rencontrées pour faire publier une édition française de
The Age of Extremes : le refus de Pierre Nora de le faire paraître chez Gallimard et les hésitations de Fayard, à un moment où les travaux de François Furet venaient de jeter l’opprobre sur le communisme.
Richard Evans se concentre surtout sur « l’expérience personnelle et la vie intérieure » de l’historien, dont il donne une image riche, complexe et nuancée. Dans un carnet de jeunesse, avec lucidité mais aussi l’apitoiement sur soi-même qu’on peut avoir à cet âge, Hobsbawm se décrit comme « un intellectuel de bout en bout », avec tous les inconvénients que cela implique. Passant de longues heures enfermé dans son bureau, noyé dans un océan de livres ouverts et de papiers, peu intéressé par les aspects pratiques de la vie domestique, il avait tout pour mériter une telle étiquette.
On découvre toutefois bien d’autres facettes de sa personnalité : son goût prononcé pour la littérature de fiction et la poésie, qu’il dévorait dans toutes les langues (outre l’anglais et l’allemand, ce polyglotte lisait et parlait le français, l’italien et l’espagnol) ; son amour de la beauté et de la nature, qui lui fit entreprendre de longues excursions à bicyclette dans la campagne anglaise ou dans les collines du pays de Galles ; son goût des voyages et cette curiosité pour les hommes qui frappait tous ses amis lorsqu’ils le surprenaient en train d’interroger un paysan.
Evans met aussi en lumière à quel point Hobsbawm a souffert de son physique ingrat (« Laid comme le péché, disait de lui son cousin, mais un cerveau »), qui le desservait dans ses rapports avec les femmes – du moins le pensait-il. « Un homme si vilain, s’étonnait sa sœur, comment se fait-il que toutes les femmes soient attirées par lui ? » C’est que seul son visage était disgracieux. Son corps mince et sportif respirait la santé. Il rayonnait d’intelligence et, surtout, s’intéressait aux femmes et savait les écouter. Sa vie amoureuse n’en fut pas moins très tourmentée jusqu’à l’âge de 45 ans : un premier mariage sous le signe de la camaraderie idéologique plus que de l’amour, un douloureux divorce qui le plongera dans la dépression, deux liaisons avec des femmes mariées et une troisième, qu’il savait sans avenir, avec une prostituée occasionnelle dont il avait fait la connaissance dans le milieu du jazz. Seule les réunissait la passion qu’ils partageaient. Cette période chaotique prendra fin avec la rencontre de celle qui allait être sa seconde femme, Marlene Schwartz, une jeune et belle Autrichienne, intelligente et cultivée. Ce mariage lui procurera, en même temps que l’assurance d’un soutien indéfectible, la stabilité affective qu’il cherchait. Il lui donnera deux enfants, dont il s’occupera avec beaucoup de bonne volonté, en père parfois peu présent mais attentionné.
Eric Hobsbawm n’est pas le seul intellectuel communiste à avoir été formé par la littérature. Ainsi qu’il le rappelle dans ses Mémoires, c’était aussi le cas de ses collègues du Groupe des historiens du Parti communiste Christopher Hill et Edward Palmer Thompson, ainsi que du critique Raymond Williams. Une autre influence importante fut l’école des Annales, du nom de la revue créée par Marc Bloch et Lucien Febvre, puis dirigée par Fernand Braudel.
Past & Present, la revue qu’Hobsbawm et ses amis lancèrent en 1952, avait l’ambition d’en être une sorte d’équivalent en langue anglaise, fondée sur la même idée : l’incorporation, dans la réflexion historique, de l’apport des sciences sociales.
Bien sûr, il y eut aussi la lecture des écrits de Karl Marx, qu’Hobsbawm commentait en professionnel, de manière pénétrante et originale : même des spécialistes de la pensée marxiste, a-t-on dit, apprennent quelque chose en lisant ses réflexions rassemblées dans le recueil de textes qu’il a consacrés à Marx et l’histoire
5. Les théories de Marx ont fourni à Hobsbawm un cadre d’interprétation général pour l’étude du XIX
e et du XX
e siècle. Jusqu’à quel point ont-elles influencé ses analyses ? « Tout au long de sa carrière, juge Evans, il a été tiraillé entre d’un côté son engagement communiste et, plus généralement, marxiste, et de l’autre son respect des faits, de ce que disent les documents, ainsi que des conclusions des travaux d’autres historiens dont il reconnaissait la valeur. À certains endroits de sa trilogie, le premier aspect l’emporte, mais dans l’ensemble, c’est le second qui prévaut. »
De ce point de vue, c’est son ouvrage le plus célèbre et celui qui s’est le mieux vendu,
L’Âge des extrêmes, qui a fait l’objet des plus vives critiques. Rien d’étonnant à cela. De son propre aveu, Hobsbawm s’était, durant la plus grande partie de sa carrière, délibérément abstenu d’écrire sur la période récente. Une fois le communisme disparu de la scène mondiale, il s’est senti libre d’en traiter. Il avait de surcroît évolué. Sans être réellement devenu un social-démocrate, il s’était politiquement rapproché du Parti travailliste britannique, à la réforme duquel on dit même souvent qu’il a donné une caution intellectuelle. Contre la faction radicale emmenée par Tony Benn, il appuyait en effet l’idée, défendue par Neil Kinnock, d’une large alliance des progressistes associant ouvriers et classes moyennes. Cela lui valut d’être baptisé par la presse « le gourou de Kinnock », une appellation qu’il trouvait absurde. Proche de Gordon Brown, mais déçu par le tournant libéral du New Labour, il traitera Tony Blair de « Thatcher en pantalon ».
Dans son analyse du XX
e siècle, il ne pouvait cependant pas empêcher que se reflètent ses anciennes (et en partie toujours actuelles) convictions. On a ainsi reproché à
L’Âge des extrêmes la place disproportionnée faite à l’Union soviétique, son indulgence à l’égard du stalinisme, sa discrétion au sujet du Goulag et de la dissidence en Europe de l’Est. Certains ont pointé du doigt les traces d’un certain antiaméricanisme (qu’on ne peut nier) ou le peu de pages consacrées à la Shoah (sujet qu’il se sentait apparemment trop juif pour traiter en historien et trop peu juif pour évoquer à titre personnel).
De manière générale, Hobsbawm a souvent été accusé de concentrer son attention sur l’Europe, de minimiser l’importance du nationalisme et de la révolution féministe ou, en matière culturelle, de sous-estimer la portée des mouvements modernistes. Ces accusations ne sont qu’en partie fondées. Avec Ernest Gellner et Benedict Anderson, Hobsbawm est l’un des historiens qui se sont le plus intéressés au nationalisme. Il n’éprouvait toutefois, il est vrai, aucune sympathie à l’égard de ce dernier et tendait à considérer qu’il avait aujourd’hui perdu son caractère de force historique – une thèse que l’on peut défendre. D’abondantes pages de
L’Ère des empires et de
L’Âge des extrêmes sont par ailleurs consacrées à l’évolution de la condition des femmes. Et ses opinions pour le moins tranchées en matière d’art et de musique (son constat de la faillite des avant-gardes ou sa condamnation du rock’n’roll
, par exemple) montrent à quel point Hobsbawm, qui se définissait comme « un tory communiste », était un homme de tempérament conservateur.
Peu impressionné par la révolution des mœurs des années 1960, il déplorait les effets néfastes du libertarisme, du consumérisme et de l’individualisme. S’il voyait l’avenir sans beaucoup d’optimisme, c’est en raison de la croissance des inégalités, mais aussi de la destruction, sous l’effet de l’extraordinaire dynamisme de l’économie de marché, de cet horizon « de normes claires, de perspectives et de valeurs communes » qui structuraient autrefois l’existence, et de l’érosion du rôle longtemps joué par les institutions de la sphère publique : « la politique, les partis, la presse, les organisations, les assemblées représentatives, les États ».
« Les historiens, estimait Hobsbawm, ne devraient pas écrire uniquement pour les autres historiens ». À l’instar de ses confrères A. J. P. Taylor ou G. M. Trevelyan, il s’adressait donc à la fois au grand public et au monde savant. Contrairement à beaucoup d’historiens, il n’était pas un explorateur d’archives. Ses livres s’appuient sur l’exploitation de ce qu’on appelle dans le jargon les « sources secondaires ». Mais, sous l’apparence de simples synthèses historiques, ils proposent des interprétations nouvelles, puissantes et cohérentes. « Entreprise de reconstitution sans équivalent de la manière dont s’est construit le monde contemporain », sa tétralogie sur les XIXe et XX
e siècles, souligne l’historien Perry Anderson dans la
London Review of Books, combine un ensemble stupéfiant de qualités : « sens de la synthèse ; minutie du détail ; perspective mondiale mais sens aigu des différences régionales ; curiosité tous azimuts ; égale aisance sur tous les sujets : récoltes et marchés boursiers, nations et classes sociales, hommes d’État et paysans, sciences et arts […] ; puissance analytique du récit ; et […] un style énergique d’une remarquable clarté illuminé par les éclairs d’images brillantes, sur le fond lisse d’une argumentation froide et caustique ».
Une des grandes forces d’Hobsbawm était en effet l’étendue et la sûreté de ses connaissances dans une grande variété de domaines, même très techniques. De la théorie de l’innovation de Schumpeter aux principes esthétiques de l’Art nouveau en passant par le rôle du rythme dans le jazz et les gammes musicales qu’il utilise, c’est toujours en parfaite connaissance de cause qu’il s’exprime. Les chapitres consacrés à la science, notamment dans les trois
Ères et dans
L’Âge des extrêmes, témoignent d’une maîtrise impressionnante des concepts employés dans un vaste éventail de disciplines.
Son autre point fort était la vigueur et l’élégance de son style. Le travail des historiens, affirmait Eric Hobsbawm, est condamné à l’obsolescence. Seuls survivent les ouvrages qui se distinguent sur le plan littéraire, comme ceux d’Edward Gibbon, de Jules Michelet ou de Thomas Macaulay. Des noms à côté desquels il hésitait à placer le sien, ajoutant malgré tout : « L’avenir décidera. »
Tony Judt (parfois très critique à son égard) évoquait dans
The New York Review of Books l’existence, dans le monde anglophone, d’une « génération Hobsbawm », tous ces hommes et ces femmes qui avaient commencé leur carrière d’historien entre 1959 et 1975 et « dont l’intérêt pour le passé récent a irrévocablement été marqué par ses écrits, même s’ils ne partagent plus ses conclusions ». Indépendante de son statut d’intellectuel marxiste, fruit de ses remarquables qualités d’historien et d’écrivain, l’influence d’Hobsbawm a de sérieuses chances de s’avérer durable. On peut penser avec Richard Evans que ses livres seront lus et débattus longtemps encore.
Très conscient de sa supériorité intellectuelle et de son immense talent, Hobsbawm était trop orgueilleux pour se laisser aller à cette forme de mesquinerie et de vanité puérile qui sont monnaie courante chez les universitaires. Il pouvait être cassant et dogmatique mais traitait ses contradicteurs avec respect et courtoisie. Sous des apparences de froideur, c’était un homme émotif et sensible.
À la lecture de sa biographie par Richard Evans, note l’historienne canadienne Susan Pedersen dans la
London Review of Books, « j’en suis venue à réellement apprécier Eric Hobsbawm ». Pour son sens de la décence, sa fidélité en amitié, sa curiosité constamment en éveil, la dignité dont il a fait preuve face aux misères physiques du très grand âge et sa générosité : un professeur qui l’a côtoyé au Birkbeck College se souvient qu’il passait le voir dans son bureau et le questionnait sur ses travaux : « Il cherchait souvent à montrer qu’il en savait plus que vous sur le sujet, mais on était toujours ragaillardi après sa visite. »
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié
Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).
— Cet article a été écrit pour
Books.
Notes
1. L’Ère des révolutions : 1789-1848 ; L’Ère du capital : 1848-1875 ; L’Ère des empires : 1875-1914 (disponible en poche chez Pluriel) ; L’Âge des extrêmes : histoire du court XXesiècle (André Versaille, 2008).
2. Franc-tireur. Autobiographie (Ramsay, 2005).
3. La thèse très plausible d’Evans est que Le Carré, qui affirmait ne pas se souvenir des raisons l’ayant poussé à imaginer ce nom, a dû l’apercevoir dans un dossier à l’époque où il travaillait au MI5, le service de renseignement intérieur britannique. Hobsbawm lui demanda courtoisement de le modifier, ce qu’il ne fit jamais.
4. Rébellions. La résistance des gens ordinaires. Jazz, paysans et prolétaires (Aden, 2011) ; Les Bandits (La Découverte, 2018).
5. Marx et l’histoire (Fayard, « Pluriel », 2010).