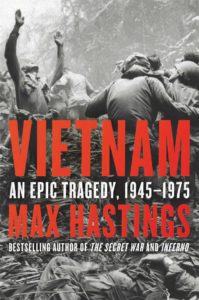La guerre du Vietnam n’était pas inéluctable
Publié dans le magazine Books n° 96, avril 2019. Par Michel André.
« Combien de temps comptez-vous combattre ici ? demandait en 1966 le Premier ministre nord-vietnamien Pham Van Dông à un journaliste américain. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans ? » Retour sur un carnage inutile.

1962. Deux soldats sud-vietnamiens embourbés dans le delta du Mékong.
La découverte d’un pays dont ils ignoraient tout fut un choc
Les 2 700 000 soldats américains présents au Vietnam à un moment ou à un autre n’étaient pas tous des conscrits : une bonne partie d’entre eux étaient des volontaires. Beaucoup venaient de milieux pauvres et ils étaient généralement très jeunes : la moyenne d’âge était de 19 ans. Tous n’étaient d’ailleurs pas affectés dans une unité combattante. Beaucoup n’ont jamais été au feu : leur guerre s’est déroulée dans un campement doté d’un incontestable confort, autour duquel se développaient rapidement marché noir et prostitution. Pour la plupart de ces très jeunes gens, la découverte d’un pays dont ils ignoraient tout fut un choc. Plus encore la réalité des combats dans une nature hostile : « Tout ce qui avait rapport avec la guerre était dur – les véhicules, les armes, les obus, les avions, les gilets pare-balles, les rations en conserve [...], la volonté de l’ennemi – à l’exception de la chair humaine et de la plus grande partie du sol sous les pieds. » Hastings évoque l’horreur de la progression dans les rizières où l’on pataugeait durant des heures, dans la jungle infestée de moustiques et de sangsues, avec la hantise de se prendre les pieds dans un piège ou de marcher sur une mine et de perdre une jambe, constamment sous l’œil d’ennemis invisibles qui disparaissaient à peine aperçus. En l’absence d’un véritable front, donc de lignes susceptibles de reculer, la seule manière de mesurer le succès des actions engagées était le macabre body count, le décompte des ennemis tués. Au fil des ans, le moral des troupes américaines déclina, pour finir par tomber très bas. La consommation et le trafic de drogues augmentèrent. La discipline s’effondra. Les manifestations de racisme entre soldats blancs et noirs se multiplièrent, dans les deux sens. Des hommes de troupe s’en prirent physiquement à leurs officiers. Historien militaire, Hastings est plus familier des armes et des équipements que beaucoup de ses prédécesseurs. Comme ceux de la plupart des armées révolutionnaires du monde, les combattants du Viêt-cong étaient équipés du célèbre fusil d’assaut soviétique AK-47, une kalachnikov rustique et imprécise. Face à eux, les GI’s avaient un nouveau type de fusil automatique, le M-16, plus élaboré mais qui avait à peine été testé et se révéla vite poser problème : l’arme avait tendance à s’enrayer et, en milieu tropical, à se corroder. Bien que certains de ses défauts aient été corrigés, « le fait fondamental demeure, écrit Hastings, que si le M-16 était beaucoup plus perfectionné que la kalachnikov, il n’était pas aussi robuste. [...] À bien des égards, l’histoire du M-16 et de la kalachnikov peut être considérée comme emblématique des obstacles militaires auxquels se sont heurtés les États-Unis au Sud-Vietnam ».Plus de 1 million de tonnes de bombes larguées en vain sur le Nord-Vietnam
Max Hastings évoque les fameux hélicoptères d’assaut Bell UH-1 Iroquois, surnommés « Huey », avec lesquels les images d’actualité et les films de fiction sur le Vietnam nous ont familiarisés : « Même les hommes qui détestaient la guerre aimaient les Huey. La brise fraîche qui passait sur eux lorsqu’ils étaient assis à la porte les pieds posés sur les patins, parfois un bras imprudemment enroulé autour du montant, observant les paysages de l’Asie du Sud-Est de la meilleure manière possible – tous ces rouges, ces bruns, ces verts brillants aperçus de plusieurs centaines de mètres d’altitude ». La rapidité d’intervention de ces engins, qui permettaient de transporter les blessés sur la table d’opération en quelques minutes, a eu pour conséquence de réduire considérablement le nombre de morts dans les rangs américains, mais de multiplier celui des jeunes soldats gravement mutilés, condamnés à une vie d’infirme. Le livre emmène aussi ses lecteurs dans l’habitacle d’un B-52. Dans le cadre des opérations Rolling Thunder et Linebacker, ces bombardiers « stratoforteresses » ont largué en vain plus de 1 million de tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam. Tremblant à l’idée de voir son énorme appareil abattu par la défense antiaérienne, un missile ou un chasseur MiG nord-vietnamien, l’équipage ne songeait guère à ce qu’il infligeait aux populations invisibles plusieurs milliers de mètres plus bas. Hastings rapporte également des témoignages de combattants du Viêt-cong et de civils victimes d’attaques ou de bombardements, dans les deux camps. Il a même rencontré d’anciens conseillers soviétiques de l’armée nord-vietnamienne. Bien que venant d’une société loin d’être prospère, fait-il observer, les Russes étaient choqués par la pauvreté du Nord-Vietnam et contrariés par l’absence de viande dans le régime alimentaire local. Certains apprirent à manger du serpent. « Les Vietnamiens, aimaient-ils dire, mangent tout ce qui rampe excepté les chars d’assaut, tout ce qui nage sauf les porte-avions, tout ce qui vole hormis les B-52. » Comment les États-Unis se sont-ils laissé entraîner dans cette aventure ? Après d’autres, Hastings souligne le rôle joué par « les meilleurs et les plus intelligents » 1, l’équipe de responsables de haut calibre intellectuel qui entouraient les présidents John Kennedy, puis Lyndon Johnson : McNamara, mais aussi le secrétaire d’État Dean Rusk, le conseiller à la sécurité nationale et ancien doyen de Harvard McGeorge Bundy, le diplomate Averell Harriman et d’autres. Doués, rapides, travailleurs, ambitieux, ils étaient terriblement sûrs d’eux, arrogants et très éloignés des réalités politiques. Après sa première réunion avec eux, Johnson fit part de son enthousiasme à celui qui avait été son mentor en politique, l’ancien président de la Chambre des représentants Sam Rayburn. « Eh bien, Lyndon, répondit celui-ci, il se peut que tu aies raison et qu’ils soient tous aussi intelligents que tu le dis. Mais je serais beaucoup plus rassuré si seulement l’un d’entre eux avait été un jour candidat à un poste de shérif. »
« Nous nous ferons un plaisir de vous héberger. »
Tout cela se passait au beau milieu de la Guerre froide. Selon la « théorie des dominos », qui faisait autorité, l’objectif de l’URSS et de la Chine était de faire tomber un par un tous leurs pays voisins dans l’orbite communiste. En réalité, bien qu’elles aient alimenté le Nord-Vietnam en armes, munitions et techniciens, ni l’URSS ni la Chine n’avaient de visées sur la péninsule indochinoise. Mais, à Washington, on était persuadé du contraire. Les responsables politiques et militaires américains ont aussi considérablement sous-estimé le nationalisme et l’anticolonialisme du Front national de libération du Sud-Vietnam (FNL). Certes, au Nord, Hô Chi Minh et ses collaborateurs étaient des communistes, et de l’espèce la plus doctrinaire. Mais, dans un pays où s’était forgé un fort patriotisme au cours de siècles de lutte contre la Chine, le combat contre la France, puis les États-Unis, était animé par un puissant sentiment de fierté nationale. S’obstinant à soutenir le régime impopulaire de Ngô Dinh Diêm puis, après son assassinat à la suite d’un coup d’État, celui, corrompu, de Nguyên Van Thiêu et de son Premier ministre Nguyên Cao Ky, les Américains n’ont pas pris la mesure de la sympathie de la population du Sud à l’égard des insurgés. Ils ont beaucoup sous-évalué la qualité des troupes auxquelles ils faisaient face, sans parler de la détermination inflexible des Nord-Vietnamiens. « Combien de temps, vous, les Américains, comptez-vous combattre [au Vietnam] ? demandait, en 1966, le Premier ministre nord-vietnamien Pham Van Dông au journaliste du New York Times Harrison Salisbury. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans ? Nous nous ferons un plaisir de vous héberger. » À Washington, les considérations de politique intérieure pesaient très lourd. Kennedy, Johnson et Nixon étaient tous trois obsédés par leur réélection. Traumatisés par l’opprobre jeté sur Truman pour avoir « perdu la Chine » en laissant s’y installer un régime communiste, Johnson et Nixon ne voulaient à aucun prix entrer dans l’histoire marqués par le stigmate d’avoir perdu une guerre. Ces considérations expliquent à la fois certaines décisions et les atermoiements qui les ont précédées. « L’envie de Johnson de se montrer fort et déterminé au Vietnam, remarque Hastings, se heurtait à ses propres incertitudes : ses craintes au sujet de son programme de “Grande Société” ; la peur de provoquer une intervention militaire de la Russie ou de la Chine ; son souci de conserver le soutien des alliés des États-Unis à une action militaire ; sa volonté de protéger à la fois les intérêts de sa base politique à l’intérieur et l’image du pays à l’extérieur. » Au bout du compte, il finit par écouter ses conseillers les plus belliqueux : ce fut l’escalade. Au début de 1968, les troupes du Viêt-cong et l’armée nord-vietnamienne lançaient une campagne militaire de grande ampleur. Baptisée « offensive du Têt », d’après le nom du nouvel an lunaire avec lequel son début a coïncidé, l’opération fut un échec : l’attaque fut repoussée et les assaillants subirent de lourdes pertes. Mais, en démontrant la capacité des rebelles et de leurs alliés du Nord à mener des actions d’envergure et le peu de contrôle exercé sur le territoire du pays par l’armée sud-vietnamienne et les troupes américaines, cet épisode marqua un tournant décisif dans le conflit. Plusieurs conseillers de Johnson, dont le très respecté Dean Acheson, plaidèrent en faveur d’un désengagement. Au mois de mars, préoccupé par l’impopularité grandissante et les coûts croissants de la guerre, Johnson ordonnait la suspension des bombardements sur le Nord-Vietnam. Découragé, inquiet pour sa santé – il craignait une nouvelle crise cardiaque –, perturbé par l’annonce de la candidature de Robert Kennedy à la présidence, il renonçait à se présenter à l’investiture du Parti démocrate.Le retrait américain
Avec l’arrivée de Richard Nixon à la Maison-Blanche, au début de 1969, s’amorça le processus de « vietnamisation » du conflit (un euphémisme pour « retrait américain »). La guerre allait toutefois durer sept ans de plus, tout aussi meurtrière. L’histoire retiendra à l’encontre de Nixon et Kissinger, écrit Hastings, qu’ils ont « présidé à des années de carnage inutile, dans le seul but de dissimuler à l’électorat américain, à des fins partisanes, le caractère inéluctable de l’humiliation [des États-Unis] en Indochine ». Très rapidement, des pourparlers s’engagèrent à Paris entre Kissinger et le diplomate nord-vietnamien Lê Duc Tho. Interrompus par l’opération Linebacker, une campagne de bombardements menée dans l’illusion de faire plier les Nord-Vietnamiens, ils débouchèrent en 1973 sur un accord de cessez-le-feu prévoyant le retrait complet des troupes terrestres américaines. Deux ans plus tard, en 1975, l’armée du Nord-Vietnam envahissait Saigon. Le général Westmoreland, le commandant en chef des forces américaines au Vietnam auquel est associé le nom de la stratégie de search and destroy, a notoirement dit de la guerre du Vietnam qu’elle était la première guerre de l’histoire perdue dans les colonnes du New York Times. Il exagérait. Mais il est certain que des photos comme celle de la petite Kim Phúc brûlée par le napalm ou celle, tout aussi célèbre, de l’exécution à bout portant d’un soldat du Viêt-cong par le futur général sud-vietnamien Nguyên Ngoc Loan ont énormément contribué à marquer l’intervention américaine du signe de l’horreur. « Hanoï, fait observer Hastings, ne diffusa jamais de photos de cadres exécutant des opposants locaux en les enterrant vivants, ou de combattants du Viêt-cong fauchés au cours d’assauts ratés. » Et en matière de propagande, « le contraste visuel entre la guerre mise en œuvre par une superpuissance, à l’aide d’une technologie diabolique symbolisée par les B-52, et celle que menaient des paysans coiffés de chapeaux chinois […] se déplaçant en sandales et à bicyclette conférait un avantage écrasant aux communistes ». Prudent lorsqu’il s’agit d’apprécier les effets sanitaires des campagnes de défoliation chimique à l’aide du fameux « agent orange », souvent exagérés, affirme-t-il, Hastings n’excuse pas des massacres comme celui que commit un détachement de marines à My Lai ou celui, moins connu, de Thanh Phong – il y en eut bien d’autres –, ni les méthodes brutales et expéditives utilisées pour la mise en œuvre du programme de contre-insurrection Phoenix de la CIA. Mais il connaît assez les réalités de la guerre pour ne pas surestimer la capacité des états-majors et des décideurs politiques à empêcher de telles atrocités : « C’est une illusion répandue que, sous leur tenue de combat, les jeunes Occidentaux qui se battent à l’étranger demeurent les bons garçons qu’ils sont chez eux. Certains le restent, d’autres non […]. Il n’est pas aisé de contrôler avec précision le comportement de jeunes hommes en possession d’armes létales qui – comme tous les soldats à toutes les époques – souffrent de la chaleur et du froid, de la saleté, de la faim, de diarrhée et de constipation, de la soif, de la fatigue […] leurs nerfs tendus et leur fusil armé en permanence, parce que c’est le seul moyen d’espérer survivre. » Dans certains livres sur la guerre du Vietnam, les États-Unis portent tout le blâme. Pour Hastings, « seuls des nigauds de gauche ou de droite osent suggérer qu’un des deux camps possédait le monopole de la vertu ». Mieux que d’autres historiens, il met en lumière les actes de barbarie commis par les soldats du Viêt-cong – exécutions de masse, tortures, meurtres par les moyens les plus spectaculaires et cruels – ainsi que l’extraordinaire dureté des dirigeants militaires et politiques nord-vietnamiens. Alors qu’on s’approchait de la fin de la guerre, Lê Duan, par exemple, inamovible premier secrétaire du parti communiste du Nord-Vietnam, « envisageait avec indifférence la perspective de voir périr plusieurs dizaines de milliers d’hommes de son propre peuple à un moment où le retrait américain était déjà garanti ». Au regard de la cause pour laquelle ils luttaient, « la vie ou la mort de cent, mille, dix mille êtres humains, même de compatriotes, importe peu », affirmait dans le même esprit le légendaire général Giap, infatigable combattant de toutes les guerres d’Indochine. Lorsque le journaliste canadien Morley Safer lui demanda si cela ne le gênait pas d’envoyer tant de jeunes hommes au combat, Giap se contenta en guise de réponse « d’un geste de la main devant le visage, comme pour chasser un moucheron importun ». Quarante-trois ans se sont écoulés depuis le moment où le dernier hélicoptère a décollé du toit de l’ambassade des États-Unis à Saigon. L’évacuation a pris la forme d’une peu glorieuse débâcle, les Américains abandonnant à leur sort des milliers de leurs anciens collaborateurs sud-vietnamiens. Réunifié, appauvri, le pays a peu à peu retrouvé le chemin de la prospérité. Tout en demeurant un État communiste, suivant en cela l’exemple de son ennemi séculaire, la Chine, il a développé une forme d’économie de marché. Aujourd’hui, constate Max Hastings, « le nom d’Hô Chi Minh-Ville donné à Saigon perd en popularité et va probablement disparaître à la manière dont Léningrad est redevenu Saint-Pétersbourg. Les scintillantes vitrines des magasins de la capitale, temples de la consommation, brillent de noms de marques de bijoux et de vêtements. On peut non sans raison affirmer que la guerre que les États-Unis ont perdue il y a un demi-siècle sur le terrain militaire, ils l’ont à présent gagnée sur les plans économique et culturel. »La guerre du Vietnam a été une tragédie
Deux à trois millions de Vietnamiens, selon les estimations, surtout des civils, et 58 000 Américains ont péri dans cette guerre. Celle-ci a coûté aux États-Unis 150 milliards de dollars, l’équivalent de plus de 1 000 milliards aujourd’hui, et a eu pour effet de ruiner leur prestige international, de saper pour longtemps la crédibilité de la classe politique du pays et d’instaurer parmi beaucoup de ceux qui en sont revenus un puissant sentiment de culpabilité. Aux yeux de certains « faucons », les États-Unis auraient pu remporter militairement la victoire s’ils avaient moins hésité et frappé vite et fort. La plupart des historiens sont presque certains du contraire. Mais était-il fatal que l’Amérique s’engage dans ce conflit ? On spécule sur ce qui se serait passé si Kennedy n’avait pas été assassiné à Dallas. C’était un anticommuniste résolu, et il a présidé à une augmentation considérable du nombre de conseillers militaires américains auprès de l’armée sud-vietnamienne. Mais aurait-il laissé le pays se faire happer dans l’engrenage ? Un sérieux doute est permis à ce sujet, estime l’historien Fredrik Logevall dans un texte repris dans l’ouvrage de Geoffrey C. Ward et Ken Burns qui accompagne leur récente série documentaire sur la guerre du Vietnam 2. Kennedy était plus expérimenté que Johnson en matière de politique internationale. Contrairement à lui, il avait une expérience personnelle de la guerre et savait ce qu’un conflit armé a d’imprévisible et de peu maîtrisable. Sur le plan personnel, il était à la fois plus sceptique, plus enclin à la prudence et plus sûr de lui : il aurait moins vu la guerre comme un test de sa virilité et de ses capacités de commandant en chef. Comme le souligne le titre du livre de Hastings, la guerre du Vietnam a été une tragédie. Mais ce mot ne doit pas être entendu avec sa connotation de fatalité. À chaque moment, d’autres choix que ceux qui ont contribué à amplifier et prolonger le conflit étaient possibles, des deux côtés. S’ils n’ont pas été faits, c’est en raison d’erreurs d’appréciation, par aveuglement idéologique, manque de courage politique ou calcul opportuniste. — Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquième Parallèle. Petit essai sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008). — Cet article a été écrit pour Books.Notes
1. Voir On les disait les meilleurs et les plus intelligents, de David Halberstam (Robert Laffont, 1974).
2. The Vietnam War (Penguin, 2017).
Pour aller plus loin
♦ La Guerre du Viêt Nam, de John Prados (Perrin, 2015).
♦ Indochine et Vietnam. Trente-cinq années de guerre : 1940-1975, de Dennis Wainstock et Robert L. Miller (Nouveau Monde Éditions, 2017).