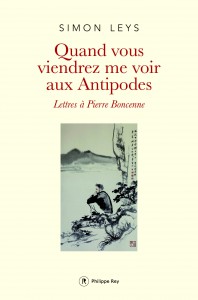« Étranger, mais francophone, chaque fois que je passe en France, je me sens chez moi. C’est seulement quand il est question de Malraux que l’évidence me frappe : décidément, je ne suis pas de la paroisse. » L’auteur de ces lignes, Simon Leys (nom de plume de Pierre Ryckmans), décédé au mois d’août 2014, était né en Belgique. Après quelques années à Taïwan, Singapour et Hongkong, il a vécu toute sa vie en Australie. Il écrivait en français et en anglais. Sinologue, spécialiste de la peinture chinoise, il est surtout célèbre pour avoir exposé et dénoncé, au début des années 1970, le caractère impitoyablement totalitaire du régime de Mao Zedong.
Leys était aussi un excellent connaisseur des littératures d’expression française et anglaise : dans les collections d’essais (1) qu’il a publiés en plus de ses livres sur la culture chinoise et la Chine contemporaine (2), on trouve des pages d’une grande sagacité sur George Orwell, G. K. Chesterton, Evelyn Waugh, D. H. Lawrence, Joseph Conrad ainsi que des figures de la littérature francophone comme Balzac, Hugo, Gide, Simenon, Michaux, Victor Segalen ou le prince de Ligne. En lisant l’ouvrage posthume
Quand vous viendrez me voir aux antipodes, sélection d’extraits de lettres adressées par Leys, épistolier prolifique et brillant, à son ami Pierre Boncenne, on découvre que les littératures espagnole, latino-américaine et russe lui étaient également familières. L’ouvrage met aussi en lumière, à côté de son singulier rapport amoureux avec la langue française, le regard original et critique que sa position excentrée dans le monde francophone et à l’intersection plusieurs cultures l’a conduit à jeter sur la France et la littérature de ce pays.
Tout en reconnaissant qu’André Malraux avait à l’évidence du génie (« Mais le génie de quoi, exactement ? On ne sait pas trop », ajoutait-il aussitôt), Leys s’étonnait de l’incapacité du public français à entériner le jugement de ces critiques étrangers qui « de Koestler à Nabokov [ont] passé un bon demi-siècle à traiter Malraux de
phoney – de charlatan ». Une autre figure emblématique de la littérature française du XXe siècle dont la réputation le laissait perplexe était André Gide. « Plus je lis du Gide et sur Gide, confiait-il à Pierre Boncenne, moins j’y vois clair », avouant qu’il se demandait « sur quoi reposait [son] crédit (qui fut colossal) ». Au moment où il s’exprimait de la sorte, Leys était occupé à rédiger un long texte sur Gide, recension d’une biographie en anglais qui a fini par prendre la forme d’un abécédaire. On y trouve sur la vie et la personnalité de l’auteur des
Faux-monnayeurs, son œuvre et ses rapports avec son entourage une série d’observations extrêmement bien documentées, quelquefois admiratives, le plus souvent sévères, parfois franchement cruelles, mais toujours saisissantes d’intelligence.
De manière générale, Simon Leys déplorait la propension des Français à aduler leurs écrivains illustres (3) : « Ils les prennent pour guides, ils les consultent sur tous les problèmes, et quand ces oracles se trompent – ce qui leur arrive souvent – on leur accorde cette immunité dont normalement seuls jouissent les petits enfants et les simples d’esprit. » C’est à propos de Sartre qu’il faisait cette réflexion, à ses yeux un homme au génie éclatant qu’on continuera à lire « comme on lit Céline », mais en même temps un « vieil adolescent irresponsable et hurluberlu ».
La même remarque s’appliquait dans son esprit à tous ces intellectuels français qui, des membres du groupe Tel Quel à Roland Barthes, se sont aveuglés au sujet de la Chine de Mao, avec cette même remarquable obstination à ne pas voir l’évidence dont leurs aînés avaient déjà fait preuve au sujet de l’URSS de Staline. Dans le pays « qui a produit Rabelais et Hugo, Montaigne et Pascal, Stendhal et Baudelaire » n’hésitera-t-il pas à écrire à ce propos, « certains intellectuels ont […] battu un record mondial de stupidité ».
Au moment de leur parution, les ouvrages de Leys sur la Chine communiste ont de fait été ignorés ou fortement critiqués par l’intelligentsia française. Seuls René Étiemble, Claude Roy et quelques rares commentateurs les ont défendus. Parmi ceux qui en ont fait l’éloge figurait Jean-François Revel, avec qui Leys nouera une amitié durable et dont il salue dans ses lettres l’« intelligence puissante et juste [et] le salubre sens du comique », ne lui reprochant qu’un peu trop d’indulgence à l’égard de la société américaine, de placer Zola au-dessus de Balzac et, dans son livre
Sur Proust, de contester la thèse de ce dernier selon laquelle « le moi-qui-dîne-en-ville et le moi-qui-écrit sont différents ».
Leys stigmatisait aussi volontiers l’horizon intellectuel limité des Français. « En France, se plaignait-il dans son éblouissant petit livre sur Orwell, [celui-ci] demeure sinon inconnu, du moins largement incompris. Est-ce seulement un effet de l’incurable provincialisme culturel de ce pays ? » Dans un article sur Henri Michaux, il cite à ce propos une réflexion faite par Borges au sujet du poète d’origine belge : « Un écrivain né dans un grand pays court le risque de présupposer que la culture de sa patrie lui suffit. Paradoxalement, c’est lui qui tend ainsi à être provincial. » Dans une interview donnée au
Figaro, il s’exprimera lui-même en ce sens : « Si vous vivez à Paris, vous êtes tenté de croire que vous habitez au centre du monde, votre attention, votre information, vos préoccupations et curiosités risquent de devenir provinciales. Si, au contraire, vous vivez dans une province reculée, en Australie, disons […], la conscience aiguë de votre marginalité stimule votre désir de rester au courant de tout ce qui se passe, se dit, se publie partout ailleurs. »
La curiosité ne suffit toutefois pas. La compréhension d’autres cultures requiert un effort d’attention. Victor Segalen, note Leys dans l’un des textes qu’il lui a consacrés, pourtant grand voyageur et inventeur de l’exotisme (4), est resté fermé à la réalité chinoise : « Mélomane [il] demeura sourd à la musique chinoise ; poète, il ignora la poésie chinoise ; esthète, il ne regarda pas la peinture chinoise ; vivant en Chine à un moment particulièrement dramatique de son histoire, il ne comprit rien aux événements qui se déroulaient sous ses yeux. »
La combinaison du « regard éloigné » de Leys et de sa connaissance intime de la littérature française lui permet de formuler sur les écrivains du pays des observations très pertinentes. Deux des plus grands d’entre eux, fait-il ainsi remarquer, échappent complètement au moule français classique. Le premier est Balzac, prodigieux créateur de personnages, aussi inventif que Shakespeare et Dickens, mais qui écrivait dans une langue baroque et sauvage souvent entachée de clichés et pleine d’images saugrenues. Le second est Victor Hugo : « Le plus fameux de tous les écrivains français est aussi celui qui offense le plus agressivement le goût français. Le génie de ce pays vise essentiellement à la mesure, à la clarté et à la perfection. Or Hugo est excessif, brumeux et déséquilibré. Dans une tradition qui prise par-dessus tout l’ordre, l’harmonie et le sens des proportions, Hugo est venu planter la tente bariolée de son musée ambulant des horreurs : un cirque de cauchemar […] sur une toile de fond d’égouts, de ruines gothiques, de nuits de tempête, d’incendies, de raz-de-marée et de naufrages. »
Sa familiarité avec le monde anglo-saxon aide par ailleurs souvent Leys à identifier par contraste les particularités de l’histoire et de la culture françaises. Parce qu’il était marin amateur et un grand amoureux de la mer, il a entrepris de composer une anthologie de textes littéraires qui se voulait l’équivalent en français de l’
Oxford Book of the Sea. Dans l’introduction, il attire l’attention sur le fait suivant : « À la différence de l’Angleterre, dont la langue et la civilisation sont intimement liées à la mer (pour des raisons géographiques et historiques bien évidentes), la France, dont les entreprises maritimes ne furent pourtant guère moins considérables, n’a pas vraiment réussi à en intégrer la mémoire dans sa culture. C’est que la France des marins fut avant tout une France provinciale – celle des Flamands, des Normands, des Bretons, des Gascons, des Basques et des Provençaux. » La mer, s’empressait-il toutefois d’ajouter, n’a cependant jamais cessé d’inspirer des écrivains français.
Enfin il y a la langue. À plusieurs endroits de sa correspondance, Simon Leys exprime son émerveillement pour la langue française et son admiration pour ceux qui savent en user avec un art immense, comme Jacques Chardonne : « Vis-à-vis de Chardonne mes sentiments sont partagés : ses vues politiques me sont antipathiques, il a des opinions médiocres, parfois odieuses. Mais son jugement littéraire est superbe de justesse et de justice. C’est un incomparable critique […]. Et sa langue est une merveille. » En ouvrant par hasard un de ses livres, écrit-il, « j’ai fait la découverte bouleversante de la beauté de la prose française : clarté, concision, naturel. » Chardonne lui apparaît faire partie de ces écrivains qui sont indéfectiblement liés à une seule langue et une seule culture, comme l’était aussi François Mauriac : « Chaque fois que je relis Mauriac […] je suis frappé de deux choses : 1) le caractère étroitement et provincialement français de sa culture (il connaît merveilleusement ses auteurs : de la façon la plus intime, la plus vivante, mais ses auteurs sont exclusivement français) […] 2) La prodigieuse musique de sa langue : il a une manière magique de manier le français. […] J’ai l’impression qu’il doit y avoir un lien entre ces deux traits. » Pour la langue anglaise, un équivalent serait le poète Philip Larkin, qui déclarait sans ambages que, pour lui, les langues étrangères ne comptaient pas. Dans un texte très fouillé sur la traduction littéraire, une activité qu’il a abondamment pratiquée (5), Leys oppose à cette catégorie d’écrivains un groupe rassemblant des auteurs « que les langues étrangères inspirent, stimulent et fascinent », bilingues (Samuel Beckett, Julien Green) ou qui ont fait le choix de s’exprimer dans un autre idiome que leur langue maternelle : Conrad, Cioran, Nabokov ou Michaux, qui a été éduqué en flamand et élevé dans un environnement où l’on parlait le dialecte wallon. (6)
Simon Leys était lui-même parfaitement bilingue. « Leys est peut-être unique en ce que sa prose en anglais n’est pas moins étincelante qu’en français », écrivait Ian Buruma dans sa recension de la compilation d’essais de Leys en langue anglaise
The Hall of Uselessness. S’il se plaint dans plusieurs de ses lettres de l’envahissement de sa prose par des belgicismes et des anglicismes, la vérité est en effet qu’il écrivait un français d’une grande pureté et d’une constante élégance. Jean-François Revel a justement souligné son « rare talent d’écrivain » et François Bott son « français impeccable ». Le talent littéraire de Simon Leys éclate dans
Les Naufragés du Batavia, récit du naufrage, au XVIIe siècle, d’un navire de commerce hollandais sur un archipel situé au large de l’Australie, et de la façon dont les survivants tombèrent sous la coupe d’un membre de l’équipage psychopathe et sanguinaire. Durant des années, Leys avait accumulé de la documentation et des notes sur cette histoire. Pris de court par la publication du livre de Mike Dash sur le sujet, tout en invitant vivement ses lecteurs à lire cet ouvrage, il tint à proposer malgré tout sa propre version des terribles événements. Quatre fois plus court que celui, très détaillé, de l’historien anglais, son récit est saisissant de puissance dramatique et de précision, du fait notamment de sa parfaite maîtrise du vocabulaire de la mer.
La perfection classique du français de Simon Leys fait aussi le charme de ses essais politiques, ainsi qu’en témoigne ce portrait de Zhou Enlai, qu’on pourrait croire tiré, n’était le sujet, des Mémoires de Saint-Simon ou des souvenirs d’Alexis de Tocqueville : « Seul parmi les dirigeants maoïstes, Zhou Enlai avait une élégance d’Ancien Régime, du charme, de l’esprit et du style. Il fut certainement l’un des plus brillants comédiens de notre siècle. Il avait un talent pour proférer des mensonges énormes avec une angélique suavité. Eût-il jamais été dans la pénible obligation de vous planter un poignard dans le dos, il se serait acquitté de cette tâche avec tant de gentillesse que vous vous seriez encore senti obligé de l’en remercier. […] Son activité publique n’était encore qu’une sinécure par comparaison avec l’activité secrète – bien plus intense, absorbante et décisive – qu’il poursuivait de façon ininterrompue dans les coulisses ténébreuses de la politique intérieure du Parti. […] Il s’agissait constamment d’éliminer des rivaux dans l’impitoyable lutte pour le pouvoir, d’éviter des embûches, de désamorcer des conspirations meurtrières ourdies contre lui par de vieux camarades. »
Les réflexions sur la France et la langue française qui émaillent les livres de Simon Leys ne forment qu’un des fils conducteurs possibles pour leur lecture. Un autre thème récurrent sous sa plume est le rôle fondamental joué en art, dans la vie et en politique par l’imagination. Il est bien mis en évidence par Pierre Boncenne dans son essai biographique
Le Parapluie de Simon Leys. Françoise Sagan a un jour affirmé qu’à ses yeux la vertu cardinale était l’imagination. Voilà une déclaration que Leys aurait pu reprendre à son compte. Ce qui permet aux grands artistes et écrivains de créer, fait-il remarquer en conclusion de son essai sur Balzac, ce n’est pas l’intelligence, ni même la sensibilité (« bien des gens peuvent “ressentir” les choses avec une extrême acuité sans être pour autant capables de les exprimer »), c’est l’imagination. Bien avant Léonard de Vinci, les peintres chinois savaient que leur art était « cosa mentale ». Et l’imagination est à la base de la lucidité en politique. George Orwell n’avait peut-être pas le talent nécessaire pour inventer des personnages de roman psychologique. Mais son « imagination sociologique » lui a permis d’extrapoler à partir d’éléments fragmentaires « la réalité massive, complète, cohérente et véridique » du totalitarisme soviétique que beaucoup d’Occidentaux ne voyaient pas, « faute d’imagination ». À de nombreuses reprises, Leys rappellera à cet égard que pour écrire ses essais sur la Chine maoïste, il n’avait pas disposé de plus d’informations que les autres observateurs et commentateurs des affaires chinoises, et ne s’était appuyé que sur ce que la presse internationale et celle du régime rapportaient de son fonctionnement.
Une autre idée au cœur des livres de Simon Leys a été bien identifiée par Ian Buruma. C’est que « l’art, l’éthique et ce qui concerne la spiritualité, y compris la foi religieuse, proviennent d’une même place centrale ». Leys avait une profonde foi catholique dont il est impossible de faire abstraction. Beaucoup parmi les écrivains auxquels il fait constamment référence (Pascal, Chesterton, Waugh, Graham Greene, C. S Lewis, Bernanos, Hilaire Belloc, Simone Weil) étaient catholiques, voire des ecclésiastiques comme saint Augustin ou le cardinal Newman. Un de ses auteurs de chevet était toutefois Emil Cioran, non-croyant habité par l’angoisse métaphysique, et jamais il n’a cessé de témoigner d’un intérêt prononcé pour la spiritualité asiatique. Par-delà la foi dont il avait hérité et par l’intermédiaire de laquelle elle se présentait à lui, l’objet de sa constante réflexion était donc en vérité la dimension spirituelle de l’existence.
À côté de cela, Simon Leys était un écrivain très drôle maniant l’ironie et le sarcasme avec brio, et un esprit original qui abordait volontiers l’histoire littéraire sous un angle insolite et de manière oblique, en traitant de sujets comme les rapports des écrivains avec l’argent, les ouvertures (incipit) des grands romans, ou ces « blancs » dans le récit qui en disent plus long que des pages entières : transitions brutales qui laissent libre champ à l’imagination comme celle qui contraint le lecteur, dans
Le Rouge et le Noir, à reconstituer mentalement ce qui s’est passé dans la chambre de Mme de Rénal après que Julien Sorel s’y fut introduit, ou ce brusque changement de vitesse dont Proust disait qu’il était « la chose la plus belle de
L’Éducation sentimentale », qui fait passer du ponctuel « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal » à l’évocation panoramique d’années entières de vie (« Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, etc. »).
Dans son récent
Dictionnaire amoureux de la Belgique, Jean-Baptiste Baronian affirme à propos du petit livre de Leys
Les Idées des autres, un florilège de citations, qu’il pourrait bien être paradoxalement son ouvrage le plus personnel. Il y a du vrai dans cette affirmation, cette collection tirant aux dires même de l’auteur son unité interne « de la personnalité et des goûts du compilateur lui-même, dont [elle] présente une sorte de miroir ». Mais le superlatif est de trop. Davantage encore que dans cet ouvrage, c’est dans sa correspondance avec Pierre Boncenne que Simon Leys se révèle de la façon la plus complète, dans la cohérence de ses idées, ses convictions, ses goûts, ses passions et son caractère. Ceux qui le connaissaient déjà l’y retrouveront avec enchantement. Ceux qui ignoraient son existence le découvriront avec surprise et ravissement, et on comprend aisément pourquoi : Simon Leys ne se sentait peut-être pas appartenir à la paroisse de France, mais il peut sans conteste être compté au nombre des plus brillants esprits et fins stylistes qui se sont exprimés en français.
Cet article a été rédigé pour
Books.
Notes
1. L’Ange et le Cachalot (Seuil, 1998), Protée et autres essais (Gallimard, 2001), Le Bonheur des petits poissons (Jean-Claude Lattès, 2008), Le Studio de l’inutilité (Flammarion, 2012).
2. Les Habits neuf du président Mao, Ombres chinoises, Images brisées, La Forêt en feu, L’Humeur, l’honneur, l’horreur, réunis en un volume dans la collection Bouquins (Robert Laffont, 1998).
3. Pas seulement les écrivains. Dans l’unique œuvre de fiction de Simon Leys, un facétieux conte philosophique intitulé La Mort de Napoléon, l’Empereur, qui s’est échappé de l’île de Sainte-Hélène après y avoir laissé un sosie à sa place, regagne la France dans l’espoir de reconquérir le pouvoir. Ne parvenant pas à se faire reconnaître, il meurt dans l’anonymat. Constatant le peu d’écho suscité par ce livre en France par rapport au monde anglo-saxon, Leys conclut que « beaucoup de Français considèrent encore Napoléon comme un sujet tabou ».
4. C’est le nom du personnage éponyme du roman de Segalen René Leys, un homme d’origine belge établi en Chine, qui inspira à Pierre Ryckmans son pseudonyme.
5. On lui doit notamment des versions française et anglaise des Entretiens de Confucius et la traduction en français du récit maritime autobiographique de l’américain Richard Henry Dana Two Years Before the Mast (Deux années sur le gaillard d’avant).
6. Un cas similaire est celui du Belge Luc Sante, dont la famille a émigré aux États-Unis lorsqu’il était enfant et qui écrit aujourd’hui en anglais. Simon Leys a rendu compte de son livre de souvenirs The Factory of Facts dans un article (non traduit) de la New York Review of Books.