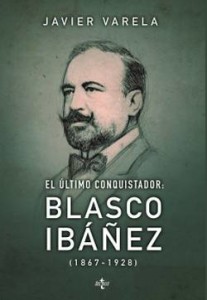Le meilleur roman de Vicente Blasco Ibáñez, a-t-on souvent dit, fut sa vie. Très populaire dans son pays, il fut aussi de son vivant l’auteur espagnol le plus vendu dans le monde après Cervantes. Il fut également agitateur politique, directeur de journal, correspondant de guerre, éditeur, conférencier itinérant et un grand voyageur qui se voulait un aventurier : en 1910, en pleine force de l’âge, il entreprit de créer deux colonies agricoles en Argentine ; quelques années avant son décès, à l’âge de 61 ans, il se lançait dans un vaste tour du monde. Fondateur d’un mouvement politique qui portait son nom (le blasquisme), élu six fois député de sa ville de Valence, emprisonné à plusieurs reprises pour la diffusion d’idées séditieuses, impliqué dans plusieurs duels, il fut aussi une célébrité et une figure de la vie mondaine, et le seul homme de lettres espagnol de son époque que ses livres, adaptés pour certains au cinéma, aient enrichi ; il s’habillait chez les plus prestigieux tailleurs et roulait en Cadillac.
Au cours des décennies qui suivirent sa mort, son souvenir s’estompa, notamment en raison de l’aversion du régime franquiste, qui trouvait ses écrits immoraux et subversifs. Dans les années 1970, ses livres recommencèrent à se vendre. En 1998, à l’initiative des autorités de Valence, où son culte ne s’était jamais éteint, un colloque international à son sujet était organisé. Longtemps, on n’a disposé comme source d’informations sur sa vie agitée que des témoignages de personnes qui l’avaient connu, comme Emilio Gascó Contell, J. L. León Roca ou sa belle-fille Pilar Tortosa. Deux biographies sont parues récemment : celle, très synthétique, de Ramiro Reig (1) et celle, monumentale, de Javier Varela (2).
Né en 1867 de parents d’origine aragonaise, petits commerçants à Valence, Vicente Blasco Ibáñez a eu une jeunesse agitée et rebelle, marquée par un fort esprit d’indépendance. Renonçant à faire carrière dans la marine par manque de goût pour les mathématiques, il entreprit des études de droit tout en lisant avec voracité. Deux figures déterminèrent sa double vocation politique et littéraire : l’homme d’État libéral Francisco Pi y Margall et Victor Hugo. Rapidement, Blasco développa des idées républicaines et anticléricales. Orateur de grand talent, doté d’une formidable présence physique, il exerçait sur les foules un pouvoir magnétique bien décrit par l’écrivain Max Aub, qui l’a connu dans sa jeunesse : « C’était un dieu, vous m’entendez ? Un dieu, et il en avait l’apparence : grand, fort, quasi herculéen, les cheveux bouclés, un peu gros, peut-être… Et une voix ! Quelle voix ! »
En peu de temps, Blasco Ibáñez devint l’âme d’un mouvement politique régional. Fédéraliste sans être régionaliste (bien que maîtrisant le valencien, Blasco n’a jamais souhaité promouvoir cette langue ni se rapprocher des mouvements catalanistes), défendant des thèses proches à certains égards de celles du Parti radical en France, le blasquisme était une variété républicaine de populisme, appuyé sur la petite bourgeoisie et les classes populaires. Sa forte présence à Valence, où, à l’exception des années de dictature de Primo de Rivera (1923-1930), il est resté au pouvoir sans interruption jusqu’à la guerre civile (1936-1939), réduisit considérablement dans cette ville l’influence du Parti socialiste et du mouvement anarchiste (3).
Pour propager ses idées, Blasco Ibáñez créa un quotidien,
El Pueblo, qu’il dirigeait, animait et rédigeait lui-même en grande partie. Dans l’intention d’aider la population à s’informer, s’éduquer et se cultiver, il mit sur pied une maison d’édition qui publiait des classiques de la littérature (Walter Scott, Tolstoï, Schiller, Cervantes, Hugo, Zola) et de la pensée politique (Proudhon, Kropotkine). Au catalogue figuraient deux gros ouvrages que Blasco avait lui-même traduits :
Histoire de la Révolution française, de Michelet, et
Nouvelle géographie universelle, d’Élisée Reclus.
Durant cette époque, Blasco Ibáñez a produit à un rythme soutenu ceux de ses livres qu’on considère unanimement comme ses meilleurs, ses « romans valenciens » :
Arroz y tartana (« Riz et tartane »),
Flor de mayo (Fleur de mai),
La barraca (Terres maudites, sans doute son chef-d’œuvre),
Entre naranjos (Dans les orangers) et
Cañas y barro (Boue et roseaux). Bâtis sur des intrigues simples et solides, rédigés dans une langue vigoureuse et colorée faisant largement appel au style indirect libre, notamment dans le souci de réduire au minimum l’usage du valencien, ces romans, avec un mélange d’empathie et de crudité qui n’est pas sans faire penser à Maupassant, racontent la vie des petits commerçants de Valence, le combat pour la subsistance des pêcheurs du littoral, les luttes des cultivateurs de riz avec les grands propriétaires terriens. Écrits frénétiquement, souvent la nuit après le bouclage du
Pueblo du lendemain, presque toujours publiés d’abord en feuilleton dans le journal, ces livres portent les traces des circonstances de grande tension dans lesquelles ils furent composés. Peu de temps après, Blasco fera paraître une série de romans dits « sociaux », dont l’action se déroule dans d’autres milieux et régions d’Espagne qui lui étaient moins familiers : leur réalisme et leur force en sont moindres.
En 1909, Blasco Ibáñez fut invité à faire en Argentine une tournée de conférences qu’il consacra à une série de grands noms de l’histoire littéraire et artistique espagnole (Cervantes, Calderón, Quevedo, Velázquez, Goya) et française (Balzac, Hugo, Zola). Il conçut à cette occasion le projet de fonder dans cette partie du monde une colonie de peuplement pour les agriculteurs valenciens. Avec l’appui des autorités argentines, qui lui concédèrent des terres, deux colonies de ce type virent le jour : l’une appelée Colonie Cervantes, établie sur les bords du Río Negro, dans une région de Patagonie glaciale en hiver, l’autre baptisée Nouvelle Valence, tout au nord, à la frontière de l’Uruguay et du Paraguay, en pleine zone tropicale. Avec ce mélange de témérité et d’ostentation qui caractérisait tout ce qu’il entreprenait – des photos le montrent paradant au milieu d’Indiens à demi nus ou en poncho, un fusil à la main –, Blasco déploya des efforts énormes pour concrétiser ce qui ne demeura qu’un rêve très vite fracassé. Au bout de quatre ans, mesurant les sacrifices qu’allait exiger la transformation de ce songe en une entreprise rentable et refusant la perspective de devoir renoncer pour toujours à la littérature, ruiné et endetté, il revint en Europe pour se remettre à écrire.
Homme d’action, Blasco Ibáñez exsudait une prodigieuse énergie vitale. Impétueux, passionné et sensuel, il aimait la musique, plus particulièrement celle de Wagner et de Beethoven, les paysages et les odeurs de Valence, les jardins, surtout d’orangers, et les femmes. « À la différence des grands amants romantiques, souligne J. L. León Roca dans le petit livre qu’il a consacré à sa vie sentimentale (4), Blasco Ibáñez goûtait les aventures amoureuses mais ne s’engageait pas. […] Le risque de la chasse l’excitait, comme l’émotion de voir s’écrouler une forteresse qui lui opposait de la résistance. Mais, quand les filets de l’amour menaçaient de l’emprisonner dans les bras d’une femme, il abandonnait le terrain. » En d’autres termes, il se comportait, selon Roca, comme « notre classique Don Juan ».
Blasco s’est marié à l’âge de 25 ans avec une Valencienne qui lui a donné quatre enfants, dont un fils mort en pleine jeunesse. Ses activités politiques et littéraires lui laissaient peu de disponibilité pour la vie familiale mais ne l’empêchaient pas de saisir les occasions d’aventures qui se présentaient. Toutes ont été éphémères, à quelques exceptions près, dont la plus fameuse fut sa longue liaison avec Elena Ortúzar, femme d’un riche homme d’affaires chilien et le grand amour de sa vie. Il l’avait rencontrée à Madrid, et elle l’accompagna lors de plusieurs de ses séjours à l’étranger, notamment à Paris et à l’occasion de ce voyage en Turquie dont il allait ramener le récit
Oriente. Fervente catholique, elle ne consentit jamais à divorcer. Mais, après le décès de son mari et la mort de la femme de Blasco, elle l’épousa.
«Blonde, opulente, orgueilleuse, observe Javier Varela, [Elena Ortúzar] paraît incarner l’idéal type des femmes que Blasco Ibáñez a décrit dans presque tous ses romans » : des Walkyries, de la variété rustique ou cultivée, imposantes et tentatrices, inspirant à la fois fascination, désir et crainte. La passion de l’écrivain pour Elena Ortúzar lui a inspiré trois romans (
La femme nue de Goya,
Arènes sanglantes et
Les morts commandent), quatre si l’on compte
La voluntad de vivir, que son auteur, pris de remords, fit retirer de la vente à peine imprimé et qui ne parut qu’après sa mort.
Arènes sanglantes raconte l’amour tragique d’un jeune et brillant torero pour une riche et séduisante aristocrate, qui le mènera à sa perte. Contrairement à beaucoup d’écrivains espagnols, Blasco n’éprouvait pas beaucoup d’attirance pour la corrida. Mais il connaissait très bien le milieu de la tauromachie, dont le roman met en lumière de façon réaliste les aspects les moins reluisants : la cruauté du spectacle, la grossièreté et la versatilité du public, la vénalité et la soif de notoriété des protagonistes.
Une question souvent posée est celle de l’appartenance de Blasco Ibáñez à la « génération de 98 », ce groupe d’écrivains espagnols du tournant du XXe siècle comprenant notamment le philosophe Miguel de Unamuno, les romanciers Ramón del Valle-Inclán et Pío Baroja, l’essayiste Azorín et le poète Antonio Machado. En raison de sa date de naissance, Blasco Ibáñez est parfois rattaché à ce groupe, avec lequel il n’avait en réalité rien en commun. Bien plus proche par ses intérêts et ses choix artistiques des grands romanciers réalistes du milieu du XIXe siècle comme Benito Pérez Galdós et Clarín, Blasco, par sa passion de l’action et son goût du luxe, son caractère instinctif et exubérant, son féroce appétit de la vie et sa propension à la vantardise, se distinguait radicalement de ces hommes au tempérament plutôt méditatif et angoissé, traumatisés par la perte des colonies de Cuba et des Philippines, préoccupés par l’identité et l’avenir de leur pays et soucieux d’expérimenter de nouvelles formes d’expression. Même lorsqu’ils venaient comme lui de province, tous ces écrivains participaient de surcroît assidûment à cette viesociale, littéraire et intellectuelle madrilène à laquelle, considérant qu’il y avait mieux à faire que « passer son existence dans les cafés et ne connaître la vie que par l’intermédiaire des livres et des conversations », il ne s’est jamais vraiment intégré.
En dépit de tout ce qui le séparait d’eux, Blasco Ibáñez parvint à maintenir des relations courtoises, cordiales et assez amicales avec Unamuno et Azorín. Il ne cessa par contre de faire l’objet d’une hostilité déclarée de la part de deux autres représentants du groupe : Baroja, qui l’accusa d’avoir plagié un de ses romans et le traitait de « Tartarin valencien » vulgaire, et Valle-Inclán, qui, interrogé à la mort de Blasco, présenta l’annonce de celle-ci comme un « coup de publicité », puis prétendit contre toute évidence n’avoir jamais rien lu de lui. Toute sa vie, l’écrivain valencien dut subir des attaques de ce genre, auxquelles, avec magnanimité, il ne répondit jamais. On lui reprochait son style relâché, l’atmosphère « levantine » de ses récits, la grossièreté de ses sujets. Derrière les considérations morales et artistiques, ces critiques étaient sans doute en grande partie motivées par la jalousie qu’éveillait le succès commercial de ses livres.
Sa réputation auprès de ses pairs ne s’améliora guère avec le temps. Aux yeux des deux figures les plus célèbres de la « génération de 14 », José Ortega y Gasset (5) et Ramón Pérez de Ayala, Blasco était « un républicain romantique à l’esthétique dépassée : un homme du XIXe siècle », écrit Javier Varela. Quant aux écrivains proches du franquisme, ils n’eurent pas de mots assez durs à son égard. Eugenio d’Ors l’accusait d’« imposture littéraire » et d’avoir contribué à diffuser une grille de valeurs contestable. Gonzalo Torrente Ballester, qui lui reconnaissait pour seule vertu son « extraordinaire vitalité », stigmatisait son « immense vulgarité » et la façon dont ses romans exhalaient « une odeur de sexe et de sueur avec des relents de paella valencienne ».
Dans une lettre envoyée à Julio Cejador, un érudit et critique littéraire par ailleurs prêtre – texte d’anthologie extrêmement révélateur –, Blasco Ibáñez livre son credo artistique. « Je m’enorgueillis d’être un écrivain le moins littéraire possible. Je suis un homme qui vit et qui, de surcroît, écrit des livres. » Cela dans le prolongement de la « tradition espagnole noble et virile » : « Les meilleurs génies littéraires de notre race furent des hommes, de vrais hommes, au sens le plus fort du mot ; des soldats, de grands voyageurs, qui ont couru l’aventure en dehors de l’Espagne, connu la captivité et la misère et, en outre, ont écrit ». Prenant ses distances avec les théories « scientifiques » de la littérature d’une de ses idoles de jeunesse, Zola, il réaffirme avec force le rôle central de l’irrationnel dans la création : « La raison et l’intelligence peuvent former de grands écrivains dignes d’admiration, mais ni des romanciers, ni des dramaturges, ni des poètes », dont le talent repose sur « l’instinct, le subconscient, les forces mystérieuses et invisibles qu’on appelle communément “l’inspiration” ».
En 1923, il effectue un grand périple sur le continent américain, en Asie et en Afrique, dont il fait peu après la relation circonstanciée dans les trois volumes de son
Voyage d’un romancier autour du monde. Dans le prologue de ce gros ouvrage, soulignant qu’il éprouvait depuis ses premières lectures d’enfance l’envie de voir le monde, il justifie son initiative par « le plaisir du mouvement, l’ivresse de l’action, la curiosité ardente de contempler de près, de ses propres yeux, ce que l’on a lu dans les livres ». Son voyage n’a rien de très aventureux : Blasco navigue sur un paquebot de luxe, dort dans les meilleurs hôtels, est accueilli partout avec tous les honneurs, et, sur certaines des très nombreuses photos qu’il a soin de faire prendre tout au long de ses déplacements, on le voit en costume impeccable, confortablement assis dans une chaise à porteurs. Rédigé dans un esprit encyclopédique, n’épargnant au lecteur que peu d’informations sur la géographie, l’histoire, les mœurs et les coutumes des pays traversés, le récit de cette excursion de quelques mois n’est pas sans charmes. Ne goûtant que médiocrement ce qui différenciait les pays qu’il visitait du sien, Blasco, relève justement Javier Varela, était « moins un amateur d’exotisme, pour employer le terme inventé par Victor Segalen, qu’un amoureux du pittoresque à la manière de Pierre Loti ». Son récit est souvent entaché de clichés orientalistes ou coloniaux, et certaines de ses remarques au sujet des populations qu’il rencontre choquent par leur caractère condescendant ou méprisant.
Mais c’est un observateur hors pair, un voyageur instruit et souvent très lucide. C’est aussi un écrivain de talent, qui parsème son récit de descriptions évocatrices comme celle qu’il fait d’une petite bourgade de l’île d’Hawaii : « Une pluie fine et tiède commença à tomber, le rafraîchissement quotidien des pays tropicaux à la végétation exubérante. Les chaussées bitumées luisaient comme des miroirs noirs, reflétant, la tête à l’envers, les pylônes de l’éclairage public avec leurs globes de lumière lactée et les cocotiers alignés des deux côtés de la route. La terre exhalait une pénétrante et riche odeur de guano. »
Peu après le retour de Blasco en Europe, la Première Guerre mondiale éclatait. Ardent francophile, il mit immédiatement sa plume au service des forces de l’Entente et de la lutte contre l’envahisseur allemand : articles polémiques contre les milieux germanophiles en Espagne, textes de propagande militaire, reportages sur le front. Rêvant de rédiger une « Histoire de la guerre » qui ne vit jamais le jour, il réussit en revanche à publier durant celle-ci trois romans dont l’intrigue lui était directement liée. Le plus réussi est
Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, histoire de deux belles-familles d’origine argentine se retrouvant des deux côtés du conflit. Contenant une description de la bataille de la Marne qui, sans égaler le récit de celle Borodino par Tolstoï – un autre de ses maîtres –, ne manque pas de puissance, le livre rencontra immédiatement un grand succès public et critique en Espagne et à l’étranger. Il transforma la carrière de l’écrivain, notamment en lui ouvrant les portes d’Hollywood.
Blasco Ibáñez avait toujours été fasciné par le cinéma. Durant la guerre, avec les encouragements de Gabriele D’Annunzio, il produisit à Paris une adaptation de son roman
Arènes sanglantes, réalisée par Max André, dont il avait lui-même écrit le scénario. Dans l’immédiat après-guerre, il fut sollicité pour un cycle de conférences aux États-Unis, qu’il donna en espagnol en se faisant traduire. Très sévère à l’égard du Mexique, dont il condamnait les excès révolutionnaires tout en dénonçant le régime militaire, Blasco appréciait par contre le dynamisme de la société américaine, l’esprit d’entreprise et de liberté qui la caractérisait. Son circuit le conduisit jusqu’à Hollywood, où il eut l’occasion d’assister au tournage de certaines scènes du film tiré des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, réalisé par Rex Ingram avec Rudolph Valentino et Wallace Berry. Peu après, une nouvelle adaptation d’Arènes sanglantes fut tournée, avec le même Valentino dans le rôle du matador. D’autres films tirés de ses romans suivirent, dont deux lancèrent la carrière américaine de Greta Garbo. Blasco se mit à écrire des scénarios, mais leur intrigue n’avait pas la solidité de celles de ses romans. Longtemps après la mort de l’écrivain, Rouben Mamoulian réalisa une troisième version d’
Arènes sanglantes avec Tyrone Power, Rita Hayworth et Linda Darnell, et Vincente Minelli une deuxième adaptation des
Quatre Cavaliers de l’Apocalypse avec Glenn Ford, Ingrid Thulin et Charles Boyer.
L’instauration en 1923 de la dictature de Miguel Primo de Rivera, président du gouvernement du roi Alphonse XIII après son coup d’État, remit la politique au cœur de la vie du romancier. Avec Unamuno, il fut en effet l’une des figures centrales de l’opposition au régime, contre lequel les deux hommes multiplièrent les initiatives. Unamuno et Blasco Ibáñez menaient leur action à partir de Paris, et on a conservé une photo des deux écrivains assis à la terrasse de La Rotonde au milieu d’autres intellectuels espagnols en exil. Le contraste de leur apparence respective lorsqu’on les voyait côte à côte, reflet de leurs personnalités très différentes, est bien saisi par Javier Varela : Unamuno « comme toujours en pantalon et veston noirs, gilet noir fermé au col d’où dépassaient les pointes d’une chemise blanche, avec un chapeau rond qui lui donnait l’air d’un prédicateur ou d’un quaker […] la barbe entièrement blanche et un nez aquilin d’oiseau de mauvais augure » ; Blasco Ibáñez « habillé d’un complet neuf et élégant […] bien coupé, orné d’une cravate et d’une pochette, en chaussures vernies, un monocle à monture dorée à l’œil, la silhouette arrondie et élargie par les années et le manque d’exercice physique ». Ni Alphonse XIII ni son Premier ministre, souligne Varela, ne prirent la mesure des conséquences de la réunion à Paris de ces deux hommes, les écrivains espagnols les plus connus, dont l’association contre eux contribua significativement au discrédit international du régime dictatorial et de la monarchie.
Un an auparavant, Blasco Ibáñez s’était établi dans le midi de la France, dans une propriété située à Menton appelée Fontana Rosa qu’il transforma peu à peu en un étrange monument kitsch. Cet ensemble d’édifices de couleurs vives, de jardins d’orangers et de citronniers, de colonnades, de bassins, de jets d’eau et de tonnelles se voulait à la fois un morceau d’Espagne en territoire français et un hommage architectural aux grands écrivains : où que le regard se tournât, il tombait sur un portrait ou un buste de Cervantes, Shakespeare, Dickens, Hugo, Zola ou Dostoïevski. Ornée de mosaïques, décorée d’objets d’art exotiques ou d’origine orientale, la propriété, à force d’extensions, finit par compter douze bâtiments dont un, surmonté d’un belvédère, comprenait la bibliothèque de l’écrivain et une salle de cinéma de 130 places. « Par bonheur, ironise Javier Varela, les voies ferrées et les Alpes limitaient les possibilités de construction » (6).
C’est là que Blasco Ibáñez passa ses cinq dernières années, essentiellement à écrire. Blasco, observe Varela, « ne cherchait plus ni la gloire ni l’argent. Le travail, affirmait-il, était le seul plaisir qu’il s’autorisait. Quand il ne travaillait pas, il s’ennuyait et était de mauvaise humeur ». Au cours de cette dernière période, il produisit une série de romans historiques alourdis par une érudition gratuite et sans grande puissance dramatique. Parce qu’il était coupé de sa principale source d’inspiration, le monde populaire valencien, le talent n’était plus au rendez-vous. Peu à peu, les problèmes de santé eurent raison de sa formidable vitalité. Diabétique à une époque où le traitement par l’insuline était encore à inventer, tentant sans succès de limiter sa tendance à l’obésité par la marche et des régimes auxquels il ne parvenait pas à se tenir, il perdit progressivement la vue d’un œil. Fumeur invétéré de cigares jusqu’au milieu de la cinquantaine, il souffrait aussi de troubles respiratoires chroniques, ainsi que des séquelles de la malaria. En 1928, il mourut. Dans le délire de son agonie, il prononça les noms de Cervantes et Christophe Colomb et était persuadé d’avoir aperçu Victor Hugo.
« Puissant raconteur », pour reprendre l’expression de la romancière Almudena Grandes, Vicente Blasco Ibáñez a été et demeure un auteur extrêmement apprécié du public, à l’instar, aujourd’hui, d’Arturo Pérez-Reverte, auquel le critique de cinéma Carlos Boyero l’a comparé non sans justesse. Mais il n’était pas un écrivain du même calibre que les géants des lettres qu’il vénérait. Si son activité journalistique et éditoriale a laissé des traces, le mouvement qui porte son nom est resté sans héritage politique ou intellectuel. Ses projets de colonies se sont vite effondrés, et, à des yeux un peu exigeants, être devenu un homme riche et célèbre ne peut être considéré comme une authentique réussite. Pourtant, on ne peut s’empêcher d’éprouver l’impression qu’il a eu une existence exceptionnelle. C’est que le tout de sa vie tumultueuse est plus que la somme de ses parties : peu d’hommes ont été tout ce qu’il a été à la fois, et avec une telle intensité. En ce sens, il était bien une sorte de personnage de roman.
—
Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié en 2008
Le Cinquantième Parallèle. Petit essai sur les choses de l’esprit (L’Harmattan).
Cet article a été écrit pour
Books.
Notes
1. Vicente Blasco Ibáñez, una biografía (Espasa Libros, 2002, épuisé en version papier, disponible seulement en format électronique).
2. Cet ouvrage extrêmement riche, fondé sur un impressionnant travail de recherche, rend compte de la vie de Blasco Ibáñez quasiment au jour le jour.
3. Le blasquisme a disparu après les élections législatives de 1936.
4. Los amores de Blasco Ibáñez (Mare Nostrum, 1992).
5. Lire « La revanche posthume d’Ortega y Gasset », par Mario Vargas Llosa, Books, octobre 2011.
Pour aller plus loin
La plupart des romans de Vicente Blasco Ibáñez et même son Voyage d’un romancier autour du monde ont été traduits et publiés en français peu après leur parution. Mais, aujourd’hui, très peu de titres sont encore édités. On peut cependant encore trouver :
♦ Terres maudites. La barraca (traduit par Georges Hérelle, L’Harmattan, 2004)
♦ Boue et roseaux (traduit par Yann Le Chevalier, Ombres, 2000)
♦ Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse (traduit par Georges Hérelle, Large Print, 2015)
♦ Arènes sanglantes (traduit par Georges Hérelle, Sillage, 2009).