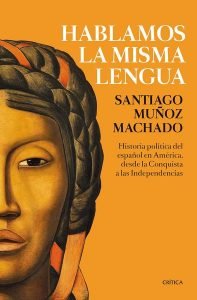Avec un nombre de locuteurs estimé à 534 millions de personnes, dont 460 millions de locuteurs natifs, l’espagnol est la quatrième langue parlée dans le monde après le chinois (mandarin), l’hindi et l’anglais. Il est la langue officielle de 21 pays, ce qui le place au 4
e rang mondial de ce point de vue derrière l’anglais, le français et l’arabe. À l’exception de l’Espagne et de la Guinée équatoriale, tous ces pays sont situés en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il aurait pu en aller différemment. L’espagnol ne s’y est diffusé qu’assez tardivement, et son usage ne s’y est généralisé qu’à l’issue de la période coloniale.
Pourquoi en a-t-il été ainsi et comment a-t-il fini par s’imposer dans la totalité de cette région du monde, à l’exception du Brésil ? Tout en traitant succinctement des aspects linguistiques de la question, Santiago Muñoz Machado a pris le parti d’écrire une histoire avant tout juridique, politique et sociale de l’espagnol en Amérique : celle qu’on peut raconter à partir de l’étude des textes de loi, des régimes administratifs et des systèmes d’organisation.
Lorsque Christophe Colomb débarqua aux Antilles, en 1492, le continent américain comptait 50 millions d’habitants d’après les estimations. Un siècle plus tard, la population était tombée à un niveau compris entre un dixième et la moitié de ce chiffre, sous l’effet des massacres commis au cours de la Conquête, des guerres intestines engendrées par celle-ci, des crises de subsistance provoquées par la perte de ressources agricoles mais, surtout, des épidémies de maladies apportées par les Européens (grippe, rougeole, variole, diphtérie, coqueluche) ou, plus tard, par les esclaves africains (fièvre jaune), contre lesquelles les populations autochtones ne possédaient aucune résistance.
Au moment des découvertes, la population autochtone s’exprimait dans quelque 1 500 langues que l’on peut regrouper en 170 grandes familles. Dans son ouvrage
Empires of the World 1, Nicholas Ostler étudie en détail la répartition géographique et l’histoire compliquée de ces nombreuses langues, dont trois étaient parlées dans de vastes zones : le nahuatl au Mexique et en Méso-Amérique, le quechua dans la région des Andes, le tupi-guarani dans le bassin amazonien. Ces trois langues, dont les deux premières avaient été respectivement celles des empires aztèque et inca, allaient devenir les principales « langues générales » utilisées par les Espagnols pour communiquer avec les autochtones et administrer leurs possessions américaines.
L’exploitation des richesses agricoles et minières reposait au départ sur l’
encomienda, un système de quasi-servage impliquant le regroupement des Amérindiens sous l’autorité d’un colon mandaté par la couronne d’Espagne. Lorsque ce système fut aboli pour des raisons humanitaires et sous la pression de l’Église, il se poursuivit sous la forme de modalités de travail forcé telles que le
repartimiento ou la
mita, appliquées en agriculture dans les
haciendas et les
fincas ainsi que dans les mines, notamment les mines d’argent tristement célèbres de Potosí.
Pour ce qui est de l’organisation politique et administrative, les représentants de la Couronne se reposaient largement sur l’autorité des chefs coutumiers, les caciques, conservant toutefois sous leur contrôle direct l’exercice de la justice, administrée avec l’aide d’interprètes. Regroupées en
pueblos ou
reducciones sous contrôle religieux, les populations autochtones vivaient physiquement et linguistiquement isolées sous un régime de séparation des « républiques d’Espagnols » et des « républiques d’Indiens ».
Outre l’exploitation des nouveaux territoires, un des objectifs affichés par la monarchie espagnole était d’apporter aux populations autochtones les bienfaits de la civilisation chrétienne. Mais la question de la langue n’était pas jugée prioritaire, et les timides encouragements à développer l’enseignement de l’espagnol sporadiquement prodigués par Madrid n’eurent que peu de suites concrètes. Les autorités se heurtaient d’ailleurs sur ce plan à la résistance des prêtres, qui ne cessèrent de s’opposer à la politique d’hispanisation recommandée par la métropole. Une des raisons pour lesquelles les ordres religieux (Franciscains, Dominicains, Jésuites) préféraient avoir recours aux « langues générales » plutôt qu’à l’espagnol était de nature pratique : « Les missionnaires n’étaient pas là pour “civiliser” mais pour prêcher l’Évangile. Pour ce faire, l’utilisation d’une langue que les Amérindiens connaissaient leur semblait plus indiquée. » Il leur apparaissait aussi que la connaissance de l’espagnol aurait ouvert aux autochtones un monde, celui des colons, dangereux pour leur moralité en raison des mœurs dissolues qui y sévissaient et des idées subversives (celles de la Réforme) qui y circulaient. Enfin, en maintenant les Indiens dans l’ignorance de l’espagnol, ils s’assuraient une place d’intermédiaires dans les relations entre la monarchie et les territoires du Nouveau Monde, ce qui leur garantissait une position privilégiée.
C’est d’ailleurs une des raisons qui poussèrent les religieux à devenir, souligne Muñoz Machado, « les premiers linguistes et anthropologues d’Amérique » en apprenant les langues amérindiennes, en établissant des dictionnaires et des grammaires de beaucoup d’entre elles, en étudiant la culture de ces peuples, leurs coutumes, leur religion, leurs croyances. « La connaissance des langues amérindiennes plaça d’emblée les missionnaires en position de pouvoir par rapport à la bureaucratie de l’État, au clergé séculier et aux colons ».
Entre le monde des Indiens et celui des Espagnols figurait le groupe des métis, très vaste en raison de la faible proportion de femmes parmi les colons. Souvent issus d’unions illégitimes ou de viols, ils étaient affublés de noms dépréciatifs variant en fonction de leur ascendance :
mestizo (né d’un parent blanc et d’un parent amérindien),
mulato (né d’un parent blanc et d’un parent noir),
zambo (né d’un parent amérindien et d’un parent noir), mais aussi
castizo,
morisco,
chamizo,
cholo,
chino, termes employés pour désigner les produits des combinaisons réalisables à partir de ces catégories. Ils occupaient une position subalterne par rapport aux Espagnols venus d’Europe ou nés sur le continent (les créoles), mais beaucoup d’entre eux étaient bilingues et certains réussirent à s’enrichir et s’élever dans l’échelle sociale.
Les choses changèrent quelque peu avec la fin du règne des Habsbourg (Charles Quint, Philippe II et leurs descendants) et l’arrivée des Bourbons sur le trône d’Espagne, en 1700. Animés par l’esprit centralisateur de la monarchie française dont ils étaient issus, les Bourbons adoptèrent une série de réformes visant à donner à la Couronne les moyens d’exercer un contrôle direct en matière politique, économique et administrative, aussi bien sur le continent américain qu’en métropole. En raison du pouvoir considérable qu’ils avaient acquis, les Jésuites, grands défenseurs de l’autonomie des Indiens et de leurs langues, furent expulsés d’Amérique comme d’Espagne. L’espagnol fut promu au rang de langue officielle et l’usage du catalan proscrit pour les usages administratifs. Après s’être contenté dans un premier temps d’inviter à introduire avec prudence l’enseignement de l’espagnol dans les missions, le roi Charles III promulgua un décret le rendant obligatoire. Mais les réformes ne furent que très partiellement appliquées : l’Amérique est séparée de l’Espagne par un océan, son territoire est immense, et les mesures envisagées se heurtèrent aux habitudes prises sous les Habsbourg et à la résistance de tous ceux qui, dans les colonies, tiraient bénéfice du système en place.
La situation linguistique de l’Amérique espagnole ne changea en profondeur qu’avec les mouvements d’indépendance. Au début du XIX
e siècle, dans le prolongement de révoltes indiennes dans les régions rurales, des soulèvements de plus en plus violents éclatèrent dans les villes. Ils étaient le fait de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie créoles (appuyées dans certains cas par la population métisse), humiliées de ne pouvoir accéder aux positions de pouvoir réservées aux fonctionnaires venus d’Europe et s’estimant exploitées économiquement par la métropole. Inspirés par la Révolution française, la Révolution américaine et la révolte de Haïti contre Napoléon, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio José de Sucre et d’autres militaires et dirigeants politiques se lancèrent dans une série de guerres de libération. Au terme d’une période tumultueuse marquée notamment par l’effondrement du projet de « Grande Colombie » de Bolívar, quasiment tous les pays de l’Amérique espagnole acquirent leur indépendance.
Cette évolution voulue par la haute société créole n’eut pas que des conséquences heureuses pour les Amérindiens. « La lutte pour l’indépendance, souligne Muñoz Machado, conduisit à la proclamation du principe d’égalité et à l’abolition de toutes les formes de servitude personnelle, à la privatisation des terres et à la suppression des tribunaux et autres institutions destinées spécialement aux Indiens. [Ceux-ci] perdirent ainsi leur autonomie et le contrôle des ressources naturelles et ne purent empêcher, faute de moyens de protection suffisants, que leurs terres tombent entre les mains des classes privilégiées. »
Ce moment marque le début de la disparition des « langues générales » et du règne de l’espagnol : à l’indifférence et au paternalisme qui avaient caractérisé jusque-là l’attitude de la couronne espagnole, « les nouvelles républiques indépendantes substituèrent des politiques actives visant à implanter l’usage de l’espagnol et à éliminer celui des langues autochtones. Tous ces nouveaux gouvernants adhéraient à l’idée que la langue était le marqueur d’identité culturelle qui caractérisait le mieux la nation. La nation se devait donc d’avoir une langue qui lui soit propre et il ne pouvait n’y en avoir qu’une. » En l’occurrence, il ne pouvait s’agir que de l’espagnol, « langue des créoles, des nantis, des dirigeants blancs, des catégories de la population ayant prestige et influence, […] la langue du législateur et de l’administration. Une langue urbaine et européenne à même de soutenir l’aspiration au progrès des nouveaux gouvernements ».
L’espagnol a bien failli ne pas devenir la langue de presque tout un continent. Peu après l’accession des différents pays à l’indépendance, un mouvement en faveur du séparatisme linguistique se développa dans certains d’entre eux, plus particulièrement en Argentine et au Chili. Ses promoteurs faisaient valoir l’existence de différences substantielles entre l’espagnol d’Amérique et celui d’Espagne. Le fer de lance de ce mouvement était un groupe d’écrivains et d’intellectuels connu sous le nom de « génération de 1837 ». Dans l’esprit de ses membres, souligne Muñoz Machado, il ne faisait pas de doute que l’espagnol était appelé à connaître le sort du latin : il allait se fragmenter à la manière dont celui-ci avait donné naissance aux langues romanes.
Un des plus éloquents avocats de la spécificité de l’espagnol d’Amérique était l’écrivain et homme politique argentin Domingo Faustino Sarmiento, exilé au Chili. Il allait trouver sur son chemin un autre intellectuel établi dans ce pays, le vénézuélien Andrés Bello, que l’on peut considérer comme un des grands artisans du triomphe de l’espagnol en Amérique du Sud. Érudit, poète, juriste, philosophe, homme d’État, Bello, qui avait été le précepteur de Bolívar et avait longtemps séjourné en Europe, était attaché à l’ordre et à la raison. La perspective de voir éclater la langue espagnole lui répugnait profondément. Pour éviter ce danger, il composa une « Grammaire de la langue castillane à l’usage des Américains » qui rencontra un immense succès. Dans son esprit, la langue, l’éducation et le droit entretenaient des liens puissants. Outre de multiples autres réalisations, il est passé dans l’histoire comme l’auteur du Code civil du Chili, un texte modèle qui sera copié dans de nombreux pays du continent et ne pouvait qu’enthousiasmer le juriste qu’est Muñoz Machado : « Le Code civil fut un exemple de langage puriste et soutenu, épuré et précis ; diffusé dans toute l’Amérique, il ajouta au prestige de la littérature, des grammaires, des traités d’orthographe et des dictionnaires académiques, l’autorité finale de la législation. »
Si l’espagnol a su maintenir son unité et se doter de normes internationales, c’est aussi grâce à l’action de l’Académie royale espagnole. Fondée en 1713 sur le modèle de l’Académie française, elle décida au milieu du XIX
e siècle de nommer des membres correspondants dans tous les pays de l’Amérique hispanique et d’y soutenir la création d’académies nationales, auxquelles elle est aujourd’hui liée.
L’unité de l’espagnol dans le monde n’empêche pas l’existence de différences lexicales, syntaxiques et, surtout, phonétiques entre l’espagnol d’Amérique (dans toutes ses variantes) et celui d’Espagne. Des linguistes ont attribué les formes dialectales de l’espagnol d’Amérique à l’influence des langues autochtones. Il semble toutefois que cette influence soit essentiellement restée limitée au lexique : plusieurs centaines de mots amérindiens sont passés en espagnol, souvent ceux que l’on utilise pour désigner des aliments, des plantes, des animaux, des outils ou des objets inconnus en Europe
2.
En matière phonétique et morphologique, on s’est interrogé sur la présence, variable selon les régions, de traits comme le
seseo et le
ceceo (la prononciation des « s » comme des « c », ou l’inverse), le
yeísmo (la prononciation identique des sons « ll » et « y ») et le
voseo (l’emploi du pronom «
vos » au lieu de «
tú » à la deuxième personne du singulier). Le dernier de ces traits est un archaïsme, mais les trois premiers sont typiques du dialecte andalou et du parler des Canaries. Une forte proportion des conquistadors et des premiers colons venaient de fait de ces régions. Pour autant, fait remarquer le linguiste cubain Humberto López Morales, on ne peut pas dire de l’espagnol d’Amérique qu’il est simplement de l’andalou transplanté dans le Nouveau Monde
3. Mais l’influence exercée par ce dernier est incontestable.
« L’espagnol américain, résume López Morales en des termes paraphrasés par Muñoz Machado, se sépare en deux variétés. D’un côté l’original andalou, transformé par un processus de mélange avec d’autres dialectes de l’Espagne pour former un ensemble où leurs traces se perdent ; cette variété s’est conservée dans les zones côtières en contact avec les ports andalous par l’intermédiaire des navires de commerce. De l’autre côté, une variété imitant la langue de cour, apparue ultérieurement dans les capitales administratives et leurs zones d’influence, sous l’effet de l’arrivée continue de fonctionnaires, d’hommes de loi et de colons originaires du centre et du nord de l’Espagne. »
Un chapitre de
Hablamos la misma lengua est consacré à la place de la littérature dans la culture hispano-américaine. Elle était considérable. Si certains des conquistadors et des colons étaient analphabètes (Francisco Pizarro, par exemple), un grand nombre d’entre eux étaient des hommes cultivés : des cadets de famille en quête d’aventures, des hidalgos désargentés, des fonctionnaires lettrés, des ecclésiastiques. Et les débuts de la présence espagnole en Amérique ont coïncidé avec le Siècle d’or : l’âge, en littérature, de Félix Lope de Vega, Tirso de Molina, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián et, bien sûr, Miguel de Cervantes, dont le
Quichotte fut très vite diffusé sur le continent américain et y rencontra immédiatement un grand succès. Dans les cales des navires voguant vers les côtes américaines voyageaient des exemplaires des dernières œuvres publiées en Espagne.
Rapidement, les mêmes navires commencèrent à apporter en Espagne des livres publiés de l’autre côté de l’Atlantique, rédigés par des Espagnols fraîchement installés, des créoles, mais aussi des métis, voire des Indiens lettrés. Pour l’essentiel, il s’agissait de récits historiques, de chroniques de la Conquête ou de traités sur les mœurs et les conditions de vie des populations autochtones. L’influence de la littérature hispano-américaine ne fit que croître. Au xix
e siècle, tous les grands mouvements littéraires européens (romantisme, réalisme, naturalisme) se reflétèrent dans ses œuvres de fiction. Au xxe siècle, les écrits du Nicaraguayen Rubén Darío, de l’Argentin Jorge Luis Borges, du Cubain Alejo Carpentier et du Mexicain Octavio Paz firent connaître la littérature hispano-américaine au monde entier et ouvrirent la voie à un bataillon d’auteurs de tous les pays du continent parmi lesquels Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti et Guillermo Cabrera Infante, pour n’en citer que quelques-uns.
L’histoire de l’espagnol en Amérique ne se limite pas aux régions étudiées par Santiago Muñoz Machado. Depuis les expéditions de Ponce de León en Floride, d’Hernando de Soto au Mississippi et au Texas, et de Francisco Vázquez de Coronado le long des côtes de Californie, la langue espagnole est présente dans le sud des États-Unis. L’attestent les noms de plusieurs États (Colorado, Nevada, Montana, Arizona, Floride, Texas), qui sont des appellations espagnoles ou amérindiennes hispanisées, tout comme ceux de nombreuses villes (Los Angeles, San Diego, Santa Fe, El Paso), de tribus indiennes (Comanches, Apaches, Navajos, Mohaves) et de certains de leurs chefs les plus célèbres (Geronimo). L’annexion en 1848 par les États-Unis des territoires successivement détenus par l’Espagne et le Mexique s’est traduite par l’incorporation dans la population d’un certain pourcentage d’hispanophones, que les vagues successives d’immigration ont multiplié dans des proportions spectaculaires. Aujourd’hui, aux États-Unis, 42 millions de personnes (13 % de la population) ont l’espagnol pour langue maternelle, et 58,2 millions le parlent. Des centaines de journaux sont publiés en espagnol et plusieurs dizaines de chaînes de télévision et stations de radio diffusent des programmes dans cette langue. L’espagnol y subit cependant l’ascendant de l’anglais, et beaucoup d’Américains hispanophones s’expriment dans cet hybride des deux langues qu’on appelle le spanglish.
Comme toutes les autres langues, dont le français, l’espagnol souffre de l’influence de l’américain technico-commercial et tend à se détériorer sous l’effet de l’appauvrissement du vocabulaire et de l’effondrement de la syntaxe dans un monde dominé par l’image. Mais il demeure une grande langue internationale à la qualité de laquelle veille l’Association des académies de la langue espagnole et dont le réseau des instituts Cervantes s’efforce d’assurer le rayonnement. Ce qui lui a permis, contrairement à l’allemand ou à l’italien, de connaître un destin planétaire, c’est d’avoir pénétré sur un immense continent et de s’y être maintenu, par cette conjugaison d’accidents de l’histoire et de décisions opportunes dont le livre de Santiago Muñoz Machado fait le récit passionnant et détaillé.
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié
Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008). — Cet article a été écrit pour
Books.
Notes
1. Harper, 2005.
2. En français, ces mots sont devenus « tomate », « chocolat », « avocat », « cacahuète », « jaguar », « pétunia », « tapioca », « guano », « canoë », « pirogue », etc.
3. La andadura del español por el mundo (Taurus, 2010).