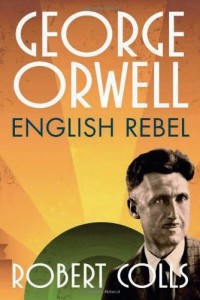George Orwell, à contre-France
Publié dans le magazine Books n° 81, janvier / février 2017. Par Michel André.
Francophone et francophile, l’écrivain est resté longtemps incompris dans l’Hexagone. Parce qu’il était trop anglais, trop rétif à nos chères généralités, politiquement trop hétérodoxe ? Nous ne connaissions guère que 1984, alors qu’il était un immense essayiste. L’actualité redonne toute sa dimension à un homme qui avait la politique en « horreur ».

Réputé pour avoir élevé le journalisme au rang de littérature, Orwell ne se considérait pas comme un vrai romancier.
Son image souffre d’une troisième distorsion. Nous avons presque sanctifié cet homme complexe qui écrivait, dans un essai sur Gandhi : « Jusqu’à preuve de leur innocence, les saints doivent toujours être considérés comme coupables. » Dans son étude sur la destinée de la figure d’Orwell (1), John Rodden montre que ce processus de canonisation a commencé peu après la mort précoce de l’écrivain en 1950, à l’âge de 46 ans, de tuberculose. « La conscience de notre temps » (V. S. Pritchett), « l’homme qui disait la vérité » (Lionel Trilling), « un héros intellectuel » (Irving Howe) : en quelques formules, les grands critiques anglais et américains ont fabriqué la statue d’un Orwell prophète et martyr.
Cette représentation est fondée sur la lutte opiniâtre qu’il a menée contre le mensonge en politique, son engagement aux côtés des troupes républicaines dans la guerre d’Espagne, d’où il rapportera Hommage à la Catalogne, et le choix qu’il a effectué de partager durant plusieurs mois la vie de ces mineurs du nord de l’Angleterre qu’il décrit dans Le Quai de Wigan. Elle reflète aussi la présence, chez lui, d’une tendance à l’ascétisme – pouvant aller jusqu’à une forme de masochisme – qui l’a fait comparer à T. E. Lawrence.
Peu enclin à se livrer, Orwell ne souhaitait pas qu’on écrive sa biographie. Pour éviter les publications sauvages, sa veuve Sonia, qui a géré avec intelligence son héritage littéraire après l’avoir épousé trois mois avant sa mort, a fini par passer une commande au théoricien politique Bernard Crick (2). Trouvant l’ouvrage trop sec et peu amène, elle l’a renié à sa parution et confié la rédaction d’une nouvelle biographie à Michael Shelden (3).
Crick met en doute la véracité de certaines anecdotes, sujets de textes célèbres d’Orwell. Lorsqu’il était policier en Birmanie, a-t-il personnellement assisté à une pendaison, comme il le raconte, et tué un éléphant furieux pour se conformer aux exigences de son rôle de représentant de l’Empire britannique ? Et a-t-il été lui-même victime, à l’école préparatoire Saint-Cyprien, des traitements cruels qu’il stigmatise dans son essai Tels, tels étaient nos plaisirs ? Les récits qu’il a donnés de ces épisodes comportent à l’évidence une part considérable de reconstruction.
Trois autres biographies ont suivi, sans apporter de révélations bouleversantes (4). « La vérité, c’est qu’il y a peu de choses nouvelles à dire au sujet de la vie d’Orwell », écrivait John Banville en 2003. Il est cependant toujours possible d’appréhender une existence sous un angle inédit. Dans George Orwell, English Rebel, ouvrage salué par des intellectuels aussi différents que John Gray, A. N. Wilson et David Aaronovitch, l’historien Robert Colls prend pour fil rouge la question de l’« anglicité » (« englishness ») de l’écrivain. Colls ne prétend pas en faire la clé du personnage. Elle n’en constitue pas moins à ses yeux une réalité « à partir de laquelle et à laquelle il n’a cessé de penser ».
Avant lui, Christopher Hitchens – dans son petit livre Orwell’s Victory (2002) –, ainsi que Julian Barnes et Timothy Garton Ash dans deux articles de la New York Review of Books, avaient déjà attiré l’attention sur quelques traits qui font de lui « une anthologie vivante de l’anglicité » (Garton Ash). L’un d’eux est son extrême sensibilité aux différences de classe. Orwell disait appartenir à « la couche inférieure de la strate supérieure de la classe moyenne », expression dont l’emploi suppose une puissance de discernement peu commune en matière de catégorisation sociale. Et tout en luttant contre ses préjugés, jamais il n’est parvenu à surmonter complètement la répulsion que lui inspiraient certains aspects de la vie des classes populaires. Il avait d’ailleurs le sentiment que les socialistes de la classe moyenne, observe à ce propos Robert Colls, « au fond d’eux-mêmes, détestent les ouvriers d’être des ouvriers, comme ils se détestent eux-mêmes d’appartenir à la classe moyenne. »
On songe aussi, entre autres signes d’anglicité, à son aversion pour les idées générales, à son goût des faits, des chiffres et de l’observation, à son empirisme foncier, à son culte du sens commun. Quand il lui a fallu prendre un pseudonyme, l’homme qui était né et a été enterré sous le nom d’Eric Blair a choisi George Orwell parce qu’il lui semblait « un bon nom anglais bien rond » (saint Georges est le patron de l’Angleterre et l’Orwell une rivière du Suffolk). L’écrivain, qui mentionnait parmi les choses rendant heureux d’être chez soi en Angleterre « les fauteuils, la sauce à la menthe, les pommes de terre nouvelles correctement cuisinées, le pain complet, la marmelade [et] la bière de vrai houblon », aimait fabriquer lui-même ses étagères, cultiver ses légumes et pêcher en rivière. Dans le cottage qu’il a habité avec sa première femme Eileen O’Shaughnessy et la ferme d’une région désolée des îles Hébrides où il a vécu à la fin de sa vie, il élevait des poules et des chèvres. Et l’un des plus beaux textes dont il ait gratifié ses lecteurs du journal de gauche Tribune est un hymne au printemps intitulé « Quelques réflexions sur le crapaud ordinaire ».
Robert Colls montre comment cet attachement spontané à un certain mode vie s’est progressivement transformé en un amour raisonné de l’Angleterre, où se mêlaient ses convictions socialistes, le patriotisme né chez lui de la guerre et l’image idéalisée qu’il se faisait des « gens ordinaires ». Ce sentiment s’exprime dans les deux essais « Le lion et la licorne » et « Le peuple anglais » (5). Pour rendre compte du pays dans sa diversité, Orwell y évoque « le claquement des galoches dans les villes industrielles du Lancashire, le va-et-vient incessant des camions sur les routes du Nord, les files qui s’allongent devant les Bourses du travail, le crépitement des machines à sous dans les pubs de Soho, les vieilles filles se dirigeant à bicyclette vers la sainte communion dans les brumes du matin ». Il y célèbre « une culture faite de copieux petits déjeuners et de mornes dimanches, de villes enfumées et de petites routes sinueuses, de vertes prairies et de boîtes aux lettres rouges ». Et il décrit « une nation d’amateurs de fleurs, […] de collectionneurs de timbres, de colombophiles, de menuisiers du dimanche, de découpeurs de bons, de joueurs de fléchettes, d’amateurs de mots croisés ».
Dans le même esprit, Orwell livrera des réflexions sur le cricket, les pubs, la cuisine anglaise et la meilleure façon de préparer le thé, mais aussi les magazines pour jeunes gens, les cartes postales humoristiques et grivoises en vente dans les stations balnéaires, sans oublier le déclin du roman policier anglais, dans une perspective qui annonce les travaux sur la culture populaire de Raymond Williams (Culture et matérialisme, notamment) et Richard Hoggart (La Culture du pauvre).
Il consacrera aussi de grands essais critiques à des écrivains emblématiques de l’anglicité comme Dickens (un homme « animé d’une colère généreuse » critiquant l’exploitation capitaliste, non d’un point de vue politique ou social, mais pour des raisons morales), Kipling (apologiste de l’empire, mais « doté d’un sens des responsabilités » que ne possèdent pas des gens plus « éclairés ») et Wodehouse (qui a collaboré avec la radio de propagande nazie, mais en raison de sa naïveté et de son « innocence politique ») (6).
Orwell a aussi écrit sur les particularités linguistiques de l’anglais, sur ce qui le distingue de l’américain et sur les risques que lui font courir l’usage croissant du jargon. Dans La Politique et la Langue anglaise, il dénonce la corruption du langage par une pensée vicieuse et la corruption réciproque de la pensée par l’emploi d’un vocabulaire prétentieux et euphémistique : « La langue anglaise […] devient laide et imprécise parce que notre pensée est stupide, mais ce relâchement constitue à son tour une puissante incitation à penser stupidement. » Pour réfléchir correctement, il faut donc commencer par s’exprimer clairement, ce que l’on peut faire, dit-il, en suivant quelques règles simples (7).
«La bonne prose, déclarait-il dans une formule fameuse, est comme une vitre transparente. » Admirant la capacité d’un Somerset Maugham à raconter des histoires « sans détour et sans fioritures », il s’efforçait d’écrire dans un style « [bannissant] le pittoresque au profit de l’exactitude ». Orwell ne possédait pas au départ cette façon simple et directe de s’exprimer qui est devenue sa marque. C’est à force de travail acharné qu’il a peu à peu conquis son style. Au bout de quelques années, il le maîtrisait au point de pouvoir rédiger quasiment d’un jet, en se corrigeant à peine, ses chroniques dans Tribune et ses critiques de livres pour l’Observer, qu’il produisait au rythme de plusieurs par semaine. Comme l’a souligné Clive James, ce style « de conversation » était, derrière son apparente facilité, le produit d’une grande sophistication. Dans ce genre éminemment anglais qu’est l’essai, la langue fluide et familière d’Orwell fait de lui l’héritier de William Hazzlitt et de ses « propos de table » davantage que de Samuel Johnson, dont il partageait le bon sens mais n’avait pas le style fleuri.
Bien qu’il ait consacré de belles pages à Jack London, à Henry Miller et à la littérature populaire américaine, Orwell ne s’est pas beaucoup intéressé aux États-Unis. Après l’Angleterre, c’est la France qui a le plus compté pour lui. Sa famille maternelle, installée en Asie comme celle de son père (administrateur en Inde), était d’origine française. À Eton, il a perfectionné sa connaissance du français en suivant le cours d’Aldous Huxley. Et il a séjourné deux fois à Paris. D’abord dans sa jeunesse, durant deux ans, après son retour de Birmanie. Subvenant à ses besoins grâce aux revenus de son travail et à l’aide financière d’une de ses tantes, il vivait loin du milieu des écrivains anglophones qui avaient élu domicile dans la capitale française.
Après être tombé malade et avoir passé quelques jours à l’hôpital Cochin dans des conditions effrayantes dont il fera le récit dans « Comment meurent les pauvres », il travailla plusieurs mois comme plongeur au luxueux hôtel Lotti, puis dans un restaurant russe : une expérience dont il tirera les pages parisiennes de son premier livre publié, Dans la dèche à Paris et à Londres. Orwell jugeait moins pénible d’être pauvre en France qu’en Angleterre. En revanche, il estimait la colonisation française, avec laquelle un bref séjour au Maroc le familiarisera un peu plus tard, pire encore que l’impérialisme anglais tel qu’il avait pu l’observer en Birmanie.
Orwell connaissait bien la littérature française. Dans ses comptes rendus de versions anglaises de livres français, il lui arrive de porter un jugement sur la qualité de la traduction. Il appréciait Villon et Baudelaire, les grands romanciers du XIXe siècle Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant et Zola, ainsi qu’Anatole France, un auteur « surestimé de son vivant », reconnaissait-il, mais dont il appréciait le courage et le radicalisme. Souvent justes, ses observations sur les écrivains français sont parfois dures. Déplorant la tendance de Mallarmé à l’hermétisme, par exemple, il affirmait à son propos : « Quelque chose ne va pas quand des poètes d’un talent aussi évident produisent des œuvres quasiment incompréhensibles. »
Orwell avait l’esprit suffisamment ouvert pour reconnaître les qualités morales ou les mérites littéraires d’écrivains français dont les vues politiques n’étaient pas les siennes, voire le révulsaient. Le « royalisme romantique » de Bernanos ne l’inspirait guère, et il ne prisait pas sa « tendance à la rhétorique ». Mais son honnêteté et sa combativité l’impressionnaient, tout comme sa « haine du mensonge et de la tyrannie ». L’aversion qu’il éprouvait pour les idées politiques de Céline ne l’empêchait pas d’admirer Voyage au bout de la nuit, « cri de protestation contre l’horreur et l’absurdité de la vie moderne – en réalité de la vie tout court ».
Orwell se sentait proche de Malraux, qui avait comme lui combattu en Espagne. Envoyé en Europe à la fin de la guerre comme correspondant de l’Observer, il eut l’occasion de le rencontrer à Paris. Il avait également de l’estime pour Albert Camus, qui l’admirait en retour. Un rendez-vous avait été pris entre ces deux écrivains si semblables à bien des égards, qui ne put avoir lieu en raison du mauvais état de santé de Camus. Orwell n’avait en revanche aucune sympathie pour Sartre, « une outre pleine de vent » dont il éreinta les Réflexions sur la question juive.
La proximité d’Orwell à l’égard de la France ne l’a pas aidé à se faire connaître dans ce pays. 1984 n’est paru en poche en français que dix ans après sa publication en paperback. Plusieurs ouvrages d’Orwell sont sortis en français dans les années 1960, sans rencontrer le succès. Et, pour disposer d’une version française des quatre volumes posthumes d’Essais, articles et lettres rassemblés par Sonia Orwell et Ian Angus, il a fallu attendre le milieu des années 1990 (8).
Pour quelle raison ? On a invoqué le peu de sympathie pour cet auteur qui défendait un socialisme hétérodoxe, sentimental, d’inspiration morale et anticommuniste, dans un pays où la pensée de gauche a longtemps été marquée par la tradition marxiste ; ou l’anti-intellectualisme d’Orwell et sa conception militante de la littérature. Peut-être faut-il aussi incriminer ce que Simon Leys, évoquant l’incompréhension dont celui-ci faisait l’objet en France dans un petit livre qui demeure la meilleure introduction en français à l’œuvre d’Orwell, appelait sévèrement « l’incurable provincialisme culturel de ce pays » (9).
Grâce aux maisons d’édition Champ libre, Ivrea et Agone, une grande partie de l’œuvre d’Orwell est à présent disponible en français. S’il continue à occuper dans le paysage intellectuel de l’Hexagone une place beaucoup plus réduite que dans le monde anglo-saxon, l’écrivain y fait aujourd’hui l’objet de plus de curiosité, du fait de l’attention que lui ont accordée quelques auteurs : Bruce Bégout, qui a développé toute une réflexion à partir de la notion de « décence ordinaire » (common decency), jamais définie par Orwell mais au cœur de sa pensée politique et qu’on pourrait caractériser comme le sentiment qu’il y a « des choses qui se font et des choses qui ne se font pas » ; Jacques Dewitte, que son intérêt pour les relations de la politique et du langage ne pouvait laisser insensible aux thèses de l’inventeur de la « novlangue » et de la « double pensée » ; et surtout Jean-Claude Michéa et Jean-Jacques Rosat, qui ont tous deux beaucoup accompli pour faire connaître Orwell en France. Michéa en mobilisant Orwell, aux côtés de l’historien américain Christopher Lasch, dans la réflexion critique sur la gauche, le libéralisme et la modernité qu’il poursuit depuis plusieurs années ; Rosat en commentant longuement dans ses Chroniques orwelliennes du Collège de France ses idées sur la politique, la société et la littérature.
Moitié sérieusement, moitié par plaisanterie, Orwell se présentait volontiers comme un « anarchiste tory ». Suivant en cela Simon Leys, Michéa considère cette expression comme la meilleure définition de son tempérament politique. Faisant valoir que Jonathan Swift, écrivain dont il admirait le talent mais ne partageait pas la vision du monde, est la seule personne jamais qualifiée de la sorte par Orwell, Rosat s’insurge contre cette étiquette. Un peu trop rapidement. Certes, Orwell n’a jamais défendu ni la doctrine anarchiste, ni la doctrine tory. Mais, réfractaire à l’autorité, détestant la bureaucratie, hostile à la technocratie, et en même temps attaché à certaines valeurs traditionnelles, il avait indubitablement une sensibilité à la fois libertaire et conservatrice.
L’écrivain, fait souvent remarquer Robert Colls, était un homme pétri de contradictions apparentes : « Un intellectuel qui n’aimait pas les intellectuels, un socialiste qui ne faisait pas confiance à l’État, un écrivain de gauche indulgent avec les écrivains de droite, un libéral opposé au libre marché, un protestant qui, s’il croyait dans la religion, ne croyait pas en Dieu ». Conscient qu’aujourd’hui « peu d’hommes raisonnables croient encore en une vie après la mort », il soutenait que « le vrai problème est : comment rétablir une attitude de vie religieuse, tout en acceptant que la mort est définitive ».
Bien qu’il ait écrit : « Ce que j’ai vu en Espagne m’a fait prendre la politique en horreur », son ambition était de « faire de l’essai politique une forme d’art ». Dans sa recension du livre de Friedrich Hayek La Route de la servitude, il résume ainsi sa position : « Le capitalisme aboutit au chômage, à la compétition féroce pour les marchés et à la guerre. Le collectivisme mène aux camps de concentration, au culte du chef et à la guerre. » Pour échapper à ce dilemme, il faut « rétablir la notion de bien et de mal en politique ».
Orwell n’était pas un prophète, et pas toujours clairvoyant. S’il a anticipé la « guerre froide », qu’il est le premier à avoir ainsi appelée, il a mis du temps à prendre conscience de la gravité de la menace que faisait peser sur l’Europe l’essor du nazisme. Dans « De droite ou de gauche, c’est mon pays », il s’est aventuré à imaginer que la victoire sur l’Allemagne hitlérienne allait s’accompagner d’une révolution socialiste sanglante en Angleterre.
Mais, lorsqu’il s’est fourvoyé, il l’a généralement reconnu, en cherchant à comprendre les raisons de son erreur. « Jusqu’à la fin de 1942, au moins, écrit-il en 1944 à ses lecteurs américains de la Partisan Review, je me suis trompé dans mes analyses de la situation. » Et il explique de quelle façon et pourquoi. Orwell, dit très bien l’essayiste américain Joseph Epstein, « était honnête et possédait une inébranlable intégrité, et ces qualités conférent à ses écrits une très grande force ».
Sur le plan personnel, l’homme n’était pas non plus sans faiblesses. D’avis que « mieux vaut mourir de mort violente et pas trop vieux » parce qu’« une mort “naturelle” signifie, presque par définition, quelque chose de lent, de nauséabond et d’atroce », il traitait sa santé avec une irresponsabilité qui consternait ses proches. Mal à l’aise et maladroit avec les femmes, il pouvait être avec elles d’une grande rudesse (10). Il n’a pas été un mari fidèle, et sa première femme, Eileen, qui lui a beaucoup apporté du point de vue littéraire, est morte d’un cancer sans qu’il remarque à quel point elle était malade, tant son travail l’absorbait. Mais c’était un ami solide et généreux, un père dévoué et affectueux pour le petit garçon qu’ils avaient adopté et un homme aux goûts sans prétention. « Tant que je demeurerai en vie, écrivait-il, […] je persisterai à aimer la surface de la Terre et je conserverai mon attachement aux simples objets matériels et aux connaissances inutiles. »
Dans sa jeunesse, Orwell avait été très amoureux d’une jeune fille nommée Jacintha Buddicom. Parce qu’il s’était comporté brutalement avec elle au cours d’une promenade, leurs relations s’interrompirent. Puis la vie les sépara et ils ne se revirent jamais. Dans une lettre à une amie écrite cinquante plus tard, elle avoue le regretter : « Il m’a fallu littéralement des années pour reconnaître que nous sommes tous des créatures imparfaites, mais qu’Eric était moins imparfait que n’importe quelle autre personne que j’ai rencontrée. » À défaut d’être un saint, voilà qui n’est pas si mal.
— Cet article a été écrit pour Books par Michel André. Né et vivant en Belgique, ce philosophe de formation a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international.
Notes
1. George Orwell. The Politics of Literary Reputation, Transaction Publishers, 2006.
2. George Orwell. A Life, 1980, paru chez Flammarion en 2008.
3. Orwell. The Authorised Biography, Heinemann, 1991.
4. Jeffrey Meyers, Orwell, Wintry Conscience of a Generation, 2000 ; D. J. Taylor, Orwell, The Life, 2003 ; Gordon Bowker, George Orwell, 2003.
5. Sans doute parce qu’il trouvait rétrospectivement leur ton trop propagandiste, Orwell a demandé à ses exécuteurs testamentaires que ces deux textes, comme l’essai « De droite ou de gauche, c’est mon pays », ne soient pas republiés.
6. Au moment de sa mort, Orwell préparait un article sur cet autre écrivain typiquement anglais qu’est Evelyn Waugh.
7. Éviter les comparaisons éculées, préférer les tournures verbales actives aux formes passives, ne pas employer un mot long là où un plus court de même signification existe ou un terme savant quand un mot du langage courant fait l’affaire, etc.
8. Une édition complète des œuvres d’Orwell en anglais, comprenant plus de 8 600 pages et 20 volumes, a été réalisée depuis lors par Peter Davison.
9. Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, 1984 ; Flammarion, 2014.
10. Après la mort d’Eileen, conscient qu’il n’avait plus beaucoup de temps à vivre mais qu’avec 1984 son nom était à présent sur toutes les lèvres, il a gauchement proposé à plusieurs femmes de sa connaissance de l’épouser dans la perspective de « devenir la veuve d’un écrivain célèbre ».
Pour aller plus loin
♦ Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Climats, 2008. Une étude essentielle sur les positions politiques iconoclastes d’Orwell.
♦ Jean-Claude Michéa, Orwell éducateur, Climats, 2009. Sur la notion de « décence ordinaire » dans sa philosophie politique.
♦ Jean-Jacques Rosat, Chroniques orwelliennes, Collège de France, 2013, disponible en format numérique. Une réflexion de longue haleine sur la littérature et les idées d’Orwell.