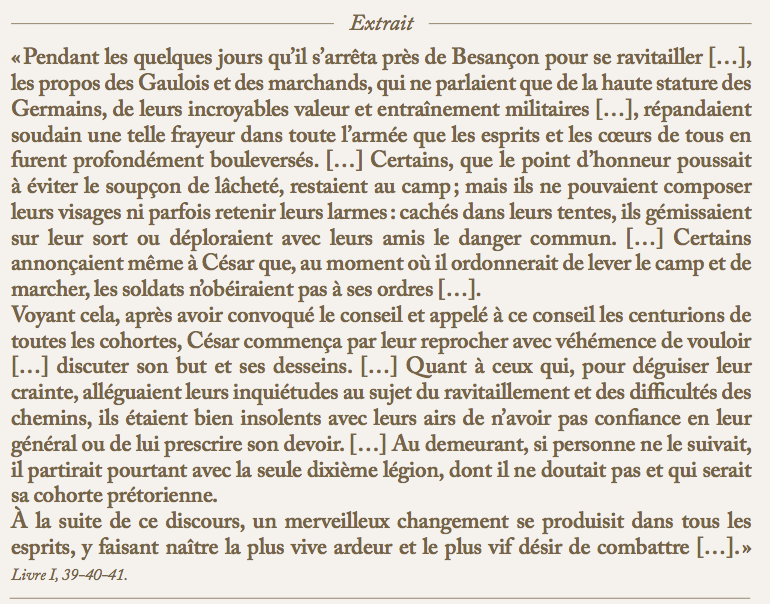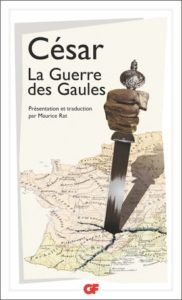Jules César prix Nobel
Publié dans le magazine Books n° 110, septembre 2020. Par Jean-Louis de Montesquiou.
Le général romain était un stratège hors pair et un excellent chroniqueur de ses exploits militaires. L’homme, qui avait le cœur plutôt à gauche, se révéla en revanche un piètre politique.
Jules César, on l’a un peu oublié, était un véritable surhomme. Si le prix Nobel avait existé au Ier siècle avant notre ère, il en aurait obtenu plus d’un, à commencer par celui de littérature. Le général romain écrivait beaucoup, et sa production propre (dont ne subsistent quasiment que les Commentaires sur la guerre des Gaules, appelés aussi La Guerre des Gaules) comprenait des discours, des pièces de théâtre, des poèmes, des maximes et même un livre de grammaire. Il écrivait très vite, dictant à deux ou trois secrétaires en même temps (comme Churchill). À peine descendu de cheval, alors que ses légions prenaient leurs quartiers, il rédigeait la chronique de la campagne tout juste achevée. Il écrivait aussi très bien – même Cicéron dut en convenir –, évitant les mots « compliqués et insolites comme le timonier les récifs », et avait porté la concision latine à son summum de « luminosité et de pureté ».
César n’était pas de ces hommes politiques qui pensent devoir ajouter la plume littéraire à leur chapeau ; il écrivait parce qu’il avait quelque chose à dire : en l’occurrence, présenter, ou défendre, son action. Était-il honnête et sincère ? Suffisamment, quoi qu’en dise Napoléon, pour que ses détracteurs puissent utiliser ses propres textes contre lui. La clarté et la précision de ses notes lui auraient accessoirement valu le Nobel de géographie ou ce qui en tient lieu, le prix international Vautrin-Lud. Beaucoup de ce que l’on sait de la Gaule et des Gaulois, on le trouve dans La Guerre des Gaules, qui regorge d’informations ethnographiques collectées sur le terrain à des fins militaires mais surtout politico-diplomatiques.
César aurait sans doute aussi mérité le Nobel de la paix. Quid, diront certains, du bilan de plus de 1 million de morts (selon Pline l’Ancien) qu’il a fait en une douzaine de campagnes ? Oui, mais il s’agissait, en Gaule du moins, de campagnes de pacification (le verbe pacare, « pacifier », revenant avec insistance dans Les Commentaires), voire de guerres défensives. Par exemple, lorsque, en 58 av. J.-C., il était allé défendre les Éduens et les Séquanes, alliés de Rome, contre les Helvètes qui, trop à l’étroit dans leurs montagnes, lorgnaient sur les terres fertiles et peu peuplées de la côte Atlantique. Le sang de César n’avait fait qu’un tour et il avait réexpédié les intrus chez eux, puis, une chose en appelant une autre, s’était retourné contre les Germains et contre les Belges.
La défense des tribus fidèles à Rome (du moins tant qu’elles le demeuraient, c’est-à-dire jusqu’à la grande rébellion menée par Vercingétorix en 52 av. J.-C.) entraîna certes quelques fameux dérapages et carnages, mais César préférait la négociation directe avec les chefs de tribu, souvent d’ailleurs assortie d’une clémence présageant celle d’Auguste. En une génération, la Pax romana allait s’étendre à toute la Gaule, qui deviendrait quasi romaine et s’en trouverait plutôt bien. La langue, les institutions, les mœurs et surtout le confort latins remplaceraient leurs équivalents celtiques, tandis que beaucoup d’aristocrates gaulois trouveraient à s’employer dans la haute fonction publique romaine.
Pourtant, César était avant tout un chef militaire hors pair, un stratège d’une rapidité de décision et de déplacement légendaires (il parcourait parfois plus de 150 kilomètres par jour), doublé d’un formidable logisticien et d’un meneur d’hommes qui s’entourait des meilleurs officiers, dont il attirait les talents et verrouillait la loyauté à coups de largesses. C’est à ses guerriers qu’il accordait le plus d’attention (notamment aux frustes mais essentiels centurions, l’équivalent des sous-officiers d’aujourd’hui) : ils étaient choyés, complimentés, décorés et rémunérés au mieux. César allait à pied avec ses soldats et partageait leurs conditions de vie malgré une santé médiocre. Ses quelque 50 batailles, il ne les mena pas de l’arrière comme les généraux de 1914, mais de la deuxième ou troisième ligne face à l’ennemi, sachant qu’« une armée c’est comme un spaghetti : on peut la tirer mais pas la pousser », comme dirait bien plus tard le général Patton. Mieux encore, il lui arriva de combattre au corps-à-corps, où il était, dit-on, très habile et courageux, qualités qui lui valurent à 19 ans la corona civica, l’une des plus hautes décorations militaires. Ce n’est pas pour rien que Napoléon voulait que ses officiers étudient en détail ses campagnes.
Les talents de gestionnaire de César sont en revanche moins spectaculaires. C’était avant tout un joueur, qui s’endettait pour acquérir notoriété et votes, avant de se payer sur la bête pour pouvoir mieux recommencer. Il n’aurait en tout cas pas mérité le Nobel d’économie, mais Rome s’enrichit cependant sous son règne, principalement grâce aux gains procurés par les expéditions militaires (butin, esclaves ou tributs des peuples assujettis), auxquels s’ajouteraient plus tard les revenus de la prospère Égypte.
Politiquement, César avait, ou prétendait avoir, le cœur à gauche. Il venait d’une famille aristocratique mais pas particulièrement riche et avait longtemps habité aux confins du quartier malfamé de Suburre. À Rome, argent et politique allaient main dans la main et se faisaient la courte échelle, mais César était pour sa part plus enclin à redistribuer qu’à thésauriser, à accumuler du capital social plutôt que financier. Car son vrai sujet, c’était le pouvoir, dont la quête lui fit gravir, lentement mais implacablement, tous les échelons militaires, politiques et même religieux du cursus honorum. Mais, malgré un travail acharné, qu’il n’interrompait même pas aux arènes pendant les combats de gladiateurs (ce qui était assez mal vu), sa prestation, une fois au sommet, fut décevante, surtout comparée à la frénésie législatrice et à la vision sociétale d’un Napoléon.
Jules César semble avoir voulu corriger quelques injustices criantes (d’où ses lois agraires) et surtout réformer le système politique inefficace et corrompu, ce qui n’était déjà pas si mal mais lui valut une fin précoce. Sans doute par souci d’efficacité, il dériva vers une pratique du pouvoir de plus en plus personnelle et même – horreur ! – potentiellement monarchique. Souhaitait-il poursuivre dans cette voie ? Sans doute pas – il était même prévu qu’il quitte Rome pour trois ans après les Ides de Mars de l’an 44 avant notre ère. Mais de jeunes ambitieux, Marcus Junius Brutus en tête, inquiets de voir leurs ambitions politiques réduites à néant, prirent les devants et l’assassinèrent.
Son talent pour l’autopromotion et son immodestie colossale propulsèrent César là où il voulait aller de son vivant. Ses conquêtes militaires et féminines (ces dernières venant corriger une erreur de jeunesse – s’être probablement laissé séduire par le roi de Bithynie Nicomède IV, alors que l’homosexualité « passive » était jugée indigne d’un aristocrate) fascinèrent les générations suivantes. Son impact sur les futurs romanciers, dramaturges et cinéastes fut en revanche étrangement limité, exception faite d’une apparition comme tyran évanescent chez Shakespeare ou comme victime récurrente de la malice d’Astérix. Serait-ce que la réalité du personnage dépasse à ce point la fiction qu’elle décourage ceux qui la produisent ?