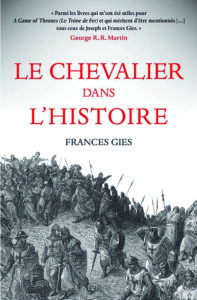Le chevalier, une exportation française
Publié dans le magazine Books n° 116, novembre-décembre 2021.
Comment de simples soudards à cheval, incultes et violents, se sont-ils mués en preux défenseurs des plus faibles ? L’histoire de la chevalerie est celle d’une étonnante ascension, avant un long déclin.

Le chevalier fascine, il fait rêver, et ce n’est pas tout à fait un hasard. Comme le note Frances Gies dès les premières lignes du Chevalier dans l’Histoire, l’ouvrage qu’elle lui consacre : « De tous les types de soldats qui sont apparus sur la scène militaire au cours de l’Histoire, depuis l’hoplite grec jusqu’aux branches spécialisées des forces armées modernes en passant par le légionnaire romain et le janissaire ottoman, aucun n’a eu de carrière aussi longue que le chevalier du Moyen Âge européen, ni d’impact aussi profond sur l’histoire sociale, culturelle mais aussi politique. » Aujourd’hui, l’image qu’en ont non seulement les Anglo-Américains mais aussi bon nombre de Français – notamment à cause de Walter Scott, du cinéma et des séries télévisées – est celle d’un chevalier principalement anglais ou, du moins, anglophone. Or, comme le rappelle Gies, « en réalité, le chevalier est né en France et resta inconnu en Angleterre jusqu’à la conquête normande », c’est-à-dire jusqu’à la colonisation de l’île par une élite francophone.
Même la littérature arthurienne, dont les aventures sont centrées sur l’Angleterre, est en fait bien plus française qu’anglaise. Certes, le personnage légendaire d’Arthur est mentionné pour la première fois dans des chroniques saxonnes et prend véritablement forme sous la plume du clerc gallois Geoffroy de Monmouth. Mais celui-ci écrit en latin. Ensuite, à partir du poète normand Wace (contemporain de Monmouth), la plupart des romans arthuriens – et les plus beaux d’entre eux – seront écrits en français. Le dernier, celui de sir Thomas Malory, Le Morte d’Arthur, qui date de 1485, fait exception. Mais l’Angleterre vient alors de perdre la guerre de Cent Ans et, avec elle, ses possessions sur le continent. Elle se détache alors de l’univers francophone auquel elle était intégrée jusqu’ici. Par ailleurs, comme le reconnaît Gies, inutile de chercher chez Malory « le mysticisme de la légende du Graal, la comédie de l’amour courtois et les nuances satiriques ». Il n’a ni la grâce ni le talent d’un Chrétien de Troyes. Par rapport à ses illustres devanciers, la narration est devenue lourde et plate.
Décédée en 2013, l’Américaine Frances Gies a écrit, avec son époux Joseph, une vingtaine d’ouvrages de vulgarisation consacrés au Moyen Âge. Ils ont connu un grand succès outre-Atlantique (sur la couverture du Chevalier dans l’Histoire, on peut lire une citation de George R. R. Martin, l’auteur du Trône de fer, leur rendant hommage). En France, ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont commencé à être traduits. Le Chevalier dans l’Histoire est le quatrième à l’être et le premier signé uniquement de Frances. Sans révolutionner notre vision du sujet, il en offre une image claire et attrayante. Il retrace l’évolution du chevalier depuis son apparition à l’époque carolingienne, quand il ne s’agit encore que d’un soldat qui possède un cheval et une armure, jusqu’au XVIe siècle, quand Bayard, le chevalier « sans peur et sans reproche », meurt d’une balle de mousquet. C’est l’histoire d’une prodigieuse ascension qui culmine au XIIIe siècle, quand la société féodale arrive à maturité, puis d’un lent déclin.
L’importance et la centralité du territoire français au sein du monde médiéval transparaissent à chaque chapitre. La plupart des impulsions viennent de là. L’« invention » du chevalier serait à mettre au crédit de Charles Martel, qui, pour faire face aux musulmans à Poitiers, aurait imité leur cavalerie en introduisant l’usage de l’étrier (sans lequel un soldat lourdement armé n’est guère efficace sur le dos d’un cheval). Cette thèse a été contestée. Il n’en demeure pas moins que c’est à peu près à cette époque qu’apparaissent les premiers chevaliers dans la France du Nord.
L’Église joue un rôle fondamental en transformant progressivement ces simples soudards illettrés, grossiers et violents, en preux héros courtois, obligés (du moins en théorie) de respecter et protéger les plus faibles. « L’Église était déjà allée jusqu’à sanctifier le chevalier par des formules qui bénissaient son épée ; elles étaient apparues au Xe siècle et devenues courantes au siècle suivant. Peu après 1070, la cérémonie de l’adoubement, qui se faisait généralement dans une église, est mentionnée pour la première fois dans des sources françaises. Par ce rituel d’initiation, l’Église adoptait la chevalerie, comme elle l’avait fait de tant d’autres institutions laïques telles que les fêtes et les sanctuaires païens », explique Gies. En échange de ses services, le chevalier reçoit un fief qui devient héréditaire. Il intègre ainsi la noblesse, dont il occupe le premier échelon. Encore ouverte au début du XIe siècle, la chevalerie se ferme peu à peu aux « hommes nouveaux ».
Son plus grand exploit est sans doute la première croisade, dont le résultat, rappelle Gies, dépasse largement l’objectif du fameux appel lancé par le pape (champenois) Urbain II en 1095, à Clermont. Celui-ci pensait n’envoyer qu’« une petite armée pour aider l’empereur byzantin, Alexis Comnènes, qui avait appelé à l’aide contre les Turcs ». Mais à l’issue d’une « remarquable opération militaire », dont l’efficacité est d’autant plus étonnante que son organisation et son financement étaient « complètement improvisés », les croisés s’emparent de Jérusalem et fondent plusieurs principautés au Proche-Orient.
Pour illustrer les métamorphoses du chevalier, Gies choisit trois de ses plus célèbres incarnations : Guillaume le Maréchal, Bertrand Du Guesclin et sir John Fastolf. Le premier commença par servir le fils aîné d’Henri II Plantagenêt et finit régent d’Angleterre à la mort de Jean sans Terre. Il brilla dans les tournois et fit l’objet d’une biographie en vers (et en français) qui assura sa réputation posthume de « meilleur chevalier du monde ». On ne présente plus le second, qui contribua à renverser le cours de la guerre de Cent Ans sous le règne de Charles V, dans les années 1360 et 1370. Lui aussi brilla dans les tournois, mais il ne fut adoubé que sur le tard, à 34 ans. C’est que devenir chevalier coûtait cher, et beaucoup préféraient rester écuyers : « En tant qu’écuyer, un homme avait de bonnes chances que l’on pourvoie à ses besoins, et que son cheval et son équipement lui soient fournis. En tant que chevalier, il était supposé s’équiper lui-même non pas d’un seul mais de trois chevaux, et équiper en outre son propre écuyer. » Or Du Guesclin ne fut jamais très riche. Bien qu’il ait obtenu le titre de connétable, réservé d’ordinaire à la haute noblesse, et que l’on ait déboursé pour lui des rançons stratosphériques dignes d’un prince de sang royal, il mourut presque aussi pauvre qu’avant ses exploits. Gies en dresse un portrait où, si l’on mesure la distance qui le sépare des héros fictifs de la Table ronde, on voit bien aussi qu’il n’était pas sans posséder certaines de leurs vertus. Ce que son aspect, du reste, ne laissait pas nécessairement présager : il était, en effet, « de taille moyenne (sans doute guère plus de 1,52 m) et de teint bistre. Il avait le nez camard, les yeux gris, les épaules larges, les mains petites ».
Le contraste est saisissant entre d’un côté Guillaume le Maréchal et Bertrand Du Guesclin, et de l’autre John Fastolf. Ce dernier fut certes « un soldat capable et courageux », qui se distingua lors de la grande victoire anglaise d’Azincourt, mais il ne présente pas « l’attrait romanesque » de ses prédécesseurs. Sachant lire et écrire, il possédait même une bibliothèque bien garnie pour son époque (le XVe siècle). Il savait aussi compter et se lança dans le commerce, ce qui aurait été inenvisageable pour les deux autres. Si le lecteur pense n’en avoir jamais entendu parler, c’est qu’il est passé à la postérité sous le nom de Falstaff : Shakespeare, reprenant de vieilles calomnies selon lesquelles il aurait, par sa lâcheté, provoqué la défaite anglaise de Patay, l’a figé en un personnage « bouffon, couard et corpulent ». Il semble n’avoir été rien de tout cela.